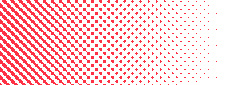À la mémoire d’Idolina Landolfi et de Mario Fusco
1Évoquer Tommaso Landolfi, c’est souvent formuler un regret : celui que son œuvre ne soit pas davantage connue, en Italie et même hors de ses frontières. Partageant nous-même ce regret, nous soulignerons ici la similitude entre les récits de fiction métalittéraires de Landolfi et ceux de Borges. Mais avant d’expliquer les raisons de ce rapprochement et de nous pencher sur l’analogie entre La déesse aveugle ou voyante (traduite en annexe) et Pierre Ménard auteur du Quichotte, nous dresserons un rapide portrait de l’écrivain italien1.
2Né en 1908 dans une famille aristocratique du sud de l’Italie, Landolfi grandit dans le manoir familial de Pico Farnese (Latium) qui restera toute sa vie un lieu central pour lui. À travers ses récits de fiction, puis également dans des livres autobiographiques, Landolfi joue sur son image d’aristocrate désœuvré, tantôt dandy sans le sou, hobereau de province ou amateur de casinos. Il passe son enfance et son adolescence entre Pico, Rome, et divers collèges ou lycées d’Italie (dont le collège Cicognini de Prato qui avait accueilli d’Annunzio) jusqu’à des études de Lettres à Florence. Sa passion précoce pour la littérature et les langues étrangères l’amènent à soutenir une thèse sur la poétesse russe Anna Achmatova en 1932. Le choix est excentrique : il est alors très rare de travailler sur un auteur encore vivant, et l’université florentine ne compte aucun spécialiste de russe. Landolfi commence aussi très tôt à traduire ; du français, de l’allemand, de l’espagnol, mais surtout du russe. Sa vie à Florence l’amène à fréquenter des jeunes passionnés de Lettres, gravitant autour du café des Giubbe rosse et du mouvement hermétique, comme Carlo Bo qui devient son ami et dont il partage la devise donnée comme titre à son essai-manifeste : Letteratura come vita (La littérature comme vie). Remarqué pour des propos jugés subversifs envers le régime fasciste, Landolfi est emprisonné un mois (du 23 juin au 26 juillet 1943). Mais la démocratie n’est pas beaucoup plus estimable à ses yeux : réactionnaire mais surtout antisocial, il se tient toute sa vie à l’écart de la vie politique. Plus globalement, Landolfi ne cesse d’écrire qu’il méprise la « réalité », c’est-à-dire la réalité sociale quotidienne, organisée autour du travail. Plus largement, c’est même le « réel », la réalité existante dans son ensemble, que rejette l’ultra-romantique Landolfi, tourné vers le « possible » (le « poétique halo du peut-être2 »). Après la guerre, Landolfi, qui se marie en 1955 et aura deux enfants, Idolina et Landolfo (surnommant sa femme et sa fille la Major et la Minor, puis son fils Minimus3), continue à se placer en marge de la vie culturelle italienne, menant une vie de plus en plus solitaire, sans exercer d’autre travail que celui d’écrire ou de traduire. Admiré par ses pairs, il reçoit de nombreux prix, assez prestigieux, mais ne se donne pas la peine d’aller les retirer, sauf quand Palazzeschi ou Carlo Bo l’en prient instamment, voire font de sa venue une condition sine qua non à l’obtention de la récompense financière4.
***
Les nouvelles métalittéraires de T. Landolfi
3Landolfi se fait connaître, à partir de son premier recueil Dialogue des grands systèmes (1937), comme un auteur de nouvelles étranges ou fantastiques. On l’a souvent rapproché du surréalisme5, notamment pour l’onirique La mer des blattes (qui donne son titre au deuxième recueil, en 1939), où se succèdent les images bizarres, érotiques ou effrayantes à un rythme étonnant. Cet univers singulier prend aussi corps dans des récits de fiction plus longs, parfois considérés comme de brefs romans, tels que La pierre de lune, Les deux vieilles filles, La jeune fille et le fugitif, Cancroregina6. De livre en livre, Landolfi s’affirme comme un spécialiste de la nouvelle étrange, dont il explore les multiples ressources narratives, tirant notamment parti dans son Petit théâtre7de courts dialogues mystérieux où le lecteur, du fait qu’il n’est guidé par aucun narrateur (sans pour autant être face à une scène de théâtre: ces dialogues ne sont pas fait pour être joués) se trouve en quelque sorte dans la situation d’un spectateur privé de la vue : il aimerait, mais ne peut voir, les choses étranges qui se déroulent. Par exemple, des extraterrestres aux noms fantaisistes défilent dans une gare intergalactique. Dans un autre dialogue, un jeune étudiant désargenté devient fou à cause d’un tout petit objet, à moins que ce ne soit plutôt à cause d’un tout petit mot. En effet, il voit tomber quelque chose de la bouche de sa logeuse. Celle-ci lui répond tranquillement que c’est juste une fausse dent, fabriquée avec de la « cire jasse ». Puis elle la remet en place comme si de rien n’était. Or, ce que le jeune homme n’arrive pas à supporter, c’est ce néologisme (« cire jasse ») qui ne se rattache à rien de connu, mais que son interlocutrice emploie pour désigner, à l’en croire, une matière des plus banales. On aura donc remarqué que le fantastique landolfien apparaît souvent comme un fantastique linguistique, où l’invention verbale tient une large place8.
4Cela nous amène à examiner le Dialogue des grands systèmes, la nouvelle qui donne son titre au premier recueil. Le narrateur y raconte l’histoire de son ami, appelé simplement Y. Y est venu le voir pour lui confier qu’il croyait avoir appris le persan, après avoir rencontré un pittoresque capitaine de marine, anglais et polyglotte. Mais la langue qu’il croyait avoir apprise de cet individu n’est ni le persan, ni quelque autre langue vivante ou morte que ce soit. C’est une langue que le capitaine aurait forgée à partir de ses souvenirs incertains du persan et avec sa propre imagination, avant d’oublier tout de cet idiome, ainsi que de sa transcription graphique. De son côté, l’enthousiaste Y a écrit trois poèmes dans ce persan inouï qu’il avait appris et mémorisé imparfaitement, mais il a brûlé toutes ses notes et il ne saurait le reconstituer. Ainsi les trois poèmes qu’Y a composés sont-ils le seul témoignage d’une langue artificielle dont l’existence fut éphémère et qui ne peut être communiquée : le « problème esthétique effroyablement original9 » d’Y et de son ami, qui les conduit à prendre rendez-vous dès le lendemain avec un grand critique, est de savoir quelle peut être la valeur artistique de ces trois poèmes, dont l’un est lu au critique et retranscrit à l’écrit par le narrateur qui le cite intégralement. Voici le premier vers : « Aga magéra difúra natun gua mesciún10 ». Landolfi a donc vraiment écrit un sonnet en faux persan (censé, dans la nouvelle, être l’œuvre d’Y), autour duquel s’organisent sa nouvelle et le débat littéraire engagé par les personnages. La réponse du grand critique fait du Dialogue une variation plaisante, pleine d’ironie, sur le fameux thème littéraire ou métalittéraire de l’incommunicabilité :
Le seul qui soit compétent pour en juger [juger de la qualité du poème], c’est l’auteur lui-même, étant le seul à connaître, bien ou mal, la langue. [...] Croyez-moi, mieux vaut avoir à faire à une seule personne qu’à trop de monde. Croyez-moi... N’ayez crainte, s’il vous arrivait de vous croire un grand poète, comme je vous le souhaite, votre gloire serait aussi pleine et complète que celle de Shakespeare, et nullement inférieure à elle. Vous seriez en tel cas glorifié par tous ceux qui comprennent votre langue poétique, qui se trouveraient certes n’être qu’un, mais qu’importe : la gloire n’est pas une question de quantité, mais de qualité...11
5Ainsi Y est-il le glorieux auteur d’une œuvre dont il ne peut être que le seul destinataire. Une situation qui ne laisse pas sa raison indemne, puisqu’il finit par sombrer plus ou moins dans la folie (destin qui attend, on l’a vu, plusieurs personnages landolfiens).
6Devant l’invention de ce cas littéraire original, on tend assez naturellement à rapprocher Landolfi de Borges. Or, ce rapprochement paraît d’autant plus justifié si l’on s’intéresse à une autre nouvelle, La déesse aveugle ou voyante (1962), qui présente de grandes similitudes avec Pierre Ménard auteur du Quichotte. C’est ce texte que nous avons traduit afin de le publier au sein du présent volume. Un écrivain nommé Ernest, en panne d’inspiration, décide de composer un poème en se faisant aider par le hasard, c’est-à-dire en tirant au sort des mots qu’il ajuste les uns avec les autres pour arriver à un poème. Il faut préciser que le hasard est un thème récurrent chez Landolfi : d’une part, il est un joueur invétéré, dépendant ou pathologique dirait-on aujourd’hui ; d’autre part, le hasard en soi le fascine et l’idée d’écrire au hasard lui apparaît comme un idéal à partir de son premier livre autobiographique, Labiere du pecheur12 (1953). Or, en procédant de la sorte, le personnage de La déesse n’écrit pas un nouveau texte, mais un des plus célèbres poèmes italiens : L’infini de Leopardi. Ernest, comme Y dans le Dialogue, se rend alors chez un critique de renom pour chercher des réponses qu’il ne trouvera pas. Puis, comme dans un conte, il rencontre d’autres personnes afin de résoudre son problème littéraire et existentiel : d’abord un mathématicien, puis sa fiancée. Mais le dénouement est plus ou moins le même que dans le Dialogue, car Ernest finit seul et malheureux. Après avoir essayé d’écrire un autre poème à l’aide de la même méthode, il compose un autre monument de la poésie italienne, le sonnet inaugural du Chansonnier de Pétrarque. Puis il se convainc que sa malchance dans le tirage au sort des mots d’un poème peut se muer en chance au jeu de la roulette. Mais cela ne marche pas, et il gaspille en vain son argent.
7La nouvelle illustre donc l’idée pessimiste que les combinaisons possibles offertes par une langue comme l’italien seraient non pas infinies mais limitées, si bien qu’il deviendra un jour impossible d’écrire quoi que ce soit de nouveau. L’ironie côtoie le thème de l’incommunicabilité, dans le discours du narrateur expliquant qu’Ernest ne peut se résoudre à considérer qu’il n’est pas l’auteur du poème :
Et maintenant? Aurait-il dû renoncer à la fière et enivrante paternité de ce poème pour cette seule raison qu’un autre, par surprise, subrepticement, l’avait composé avant lui? Non, ce poème était le fruit de ses entrailles, il était à lui et à personne d’autre, comme aurait suffi à le démontrer sa méthode de composition. Oui, il ne pouvait même pas s’être agi de réminiscences inconscientes ; le sort inflexible en avait décidé ainsi [...]13
8Comme Pierre Ménard avec le Quichotte de Cervantès, le protagoniste est convaincu d’être l’auteur de L’infini de Leopardi, selon une logique invraisemblable qui toutefois n’est pas étrangère à une poétique de l’énergie que Landolfi avait exposée un peu plus tôt dans son journal Rien va (1960) :
Il suffit de faire passer dans une œuvre une certaine somme d’énergie (et d’abandon), pour qu’elle atteigne inévitablement une certaine consistance et validité, sans préjuger de ses contenus spécifiques et en quelque sorte malgré eux14.
9Ernest a l’impression que le processus créatif ne concerne que lui-même. L’« énergie » mise dans la composition de son poème n’a d’après lui rien à voir avec celle de Leopardi (appelé sarcastiquement le « petit bossu15 » de Recanati), bien que leurs deux textes soient identiques et que celui de Leopardi ait été écrit auparavant : c’est cette énergie investie dans l’écriture, par opposition au texte une fois produit, qui nourrit l’impression d’avoir écrit quelque chose de tout à fait personnel. Cette position, que Landolfi expose non sans humour dans la Déesse, s’explique donc par la primauté accordée au processus même de la création, par rapport à son résultat. Or, cette primauté n’est autre que l’une des formes multiples d’opposition entre un « possible » désiré et un « réel » décevant. Car Landolfi lui-même préfère se replier sur son monde intérieur tourné vers un possible inatteignable que d’accepter la triste réalité du monde extérieur. Même si ce monde intérieur, comme nous l’expliquerons, est de plus en plus marqué par les sentiments d’échec et d’impuissance.
Du Dialogue à la Déesse : un parcours en forme de cercle vicieux
10Ainsi, le poète de la Déesse partage une même conception solipsiste de la littérature et de sa propre existence avec cet autre personnage qu’est Pierre Ménard, mais aussi avec Landolfi lui-même. On ne peut pas tout à fait exclure que l’auteur ait lu la traduction italienne des Ficciones parue chez Einaudi en 1955 puis rééditées en 1962. Mais la trajectoire menant Landolfi à La déesse n’est pas liée au parcours de Borges : elle s’inscrit dans un cheminement personnel dont le Dialogue est la première trace la plus visible, et qui s’enracine bien en amont. L’analogie entre la Déesse et le Dialogue est évidente : on aura remarqué les similitudes narratives, ainsi que l’ironie commune aux deux nouvelles. Ce que Landolfi tourne en dérision, outre le caractère peu vraisemblable des deux cas qu’il invente et dont il s’amuse, c’est aussi une tendance qu’il ressent fortement en lui depuis longtemps et qui ne l’abandonne jamais vraiment. Il n’est guère surprenant que la Déesse puisse apparaître comme une reprise ou une variation du Dialogue vingt ans plus tard : c’est toute l’œuvre de Landolfi que l’on peut appréhender comme un vaste ensemble de variations autour d’un petit nombre de thèmes, où s’affirme avec force une vision tragique de l’existence. En effet, malgré leur commune ironie, les deux nouvelles sont révélatrices de cette vision tragique de l’existence, qui correspond à une conception idéaliste, allant jusqu’au solipsisme, de la langue, du rapport entre langage et pensée, entre langue et création. Du Dialogue à la Déesse, le processus est le suivant : la réflexion sur le langage se développe, donnant naissance à d’autres trouvailles fictionnelles (comme La grève des mots ou La promenade : nous y reviendrons), mais elle tourne aussi en rond en ne sortant pas des mêmes structures, et se voit déterminée par cette affirmation d’une pensée tragique.
11Tout d’abord, en mettant en scène le fantasme d’une langue inventée, et l’image pitoyable d’un locuteur parlant une langue connue de lui seul, Landolfi tourne en dérision ses propres aspirations, et même ses propres rêveries de toute-puissance. Dans le Dialogue, texte qui donne son titre au premier recueil, mais aussi dans Marie Josèphe qui en est la nouvelle inaugurale : Giacomo, le protagoniste, tout premier alter ego de l’auteur, y apprend l’arabe. Mais on ne voit pas avec qui il pourrait le parler, lui qui passe surtout son temps à chantonner, à parler ou à jouer tout seul, quand il n’est pas occupé à importuner sa domestique. Dans Mains, Federico a pour habitude de bavarder en français avec un interlocuteur imaginaire lorsqu’il est à table. Le personnage du marin polyglotte correspond aussi à un fantasme récurrent : c’est ainsi, sur son trône, c’est à-dire dans l’espace des cabinets propice à la rêverie, que s’imagine Untel, protagoniste occasionnellement constipé de La mort du roi de France, texte au centre duquel se trouve par ailleurs le rêve de Rosalba, exemple tout à fait remarquable de transcription littéraire d’un flux onirique. Or, on est d’autant plus autorisé à voir dans ces personnages autant de reflets ridicules de leur auteur que Landolfi publie en 1937 un texte où il se présente comme l’inventeur d’une langue appelée le Landolfiano 1 (de même qu’il rend hommage, dans une sorte d’élucubration farcesque sur la constitution de l’univers, au grand astronome Onisammot Iflodnal, anagramme inversée de son propre nom).
12Ces exemples fictionnels, tirés donc du tout premier livre de Landolfi, laissent entrevoir que l’ironie n’est pas étrangère à une forme comique d’autodestruction, c’est-à-dire à une agressivité tournée vers l’auteur et sa création : plusieurs récits sont présentés comme inachevés, les personnages reçoivent pour noms Untel ou des lettres comme Y, le paratexte d’un pseudo-éditeur vient contredire ou critiquer les intentions des auteurs fictionnels. De livre en livre, cette tendance à s’agresser soi-même en se moquant indirectement de soi ou de ses créations (qu’il s’agisse des personnages ou du récit lui-même), loin de s’atténuer, ne cesse de s’affirmer, voire de s’amplifier, tandis que l’image clownesque de l’auteur, si elle ne disparaît jamais totalement de son œuvre, laisse place à une image de plus en plus désespérée. Un désespoir de moins en moins masqué par l’enthousiasme et les pitreries des tout premiers livres, où Landolfi parvient à se moquer joyeusement de ses rêves de grandeur tout en exprimant par le biais de la fiction le désir d’absolu qui le pousse à écrire, et la foi sans limites dans les pouvoirs de la parole, qui se traduit entre autres par le fantasme d’une langue inventée. Une foi qui mène Y au désespoir et à la folie. Landolfi se moque de ce reflet déformé de lui-même, tout en ne sortant jamais vraiment des mêmes cadres de pensée.
13Ses rêves d’absolu associés à une foi dans les pouvoirs magiques de la parole sont très profondément enracinés en lui, bien en amont de ses premières nouvelles qu’il commence à publier dans les années 1930, et même des nombreux poèmes composés quand il était lycéen. Préfigurations : Prato16 est un texte autobiographique qui s’ouvre sur le drame initial de la mort de sa mère quand il n’avait pas deux ans, et où il évoque l’expérience pour lui douloureuse de sa première année de pensionnat en 1919. Cette année-là, Landolfi connut deux nouveaux deuils : d’abord sa cousine Rosina âgée de vingt-six ans (figure tutélaire de son enfance, dont il pense notamment qu’elle lui a appris à écrire), puis sa grand-mère17. Landolfi raconte comment, à l’âge où il se retrouva douloureusement pensionnaire, il éprouvait une forme de terreur religieuse à l’égard de certains mots désignant obscurément une réalité inconnue (celle du sexe), et comment les mots en général constituaient pour lui sa « seule réalité ». Quant à l’écriture précisément, le surinvestissement dont elle fait l’objet remonte à l’enfance18.
14Nous disions que les premiers livres plaçaient les bases d’une réflexion sur la langue (toujours associée à la littérature, à l’écriture) qui se développe lentement à travers les textes successifs, qu’ils soient fictionnels ou autobiographiques. Par exemple, la poétique de l’énergie, avant d’être développée dans les journaux, fait l’objet des divagations nocturnes, constituant le texte « Night must fall », d’un alter ego de Landolfi, comme lui insomniaque (dans le tout premier recueil, celui du Dialogue). Celui-ci est convaincu que s’il se laissait aller à dépenser toute son énergie dans une création littéraire, il en sortirait quelque chose de si beau que l’univers entier en serait détruit. Aussi préfère-t-il ravaler en lui cette énergie, se refusant à « gober l’univers tel un œuf19 ». On voit ici, sous un mode volontairement exagéré par l’auteur, un indice de la toute-puissance qu’il accorde aux mots et aux pensées : nous y reviendrons. Nous évoquerons aussi un autre passage fréquemment cité de « Night must fall », où le personnage se dit obsédé par le cri d’un petit-duc qu’il entend pousser exactement la même note. C’est comme si l’oiseau projetait tout son être dans sa voix, et comme s’il oubliait aussitôt qu’il vient de le faire, ce qui lui permet de recommencer à nouveau avec la même naïveté et la même évidence, alors qu’un homme serait incapable de le faire. C’est ce type de rapport absolu à sa propre parole que recherche Landolfi, et que la langue existante ne peut lui offrir, ce qui le conduit à la recherche d’une langue pure, entièrement nouvelle.
15La création, ex nihilo ou presque, d’une langue nouvelle, apparaît comme la modalité extrême d’une quête d’un ailleurs linguistique qui conduit à se désintéresser de toute langue familière. Revenons au Dialogue, pour voir comment Y explique son intérêt pour les langues étrangères :
il est d’après moi hautement préférable d’écrire dans une langue imparfaitement connue, plutôt que dans une qui nous soit entièrement familière. [...] évidemment, quelqu’un qui ne connaît pas les mots propres à indiquer des objets ou des sentiments est obligé de les remplacer par des périphrases, ainsi que par des images ; avec quel avantage pour l’art, je te laisse le deviner. [...] Mon idée, tu l’auras compris, était justement d’apprendre cette langue imparfaitement : assez pour m’exprimer, mais pas assez pour appeler les choses par leur nom20
16Ainsi la désignation précise d’une chose par un mot est-elle envisagée comme un obstacle à l’imagination poétique. Mais au-delà de cette seule idée, l’envie d’écrire dans une langue étrangère maîtrisée imparfaitement peut être reliée à la préférence accordée au « possible » au détriment du « réel » : plutôt que de recourir au « réel », c’est-à-dire à un mot connu dont la signification est ancrée dans une langue familière, le protagoniste de la nouvelle préfère envisager le « possible », c’est-à-dire l’emploi de mots inconnus et incertains dont les rapports avec la réalité paraissent moins déterminés. À la fin de la nouvelle, Y pousse encore plus loin ce raisonnement en formulant l’idée ou le vœu d’une écriture où l’on s’affranchirait entièrement des rapports préétablis entre signifiant et signifié (ce qui n’est pas sans rappeler les rêveries ou projets de Mallarmé tel Le coup de dés) :
Cela veut dire que dorénavant, pour écrire des poèmes, on pourra partir du son plutôt que de l’idée : [...] réunir des mots beaux et sonores, ou suggestifs et obscurs, puis leur attribuer un sens, ou voir seulement ce qu’il en sort21 ?
Pessimisme linguistique et désir d’absolu
17Dans La grève des mots, une nouvelle publiée en 1963, à une époque où il fournit environ tous les dix ou quinze jours un elzeviro22 au « Corriere della sera », Landolfi imagine la situation amusante de mots qui se présentent sous la forme de petites créatures sorties de la bouche de l’auteur, qui se brossait les dents dans sa salle de bains. Ces mots se plaignent du sens qui leur attribué, qu’ils jugent sans rapport avec leurs sonorités. Dans ses journaux Rien va puis Des mois écrits en 1958-1960 et 1963-1964, où Landolfi se livre sans les masques de la fiction, l’écrivain ne cesse de se critiquer et de déplorer la vanité de l’écriture, tout en développant des réflexions sur la langue qui reprennent les idées exprimées par les personnages de son premier recueil. Par exemple, les premiers mots prononcés par les enfants de l’écrivain apparaîtront comme une autre forme de parole pure, pour cette raison qu’ils échappent aux formes figées de rapports entre signifiant et signifié que constituent les mots de la langue. La réflexion linguistique de Landolfi dans ses journaux continue de se fonder sur des conceptions qui favorisent sa tendance à s’enfermer dans une vision tragique de son rapport à l’écriture (et à la vie). Tout d’abord, la langue est perçue comme un instrument hétérogène par rapport à une parole authentique, qui se trouverait au sein de l’être humain, mais qui aurait nécessairement besoin d’emprunter les moyens de la langue pour être exprimée : ainsi toute langue s’apparente-t-elle à la traduction insatisfaisante d’une intériorité trahie, celle de l’énergie ou celle d’une pensée pure, non linguistique. Ensuite et surtout, la langue n’est pas envisagée dans sa dimension pratique d’une réalité en constante évolution, mais comme un système clos qu’on adopte tel quel, ou d’où l’on s’évade radicalement par le choix d’une langue étrangère voire par celui, extrême, d’une langue inventée.
18Ainsi Landolfi revient-il avec nostalgie sur ses « amènes tentatives d’inventer de nouveaux langages23 ». Il convient qu’il était bien sûr impossible d’inventer une langue, pour les raisons assez évidentes qu’une langue ne peut se développer qu’avec un peuple :
Quand j’étais adolescent, je voulus un jour me forger une langue personnelle : il me semblait nécessaire de commencer par là ; une véritable langue, avec toutes ses règles. Mais je compris bien vite que pour cela, je devais partir d’encore plus loin, c’est-à-dire inventer en premier lieu un pays, un peuple, son histoire, et ainsi de suite, la langue étant la fleur suprême d’une civilisation ; je remplis des feuilles et des feuilles, que je retrouve de temps à autre. Et peut-être que cela se configura dans mon crâne comme la recherche d’autre chose. / Eh bien, j’étais voué à l’échec. [...] Amènes tentatives de ceux qui cherchent de nouveaux langages ! Et nécessairement retombent dans quelque très ancien système de rapports, d’où l’on ne s’évade pas.
19Mais il en arrive, dans une logique du tout ou rien, à considérer que le seul choix raisonnable est d’écrire le plus simplement possible, en tournant le dos aux expérimentations pour n’utiliser que des expressions très communes dont l’usage séculaire prouverait la justesse. Or, la dernière étape de ce raisonnement montre à quel point les réflexions de Landolfi sont déterminées par la conviction d’être unique et d’être maudit :
Il est toutefois une difficulté. Donc : j’ai jusqu’ici affirmé en substance, semble-t-il, une poétique du mot ou de l’expression qui se présentent les premiers ; lesquels seraient par définition les meilleurs, et le seul rempart contre une complaisance pernicieuse de l’écriture. Mais voilà, il existe des personnes auxquelles, de manière très naturelle, par leur constitution même, ce qui se présente d’abord est le mot rare, la construction précieuse, l’acception désuète, la variante la plus compliquée. Eh bien, que faire de ces gens-là ? Et que feront-ils d’eux-mêmes ?24
20La conception d’une langue comme système clos, sur le plan général, se traduit, sur le plan personnel, dans l’image d’un écrivain prisonnier de sa propre langue. Une langue-peau (comme l’a écrit Paolo Zublena25), enveloppe protectrice avant d’être une prison, trouée par les frustrations comme par autant de coups d’épingles26. On a bien affaire à l’œuvre profondément tragique d’un écrivain replié sur un monde intérieur où il se pense enfermé : le projet initial de la Déesse, celui d’écrire au hasard, ne peut donc connaître qu’une issue malheureuse, révélant que la langue italienne est un système clos. Tout comme la langue personnelle de Landolfi, qui lui apparaissait dans son premier livre autobiographique comme un voile indéchirable, faisant du projet d’écrire au hasard une tentative désespérée, vouée à l’échec :
fatalement ma plume, c’est-à-dire mon crayon, tend vers un magistère artistique, je veux dire vers un mode de rédaction et de composition qui pour finir se heurte à la libre écriture que je me suis fixée, et puis aussi à mon envie de tirer au flanc. Ne pourrai-je donc jamais vraiment écrire au hasard et sans dessein, afin d’au moins lorgner, par-delà les remous et le désordre, le fond de moi-même27 ?
21Landolfi dit vouloir se résigner à emprunter les mots simples du système clos de la langue italienne, tout comme il dit vouloir se résigner à faire de la réalité haïe la destination de ses « oisives promenades28 », sans toutefois qu’il se sente vraiment capable de renoncer à ses hautes aspirations. Cette idée vient se concentrer dans la notion de l’ « impossible » : l’écrivain qualifie son rapport névrotique à l’écriture de « manie de l’impossible en littérature29 », et intitule Récits impossibles un recueil de fictions de 1966, non sans préciser dans l’un de ses textes qu’il aurait mieux fait d’écrire : « Récit : impossible ». Plus il écrit, plus la conscience aiguë de l’échec accompagne toujours son écriture, mais le désir d’écrire reste toujours plus fort que le silence. Car malgré la souffrance qu’elle charrie et inflige, l’écriture, qualifiée par Landolfi d’activité « hygiénique », permet de dépenser l’ « énergie » et de trouver un refuge à l’abri du monde extérieur et de la mort. Elle reste également source de plaisir malgré tout : nous y reviendrons.
22C’est le plus souvent par le biais de la fiction que se trouve exprimée la croyance magique, tout à fait déraisonnable à l’âge adulte, d’une toute-puissance des mots et des idées qui peuvent agir sur la réalité extérieure et sur la mort elle-même. Mais il arrive que Landolfi lui donne forme également dans ses textes autobiographiques. On peut comprendre qu’il ait été marqué par la comparaison faite par son père entre sa vie et les quatre acacias du jardin :
Ces acacias représentent ta vie: son premier quart nous a quittés. C’était un vœu, c’était aussi une triste consolation paternelle, c’était surtout une phrase imprudente, liant par des nœuds indissolubles mon destin à celui de ces quatre arbres30.
23Mais on est plus étonné à la lecture d’Une mort : dans ce texte où Landolfi raconte avoir assisté aux dernières heures d’un médecin, ami de la famille, on trouve ce passage rappelant les élucubrations de « Night must fall » quand le personnage pense qu’il pourrait gober l’univers comme un œuf s’il ne retenait pas son énergie :
Je ne sais pas, quelque chose, dans cette mort, n’allait pas, comme s’il se fût agi d’une pure apparence, et que la scène à laquelle j’assistais fût un pur songe, et qu’il eût suffi d’un souffle, c’est-à-dire d’un acte infime de notre volonté, pour qu’elle s’évanouisse [...] Il me paraissait désormais évident qu’il m’aurait été parfaitement possible, peu avant, d’arracher cet homme à la mort : si seulement je l’avais voulu. Bien sûr, il aurait fallu un effort exténuant de ma volonté. Pourquoi ne l’avais-je accompli ? Par paresse, assurément31.
24Devant la mort, l’auteur s’attribue à la fois le pouvoir de l’empêcher et la faute de ne pas le faire. Quand il revient sur son tout premier récit, où il s’était inspiré de sa domestique Marie Josèphe, pour s’imaginer en jeune homme perturbé qui la tourmente quotidiennement avant de la prendre un jour de force, il se demande s’il n’a pas influencé le destin puisque Marie Josèphe a vraiment été violée ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, par des soldats africains :
Mais est-il bien vrai que je n’ai nulle responsabilité dans cette histoire ? Croyez-vous, en somme, que je veuille me vanter de ma difficile divination du destin ? Au contraire ! S’il est vrai que la nature, l’aveugle nature, ‘s’est mise à imiter l’art’, (quoique cette phrase veuille dire), et même si ce n’est pas vrai, j’ignore jusqu’à quel point une nouvelle, belle ou non, peut influer sur le sort d’une créature32.
25Dans son journal Rien va, Landolfi raconte qu’après la naissance de sa fille, il emmena son père devant le portrait de sa mère défunte, pour lui dire, comme si Idolina était la réincarnation de sa grand-mère : « elle est ressuscitée ». Toujours dans Rien va et à propos d’Idolina, Landolfi songe au fait que tout comme lui elle mourra un jour, avant de formuler ce vœu déraisonnable : « Voilà, c’est de ça, peut-être, que je serais heureux : qu’elle réalise la grande idée de son malheureux père, qu’elle triomphe de la mort33 ». Dans Des mois, son second journal, Landolfi affirme encore : « Nul ne pourra me convaincre que la réalité, que la vie n’est vraiment pas contrôlable par notre volonté34 ».
26L’envers de cette croyance magique, c’est un sentiment de culpabilité omniprésent qui accompagne la peur et l’angoisse dont les nouvelles se nourrissent et qui transparaissent même dans les journaux. On en a vu un exemple, parmi une multitude d’autres possibles, quand l’auteur attribue à sa « paresse » de n’avoir pas empêché la mort d’une personne (un médecin qui plus est) par le pouvoir magique de sa volonté.
Une écriture mélancolique... où l’amusement trouve aussi sa place
27À partir des années 1950, la démarche ultra-romantique d’une écriture tournée vers l’absolu entraîne inévitablement chez Landolfi l’affirmation d’une vision de l’existence mélancolique et tragique. Aussi les écrans de la fiction ludique, érigés comme autant de remparts protégeant l’écrivain des attaques qu’il dirige contre lui-même (en s’accusant d’impuissance et de médiocrité), opposent-ils une résistance de plus en plus fragile aux assauts d’un processus masochiste.
28Dans ses nouvelles, ses journaux et même sa tragédie en hendécasyllabes – forme inactuelle s’il en est – Landolfo VI de Bénévent (1959), l’auteur multiplie les images d’une vie crépusculaire, larvaire, une non-vie misérable. Nous citerons un passage de Rien va, que l’écrivain rédige peu de mois après avoir terminé son Landolfo :
Le fait est que je n’ai jamais vraiment su ni vivre, ni mourir, et à la rigueur, ce qui serait peut-être le pire, pas même ne pas mourir. [...] “Cet homme ne sut ni vivre ni mourir”, imagine L qu’on dira de lui: mais non, il eût fallu dire ici “Cet homme ne sut ni ne pas vivre ni ne pas mourir” [...] Épitaphe : “ci-gît (sans, pour autant que l’on puisse supposer, reposer en paix) T. L., mort de crépuscule35
29La vie est une non-vie, et cette non-vie est aussi une non-mort, comme si Landolfi était condamné perpétuellement à une existence médiocre qui ne pourrait jamais vraiment prendre fin.
30Au cœur de cette forme mi-absurde mi-pathétique de mélancolie se trouve l’idée de malédiction (grâce à laquelle il subsiste quelque chose de grandiose dans le triste sort de l’écrivain), mais aussi, plus largement, d’abandon, de déréliction, de condamnation originelle. Or il paraît difficile de ne pas revenir sur la mort de sa mère, dont l’auteur dit qu’elle peut expliquer bien des choses, sinon tout, de son enfance. Il vaut sans doute la peine de tenter de rationnaliser ce que Landolfi mythifie dès les pages, déchirantes il est vrai, de Préfigurations : Prato : « J’étais un enfant qu’on avait amené, à un an et demi, devant sa mère morte, dans le vain espoir que ses traits restent imprimés dans sa mémoire ; et qui avait dit : laissons-la, elle dort36 ». Lucide sur le vain espoir de garder la mémoire visuelle du visage de sa mère, Landolfi l’est sans doute moins sur l’image de soi (inscrite dans une mémoire familiale qui nous paraît tenir de la légende) prononçant ces mots-là à cet âge-là. Lorsqu’il a désormais plus de cinquante ans, quelques pages après le début de Des mois, il laisse entrevoir le fantasme d’une mère toute puissante mais diabolique, qui ne cesse de le rappeler à lui et qui aurait laissé mourir sa cousine. « La cousine X », écrit Landolfi, par une étonnante autocensure ; mais il s’agit assurément de Rosina Tumulini37. Comme si sa mère défunte était dotée du pouvoir d’agir sur le réel et de tuer qui ose se substituer à elle auprès de son fils. Landolfi ne semble pas décidé à formuler tout à fait explicitement ce mythe de manière à reconnaître son caractère imaginaire : quelques pages plus loin, il évoque « le plus terrible des portraits de [sa] mère », une photo où elle le tient dans ses bras, en semblant désigner, de son doigt, la terre. L’auteur interprète son geste comme une préfiguration de sa mort prochaine, mais aussi de son propre sort : « la terre avide ne semble pas rassasiée, le geste noir continue38 ».
31Pourquoi rester prisonnier de ces croyances où la mélancolie puise sa source ? Sans doute par la peur de constater que dans le monde réel et matériel, où Landolfi vit malgré tout bien qu’il méprise la réalité extérieure, sa mère n’existe plus, qu’aucun lien ne le relie à elle, et qu’il n’a pas le pouvoir ni de la faire revivre, ni d’échapper lui-même à la mort. Car la non-vie larvaire est sans doute moins angoissante que le néant, et l’attachement à une mère littéralement diabolisée moins douloureuse que la perte de tout lien avec elle et avec les autres chères disparues qui l’ont remplacée. Aussi Landolfi, pourtant loin d’être naïf ou encore moins psychotique, continue-t-il à se ménager un espace psychique où sa parole est magique, où il a le pouvoir de vaincre la mort et de réaliser ses rêves d’absolu. Mais à la possibilité de réaliser un pouvoir infini correspond l’interdiction de ne jouir pleinement d’aucun objet réel : dans les fictions de Landolfi, tout objet du désir connaît un sort comparable à Rosina. Cette Loi tragique fait de Landolfi un écrivain curieusement aux antipodes de l’hédonisme : la représentation d’un contact physique simplement agréable (que ce soit avec des corps, des objets ou des matières) est presque entièrement absente de son œuvre, ce qui peut surprendre au vu de son image de dandy anticonformiste n’ayant jamais manqué de femmes dans sa vie.
32L’attachement à la mère, la douleur d’avoir perdu Rosina, et l’angoisse du néant déterminent puissamment un imaginaire aux structures très simples mais où se mélangent les figures du père, de la mère et le motif de l’engendrement. Nous évoquerons La jeune fille et le fugitif (1947)39, véritable roman gothique, où le protagoniste, fugitif pendant la Seconde Guerre mondiale, fait face non seulement à l’hostilité du vieillard veuf dont il force l’hospitalité, mais aussi au spectre affreux de son épouse maléfique à qui l’homme tente de redonner vie. La fille de ce couple terrible, dont les traits sont parfaitement identiques à ceux de sa mère, et qui fut la victime des sévices de l’un comme de l’autre, donne tout son amour au protagoniste mais meurt à la fin du livre. Un certain type de rosier sauvage, où fleurissent en automne des « roselline », pousse près de sa tombe : l’hommage discret, conscient ou non, à Rosina, s’associe à la reconfiguration fantastique des éléments de la vie de l’auteur (la mort de sa mère, la nécessité de se cacher pendant la guerre, le viol de sa domestique par des soldats africains, la douleur de retrouver le manoir familial dégradé par le passage de troupes allemandes ou américaines). Dans le long récit suivant, Cancroregina, le protagoniste se retrouve dérivant dans l’espace, enfermé dans une navette (dont Cancroregina, qu’on peut traduire par Cancrereine ou Chancrereine, est justement le nom) figurant un absurde retour in utero, aux allures d’éternité.
33Ainsi, l’envers de la croyance magique, c’est le sentiment de culpabilité. L’envers de ces visions tristes, absurdes, désespérantes et parfaitement tragiques, c’est la préservation de la vie (fût-ce une non-vie), de l’attachement (fût-ce à une mère maléfique), d’un sens à ce qui arrive (fût-il tragique), chez l’anticlérical Landolfi qui ne paraît envisager l’existence de Dieu que si celui-ci l’abandonne ou le maudit. Et c’est aussi, nous semble-t-il, la préservation de cette foi déraisonnable dans un pouvoir magique de sa propre parole, et d’une mise à distance du monde extérieur. Cet équilibre peut être qualifié de névrotique, mais cela reste un équilibre malgré tout. Et l’écriture, dont a vu le caractère maniaque, l’investissement extraordinaire dont elle est l’objet, fait partie de cet équilibre névrotique. Or, si nous avons voulu mettre en évidence le fond psychique très noir de la fiction et de l’écriture chez Landolfi, il convient aussi de reconnaître que ce fond ne recouvre pas toute l’écriture. De même que les rêves de grandeur et même d’absolu nous semblent subsister jusqu’au bout, l’amusement parvient toujours à se frayer un chemin menant à des fictions ludiques. C’est le cas notamment avec la Conférence philologico-dramatique personnelle avec implications, texte écrit en 1969 mais inédit jusqu’à sa parution dans le recueil Les labrènes en 1974.
34Dans ce texte au titre ironiquement pompeux, qui rappelle le style de ses premières facéties, Landolfi revient sur un de ses Récits impossibles intitulé La promenade. Les critiques, explique le conférencier (l’auteur lui-même ?) à son auditoire imaginaire, y avaient vu une prouesse consistant à écrire un texte à la fois amusant et incompréhensible, car constitué presque exclusivement de mots inventés quoique leurs sonorités fussent familières, à la manière du Jabberwocky de Lewis Carroll. Mais ces mots, en fait, n’étaient pas inventés : il s’agissait uniquement de formes tombées en désuétude qu’on peut même trouver dans certains dictionnaires encore très usuels. La Promenade est donc un autre cas métalittéraire où l’on peut parler de solipsisme, puisque Landolfi a réussi à écrire un texte italien sans être compris de ses lecteurs. Mais dans la Conférence, la satisfaction d’avoir joué un bon tour permet de sortir de l’impasse solipsiste où s’enfoncent Y ou Ernest : en se moquant des critiques, Landolfi peut diriger l’agressivité habituelle de la frustration non pas vers soi mais vers l’Autre, et se dépeindre à nouveau joyeusement comme un clown génial, retrouvant le rôle d’histrion qu’il avait dû jouer dans la vraie vie au café des Giubbe rosse dans sa jeunesse florentine, lorsque le régime fasciste l’avait identifié comme subversif. Mais, plus que jamais, il le fait à l’intérieur d’une fiction, où il se représente en train de s’adresser à un public imaginaire, et à une époque de sa vie où il s’est isolé du monde littéraire et culturel italien. Dans les années 60 puis 70, loin de ses débuts désormais, et de plus en plus solitaire, Landolfi parvient donc encore à s’amuser grâce à l’écriture et de toute façon, il semble que seule une stricte impossibilité physique aurait pu le faire arrêter d’écrire. Dans son cas, il est pertinent d’invoquer le lieu commun du pharmakon : l’écriture révèle de plus en plus sa nature de poison inoculant de la douleur mais reste une source de plaisir addictive. Si bien que Landolfi, à qui un cancer a été diagnostiqué en janvier 1974, continue d’adresser des elzeviri40 au « Corriere della sera » après une attaque pulmonaire en mai 1975, qui l’a plongé cinquante jours dans le coma.
Landolfi dans l’histoire littéraire : une malchance éditoriale ?
35Pour revenir à Borges et à Ménard, Landolfi n’est pas un auteur borgesien, puisqu’il n’a assurément pas été influencé en profondeur par Borges, si tant est qu’il l’ait même lu. Mais l’univers des deux auteurs, connus tous deux pour leurs brefs récits de fiction, se ressemblent : les nouvelles landolfiennes présentent des similitudes avec celles de Borges, au-delà des seules fictions métalittéraires qui justifient le plus leur rapprochement. Nous pensons par exemple à la manière dont Coup de soleil (dans L’épée, 1942) rappelle La demeure d’Astérion (ou inversement): ces deux textes brefs où l’animalité et l’anthropomorphisme sont des éléments essentiels, se terminent pareillement sur un finale surprenant, reposant sur un changement radical de point de vue narratif. Mais Landolfi se distingue de Borges par la souffrance intime qui transparaît assez visiblement de ses histoires surréelles à la dimension autobiographique si évidente, si bien qu’il fait penser, autant qu’à Borges, à Kafka, voire à d’autres figures littéraires hantées par la souffrance voire la folie, par exemple des Forêts ou Artaud – qu’il n’a très vraisemblablement pas lus. À la manière d’un Raymond Roussel, Landolfi aurait pu susciter l’intérêt d’intellectuels attirés par les marges tels que Foucault ou Deleuze. Il rencontra en tout cas celui d’André Pieyre de Mandiargues, directeur d’une petite anthologie de textes traduits (La Femme de Gogol et autres récits, Gallimard) qui constitue une bonne introduction à son œuvre.
36Certes, il a déjà été écrit et maintes fois rappelé qu’il est en partie vain de rechercher tous les nombreux modèles de Landolfi, au risque de composer une liste aussi longue que le Gotha de la littérature41. Si nous élargissons ici la question de la ressemblance entre Borges et Landolfi aux rapprochements qu’on peut établir entre Landolfi et d’autres auteurs connus du XXe siècle, c’est pour interroger la place de Landolfi dans l’histoire littéraire, qui paraît bien moindre que celle de Borges. Que ce soit en Europe ou aux États-Unis, il paraît difficile de citer quelques exemples canoniques de fictions métalittéraires ou de nouvelles fantastiques sans mentionner le nom de Borges42. En revanche, le précoce Dialogue des grands systèmes est globalement ignoré, et des textes comme La grève des mots ou La déesse n’ont pas été traduits – jusqu’à ce numéro de Fabula-LHT en ce qui concerne la seconde nouvelle. Comme auteurs italiens de fictions à la portée métalittéraire, on pense à Pirandello, puis à Calvino, mais entre les deux, Landolfi n’a pas trouvé sa place. En Italie même, il est loin d’être unanimement reconnu comme un grand auteur du XXe siècle, et le public n’a jamais vraiment suivi l’admiration de ses pairs dont témoigne entre l’anthologie que Calvino a consacrée à l’auteur (1982, soit trois ans après sa mort43). Un article encore récent constatait la « malchance éditoriale » de Landolfi, en ne manquant pas d’observer que l’auteur, par son attitude parfois provocatrice et globalement revêche, en était un des principaux responsables, même si l’on aurait pu justement tirer un meilleur parti médiatique de cette figure si excentrique44.
37Pour notre part, nous ne saurions recommander trop chaudement au public français de découvrir Landolfi à travers la petite anthologie dirigée par Mandiargues, dont nous rappelons le titre : La femme de Gogol et autres récits. Et nous espérons que d’autres éditeurs français imiteront ceux qui ont continué à publier Landolfi après que Gallimard eut cessé de le faire en 1991, comme Allia avec entre autres L’épée [1942], recueil traduit par le regretté Mario Fusco, grand connaisseur de Landolfi, auquel nous sommes heureux de rendre ici hommage45.
***
P.-S. : Note sur la situation éditoriale de T. Landolfi aujourd’hui
38Idolina Landolfi, la fille de l’auteur, a édité chez Rizzoli une édition des œuvres complètes riche en informations précieuses sur la vie de son père, ses publications et ses manuscrits. Mais le troisième volume n’a jamais paru et les deux premiers sont épuisés. Idolina a ensuite poursuivi son travail de réédition auprès d’Adelphi, tout en encourageant l’étude des œuvres de son père, grâce notamment à la création d’un Centre d’Études Landolfiennes doté d’un site web particulièrement actif. Malheureusement, une maladie a emporté Idolina en 2008, à l’âge de cinquante ans. Les droits des manuscrits de Landolfi furent répartis en trois tiers : deux tiers pour sa veuve et son fils (Landolfo), un tiers pour Giovanni Maccari, désigné comme héritier par Idolina. Giovanni Maccari s’occupe maintenant du Centre d’Études, et il a fait don des archives du Centre, léguées par Idolina, à l’Université de Sienne. Les différentes parties sont liées à Adelphi par un contrat prévoyant que le programme de réédition de tous les livres (y compris les traductions effectuées par Landolfi) s’achève en 2020. On soulignera la parution en 2012 de Diario perpetuo, qui contient les derniers textes de Landolfi publiés dans le « Corriere della sera », les seuls qui n’avaient jamais encore été édités dans un livre.