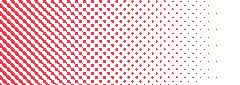1Existe-t-il une « tâche (Aufgabe) du lecteur » ? On peut en douter dans la mesure où l’engagement politique prescrit à la critique littéraire des tâches plus urgentes. En admettant même qu’il y ait une tâche du lecteur, il n’est pas certain qu’elle implique celle de lire2. L’engagement politique pousse à rejeter toutes les lectures qui mettent entre parenthèses la réalité sociale pour ne s’intéresser qu’aux aspects immanents des textes ; de ce fait, toute activité de lecture est soupçonnée de fuir la réalité. Il ne faut pas prendre cette accusation à la légère, particulièrement dans les cas où elle fait le plus mal.
2En même temps, cette accusation semble d’autant plus louche qu’elle est énoncée avec le plus grand pathos et que le refus de la lecture devient une politique de non-lecture. Ne pas lire devient une politique, une politique n’impliquant pas une attention à la “réalité” et une pratique éclairées, mais des fantasmagories par lesquelles le refus de la lecture finit par remplacer le texte. D’éminents exemples, tel Le discours politique des modernes de Habermas, montrent de façon symptomatique comment les constructions fantasmagoriques, qui effacent les textes et y substituent leur paraphrase, se dévoient dans la démagogie politique. Or dans la démagogie, la politique, indépendamment des contenus qu’elle propage, devient une pratique des « anti-Lumières ».
3De tels symptômes et leurs effets, intellectuellement et politiquement dévastateurs, révèlent l’urgence qu’il y a à penser non seulement une tâche du lecteur, mais au premier chef la tâche de lire. Il n’est pas moins urgent de chercher comment cette tâche peut se formuler et s’accomplir sans se ranger à son tour au nombre des fantasmagories. Et il faut même se demander si le concept de « tâche » n’est pas déjà empreint d’un certain pathos, qui, comme tout pathos, laisse la porte ouverte au fantasmatique. Le pathos contenu dans le concept de « tâche » communie avec un discours moral qui mêle suffisance et illusions narcissiques.
4Walter Benjamin, dont on transfère ici la « tâche du traducteur » au lecteur – le traducteur n’est-il pas le lecteur le plus littéral, et tout lecteur n’est-il pas aussi traducteur ? –, Benjamin, avec le concept de traducteur (et de lecteur), a aussi radicalement remis en cause le concept de tâche. Certes il l’a fait de manière implicite, comme le montre l’interprétation de Paul De Man, en approfondissant le concept de traducteur jusqu’à l’aporie, jusqu’au point où se donne à lire l’autre sens du mot « Aufgabe » – l’abandon, la défaite3. Mais il l’a aussi fait de façon explicite et thématisée.
5Dans l’essai sur les Affinités électives de Goethe, le concept de tâche ressortit à la sphère mythique. C’est seulement dans la vie mythique du monde héroïque que l’œuvre et l’acte sont abandonnés à un héros et qu’ils constituent des tâches à accomplir, qui ne font plus qu’un avec la vie (I, 157sq. [O, I, 326])4. La perspective éclairée (aufklärend) adoptée par l’essai sur les Affinités électives va contre les tendances mythifiantes qu’illustrent l’école de George et le livre de Gundolf sur Goethe : toute vie et toute œuvre humaines doivent être entièrement arrachées à la sphère mythique. C’est valable également pour la vie et l’œuvre du poète. Le concept de tâche est doublement inadéquat pour qualifier la poésie: si elle est d’origine divine, comme le veut l’école de George, elle ne peut alors être une tâche à accomplir, parce que « Dieu […] n’assigne pas des tâches à l’homme, mais des exigences » ; du point de vue du poète, le concept est aussi inadéquat, parce que « la poésie au sens véritable » ne prend naissance que là « où le mot se délivre de l’emprise (Bann) de toute tâche à remplir, fût-elle la plus grande » (I, 159 [O, I, 329-330]).
6Ce texte [sur Goethe], écrit à peu près en même temps que l’essai sur le traducteur, est-il une critique du titre de ce dernier [La tâche du traducteur] ou la poésie se voit-elle assigner une autre sphère que celle de la traduction ? Dans un premier temps ; la question doit rester ouverte5. Mais le lecteur ne manquera pas de remarquer que l’idée de tâche, considérée comme une sorte d’emprise (Bann), va de pair avec une forme et un effet déterminés de la lecture. Un livre, un récit, un poème, soumettent le lecteur à leur emprise [Bann], il y a là un des effets les plus attendus par nombre d’auteurs et de lecteurs. La sphère magico-mythique d’où dérive le concept d’emprise (Bann) trouve par ailleurs dans la critique littéraire ses niches privilégiées. L’enchantement des poèmes d’Eichendorff, mais aussi la poésie lyrique moderne, ont beaucoup contribué à accréditer l’idée d’une « magie du langage ».
7De son côté, Benjamin a maintes fois attiré l’attention sur le lien entre écriture, lecture et télépathie6 (III, 139 ; II, 307 [O, II, 131]). À vrai dire, il n’est absolument pas établi que la relation de la lecture et de la télépathie appartient à l’espace du magico-mythique. Benjamin donne peu d’indications à ce sujet. L’étroite relation à l’écriture et au graphisme (Schriftbild) laisse penser que c’est précisément l’aspect télépathique du lire qui présente le passage à un autre espace, cet « espace d’images et de corps » (Bild— und Leibraum) qui, dans l’essai sur le surréalisme, désigne aussi de façon privilégiée la dimension radicalement politique de la chose littéraire7.
8Cet « espace d’images » (Bildraum) du politique, naît des actes manqués qui se produisent au cours de la communication – mot d’esprit, injure, malentendu (II, 1, 309 [O, II, 133-134]) – et il constitue bel et bien une bacchanale dionysiaque, où « le matérialisme politique et la créature physique se partagent entre eux l’homme intérieur, la psyché, l’individu ou quoi que ce soit que nous voudrions encore leur jeter en pâture. De ce processus de justice dialectique, aucun membre ne ressort intact », mais, en vertu de la nature des éléments mis en jeu dans cet espace – le matérialisme politique et la créature physique – ce processus reste en deçà de l’emprise et de la magie. L’espace d’images que Benjamin envisage dans le graphisme comme dans la sphère politique ne se laisse pas reconduire à l’opposition entre rationalité et irrationalité, opposition aujourd’hui très en vogue, et dont même Habermas souhaiterait qu’elle tienne sous son emprise la discussion des modernes, en un retour aux vieilles recettes8.
9Dans la topographie de Benjamin, les distinctions et les oppositions se développent selon d’autres lignes, qui ne sont pourtant pas moins claires et marquées. L’« homme intérieur, la psyché, l’individu ou quoi que ce soit d’autre », tout ce qui, dans « l’espace d’images » politique, serait jeté en pâture à la créature physique et au matérialisme historique, succombe aussi dans « l’espace d’images » de l’écriture à une lecture qui entend avant tout se soustraire à la magie et à l’emprise de l’empathie (Einfühlung). Dans la bacchanale de la politique et de la lecture, s’accomplit d’abord la dissolution des catégories qui sont au cœur de la tradition bourgeoise et de son esthétique : l’intériorité, la psychologie, la compréhension au sens herméneutique.
10Mais à quoi ressemblerait, concrètement, une lecture qui se déroule dans cet « espace d’images » de l’écriture ? Elle n’est pas une méthode que l’on pourrait prescrire, mais peut-être pourrait-on au moins décrire son processus, si elle en a un. Il ne faudra alors évidemment pas non plus exclure la possibilité qu’un acte manqué puisse se produire dans ce processus, puisqu’il est lié au risque et à la promesse. Il semble naturel de suivre ce processus de lecture chez Benjamin lui-même, et précisément là où il a suscité les plus fortes résistances chez un lecteur qui pouvait, non sans raison, se réclamer d’une certaine affinité dans son expérience de la lecture. La première grande étude de Benjamin sur Baudelaire a, comme on le sait, scandalisé Adorno. C’est donc à partir de cette étude que l’on examinera ce que signifie pour Benjamin le fait de lire, lire politiquement.
11Dans le style de Benjamin, il se produit un changement de ton très frappant entre les textes contemplatifs ou philosophiques et les analyses politiques. Mais c’est moins le signe d’une évolution chronologique, qui mènerait d’une œuvre de jeunesse « métaphysique » au matérialisme historique de l’œuvre de la maturité, que d’une différence de genre. La proximité chronologique de l’essai sur Kafka et de l’ouvrage sur l’« Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » (1934 et 1935) témoigne d’une proximité stylistique qui dépend plus du genre des textes que d’éventuels changements de convictions en l’auteur. Bien avant que ses lectures ne manifestent son intérêt pour le matérialisme historique, Benjamin veille rigoureusement à différencier les formes de textes et de lectures. Le lecteur dont l’oreille perçoit les changements de ton d’un texte à un autre, ne restera pas sourd non plus à la tonalité fondamentale qui résonne derrière la différence. (La terminologie musicale ne renvoie pas ici au vague des sensations, mais à cette précision qui détermine les rapports musicaux entre les tons, et qui est, pour Hölderlin, le talent du véritable poète.)
12Les trois chapitres de la première grande ébauche sur Baudelaire – « La Bohème », « Le Flâneur », « Le moderne » – devaient, sous le titre « Le Paris du Second Empire chez Baudelaire », constituer la deuxième partie d’un ouvrage qui en aurait comporté trois. La réalisation de cet ensemble fut abandonnée d’abord à cause du rejet qu’Adorno et Horkheimer manifestèrent pour le projet, puis à cause de la catastrophe historique. Il peut sembler discutable de vouloir définir le processus de lecture à partir d’un fragment d’un ensemble inachevé. Les circonstances indiquent cependant que, pour ce cas précis, le caractère fragmentaire se trouve investi d’une détermination signifiante et objective. Celle-ci ne doit pas être lue au premier chef comme une intention de l’auteur, bien que Benjamin lui-même fût un exceptionnel lecteur de fragments et de ruines, ni à partir d’une structure globale manquante, projetée, voire fantasmée, mais dans cette forme historiquement fragmentée de l’écrit : HIC SCRIPTA HIC LEGE.
13Le texte de Benjamin manifeste une sobriété froide et pleine de réserve, parfois même sèche et revêche, envers l’œuvre de Baudelaire, qui est belle parce qu’elle « surgit du sein de l’abîme9 », comme Benjamin l’écrivit plus tard. La sobriété est de rigueur lorsqu’il est question d’ivresse et d’abîme. De l’économie bistrotière des conspirateurs et de la Bohème au vertige fantasmagorique de l’économie des marchandises, la sobriété rencontre l’ivresse partout.
14On a voulu expliquer la froideur particulière, presque glaciale, que ce texte manifestait à l’égard de Baudelaire par la visée marxiste qui aurait guidé la lecture. Benjamin aurait eu pour intention « de tourner l’œuvre de Baudelaire contre son interprétation traditionnelle, pour la rapporter à la base objective des rapports sociaux qui régnaient à l’époque de sa conception10. » Dans sa formulation, ce commentaire pose problème puisque des expressions comme « base objective » présupposent une métaphysique et une épistémologie que Benjamin n’a jamais énoncées de façon aussi univoque. Le problème n’est pas seulement que de telles expressions n’apparaissent pas explicitement dans l’étude sur Baudelaire, mais que tout le processus de lecture s’organise selon des rapports et des catégories très différents.
15Dans un premier temps il suffira d’exprimer certains étonnements de lecteur. Car il y a de quoi être étonné à la lecture du texte de Benjamin, que l’on soit un amateur de Baudelaire ou un lecteur marxiste à peu près compétent. Même ce dernier ne pourra se sentir tout à fait à l’aise. Certes, le chapitre sur la Bohème s’ouvre en fanfare avec une citation de Marx, mais la suite est extrêmement surprenante. Dans cette analyse de textes et de rapports sociaux, on ne trouve presque aucune des catégories fondamentales de la construction marxiste, — comme la base et la superstructure — ; plus frappante encore est la façon dont les fragments de texte et les divers éléments du monde politique et social sont ici collectés et rassemblés. Tantôt surgit une image anecdotique de Baudelaire, s’écriant à un coin de rue, pendant la révolution de février : « À bas le général Aupick ! », et cette image est considérée comme ayant « force de preuve » (I, 515 [trad. fr., 28]). Le rapport de Baudelaire à Blanqui est analysé par une simple feuille de papier « qui montre la tête de Blanqui à côté d’autres dessins improvisés » (I, 518 [trad. fr., 32]). À la lecture de tels propos, le marxiste sérieux est en droit de se demander : à quoi tout cela rime-t-il ? Et quand, pour finir, le grand poème de Baudelaire « Le vin des chiffonniers » est ainsi commenté: « […] on est en droit de placer la date de sa conception au milieu du siècle. À l’époque, les motifs qui résonnent dans cette pièce étaient débattus dans l’opinion publique. Il était question, alors, de l’impôt sur le vin » (I, 519 [trad. fr., 34]), l’amateur de Baudelaire et le tenant du matérialiste historique peuvent gémir de concert. Et Adorno ne s’en priva point, lui qui, jusqu’à un certain point, incarnait ces deux types de lecteur, et il justifia en détail son indignation devant un tel réductionnisme et un tel manque de subtilité dans l’art de la preuve. Par ailleurs, l’argument s’appuyant sur la notion de « base objective » n’est pas non plus très convaincant. Devons-nous vraiment admettre que les discussions à propos de l’impôt sur le vin constituent la « base objective » du « Vin des chiffonniers » ?
16Le texte de Benjamin ne mentionne ni base ni superstructure, et il n’évoque jamais aucune autre structure hiérarchique de ce type. Le “réalisme”, fétiche qui domine la critique littéraire bien au-delà des cadres de la vision marxiste, n’apparaît qu’une seule fois sous la plume de Benjamin, encadré par des guillemets méprisants : « Dans la fulgurance visionnaire que renferme le concept hugolien de foule, l’être social accède mieux à son droit que dans le traitement “réaliste”… » (I, 565 [trad. fr., 94]). Dans la « fulgurance » visionnaire, l’être social n’est pas représenté par la littérature, il « accède à son droit ». L’éclair de la fulgurance (was einschlägt) imprime (schlägt) des traces ; dans les signes de ces traces, quelque chose devient lisible.
17Le griffonnement des traces rend le regard sensible à une catégorie fondamentale de la lecture benjaminienne : la physionomie. Elle est introduite dès les premières phrases du chapitre sur la Bohème :
C’est dans un contexte instructif que la Bohème fait chez Marx son apparition. Il y comprend les conjurés de profession. […] Rendre la physionomie de Baudelaire présente, cela revient à parler de la ressemblance qu’il présente avec ce type politique.
18Si le nom de Baudelaire désigne ici la figure littéraire et le groupe des conspirateurs professionnels une figure politique, cela ne signifie pas qu’une figure représente l’autre, mais qu’entre elles, dans leur ressemblance, apparaît quelque chose qui est de l’ordre de la physionomie, et qui, peut-être, se donne à lire comme le texte de l’être social.
19La physionomie est d’abord un concept opposé au psychologisme dominant. En commentant l’étude d’Adorno sur Wagner, le 6 janvier 1938, Benjamin écrit à Horkheimer qu’« une tendance de ce travail [l’]intéresse particulièrement : le fait d’implanter immédiatement dans l’espace social, presque sans médiation psychologique, le physionomique11. » La physionomie, au contraire de la psychologie, est la topographie des traits marqués, non l’expression d’une intériorité ; elle est écriture du corps plus que langage de l’âme.
20En tant qu’écriture du corps, la physionomie appartient à un monde spatial : c’est d’un espace d’images et d’un espace de corps que parle l’essai sur le Surréalisme ; c’est un espace d’écriture, non simplement une surface, que la graphologie lit dans la pression et l’interruption des traits d’écriture ; implanter le physionomique dans l’espace social, telle est la tendance de l’ouvrage d’Adorno sur Wagner.
21C’est manifestement un espace d’un genre spécifique, même si cette spécificité consiste tout d’abord à être un espace à lire littéralement, et non un espace métaphorique de l’intériorité. L’espace, en tant qu’il n’est pas la métaphore d’une plénitude intérieure, s’ouvre dans un entre-deux et comme un vide. C’est ainsi que Benjamin lit l’image proustienne et les traits de Baudelaire. « L’image de Proust est l’expression physionomique la plus haute que pouvait gagner le décalage croissant irrésistiblement entre la poésie et la vie » (II, 311 [O, II, 136]). L’expression physionomique n’exprime ni la vie ni la poésie, mais un espace entre les deux, et cet entre-deux, à son tour, n’est pas un vide neutre, mais le vide d’une négation déterminée, d’une coupure, d’une séparation. Les lignes (Linien) de démarcation de la séparation se font lignes (Zeilen) d’un texte écrit. Par là également la lecture proposée par le matérialisme historique rejoint exactement le discours épistémologique et sémiotique du livre sur le Trauerspiel12. Dans ce livre, c’est la mort qui « enfouit la ligne brisée de la démarcation entre physis et signification13. » À la mort correspond la figure de l’allégorie, figure dont la dialectique se déploie dans « l’abîme entre l’être imagé et le signifié » (I, 342 [trad. fr. p.178]).
22De même que l’image de Proust apparaît comme l’expression physionomique d’un hiatus, Benjamin lit les traits du dernier Baudelaire comme l’expression d’un vide essentiel. Dans la lettre du 7 mai 1940 à Adorno, Benjamin défend un concept d’attitude qui « amène l’essentielle solitude d’un homme dans notre champ de vision14. » En même temps, l’« essentielle solitude » est débarrassée de tout pathos existentiel en tant qu’elle est le lieu non d’une « plénitude individuelle », mais d’un «vide conditionné historiquement ». Ce « vide inaliénable », Benjamin le trouve « dans les traits du dernier Baudelaire », dans la mesure où ils dessinent une attitude qui se distingue de la pose suffisante d’une prétendue plénitude individuelle. Elle s’en distingue « comme la cicatrice d’une brûlure15 se distingue du tatouage ».
23La topographie physionomique, telle qu’elle apparaît dans l’image de Proust et dans les traits de Baudelaire, est représentée comme espace. Plus exactement : elle est l’espace réel comme espace de la présentation. Ce qui dans cet espace vient à la présentation, c’est un vide, mais pas n’importe quel vide, un vide déterminé : un décalage croissant chez Proust, un vide conditionné historiquement chez Baudelaire.
24Il faut maintenant explorer le caractère déterminé de ce vide ainsi que sa présentation déterminée dans l’espace. L’analogie faite par Benjamin entre l’attitude vraie et la cicatrice de brûlure nous invite à revenir brièvement sur son essai de jeunesse qui parle du signe (Zeichen) et de la tache (Mal)16. Certes il faut rester prudent, et ne pas appliquer à l’œuvre ultérieure la théorie du langage esquissée dans les œuvres de jeunesse, ni forcément tenir compte des déclarations explicites de Benjamin à ce sujet; néanmoins, les textes eux-mêmes révèlent que ses pensées de jeunesse continuent d’influer sur ses œuvres de maturité. Pour comprendre l’opposition abstraite entre les concepts de signe et de tache, il est essentiel de distinguer la façon dont chacune apparaît dans l’espace. La différence fondamentale, selon Benjamin, est « à voir en ceci que le signe est apposé de l’extérieur, la tache en revanche surgit d’elle-même » (II, 605 [O, II, 174]).
25Dans le cadre de la topographie physionomique, nous nous heurtons alors à une difficulté. Les traits physionomiques ont en effet cette particularité qu’ils résultent d’une marque et sont apposés de l’extérieur, mais qu’en même temps, ils surgissent tout aussi bien d’eux-mêmes dans l’être vivant. Il semble donc que, dans l’espace de la présentation, le signe et la tache passent l’un dans l’autre. Dans l’essai de jeunesse, une telle unification du signe et de la tache ne pouvait être attribuée qu’à Dieu (II, 605 [O, I, 175]). Si désormais la lecture qui suit le matérialisme historique rencontre cette unification, dans l’espace de présentation du politique, sous la forme d’une topographie physionomique, cela ne manifeste pas seulement une complète sécularisation du théologique, mais également le déchiffrement des marques théologiques qui estampillent irrémédiablement l’espace de la présentation. Cet estampille n’apparaît pas seulement dans la figure du nain bossu, dans l’automate du jeu d’échecs (I, 693[O, III, 427]), mais aussi dans l’évocation provocatrice du péché originel chez Baudelaire, interprété comme une façon de se protéger de l’illusion psychologique de la « connaissance de l’homme » (I, 542 [trad. fr., 64]) ; et cet estampille apparaît moins dans le contenu théologique, qui, en tant que signifié, demeure dans le domaine de la fantasmagorie, que dans l’effet « marquant » de l’espace historique, lorsque la « figure intérieure » du poème « À une passante » révèle ses traits : « l’amour même [y] est reconnu comme recevant ses stigmates de la grande ville » (I, 548 [trad. fr., 72]). Dans la stigmatisation comme forme d’apparition de la tache, comme stigmate (Wundmal), le sacré, la physis blessée et l’espace social se rencontrent pour former la constellation singulière de l’espace de la présentation.
26Ce qui apparaît dans l’espace physionomique de la présentation et – peut-être – se donne à lire, Benjamin l’appelle image. L’image de Proust est exprimée en termes de physionomie, tout comme l’attitude politique de Baudelaire trouve sa signification par l’image : « L’image qu’il nous a offerte lors des journées de février – à un coin de rue parisien quelconque, brandissant un fusil, prononçant les mots : « À bas le général Aupick » – a force de preuve. » Cette image peut semble illustrer une certaine étroitesse de la vision politique, dans un court-circuit réunissant sans médiation révolte familiale et révolution sociale. Mais déclarer qu’elle a « force de preuve » pose doublement problème au regard des postulats épistémologiques : qu’une image ait force de preuve n’est pas moins difficile à admettre qu’une image puisse prouver quoi que ce soit.
27La dernière proposition enfreint la logique scientifique de l’induction, selon laquelle un cas singulier ne prouve rien au sens strict. Lorsque Freud rencontra le même problème, le scientifique rigoureux en lui formulait une mise en garde : « Naturellement, un cas singulier n’instruit pas sur tout ce que l’on voudrait savoir », pour être corrigé aussitôt après par le Freud psychanalyste : « […] plus exactement, il pourrait tout enseigner, si seulement on était en mesure de tout concevoir, et si l’on ne se trouvait contraint, par le manque d’exercice de notre propre faculté de perception, de se contenter de peu17 ». Dans les écrits de Freud comme dans ceux de Benjamin se profile une structure signifiante pour laquelle le singulier a force de preuve contre le paradigme scientifique dominant. Mais par là, le caractère non médiatisé du court-circuit entre révolte et révolution est transposé sur un autre plan, pour devenir un processus de lecture. Telle était justement la principale objection qu’Adorno adressait à l’ouvrage sur Baudelaire.
28Chez Benjamin, le fait qu’une image ait force de preuve est étroitement lié à la possibilité qu’une image en général ait force de preuve. Il faut alors se demander quelle est la nature de cette image qui peut apparaître dans l’espace de la présentation, s’y rendre lisible et avoir force de preuve. En un premier temps, on peut d’ores et déjà exclure l’image d’imitation et par là toute conception relevant d’une théorie du reflet. L’image d’imitation fournit aussi peu de preuves qu’une photographie des usines Krupp révèle le système capitaliste, pour reprendre les paroles de Brecht18. À moins qu’il ne faille ajouter avec Freud : plus exactement, elle pourrait nous apprendre quelque chose, peut-être même tout, si seulement notre faculté de perception était plus exercée ? En admettant que ce soit le cas, ce n’est pas l’image d’imitation en tant que telle qui aurait force de preuve, mais l’apparition singulière elle-même. Selon qu’il s’agit de bâtiments ou de leurs photographies, il reviendrait à la forme de la perception de voir et de lire ce que, dans l’espace, ils font accéder à la représentation.
29Benjamin appelle « image » ce qui se présente dans une telle perception, et, comme tel, la distingue expressément de l’image d’imitation. « Unicité et durée » caractérisent la première, « fugacité et itérabilité19 » la seconde (II, 379[O, II, 311]). Si dans le contexte de la Petite Histoire de la photographie (tout comme dans l’essai sur L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique), où s’accomplit cette distinction, l’image d’imitation apparaît privilégiée en tant que forme anti-auratique de la perception, contre l’image auratique, elle ne l’est précisément pas en raison de son signifié (comme image imitant un quelconque « réel »), mais comme signifiant, par sa structure d’itérabilité.
30Ainsi, l’œuvre de Benjamin assigne à l’image une place spécifique dans l’espace de la présentation, parce qu’elle offre non pas un quelconque signifié mais une certaine structuration du signifiant. En tant que signifiant lisible, l’image est aussi bien écriture en images (rébus20) qu’image de l’écriture.
31En tant qu’écriture en images et image de l’écriture, l’image porte atteinte à une certaine convention de la critique littéraire qui voudrait l’opposer au conceptuel en la considérant comme spécifiquement « poétique ». Elle lui porte atteinte sans pour autant la nier. Benjamin reconnaît dans l’image la résistance opposée au savoir quand il se demande « si le plaisir pris au monde des images ne se nourrit pas d’un sombre défi adressé au savoir » (IV, 427[O, II, 352]). Dans cette mesure, l’image contribue à produire des illusions dotées d’un pouvoir de transfiguration onirique. Ainsi le rêveur voit le ciel « sans nuage, dans un éternel azur » et il ne veut rien savoir des gaz qui, dans ce ciel, « invisibles, luttent et bouillonnent en désordre » ; il lui faut oublier cela, et beaucoup plus, « pour s’abandonner aux images. »
32Benjamin met ici en scène la production d’images comme le scénario d’un rêveur qui, dans son repos, ne saurait être dérangé par aucun mouvement. Par là, ce « rêveur d’images » se trouve dans une situation analogue au « rêveur qui dort », dont le rêve a pour fonction, selon Freud, de protéger le sommeil. Par là, l’image serait une résistance opposée à cet instant qui se trouveà l’horizon de toute l’œuvre de Benjamin : le réveil. C’est effectivement elle qui assure cette résistance ; mais en même temps, en vertu d’un petit déplacement, quelque chose d’autre se révèle. Le rêve d’images, qui se dresse contre tout éveil au savoir, se manifeste le plus complètement « quand il réussit à prendre au mouvement lui-même son aiguillon, à changer le coup de vent en un murmure et le furtif déplacement des oiseaux en un vol migratoire » (IV, 427 [O, II, 352]). Le petit déplacement qui transforme la perpétuation du repos en une saisie du mouvement donne à la production d’images un visage complètement différent, emblématiquement ressaisi dans un des graphèmes les plus anciens, celui qui transforme le furtif déplacement des oiseaux en « vol migratoire ». La saisie d’un mouvement, la césure, apparaît, depuis les premiers écrits de Benjamin jusqu’aux plus tardifs, comme le moment de l’éveil au savoir aussi bien qu’à la pratique21. Les deux dernières phrases de l’« image de pensée » (Denkbild) attribuent à l’image un double tranchant : « Saisir ainsi la nature dans le cadre d’images pâlies, tel est le plaisir du rêveur. La frapper d’enchantement par l’emprise d’un nouvel appel est le don du poète ».
33En tant qu’écriture en images et rébus, l’image est structurée comme le rêve ; en tant qu’image dialectique, elle est en même temps une lecture de rêve. Dans la lettre du 16 août 1935 à Gretel Adorno, qui livre des réflexions préparatoires à l’ouvrage sur les Passages, Benjamin établit le rapport entre rêve et image :
L’image dialectique ne copie pas le rêve – affirmer cela n’a jamais été mon intention. Mais elle me semble bien contenir les instances, les lieux d’irruption du réveil, et même ne produire sa figure qu’à partir de ces lieux, comme une constellation naît de points lumineux22.
34Dans le passage de l’image peinte à la figure de la constellation, l’écriture en images du rêve se fait image écrite de la lecture.
35Comment naissent de telles images ? Deux conditions, étroitement connexes, agissent de concert : comme constellation, l’image apparaît en un éclair, mais elle comporte aussi une dimension temporelle. Dans l’image, le temps entre dans l’espace de la présentation comme rencontre ponctuelle du passé et du présent :
Ce n’est pas que le passé jette sa lumière sur le présent, ou que le présent jette sa lumière sur le passé, mais l’image est ce en quoi ce qui a été entre en un éclair en constellation avec le maintenant (V, 576 [Benjamin, Paris, capitale du 19ème siècle. Le livre des Passages, trad. J. Lacoste., Paris, Les Editions du Cerf, 1989, p.478]).
36Le caractère instantané de la formation de l’image correspond à la pointe du mot d’esprit. La liaison de l’image et du mot d’esprit est déterminée structurellement, non fortuitement, avec toutefois la particularité suivante : le mot d’esprit est structuré selon la forme du hasard et de l’inattendu. D’après l’essai sur le Surréalisme, le mot d’esprit est, à côté de l’injure et du malentendu, une des instances « où un agir engendre et constitue lui-même l’image » et où, par conséquent, s’ouvre également l’« espace d’images » du politique (II, 309 [O, II, 133]). Ce qui flamboie dans le mot d’esprit est la trace d’un changement radical dans la conscience. Le mot d’esprit a lieu dans le langage. Selon Benjamin, le langage est également le lieu où l’on rencontre les images dialectiques, « c’est-à-dire : les images non archaïques23 » (V, 577 [trad. fr., p. 479]).
37Le temps qui, avec l’image dialectique, apparaît en un éclair dans l’espace de la présentation, est un rapport entre ce qui est passé et ce qui est présent, et non entre le passé et le présent. Cela le rend radicalement étranger à presque toutes les formes de ce qu’on appelle les méthodes historiques, aussi bien à la totalisation positiviste de l’histoire dans l’historicisme, qu’à la totalisation systématique des théories de l’histoire hégélienne et marxiste. L’indice historique de l’image dialectique, en tant que mise en rapport ponctuelle d’un maintenant déterminé avec un moment déterminé de ce qui est passé, correspond à la structure de l’après-coup : « L’indice historique des images ne dit pas seulement en effet qu’elles appartiennent à un temps déterminé, il dit surtout que c’est seulement à un temps déterminé qu’elles accèdent à la lisibilité » (V, 577 [trad. fr., p.479]). Ainsi l’histoire apparaît dans l’espace de la présentation comme le lieu d’une lisibilité ; inversement, la lisibilité est le concept de l’histoire sous le signe de l’après-coup.
38Dans cette constellation historique, il semble que manque l’avenir. Effectivement, comme promesse d’un temps accompli, il n’a pas sa place dans l’expérience temporelle authentique de l’histoire. Comme temps accompli, l’avenir est un fantasme et une fantasmagorie. Dans ce constat réside le point qui éloigne Benjamin de Bloch. C’est seulement comme savoir de la mort que l’avenir agit comme puissance significative sur le présent. Il se caractérise par la grammaire spécifique du futur antérieur, au lieu du futur simple. Selon Lacan, le futur antérieur est la forme temporelle grammaticale du sujet, selon Benjamin, c’est celle de l’image : « Ce dont on sait que bientôt on ne l’aura plus devant soi, cela devient image », dit l’essai sur Baudelaire. Cela aura été : telle est la grammaire de l’histoire et de sa lisibilité.
39Retournons à l’image dont nous sommes partis : cette image légèrement comique que Baudelaire « a offerte pendant les journées de février » (I, 515) et qui se révèle dans le texte de Benjamin comme ayant force de preuve. L’image que quelqu’un offre est libérée de l’expression intentionnelle du sujet. C’est « l’agir lui-même » qui « engendre et constitue lui-même l’image » (II, 309 [O II, 133]) et qui, dans cet être-image, devient lisible et acquiert force de preuve. Une des tournures à la fois les plus subtiles et les plus marquantes du livre sur le Trauerspiel construit la différence entre offrande (Darbietung) et présentation (Darstellung) comme différence entre signifiant (Bedeutend) et signifié (Bedeutet). La différence se trouve dans le renversement de la nullité de tout signifié allégorique en un signe allégorique, considéré comme signifiant : « La fugacité [des choses] n’y est pas tant signifiée, présentée allégoriquement, que, elle-même signifiante, offerte comme allégorie » (I, 405-406 [trad. fr., 251]24).
40Aussi, le fait que ce soit l’image offerte, et non l’image présentée, qui acquière force de preuve dans l’espace d’images du politique, rend possible la force désignative du signifiant (Signifikant), la lisibilité dans l’espace de la présentation. Mais le concept de lisibilité est ici inversé par le retournement du signifié en signifiant. Car, de même que dans l’espace allégorique du Trauerspiel tout signifié est radicalement nul et vide – parce que toute allégorie signifie « le non-être de ce qu’elle représente » –, de même aussi dans l’espace de présentation de l’allégorie moderne, sur la place du marché, tout signifié est radicalement, et irrémédiablement condamné à n’être qu’une fantasmagorie. Dans cet espace, toute compréhension herméneutique du « visé » reste sous l’emprise de cette fantasmagorie.
41Mais que veut dire le terme de lisibilité si la lecture n’a plus un « visé » en vue? Que veut dire « lire », si l’on se réfère à un signifiant au lieu d’un signifié ? En premier lieu, ce tournant implique une certaine littéralisation du lire (Lesen), en tant que récolte (Lese), « cueillette » (Auflesen), relevé d’inscriptions (Ablesen). Celui qui lit de cette façon recueille ce qui se présente et le rassemble. Dans l’essai sur Baudelaire, c’est bien un tel geste de lecture qui s’effectue, et c’est ce geste qui fait ressembler le texte à un rassemblement hétéroclite d’éléments dispersés. C’est littéralement « au passage » (I, 514) que le lecteur recueille ceci et cela, comme, par exemple, l’ascension politique de Napoléon III dont l’« épicerie du secret » (I, 514) forme une constellation-clé avec le « bazar d’énigmes de l’allégorie » baudelairien25. L’épicerie du secret est un commerce de secrets qui n’en sont pas véritablement. Celui qui cherche à les découvrir rentre bredouille ; en revanche, celui qui sait déchiffrer dans l’épicerie du secret un commerce est, comme lecteur, sur la trace d’un autre secret, manifeste à même le signifiant26.
42Tandis que la littéralité de cette récolte soustrait la lecture à l’imaginaire, le littéral apparaît en même temps enregistré d’une façon spécifique dans l’espace d’images. L’entrecroisement de l’image et de l’écrit, qui caractérise déjà les symboliques de la Renaissance et du baroque, conduit au noyau nébuleux de la théorie benjaminienne du langage. Le dépassement de la « limite entre écrit et image » s’érige en exigence politique adressée à l’auteur considéré comme producteur (II, 693). L’image recouverte d’inscriptions, qui se trouve comme photomontage et reportage dans l’agitation politique, et comme gestuelle dans le théâtre épique de Brecht, est une des formes modernes sous lesquelles apparaît ce noyau nébuleux d’une théorie de la langue, qui se cristallise dans le concept de ressemblance.
43Il n’est pas anodin que ce concept serve à introduire la physionomie de Baudelaire comme constellation politique: « rendre présente la physionomie de Baudelaire veut dire parler de la ressemblance qu’il présente avec ce type politique » (I, 513). Si la ressemblance nous montre ici son côté politique, dans l’essai sur Proust, elle montre son côté onirique: « La ressemblance de l’un avec l’autre, que nous escomptons, celle qui nous occupe dans l’état de veille, dessine seulement la ressemblance plus profonde du monde onirique, dans lequel ce qui a lieu n’est jamais identique mais ressemblant : surgit sur le mode d’une ressemblance à soi-même difficile à cerner » (II, 314 [O, II, 140]). Ce monde en « état de ressemblance » est un monde « déformé » et pourtant, dans sa déformation, il est « le vrai visage surréaliste de l’existence » et il est, comme image, « la fragile, la précieuse réalité » (II, 314[O, II, 141]). Dans ce remarquable entrecroisement de déformation, de vérité et de réalité, « le monde en état de ressemblance » ne renvoie pas seulement au temps entrecroisé de Proust (II, 320[O, II, 149]), mais aussi aux « correspondances » de Baudelaire (II, 211 et 320 [O, II, 149]) et, à travers ces deux références, à une théorie de la mimèsis qui ne s’intègre ni à la tradition aristotélicienne ni à la théorie marxiste du reflet.
44Cette théorie est présentée dans deux esquisses, où elle est condensée jusqu’à en être presque incompréhensible: la Doctrine du ressemblant (II, 204-210) et Sur la faculté mimétique (II, 210-213 [O, II, 359-363]). Benjamin y esquisse une histoire de la mimèsis qui s’étend des premiers jeux d’enfants et de la lecture des astres dans les premiers temps de l’histoire jusqu’au champ de l’écriture et du langage. C’est à propos du jeu d’enfants – qui, en bouleversant certaines de ses hypothèses fondamentales, a aussi inscrit dans la psychanalyse l’altérité d’un au-delà – que Benjamin a développé plusieurs fois ses modèles les plus subversifs. Affranchi de tout psychologisme, il observe ces jeux dans leur présentation objectale. Il remarque ainsi que le domaine du comportement mimétique ne se « limite en aucun cas à ce qu’un être humain peut imiter d’un autre. L’enfant ne joue pas seulement au marchand ou au professeur, mais aussi au moulin à vent et à la voie ferrée » (II, 205). On perçoit mieux le caractère radical de cette observation lorsqu’on sait que presque toutes les théories de la mimèsis d’inspirations psychologique, sociologique, politique et esthétique, sont cantonnées au domaine des jeux de rôles sociaux et de l’empathie. Plus d’une révolution sociale a ainsi lamentablement échoué sur cet écueil des « role models », parce que, impuissante et aveugle à toute lecture de l’autre, elle fut dévorée par l’imaginaire de tout ce qui avait été donné par avance.
45Benjamin et Brecht ont trouvé leur plus exacte affinité dans le combat contre l’empathie, qu’ils considéraient comme la forte résistance au changement. Face à l’empathie, la chosification apparaît comme une libération révolutionnaire.
46Or, dans l’ouvrage sur Baudelaire, on trouve des allusions à une empathie pour l’âme des marchandises qui semble effacer la frontière entre la mimesis des choses, présente dans le jeu d’enfants, et l’empathie. Sa signification théorique est fortement soulignée dans la lettre du 9 décembre 1938, où Benjamin en fait « le lieu, et assurément le seul, où la théorie parvient à son droit sans être déformée27. » Dans la mesure où l’empathie pour l’âme des marchandises s’exprime comme « empathie pour l’inorganique » (I, 558), elle semble encore assez proche de l’enfant qui joue à la voie ferrée ou au moulin à vent. Et cependant, c’est là que réside toute la différence pour Benjamin. L’« empathie pour l’inorganique » se révèle un piège tendu à l’empathie pour la valeur d’échange, qui n’est autre que l’« âme » fantasmagorique des choses.
47Ce n’est pas la chosification, mais une déchosification qui ici est à l’œuvre. Plus précisément : la chosification n’a pas lieu là où une rhétorique sentimentale l’a établie – dans l’âme de l’homme –, c’est au contraire la force de travail qui est chosifiée, opération dont le pendant est la déchosification fantasmagorique et l’attribution d’une âme à la marchandise.
48L’effacement de la trace de la force de travail dans la chosecorrespond à l’effacement de la trace du signifiant dansce qui est lu, dont la représentation littérale, figurale et objectale dans l’espace de la représentation (Repräsentation) est sacrifiée à un espace fantasmagorique de l’intériorité, du « comprendre » et de l’empathie.
49La lecture de Benjamin, qui s’exprime le plus vigoureusement dans la sécheresse du premier ouvrage sur Baudelaire, est la pratique continue et conséquente d’une lecture du signifiant et, par là, une lecture de ce qui dans l’essai sur le Surréalisme désigne, comme « espace d’images » et « espace de corps », la scène authentique de la lecture politique.
50À partir de là deviennent enfin lisibles certains traits remarquables de cette lecture. Parmi les passages irritants qui provoquèrent la protestation d’Adorno, outre la relation entre le poème de Baudelaire « Le vin des chiffonniers » et l’impôt sur le vin, déjà mentionnée, on trouve d’autres interprétations remarquables par leur caractère physico-mécanique : celle du « Flâneur », par exemple, dont le vagabondage est empêché par l’étroitesse des trottoirs (I, 538 [trad. fr. 59] ; critique d’Adorno, I, 109428). L’espace de représentation comme espace d’images et de corps est d’abord un espace physique, dans lequel les choses et les figures butent les unes contre les autres. Les mouvements réflecteurs qui en résultent dessinent les traits du texte écrit lu par Benjamin.
51Le Flâneur n’est pas introduit comme personne psychologique ou sociologique, mais comme figure en mouvement, dotée d’un rythme et d’un habitus déterminés : « La tranquillité de ces descriptions s’harmonise avec l’habitus du Flâneur qui va herboriser sur l’asphalte » (I, 538 [trad. fr., 59]). Ainsi, dès le livre sur le Trauerspiel, la mélancolie ne se présente pas comme un phénomène psychologique, mais comme un mouvement d’ostentation théâtrale, au cours majestueux, et sa fidélité au monde des choses s’atteste comme « rythme des degrés de l’intention qui descendent comme des émanations » (I, 334[trad. fr., 168]). Dans ce contexte, même les passages se présentent d’abord comme des échappatoires spatiales pour le Flâneur qui suit sa paisible routine, – à la grande indignation d’Adorno.
52De la même façon, Benjamin introduit le détective comme une autre figure centrale dans la topographie de son paysage. L’« amour-propre » du détective peut s’enivrer de sa propre capacité d’observation et de combinaison : Benjamin parle sobrement d’une capacité « à élaborer des formes de réaction » (I, 543 [trad. fr., 65]). Dans l’homme de la foule de Poe, il s’intéresse à « la description de la foule d’après la façon dont elle se meut » (I, 554 [trad. fr., 80]), agitée de coups et contrecoups ; de même, le poème de Baudelaire « À une passante » met en avant « ce qui provoque la crispation du corps » (I, 548 [trad. fr., 72]).
53Aussi n’est-il pas tout à fait surprenant qu’Adorno devine dans cette lecture « des traits behaviouristes » (I, 1096 [Correspondance, 270]). On a voulu aussi, et ce n’est pas un hasard, noter de tels traits chez Brecht, à mesure que son théâtre se faisait espace d’offre (Darbietungsraum) d’une présentation gestuelle. Lecteur du livre sur le Trauerspiel, Adorno aurait tout aussi bienpu suivre une autre piste pour comprendre Benjamin. De fait, l’apparent « behaviourisme » de ce dernier n’émane en aucun cas du fanatisme ascétique propre au marxiste néophyte, comme le suggère Adorno, mais il est inscrit dans les fondements épistémologiques du livre sur le Trauerspiel. Au moment crucial où, dans le texte, la tristesse (Trauer) est avancée comme phénomène constitutif, une considération méthodologique prévient tout malentendu psychologique. La phénoménologie du sentiment, au sens extrapsychologique, comprend tout sentiment comme « lié à un objet a priori ; la présentation de cet objet est sa phénoménologie » (I, 318 [trad. fr., 150]). Ainsi la « théorie de la tristesse » se déploie non comme la description d’un sentiment, mais comme « la description de ce monde qui s’ouvre au regard du mélancolique […]. Car les sentiments s’opposent comme comportement moteur à la structure objectale du monde ». Et ainsi même la tristesse apparaît comme « une attitude motrice qui a son lieu bien déterminé dans la hiérarchie des intentions » (I, 318 [trad. fr., 151]). Ces phrases expriment déjà le mode de lecture qui caractérisera les études matérialistes-historiques de Benjamin, y compris l’ouvrage sur les Passages.
54L’espace d’images et de corps qui s’ouvre au regard de ce lecteur est un espace physique de réflexes moteurs. Mais il est, en même temps, un espace déformé de part en part, dans lequel rien n’occupe son « vrai » lieu. Concrètement, dans l’essai sur Baudelaire c’est par la place du marché et son pendant, le panorama, que s’ouvre le chapitre sur le Flâneur. L’épicerie politique du secret et le bazar à secrets allégorique commencent alors à jouer un rôle. En ce lieu se tenait l’homme de lettres, prêt « à saisir le premier incident venu, le premier mot d’esprit, ou la première rumeur qui pouvait circuler » (I, 530 [trad. fr., 48]). Par là, ce lieu est lui aussi caractérisé comme espace d’images et de corps, marqué par le mot d’esprit, l’injure ou le malentendu.
55Y correspond une lecture qui doit, au sein de cet espace, tout reconnaître dans la littéralité physique du signifiant, sans cependant rien prendre pour argent comptant dans ce mode d’apparition. Benjamin fait jouer un paradoxe : les choses et les données empiriques sont à la fois traitées avec un attachement absolu, en tant que signifiants à recueillir, et frappées de nullité, en tant que vaines apparences. C’est finalement sur ce point que la lecture de Benjamin se sépare de celle d’Adorno. Contre le goût de Benjamin pour le détail parlant, Adorno manifeste une phobie viscérale pour l’empirique, ce qui le pousse à recourir à la médiation de la théorie. La méthode de Benjamin appelle aussi la théorie, maiselle lui assigne une autre place. La position, au sens littéral, joue ici aussi un rôle déterminant : la théorie est abstraite des données, et non directement médiatisée par celles-ci.
56Cette indépendance de la théorie, qui est en même temps une prise de distance vis-à-vis de celle-ci, a des conséquences épistémologiques considérables, qui demandent à être examinées plus avant. Dans les limites de cet essai, nous nous contenterons de proposer en conclusion quelques observations sur la façon de lire. Ceux qui sont irrités par la façon dont Benjamin rattache le poème « Le vin des chiffonniers » à la discussion concernant l’impôt sur le vin présupposent qu’il s’agit d’une relation causale. C’est également la conjecture formulée par Adorno quand il attaque la méthode de Benjamin, coupable, selon lui, « d’interpréter en termes “matérialistes” des traits sensibles isolés, venant du domaine de la superstructure, en les rapportant sans médiation, et même de façon causale, aux traits correspondants de l’infrastructure » (I, 1096 [Correspondance, 270]).
57Or, il n’est justement pas question de relation causale chez Benjamin. Au contraire, on est frappé par la façon dont les « traits sensibles », incroyablement dispersés dans différents domaines, s’entremêlent dans des associations et des arabesques singulières. Ainsi le poème sur le vin de Baudelaire n’entre pas seulement en relation avec l’impôt sur le vin, mais encore avec les « bistrots des marchands de vin » de la citation de Marx (I, 513 [trad. fr., 25]), qui font office de « stations fixes » pour les conspirateurs. Ces stations fixes se croisent à nouveau avec une autre chaîne signifiante, celle des barricades comme « points fixes du mouvement conspirateur » (I, 516 [trad. fr., 30]), qui, de leurs barrières, interrompent le trafic et la communication du réseau des rues,en même temps qu’elles « sillonnent la ville » en la marquant de leurs « traits » physionomiques.
58Le modèle qui s’impose pour une telle lecture n’est pas la relation causale, ni même structurelle, entre base et superstructure, mais l’interprétation des rêves freudienne. Dans ce cadre, un détail économique comme l’impôt sur le vin ne se présente pas comme ce qui fonde en causalitéle poème de Baudelaire, mais il fonctionne sur le mode de ce que l’interprétation des rêves appelle « restes diurnes » : c’est-à-dire ces moments, disséminés tout au long du rêve, où l’on se souvient du jour précédent – des éclats de réalité donc, quine fondent pas le rêve comme une causalité mais constituent le point de départ du travail analytique, parce qu’ils ouvrent des passages pour les chaînes d’associations. Et, de même que, pour Freud, l’« essence du rêve » ne réside pas tant dans son contenu révélé que « dans le processus spécifique du travail onirique qui, à l’aide d’une motion de souhait inconsciente29, fait passer des pensées préconscientes (restes diurnes) dans le contenu de rêve manifeste30 », de même la lecture de Benjamin est aussi sur la trace de ce « travail du rêve » collectif qui forme l’espace d’images et de corps du politique. Une telle lecture du politique, qui est une lecture de rêve, exige un concept d’espace de représentation et de présentation qui dépasse l’habituelle rhétorique moralisatrice. Seul l’accomplissement de cette pratique benjaminienne de la lecture, et non sa paraphrasa, peut faire lever le rideau sur le théâtre qui met en scène la politique.