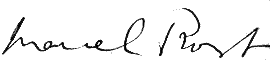
Pierre-Louis Rey : Paysages de Sodome et Gomorrhe
Parti la première fois pour Balbec afin d'y admirer une église embellie par les tempêtes, le héros de la Recherche y a surtout découvert le profil d'Albertine silhouetté sur la mer. Il y a aussi appris, avec la leçon d'Elstir, à regarder les paysages, donc à longue échéance à les écrire. Son retour à Balbec, dans Sodome et Gomorrhe, ne répond à aucun des désirs amoureux ou artistiques qui avaient été éveillés lors du premier séjour. Il cherche tout simplement à y rencontrer la femme de chambre de la baronne Putbus, dont Saint-Loup lui a appris qu'elle aimait aussi les femmes. C'est dire que l'enfer de Gomorrhe, qui va le torturer toujours davantage à partir de cet été, s'est d'abord présenté à lui comme un mirage désirable. Il sera, d'une certaine façon, puni par où il a péché. La femme de chambre de la baronne Putbus n'est liée dans son imagination à aucun paysage, ce genre de lien étant même déclaré par lui (p. 151 [1]) toujours décevant. Quant aux plages de Balbec, elles lui paraissent désormais attrayantes parce qu'elles offrent autant d'occasions de rencontre qu'un bal, et la digue est à ses yeux un lieu chic au même titre que l'hôtel de la princesse de Guermantes. Sodome et Gomorrhe, épisode du vice et de la mondanité qui éloigne (en apparence) le héros de sa quête artistique : ce détour répondait à un choix délibéré.
Si le héros n'éprouve pas, de toute façon, le besoin de retourner à Balbec pour y chercher des paysages, c'est peut-être qu'il croit les avoir trouvés auparavant à Paris, bénéficiant de ces journées et soirées de chaleur qui s'échelonnent dans le premier chapitre de Sodome et Gomorrhe II, à partir de la réception chez la princesse de Guermantes, et même dès Sodome et Gomorrhe I, quand la rencontre triviale de Charlus et de Jupien lui a ouvert, par la grâce de l'histoire naturelle et de l'esthétique, des horizons insoupçonnés, changeant la répugnante méduse de Balbec en une « merveilleuse girandole d'azur » (p. 28), comparaison empruntée à Michelet et déjà présente dans un texte abandonné des Plaisirs et les jours (« Avant la nuit ») pour que le dégoût moral et peut-être physique inspiré par l'inversion ait une chance d'être sublimé. Ainsi, dès Sodome et Gomorrhe I, la mer s'embellit-elle de « mauves orchidées », fleurs du mal dont la beauté absout un vice que le héros ne trouvera intolérable que lorsqu'il mettra sa propre quiétude en péril. Quant à l'appel à l' « antique Orient » (p. 31) suscité par l'évocation de l'hermaphroditisme, il semble qu'il soit entendu au début de Sodome et Gomorrhe II quand le héros admire, juste avant de pénétrer dans l'hôtel de Guermantes, le nougat rose de l'obélisque de Louqsor et le quartier d'orange dessiné par la lune (p. 34). Les tapisseries des salons qu'il fréquentera durant cet été, sur lequel va s'enchaîner suivant une inexplicable chronologie le printemps à Balbec, suffisent à le transporter « dans le palais non de la Seine mais de Neptune, au bord du fleuve Océan » (p. 139), expression conforme à l'origine mythologique de l'Océan (fleuve qui entoure la terre), mais qui ici a surtout l'avantage de fondre dans un même tableau le paysage parisien et celui de Balbec. Ces impressions poétiques procurées par les tapisseries, le narrateur ne les fera entrer que plus tard en ligne de compte dans ses jugements sur les salons, mais elles augmentent d'ores et déjà le bien-être artistique du héros.
Qu'il ne puisse se contenter d'unir Albertine à un paysage, il l'éprouve déjà à Paris. Comme si l'inquiétude ou la lucidité constituaient un devoir, du moment où se révèle l'attitude fuyante de la jeune fille, il tente d'unir à la « fleur rose » qui se détachait sur la « mer mauve » de septembre (p. 130) l'être plus abstrait et pourtant tellement obsédant qu'il n'a cessé de chercher depuis ce soir où, à Combray, il s'est trouvé séparé de sa mère. C'est bien cette jeune fille nourricière plutôt que la silhouette de la digue qui prend forme quand, aspirant à la fraîcheur en cette période d'intense chaleur, il partage avec elle des oranges pressées dans de l'eau, « jeux d'arrosage » dont la mésaventure de Mme d'Arpajon a offert une version cocasse, mais qui cette fois désigne le bienfaisant mûrissement d'un fruit, métaphore de la jeune fille qui déguste ce fruit en sa compagnie. « Je ne pouvais l'accuser de sécheresse », écrit Proust (p. 136), désignant cette fois Albertine plutôt que le fruit. En vertu d'une sorte de va-et-vient, c'est la « fraîcheur » des vagues qui, au début du second séjour à Balbec, donne au héros le désir d'Albertine. Le « concert symphonique mêlé au clapotement de l'eau, dans lequel les violons vibraient comme un essaim d'abeilles égaré sur la mer » (p. 176) fait écho au concert qui, à la fin du premier séjour à Balbec (dernière page d'A l'ombre des jeunes filles en fleurs), avait mêlé les « traits du violon » aux « volutes de cristal » de la mer, moment exceptionnellement heureux où avaient fusionné avec un sentiment encore serein la musique et les éléments naturels. Mais ce moment que le héros cherche à revivre est cette fois aussitôt brisé par la mauvaise humeur d'Albertine. Si la jeune fille est enfin associée à l'élément marin, c'est, plus loin encore de l'atmosphère heureuse du premier séjour, quand elle déclare solennellement : « La mer sera mon tombeau » (p. 197), anticipation sur la tragédie réellement vécue par Proust plutôt que sur la fin du personnage d'Albertine. Il peut être signifiant que le héros ait auparavant envoyé Albertine à une représentation de Phèdre, qui s'achève par la mort d'Hippolyte lui-même englouti par les flots, surtout si on se rappelle que, suivant une tradition, Proust a dans ses brouillons donné au fils de Thésée une nature équivoque : parmi les « servants » de l'hôtel, « l'un, élancé dans sa haute taille, et élevant au-dessus de son habit noir un visage coloré de la même pudeur que celui d'Hippolyte, avait l'air d'un arbuste rose. Il eût peut-être pu plaire à M. de Charlus [2]. » Le héros a-t-il voulu qu'Albertine comprenne quelle fin tragique était réservée à ceux qui pèchent par l'inversion ?
*
L'artiste d'une part, le névropathe tourmenté par des désirs égoïstes d'autre part, sont au début de Sodome et Gomorrhe radicalement séparés. Le premier peut poétiser grâce à la beauté des traditions religieuses ou mythologiques de l'Orient, ou encore grâce à l'histoire naturelle, les mondes de Sodome et de Gomorrhe du moment qu'il les explore avec l'imagination d'un esthète ou la curiosité du botaniste - le désir sensuel alimenté par l'impudique femme de chambre n'étant quant à lui nullement cause de tourments. Le second intériorise la figure d'Albertine, il s'ingénie à la séparer de ce qui l'auréolerait de poésie afin de consommer seulement sa fraîcheur. Bientôt, le téléphone va dessiner autour d'elle un paysage terrifiant parce qu'il est impossible d'en cerner les contours : hérissé de « fortifications de campagne » (p. 131), ce paysage livré à la pure imagination, loin de se prêter à la rêverie du promeneur, promet d'incessantes embuscades. Le héros ignore pourtant, à ce stade, qu'il va devoir explorer comme un enfer ce territoire de Gomorrhe qu'il avait insouciamment poétisé tant qu'il le croyait étranger à ses intérêts. Encore moins soupçonne-t-il qu'un jour - mais tout au bout du chemin, quand il aura fait son deuil d'Albertine - il sera en mesure de le poétiser à nouveau, non plus seulement à l'aide de mythes empruntés à l'Orient ou des beautés de l'histoire naturelle, mais grâce à son expérience d'artiste, capable de faire du monde de Neptune la métaphore de son besoin de fraîcheur et de fusionner les « mauves orchidées de la mer » qui l'ont enchanté avec les « vierges en fleurs » qui lui ont infligé les pires tourments.
Concurrencés par la recherche d'un plaisir tout sensuel et par l'inquiétude amoureuse, les paysages sont aussi dans Sodome et Gomorrhe menacés par la douleur. Arrivé à Balbec, le héros y trouve le visage bouleversant de la grand-mère. A peine s'est ébauchée la fusion entre les deux côtés (d'une part la mer, d'autre part les paysages agrestes aperçus jadis de la voiture de Mme de Villeparisis), permettant au héros de voir une « mer rurale » (p. 179), que le souvenir de la grand-mère retarde le moment où pourra s'épanouir la leçon donnée par les tableaux d'Elstir. Prenant aussitôt après cette découverte le petit train pour rejoindre Albertine, le héros va baisser le store de son compartiment (p. 181) en raison de la chaleur (bizarrement étouffante en ce printemps), mais, dirait-on, comme pour que cette ignorance du paysage qui défile lui permette de se retrouver en tête-à-tête avec celle qui veillait sur lui lors de son premier voyage en train. Pourtant, quelques pages auparavant, la figure de la grand-mère a, mieux que celle d'Albertine, permis que s'ébauche un paysage où se réalise une fusion de l'émotion morale et de la sensation poétique. Les pommiers qu'il avait aperçus sans leurs fleurs, au coeur de l'été, en compagnie de la grand-mère et de Mme de Villeparisis, resplendissent désormais dans un tableau auquel son fond d'estampe japonaise garantit une valeur artistique. Les flaques d'eau dans lesquelles ils baignent évoquent explicitement la maladresse de la grand-mère « qui jadis ne pouvait marcher deux pas sans se crotter » (p. 177), mais aussi le plaisir avec lequel elle a toujours accueilli la pluie. Subitement, sur ce paysage en gloire, s'abat une pluie qui semble la ressusciter. A l'averse qui « fouettait » son visage quand elle arpentait hardiment le jardin de Combray répondent dans Sodome et Gomorrhe les rayons de pluie qui « zèbrent » l'horizon. « C'était une journée de printemps », écrit Proust pour clore le chapitre I de l'épisode. Cette phrase finale n'a pas la valeur d'une simple explication météorologique : elle signifie la « reverdie » et renvoie à l'« enchantement du Vendredi saint ». Au risque de mettre la chronologie du récit en péril, le printemps sert de décor à la plupart des moments-clés de la Recherche. C'est au printemps que se situera le moment décisif du Temps retrouvé : la matinée de la princesse de Guermantes. On aura noté, en outre, combien reviennent en force dans tout ce début de Sodome et Gomorrhe les souvenirs de Combray, jusque dans ces « paysages » qu'évoquent dans la mémoire du héros les façons de parler, proches et pourtant différentes, de Françoise et de sa mère (p. 126). Bientôt se fera même entendre « l'appel des aubépines » (p. 182), retour à l'enfance auquel le héros refuse toutefois de répondre.
*
Cette difficulté d'unir le paysage et l'être aimé, levée seulement, de façon fugitive, par le sombre pressentiment de la fin d'Albertine et par une amorce de « reverdie » qui longtemps demeurera sans suite, se traduit par des formes d'expression qui semblent laisser le narrateur lui-même insatisfait. « Elles ont » (dit le héros à Mme de Cambremer à propos des mouettes sur la mer) « une immobilité et une blancheur de nymphéas », précisant qu'il parle ici à la manière de Legrandin « à cause du niveau de simple médium' où nous abaisse la conversation mondaine » (p. 203). Proust reprend en fait ici un développement initialement prévu pour le premier état de Du côté de chez Swann d'abord, pour A l'ombre des jeunes filles en fleurs ensuite, et abandonné, comme si les « chutes » de ses passages poétiques étaient jugées assez bonnes pour être réutilisées du moment qu'il s'agit d'un langage de mondains[3]. Mais posons ici une question irrespectueuse : si le héros parlait sans jouer au mondain, ferait-il tellement mieux ? Que les fleurs et les oiseaux échangent leurs qualités ébauche une métaphore qui n'est pas déshonorante. La référence à Monet vaut toujours mieux qu'une référence à Le Sidaner, que l'avocat des Cambremer place au pinacle, et le héros n'aura pas besoin de s'inventer un snobisme de mondain pour constater un peu plus loin que, devenues jaunes, les mouettes renvoient à une autre série de nymphéas. C'est du reste avec spontanéité qu'il change ses idées sur la plage de Balbec du moment que Mme de Cambremer emploie l'expression « vue de mer ». Qu'un artiste n'ait pas, devant un paysage, les moyens d'élever beaucoup plus haut son inspiration qu'un mondain, on en aura mieux encore le soupçon quand le héros (et peut-être le narrateur) rendra hommage aux hôtes de La Raspelière, M. et Mme Verdurin. Il est vrai que c'est à leur fortune plus encore qu'à leur goût que les Verdurin doivent d'habiter cette maison d'où on a le privilège de voir les deux côtés : celui de la mer et celui de la campagne. Le héros s'émerveille, en se rendant chez eux, de ces perspectives vertigineuses que ne lui avaient donné à voir ni ses promenades à Rivebelle, ni ses visites à l'atelier d'Elstir. Peut-être les mondains ne méritent-ils pas d'hommages personnels si on écoute chez eux de la belle musique ou s'ils nous permettent, en nous invitant dans leur maison, de découvrir de nouveaux paysages. Grâces leur soient quand même rendues de l'avoir permis. Il y a plus. La prétention des Verdurin « de contraindre les paysages à faire partie du petit clan, n'était pas du reste aussi absurde qu'elle semble au premier abord », déclare celui qu'il faut bien appeler ici le narrateur (p. 387). C'est en vrais connaisseurs qu'ils font admirer à leurs visiteurs des recoins, des points de vue que ceux-ci n'auraient jamais repérés sans eux. Le « charme du cadre » rejaillit aux yeux du héros « sur la qualité des visiteurs » (p. 389). Les jeunes filles ressemblent au pays, qui ressemble aux jeunes filles : ainsi s'est éclairé de poésie le premier séjour à Balbec. Les mondains désormais ressemblent au pays, qui leur ressemble et les rehausse de sa beauté. Quelle chute ! Sodome et Gomorrhe est décidément l'épisode de la mondanité. On croirait le héros, à ce stade de l'ouvrage, parti pour écrire un roman (s'il l'écrit un jour) qui comblera d'aise Mme de Cambremer.
*
Au delà des dangers où se trouve exposé un jeune homme réduit à une admiration mondaine du paysage se pose la question plus fondamentale de l'écriture de beautés qu'il a appris à découvrir grâce à l'art d'un peintre. La découverte de la « mer rurale », réalisée grâce à la leçon d'Elstir, suscite dans Sodome et Gomorrhe une description intéressante tendant à montrer comment le héros a appris à voir un spectacle à la fois naturel et peuplé sans être influencé par une intelligence qui en dissocierait d'avance et raisonnablement les éléments (p. 180). Cette page est toutefois beaucoup moins riche que la description du Port de Carquethuit peint par Elstir (deuxième partie d'A l'ombre des jeunes filles en fleurs). Quand Proust rendait compte jusque dans le détail du tableau d'Elstir, il s'agissait de peinture ; la leçon du peintre ayant été assimilée par l'apprenti écrivain, il s'agit désormais de littérature. En conclura-t-on à la supériorité de la peinture sur la description littéraire ? La déduction serait naïve puisque, le tableau du Port de Carquethuit n'ayant jamais existé (et eût-il même existé), l'ekphrasis à laquelle procédait Proust relevait purement de la littérature. Faut-il admettre que le premier exercice auquel il s'est livré contenait le meilleur de son talent, au point que le second ne peut en être qu'une plus faible réplique ? Ou que dans ce creux que paraît connaître son parcours d'artiste lors de l'épisode de Sodome et Gomorrhe, il met, si j'ose en dire, en veilleuse le talent naissant du héros reflété par l'écriture du narrateur ? Au reste, qu'on signale mieux une vocation de peintre qu'une vocation d'écrivain par son goût des paysages, c'est ce que semble attester dans Sodome et Gomorrhe une réflexion de la princesse Sherbatoff qui, lorsque le héros lui parle avec émotion des paysages qu'ils ont traversé, lui dit « qu'elle voyait qu'[il était] doué pour la peinture, qu'[il devrait] dessiner, qu'elle était surprise qu'on ne [lui] l'eût pas encore dit » (p. 291). Ce sont les mots utilisés par le héros qui convainquent la princesse Sherbatoff de sa vocation artistique. Pourquoi ne pas lui prédire un avenir d'écrivain plutôt que de peintre ?
A la dernière page de Sodome et Gomorrhe s'inscrit, comme dans Du côté de chez Swann et A l'ombre des jeunes filles en fleurs, un paysage. C'est à une convention que Proust cède, dirait-on, puisque dans les deux premières sections de la Recherche, il a procédé à un déplacement de pages écrites ailleurs pour terminer ses volumes comme en beauté. Il procède de même à la fin de Sodome et Gomorrhe en réutilisant, pour décrire le lever du soleil à Balbec, des lignes prévues initialement (et présentes jusque sur les placards Grasset) pour le lever du soleil aperçu lors du trajet en train qui menait pour la première fois le héros à Balbec. Une différence : les bateaux qu'il avait, à l'occasion de ce voyage, imaginés voguant sur une rivière peuvent ici naviguer sur la mer. Déjà était indiquée, dans le texte prévu pour A l'ombre des jeunes filles en fleurs, la pauvreté d'un paysage de lever du soleil qui n'est pas, comme le coucher, enrichi des heures du jour qui a passé et on s'éloignait déjà du lever de soleil baudelairien du « Balcon » (« Comme montent au ciel les soleils rajeunis/ Après s'être lavés au fond des mers profondes »). Ces levers de soleil auxquels le héros est peu sensible étaient accordés aux goûts de la grand-mère, à qui un idéal hygiénique commandait de se lever tôt et qui verrait sans doute d'un oeil navré son petit-fils s'avancer dans une carrière d'écrivain en se couchant toujours plus tard. Mais, dans le train du premier voyage vers Balbec, l'illumination apportée au paysage par l'apparition de la vendeuse de café au lait rendait peu adaptées à la situation ces notations négatives. A la fin de Sodome et Gomorrhe, la scène peut être donnée, comme dans le texte initial, pour « imaginaire, grelottante et déserte ». « Grelottante » renvoie à un autre lever de soleil baudelairien, moins riche en harmoniques celui-là, celui du « Crépuscule du matin ». Mais l'adjectif « imaginaire » convient mieux encore à la situation de la fin de Sodome et Gomorhhe.. C'est à une « vue peinte », comme superposée à un paysage réel, qu'est en effet comparé ici le spectacle du soleil levant. Au désir de la « fleur rose » se détachant sur la « mer mauve de septembre » tentait de s'unir, au premier chapitre de Sodome et Gomorrhe II, une figure douloureuse évoquée par le souvenir de la mère à Combray. Cette union à peine ébauchée est réalisée, à la fin de l'épisode, au delà de ce qu'avait imaginé le héros. Le paysage en effet n'est plus qu'un double décoloré d'un autre tableau surgi de l'univers de Combray, plus douloureux en la circonstance que celui du baiser refusé : le tableau que le jeune homme avait vu s'inscrire, sans en comprendre la signification, dans la fenêtre de la fille de Mlle Vinteuil à Montjouvain. A la différence des deux premiers volumes, auxquels les paysages donnaient une teinte nostalgique (pour Du côté de chez Swann) ou heureuse (pour A l'ombre des jeunes filles en fleurs), Sodome et Gomorrhe, même s'y inscrite au début de la dernière page une « vue de mer », s'achève sur une interrogation douloureuse qui ravale la poésie des éléments à un décor artificiel.
Dans Le Temps retrouvé, le narrateur récapitule les paysages qu'il a connus au long de sa vie. Cette récapitulation soulève la même question que celle d'autres sujets touchant son existence : faut-il admettre que la poésie inscrite dans les descriptions du dernier volume fournit quelques aperçus d'un style dont le narrateur va exploiter les trésors dans un « livre » donné à imaginer au lecteur, sans que nous sachions exactement en quoi il consiste ? Ou que A la recherche du temps perdu, superposant au long de ses trois mille pages à l'expérience du « temps perdu » celle du « temps retrouvé », nous a livré au fur et à mesure les beautés de cette expérience créatrice au seuil de laquelle le romancier nous conduit enfin ? S'agissant des paysages au moins, le texte du Temps retrouvé incline vers la première hypothèse : « Et au passage je remarquais qu'il y aurait là, dans l'oeuvre d'art que je me sentais prêt déjà, sans m'y être consciemment résolu, à entreprendre, de grandes difficultés. Car j'en devrais exécuter les parties successives dans une matière en quelque sorte différente, et qui serait bien différente de celle qui conviendrait aux souvenirs de matins au bord de la mer ou d'après-midi à Venise, si je voulais peindre ces soirs de Rivebelle où, dans la salle à manger ouverte sur le jardin, la chaleur commençait à se décomposer, à retomber, à déposer, où une dernière lueur éclairait encore les roses sur les murs du restaurant tandis que les dernières aquarelles du jour étaient encore visibles au ciel, - dans une matière distincte, nouvelle, d'une transparence, d'une sonorité spéciales, compacte, fraîchissante et rose [4]. » La poésie n'est ici qu'allusive, elle renvoie le lecteur qui veut prendre idée de la beauté des paysages de Balbec aux moments du roman où le héros les contemplait directement, mais en les éclairant grâce à la formule de l'art exposée par le romancier. Mais c'est au premier séjour que nous sommes ici renvoyés (celui des dîners à Rivebelle), nullement au second. Les promenades avec Albertine et les visites à La Raspelière n'ont en effet offert que de maigres prolongements aux leçons d'Elstir. Sodome et Gomorrhe ont dessiné dans l'esprit et l'imagination du héros des paysages presque édéniques pour le premier, bientôt infernaux pour le second, reléguant - pour un temps - à l'arrière-plan les beautés naturelles qu'il avait appris à admirer.
[1] Sauf indication contraire, les indications de pages renvoient à l'édition de Sodome et Gomorrhe donnée par Antoine Compagnon dans A la recherche du temps perdu, édition de Jean-Yves Tadié, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, t. III, 1988 (même numérotation dans le volume de la collection « Folio »).
[2] Variante de la page 375 de Sodome et Gomorrhe, édit. citée (Pléiade), p. 1560. Voir le commentaire de ce passage dans Antoine Compagnon, Proust entre deux siècles, Editions du Seuil, 1989, p. 77-78. Rendons ici hommage au film de Chantal Ackermann, La Captive, dont le dénouement (Albertine engloutie dans la mer) est fidèle à cette direction indiquée dans le roman. La jeune fille, tel Hippolyte, punie par Neptune à la suite d'un injuste soupçon ?
[3] Voir A la recherche du temps perdu, édit. citée ( Pléiade), t. II, var. b de la page 160.
[4] A la recherche du temps perdu, édit. citée (Pléiade), t. IV, p. 449.
