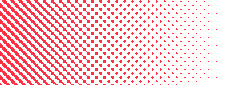1Dans la biographie de Jacques Derrida qu’il vient de faire paraître, Benoît Peeters relate une anecdote qu’il tient de la femme du philosophe : « Marguerite raconte qu’un jour […], alors qu’elle était plongée dans Splendeurs et misères des courtisanes, Jacques a regardé ce qu’elle lisait avant de lui lancer : “Eh bien, toi, tu as vraiment toute la vie devant toi !”1. »
2Une simple anecdote, je l’ai dit. Une conversation ordinaire dans une maison de vacances entre un philosophe et sa femme, que j’ai glanée au hasard de mes lectures d’un jour. Et pourtant, cet échange anodin a pris pour moi les dehors d’une véritable trouvaille : si l’on dépersonnalise les rôles, en identifiant les protagonistes au prénom près (« Emma » au lieu de « Marguerite », par exemple), une scène depuis longtemps familière se joue devant nous ; et si l’on s’interroge sur cette expression (« eh bien, toi, tu as vraiment toute la vie devant toi ! »), les situationsoù son usage pourrait faire sens se dessinent progressivement et amorcent une réflexion déroutante sur ce qu’on peut dire et penser des rapports entre la lecture savante et la lecture ordinaire.
La tentation de la paresse
3La première de ces situations campe une femme lisant un long roman balzacien, d’abord paru en feuilletons, et un philosophe célèbre qui consacre ses « vacances » à tout ce qu’il n’a pas eu le temps de finir ou de préparer. « La vie devant soi », c’est le luxe d’une paresse au fil des épisodes romanesques, l’horizon d’une lecture si peu préoccupée d’arriver au dénouement, et donc à ce point où l’œuvre s’offre tout entière à l’interprétation, qu’elle papillonne en-deçà de toute saisie d’ensemble, dans un pittoresque du détail et de la péripétie s’accommodant facilement d’interruptions fréquentes (déplacer le parasol, lever les yeux au son des grillons, relire un passage en riant, boire un verre, etc.) « Avoir la vie devant soi » signifie que l’on s’immerge dans une temporalité sans épreuves d’aucune sorte : on ne nous demandera pas de commenter le texte, ni d’en inférer quoi que ce soit. Mais le philosophe l’entend ici comme un doux reproche, où se mêle une envie sourde qu’il avait d’ailleurs confiée dans un entretien paru en 1983 :
Depuis assez longtemps, je ressens comme un vrai malheur le fait de pouvoir de moins en moins lire sans que cette lecture soit traversée par un projet d’écriture, lecture sélective, criblante, préoccupée, préoccupante. Quand je lis c’est par brèves secousses et le plus souvent en train d’écrire, de greffer l’écriture sur ce que je lis. Mais la lecture accueillante à grands flots, je m’en sens de plus en plus privé. C’est une vraie privation2.
4Voilà sans doute pourquoi sa femme prend la peine de rapporter le fait au biographe : je lisais autrement que lui, certes, mais sa manière de me le rappeler ne témoignait-elle pas aussi, de sa part, d’une fatigue ou d’une frustration de ne pouvoir jamais s’abandonner sans devoir conclure ? N’avais-je pas, moi aussi, mes raisons de ne pas lire comme lui ?
Le Grand Partage des lectures
5Il existe une deuxième situation où l’usage d’une expression telle que : « Eh bien, toi, tu as vraiment toute la vie devant toi ! » fait sens. Mais il faut, pour la brosser, donner la parole au philosophe. C’est le parti pris spontané du biographe. Si donc Derrida ne se donnait pas une « vie devant soi » lorsqu’il lisait, que faisait-il au juste ? Benoît Peeters cite, après avoir rapporté l’anecdote de Marguerite, certains des textes qui permettent de mieux comprendre la réaction du philosophe face à Splendeurs et misères des courtisanes. Et notamment ce passage d’un entretien que celui-ci a accordé en 2001 :
Je lis avec un projet en tête. Je lis rarement de manière désintéressée […], donc je lis de façon active, sélective, trop sélective, pas assez passive. […]
Je lis d’une façon très impatiente, très rapide, et cette impatience sélective me coûte cher : probablement beaucoup d’injustices, de négligences. Mais très souvent, en ouvrant un livre par le milieu, cette impatience m’a jeté vers ce que je cherchais, ou que je ne savais pas que je cherchais et que je trouvais. […]
Je m’aperçois que c’est en écrivant sur un texte littéraire que je commence à le lire et que ma première lecture, faite de lueurs intermittentes, est très lacunaire. […] Au fond, c’est l’enseignement qui me fait lire3.
6On trouve ici une opposition entre une lecture intéressée, rapide, peu soucieuse de l’ordre des textes (puisqu’elle ouvre les livres « par le milieu ») et une lecture « passive », « patiente », « lente », « juste », qui n’est ni sélective, ni lacunaire ; entre une lecture professionnelle, contrainte par le calendrier d’une recherche en cours ou d’un enseignement et la pratique oisive d’un lecteur – ou, mieux encore, d’une lectrice – qu’une « première lecture » satisfait pleinement ; entre une lecture qui trouve ce qu’elle ne savait pas chercher et une lecture qui, peut-être, ne cherche rien – ou ne retrouve que ce qu’elle sait déjà ; entre une lecture, enfin, qui est avant tout une écriture sur ce qui doit être lu et une lecture qui n’opère pas sur un texte, mais dans un autre rapport au texte : pouvons-nous dire qu’elle opère alors sous le texte (comme l’animal qui se rend à son congénère dominant en se couchant sur le dos, dans la position la plus vulnérable qui soit – ou comme la femme se couche sous l’homme qui l’ouvre alors « par le milieu ») ? Devons-nous dire qu’elle opère dans le texte (à la faveur d’une immersion sans limite dans l’univers fictionnel et jusqu’au désordre pathologique de l’imagination) ? Autrement dit, il y a d’un côté, si l’on en croit Derrida, une lecture de conquête et de connaissance, une lecture injuste mais productive, et de l’autre une lecture de soumission et de reconnaissance, qui est tout aussi charitable que tautologique.
7Derrida fragilise néanmoins cette dichotomie par endroits. Il ne se défend pas complètement d’être parfois injuste, ce qui laisse entendre que la manière de lire qu’il ne privilégie pas présente néanmoins, à ses yeux, des avantages spécifiques. Cette autre forme de lecture dont il reconnaît l’importance, sans la mettre en œuvre lui-même, répond donc à des valeurs de justice à l’égard des textes. Une justice qui condamne les négligences, les intermittences de l’attention au texte, les examens partiels. C’est la justice de l’exhaustivité. Mais cette idée régulatrice à laquelle Derrida concède quelques scrupules ne se confond pas pour autant avec ce qu’il appelle par ailleurs la « première lecture » : cette dernière, en effet, s’effiloche en « lueurs intermittentes ». On n’a même pas « commencé à lire », précise-t-il, quand on lit une seule fois ; on ne lit vraiment que lorsqu’on relit. Derrida se plie donc, en rechignant un peu, à la norme de l’exhaustivité, mais il se refuse à comparer sa pratique de lecteur à quelque « première lecture » que ce soit. Mieux vaut le fétichisme philologique que la naïveté subjuguée.
8Cette anecdote fournit, dans un tel contexte d’élucidation, un exemple parmi d’autres du Grand Partage des lectures : la lecture savante contre la lecture ordinaire ; le dévoilement contre la duperie ; la saisie contre la passivité ; la pénétration virile contre l’accueil féminin… Spectres de Cervantès, en l’occurrence, ou de Fénelon (celui de l’Éducationdes filles), ou de Stendhal, ou de Balzac, ou de Flaubert. Autant de traces indélébiles des craintes qui ont ponctué l’histoire de la discipline imposée à l’expérience esthétique par l’Église, l’École ou la bienséance, lorsque les femmes, les enfants ou les pauvres se sont mis à lire – et l’on pourrait ajouter, dans ce même ordre de craintes : lorsqu’ils se sont mis à regarder les représentations picturales du Christ d’un peu trop près, depuis cette distance où le spectacle de la chair meurtrie par les clous et les coups de lance en appelait aux sens davantage qu’à l’âme (je pense au travail sur le détail de Daniel Arasse4) ou encore, plus récemment, lorsqu’ils se sont mis à aller au cinéma et à s’adonner aux jeux vidéo.
9Derrida module pourtant ce lieu commun. Le Grand Partage qu’il tient ici pour évident ne distingue pas un savoir issu d’une « vraie » lecture et une pure ignorance, un bon usage et une dérive. Le philosophe oppose une intuition modelée par sa profession – celle-là même qui l’entraîne à trouver, dans un geste d’impatience, ce qu’il ne cherche pas vraiment – à un désintéressement docile et amorphe.
10Ce que Derrida nous donne à comprendre, dans son usage semi-réflexif d’un poncif aux implications tout sauf anodines, c’est que la « première lecture » est le plus souvent décrite ou définie dans un geste qui légitime en retour une autre pratique de lecture. Ou, pour le dire autrement, que la lecture ordinaire n’est souvent qu’un repoussoir commode ou stratégique de la lecture savante. La force de Derrida, cependant, consiste à reformuler ce hiatus entre lecture ordinaire et lecture savante de façon à ce qu’il apparaisse pour ce qu’il est : non pas le dépassement d’une illusion pernicieuse dont serait victime sa femme Marguerite (l’« illusion référentielle », par exemple), mais le troc d’une sélection ou d’une manipulation contre une autre et, plus encore, d’une habitude contre une autre. Le Grand Partage se nuance alors jusqu’à dessiner dans ses variations une sorte de polymorphisme indomptable de la lecture5, d’où émerge l’idée que la lecture savante n’est pas meilleure, mais autre chose que la lecture ordinaire.
Je lis, donc je dure
11L’adresse familière de Derrida à une lectrice de Balzac fait sens dans une troisième situation, où l’attention se porterait sur Marguerite plutôt que sur Jacques, sur l’épouse plutôt que sur le philosophe célèbre, sur la femme discrète plutôt que sur l’homme public. « Avoir toute la vie devant soi », si c’est ce que prodigue un roman balzacien lu en privé, sans aucun projet d’en partager une interprétation argumentée, n’est pas sans conséquence. Cela signifie que l’immersion dans l’œuvre romanesque, l’adhésion aux règles de son univers, affectent chez le lecteur son rapport au temps ; ou plutôt, qu’elles instituent une autre échelle temporelle de subjectivation que les cadres ordinaires de l’expérience biographique. En dépit du vieillissement biologique, et du non moins prégnant vieillissement social jadis signalé par Pierre Bourdieu6, le lecteur happé par Splendeurs et misères des courtisanes se trouve affecté par l’œuvre et par ses propres réactions de lecture sur un autre rythme que celui des âges de la vie, des calendriers sociaux et des urgences collectives. On peut qualifier une telle déprise de sublimation ou de fuite dans la fiction, si l’on défend une exploitation optimale de ce bien temporel fini qu’est l’existence. Mais peut-on dire par exemple de Joseph Czapski et des prisonniers polonais auxquels il parlait de Proust dans le camp de Griazowietz, en 1940-1941, qu’ils gâchaient le peu de jours qu’ils pensaient avoir à vivre en évoquant des souvenirs de lecture ? Auraient-ils dû profiter de ces instants de répit pour creuser des tunnels avec leurs cuillères à soupe ? Il faut chercher dans ces conversations littéraires d’individus presque condamnés une autre rationalité : celle qui vise à l’instauration d’un espace symbolique ouvert par la forme littéraire, à la consolidation d’un for intérieur où puisse s’opérer une ressaisie de soi indépendante des règles les plus terribles de la vie quotidienne. Et ceci vaudrait, pour ainsi dire, comme cas-limite d’une certaine activation des ressources des œuvres littéraires dont on pourrait, dans d’autres circonstances moins tragiques, trouver des variations de plus faible intensité.
12Une autre échelle temporelle de subjectivation que celle de la vie professionnelle, et peut-être un mode de subjectivation qui protège d’une telle pression sociale : c’est la botte secrète d’une lectrice de Splendeurs et misères des courtisanes. « Avoir toute la vie devant soi » permet d’accepter que le temps passe sans qu’on en additionne les marques sous la forme d’une « œuvre » ou d’une « carrière ». Il ne faut pas négliger cette sérénité particulière, faite de retranchement délibéré et d’élargissement intime. On pourrait même y reconnaître une forme de « souci de soi » à l’usage des personnes qui ne peuvent guère accumuler les preuves de leur propre existence dans le cadre de certaines institutions, c’est-à-dire en dehors de celle qu’on leur impose (la maternité, par exemple, et la « chance de voir ses enfants grandir »). « Je lis, donc je dure » – toutes autres temporalités collectives égales par ailleurs.
13À cette division des rapports aux textes littéraires (à toi la « première lecture », à moi la relecture productive) répond une division des formes de reconnaissance sociale (le dévouement de l’épouse ou de la mère ; l’accomplissement du « grand homme »). Cette corrélation n’est pas insignifiante, mais elle ne doit pas non plus être surinterprétée. Le mode de lecture (naïf, savant ; passif, conquérant) n’est pas l’attribut invariant d’une présentation de soi à l’horizon d’un « rôle » social. Ce qu’il faut élucider, me semble-t-il, ce sont les déterminations complexes et réciproques, à la fois matérielles, symboliques et affectives, qui caractérisent un tel ménage de « rôles » et de lectures, de rapports à soi publics et intimes.
14De même qu’une dynamique subtile de dons et de contre-dons s’instaure (ou s’instaurait, il y a de cela une ou deux générations) entre un homme à la carrière fulgurante et son épouse (dédicace émue d’un livre majeur, après que la femme eut pendant des mois, sinon des années, dactylographié le manuscrit de son mari, pointé des passages obscurs, suggéré des arguments et relu les épreuves, pour ne mentionner que ce cas très fréquent), de même peut-on envisager qu’il existe une relation à double sens entre la lecture professionnelle de l’un et la lecture oisive de l’autre. Dans une telle division domestique du « travail émotionnel », dans une telle « économie de la gratitude », pour reprendre deux notions forgées par Arlie R. Hochschild7, l’attention dévouée que l’épouse porte aux activités professionnelles de son mari est la condition de la lecture savante de ce dernier : sans un entourage qui assure l’intendance domestique durant les voyages à l’étranger ou les périodes de travail intense, point d’œuvre discutée à l’échelle internationale ; sans un entourage qui recueille tous les soirs ou presque les doléances, les inquiétudes et les espoirs liés à un environnement de travail, point de relativisation des menus tracas, ni de conseils avisés ou d’objections libératrices… Ce sentiment d’avoir parfois « la vie devant soi » devient une ressource psychique précieuse, lorsque l’on consacre l’essentiel de son existence aux autres et que cette attention portée à autrui (mari, enfants, parents âgés, « amis de la famille » ou voisins) ne laisse chaque jour qu’un court moment de répit. À cet égard, la « première lecture » contribue, dans une mesure qui n’est pas à négliger, au maintien des conditions optimales de la lecture savante de l’autre.
La conjuration du premier degré de la littérature
15Tirons de cet exemple deux conclusions provisoires. Pour autant que l’on redimensionne adéquatement les contextes (non seulement matériels ou symboliques, mais affectifs) de la lecture savante, la lecture ordinaire fait retour : comme désir réprimé, antithèse stratégique ou adjuvant invisible. On comprend dès lors la défiance qu’ont les lecteurs « actifs », ou les relecteurs, pour la « première lecture », et pourquoi cette défiance est d’autant plus forte que l’abandon à l’œuvre est plus tentant. Cette défiance témoigne, plus généralement, d’un soupçon cultivé de longue date à l’égard de ce que l’on pourrait qualifier de premier degré de la littérature8, celui-là même où un texte littéraire fait sens pour un lecteur qui se soumet à ses règles singulières, adopte son cadrage (perceptif, « pathique », cognitif, ou axiologique) de l’expérience – bref, s’essaie au mode de subjectivation qu’il propose. À ce degré de disponibilité aux œuvres, en-deçà de toute attention critique à leurs procédés, ce qui se joue ne peut pas être décrit en termes d’illusion référentielle, d’effetde réel, de piège du récit ou de travail de l’écriture, car cela supposerait d’avoir déjà récusé la légitimité qu’il y aurait à croire à l’univers que nous ouvre le texte. À quoi bon décrire les variantes de cette crédulité, s’est-on longtemps demandé, si elle est précisément ce qui fait écran au sens véritable de l’œuvre ? Mais si elle ne fait plus écran, qu’en dire ?
16Si j’ai pu par ailleurs, dans le sillage de sociologues du care comme Arlie R. Hochschild, prêter une attention quelconque à la femme d’un philosophe célèbre et à son rôle oublié mais crucial dans la carrière de son mari, c’est aussi par tropisme balzacien, en raison de l’effet produit sur moi par Splendeurs et misères des courtisanes, notamment : parce que l’importance donnée par Balzac à ce qu’il considérait comme des « héroïnes injustement méconnues de la société » fait désormais partie des critères à l’aide desquels je déchiffre le monde qui m’entoure (au prénom près, là encore : « Eugénie » au lieu de « Marguerite », par exemple). L’attention au premier degré de la littérature découle de l’expérience même que ce premier degré rend possible.
17Une fois reconnue cette prégnance de la lecture ordinaire, qu’en faire au juste ? Faut-il la définir ? Cela supposerait que les innombrables pratiques (historiques et sociales) diversifiées que l’on désigne par ce terme possèdent des traits communs qui les résumeraient toutes. Et cela signifierait également qu’il existe un ensemble homogène de manières non ordinaires de lire qui s’y opposerait en bloc.
18Or les historiens, suivant en cela la direction indiquée par les travaux de Roger Chartier, ainsi que les sociologues guidés par les enquêtes de Pierre Bourdieu ou de Jean-Claude Passeron – sur la culture des milieux populaires plus particulièrement –, nous ont donné une idée du spectre très disparate des rapports avérés aux œuvres littéraires9. La lecture ordinaire s’y révèle très hétérogène dans ses manifestations, suggérant qu’il y a maintes façons de lire « naïvement ». On peut, dans le cas du roman, s’identifier aux personnages et vibrer pour leurs malheurs ou leurs joies, les prendre pour modèles de conduite ou pour contre-exemples, se dépayser dans l’univers exotique de la fiction, être diverti par une intrigue palpitante, s’instruire au spectacle de ce théâtre exemplaire des travers de l’humanité, etc.
19Si l’on s’intéresse au sort que les études littéraires ont longtemps réservé à la lecture ordinaire, on remarque cependant que cette diversité des lectures « naïves » a le plus souvent été ramenée à la pratique unique d’une sorte d’archilecteur spontané, reconnaissable par défaut à son identification aux personnages, à son adhésion idéologique à toutes les valeurs charriées par le texte et à son intérêt insatiable pour l’histoire. On constate également que les opérations par lesquelles les textes furent transformés en objets de connaissance ont eu pour effet, sinon pour but, d’épargner toute prise en compte du premier degré de la littérature – où se jouent, précisément, l’identification, l’évasion, le divertissement ou la méditation morale.
20Pourquoi en a-t-il été ainsi ? Roland Barthes, dans ses derniers cours au Collège de France, a esquissé une réponse :
J’ai compris […] qu’aujourd’hui, nous (dont je suis parfois) passons notre temps à mettre à notre texte un système complexe de guillemets, en fait visibles de nous seuls, mais dont nous croyons qu’ils vont nous protéger, montrer au lecteur-juge que nous ne sommes pas dupes de nous-mêmes, de ce que nous écrivons, de la littérature, etc. Or, en fait, cette protection ne sert à rien, car, j’en suis persuadé, personne ne lit les guillemets, s’ils ne sont pas marqués noir sur blanc ; il faut se rendre à l’évidence : toutes choses sont lues au premier degré ; la simplicité veut, voudra donc qu’on écrive le plus possible au premier degré10.
21Il s’agit de se protéger. De quelle menace, au juste ? Du risque ou, peut-être plus encore, de la tentation d’être dupe. Et dupe de quoi ? « De nous-mêmes, de ce que nous écrivons, de la littérature ». De nous-mêmes, lorsque nous lisons un texte qui pourrait nous piéger ; de ce que nous écrivons, dont l’intertexte involontaire ou le style nous trahit toujours malgré nous ; de la littérature, parce qu’elle est, pensait-on alors, ce discours du faire-croire, du jeu subtil avec un sens commun (« idées reçues », « stéréotypes », « prénotions »…) dans lequel le lecteur peut malgré lui « tomber » à tout instant. Quant au « etc. » par lequel Barthes finit cet inventaire des craintes d’il y a trente ans, on peut imaginer qu’il irait, dans ses répercussions ultimes, jusqu’à englober une méfiance à l’endroit de tout discours et à l’égard d’autrui (autrui entendu comme celui-là même sans lequel il n’y aurait jamais eu cette possibilité de tromperie).
22Pour aller dans le sens de Rita Felski, à qui l’on doit un lumineux article paru en 2009 dans la revue Profession, et intitulé « After Suspicion11 », lorsque les critiques, après les écrivains, sont à leur tour entrés dans l’ère du soupçon, c’est tout l’investissement spontané dans la littérature qui est devenu louche et suspect. La « nouvelle critique » s’est par conséquent méfiée de ce que Michel Charles appelait en 1985 la « lecture courante », et à laquelle il opposait pour sa part la « lecture savante »12. La « lecture courante » lui paraissait trop individuelle et trop capricieuse pour être le point de départ fiable d’une interrogation savante. Il la condamnait à n’être qu’une pratique trop intime pour être exprimable, et donc trop peu verbalisée pour se laisser appréhender pleinement et devenir un objet de science partagé. Dix ans plus tard, en 1995, Michel Charles avançait un second argument : l’étude des œuvres littéraires n’est pas – ne doit pas être – « le prolongement de l’effet qu’elles ont sur nous », « une description de notre état de lecteur »13.
23Cela allait de soi jusque dans les années 1990 : la science, pensait-on depuis les années 1960 (en se réclamant de la philosophie de Gaston Bachelard), s’instaure dans une « rupture épistémologique » fondatrice, qui la détache radicalement du sens commun. Dans les sciences humaines et sociales, et par conséquent dans les études littéraires, l’« expérience première » de lecture était considérée comme un obstacle à l’élaboration d’une science des textes. Dans un tel imaginaire savant, qui faisait de la découverte scientifique une traversée des illusions, la lecture « courante » ou « naïve » ne pouvait que rester du mauvais côté du miroir : là où l’on croit à ce que le texte dit, au lieu d’interroger le faire-croire de la littérature, là où l’on adhère au contenu de l’œuvre, quand la vérité de celle-ci est dans sa structure ou sa forme, là où l’on se fie aux signifiés, sans entrevoir le travail du signifiant...
24Qu’en est-il aujourd’hui ? La conception de la science comme rupture d’avec le sens commun, d’abord, en est venue à faire problème dans les sciences humaines et sociales. Non pas pour des raisons théoriques, mais parce que cette conception inscrivait la science dans un certain projet de critique sociale et de transformation de la société qui imposait de déposséder les individus de leur double capacité à dire la vérité sur ce qu’ils vivent et à faire eux-mêmes l’histoire. La violence attachée à cette forme de critique est devenue progressivement intolérable. En anthropologie, en sociologie, en histoire, on a fini par se poser cette redoutable question : au nom de quoi, au juste, les chercheurs s’octroient-ils cette autorité exorbitante de parler au nom des autres, et en dénonçant comme « illusion » ce que ces autres pensent de leur propre existence ? La réponse était implicite dans les années 1960-1970 : au nom de la désaliénation des individus, dont on pensait qu’ils devaient être libérés malgré eux d’un pouvoir qui les incitait à la servitude volontaire ; bref, au nom d’une révolution à venir. La « lecture ordinaire », par analogie, participait de l’aliénation des masses, parce qu’elle reposait sur un rapport conservateur au langage (lire pour l’histoire, c’est être indifférent à la subversion de l’écriture) et parce qu’elle exposait les lecteurs à l’idéologie bourgeoise de maintes intrigues romanesques14. La naïveté du lecteur était dangereuse ou coupable.
25À ce premier argument contre le soupçon généralisé, dont on pourrait dire qu’il invite à substituer une « science de la critique » à une « science critique »15, s’en ajoutent d’autres, peut-être plus importants encore lorsqu’il s’agit de la littérature. On peut se demander, en effet, si la justification des études littéraires ne passe pas, aujourd’hui, par la réconciliation de la « lecture savante » et de la « lecture courante ». Et ce, pour plusieurs raisons : parce que l’idée selon laquelle ces deux lectures seraient incompatibles, sinon exclusives, fut le fruit d’une époque où les ambitions de la critique étaient différentes, et où le statut de la littérature à l’école ou à l’université était suffisamment garanti pour qu’un enseignement déconcertant ou subversif, fondé sur une rupture avec le sens commun, n’y soit pas dénoncé, pour son absence de lien avec la « vie courante », par des instances administratives soucieuses de professionnalisation ou des élèves anxieux d’obtenir leur validation. Parce que cet écart entre les deux lectures s’est lentement creusé, sous l’effet d’une sorte de force d’inertie conceptuelle, jusqu’à emprisonner les chercheurs et les enseignants dans un écheveau de notions incapables de rendre compte de leur passion pour la littérature, avec pour conséquence de transformer leur discours professionnel en un psittacisme parfois douloureusement vécu (dit-on jamais pourquoi on travaille parfois sur un écrivain durant vingt ans, au détriment de tous les autres ? et trouverait-on les mots pour le dire, si seulement on le voulait ?). Parce que la lecture « courante » ou « naïve » semble ne pas concerner seulement les autres, mais court-circuiter les clivages du savant et du populaire, du légitime et de l’illégitime, du sérieux et du frivole. Parce qu’enfin ce que les textes « font » à leurs lecteurs se déploie souvent d’abord au premier degré, si bien que l’interprétation des œuvres ne peut pas exclure a priori cette dimension du sens, au motif qu’elle fourmillerait de trompe-l’œil qui entravent l’accès à un second degré (ironique, critique, autotélique…) jugé plus crucial.
26Barthes, cependant, lorsqu’il déclarait que « [l]a chose à ne pas supporter, c’est de refouler le sujet – quels que soient les risques de la subjectivité16 », ne niait bien évidemment pas pour autant la présence d’une dimension méta- (linguistique, esthétique, discursive…) dans nombre d’œuvres, ni même l’importance critique d’en porter au jour les modalités et les enjeux. Ce qui semblait le préoccuper avant tout, avait trait à l’articulationthéorique du premier et du second degrés :
Noter : il y a de l’Ironie, du Métalinguistique dans La Recherche du temps perdu ; le narrateur raconte l’œuvre en train de ne pas se faire, et, ce faisant, il la fait ; mais, à vrai dire, ce dessin n’est pas lu au lecteur, qui consomme La Recherche au premier degré, c’est-à-dire au degré référentiel17.
27À condition que l’on ne reste pas cantonné dans une conception exclusivement référentielle du premier degré, il y a là une intuition qui mériterait d’être suivie jusque dans ses ultimes conséquences. Cela impliquerait de réfléchir au premier degré de la littérature autrement qu’on ne l’a souvent fait depuis ; ou, mieux encore, de redescendre du second degré de la littérature, où les catégories usuelles des études littéraires nous maintiennent souvent, à un premier degré appréhendé non pas tant comme l’état de nature inchoatif du sens, ou comme son âge d’or irréfléchi (dont nous séparerait la « chute » dans le discours critique) que comme une strate d’effets esthétiques trop souvent négligée.
Le retour à l’ordinaire
28Si l’on cherche à sortir de l’« ère du soupçon », quel genre de confiance nos recherches peuvent-elles accorder à la lecture ordinaire ? Ou, pour le dire autrement, peut-on attendre de l’élucidation de ce qu’est la lecture ordinaire une connaissance renouvelée de la littérature ? Et comment procéderons-nous à cette élucidation ?
29Deux pistes sont d’ores et déjà envisageables.
30La première nous conduit à théoriser ce que peut être l’expérience de lecture à partir de cas avérés– qu’il s’agisse de notre propre lecture ou de celle des autres. Comment un texte peut-il affecter son lecteur ? Et puisque ces manières d’être affecté s’avèrent parfois cruciales pour les individus concernés, comment les décrire autrement qu’en termes d’illusion, de duperie et de naïveté ? Qu’est-ce que cela suppose en outre de remettre en question dans nos routines d’interprétation ?
31Hélène Merlin Kajman s’est livrée à un tel exercice dans un article sur Le Comte de Monte Cristo18. Partant d’une anecdote personnelle vieille de vingt ans, qu’elle transforme en « cas » problématique et fortement théorisé, elle y développe l’idée que toute contextualisation historique d’une œuvre littéraire méconnaît cette « zone confondante et hypnotique » dans laquelle elle est elle-même entrée jadis en lisant ce roman de Dumas. Plus encore, cette expérience de fascination irrépressible l’a orientée vers la conceptualisation d’un « état d’apesanteur imaginaire », d’un « sentiment océanique » proprement anhistorique auxquels la littérature nous fait, selon elle, parfois accéder– à condition, bien sûr, que l’on se laisse en quelque sorte happer par l’œuvre.
32Marielle Macé, pour sa part, dans ses derniers travaux, et notamment dans l’ouvrage qu’elle vient de publier19, réfléchit d’abord sur la lecture des autres : comment Roland Barthes, Jean-Paul Sartre, Pierre Bourdieu et Pierre Pachet ont-ils été affectés par certaines œuvres, jusqu’à s’en approprier les lignes de force dans leurs « manières d’être » ? Une telle approche phénoménologique de la lecture, au lieu de souligner le « sentiment océanique » de dilution des identités, met l’accent sur cette « stylistique de l’existence » par laquelle tout lecteur se façonne une singularité toujours fragile. Le premier degré de la littérature, cette fois-ci, comme arène intime d’une « individuation ».
33Les propositions les plus récentes de Marielle Macé ont cependant un degré de généralité qui les détache progressivement des cas particuliers sur lesquels sa réflexion s’appuie. On y distingue un projet d’envergure, dont la matrice a désormais trouvé sa formulation et appelle de nouvelles mises à l’épreuve. De ce travail délicat sur des lectures singulières émerge ainsi une véritable pensée de la littérature.
34C’est la seconde piste : produire une théorisation de la littérature qui fasse d’emblée la part belle au premier degré de la littérature. Les tentatives qui vont dans ce sens se sont multipliées. Il est cependant difficile de leur trouver autre chose qu’une ressemblance de famille malaisément définissable.
35Parler à cet égard de « tournant pragmatique » aurait des avantages certains. Cette dénomination imprécise et exagérément accueillante permettrait d’embrigader sous une même bannière toutes les recherches qui ont tenté, depuis une quinzaine d’années, de dégager l’étude de la littérature de tout représentationalisme, en restituant les contextes dans lesquels des textes agissent ou ont agi sur leurs lecteurs, leurs auditeurs ou leurs auteurs, dans le cadre de polémiques, de performances ou de luttes pour l’établissement de cadres collectifs de l’expérience20. Le plus petit dénominateur commun en serait l’idée que le texte littéraire n’est plus une re-présentation plus ou moins réussie de ce qui est ou de ce qui fut, mais la présentation d’une réalité qui ne préexiste pas à l’œuvre, et qui a pu ou pourrait, au gré des circonstances, advenir (du fait de la croyance que lui ont accordée ou lui accordent des individus) ou demeurer en puissance (dans l’attente d’être activée ou, pour les œuvres du passé, de façon à nous rappeler ce qui aurait pu être).
36Un autre « tournant », « éthique » celui-là21, s’est dessiné aux Etats-Unis voici vingt ans, et s’invite depuis peu dans les débats francophones. Il incite les philosophes à lire les textes littéraires comme autant de leçons sur ce qu’est la « vie bonne » : il ne s’agit plus de se méfier du travail subreptice de l’idéologie, mais d’expliciter la forme particulière de connaissance morale que déploient certaines œuvres. Cette orientation « éthique » ne se caractérise pas par le même traitement de la textualité, le même « outillage » et les mêmes ambitions que l’orientation « pragmatique ». De plus, les recherches que l’on serait tentés de ranger sous l’une ou l’autre de ces étiquettes diffèrent largement entre elles sur l’un au moins de ces points, tandis que d’autres recherches ne ressortissent à aucune de ces deux orientations, alors même qu’elles s’inscrivent pourtant dans le mouvement théorique d’approche des usages ordinaires de la littérature que j’essaie de dessiner.
37Il n’en reste pas moins que ces recherches, aussi diverses soient-elles, présupposent de s’attacher aux modalités par lesquelles les œuvres affectent des subjectivités (ou des formes collectives de subjectivité) et mêlent leurs effets à l’expérience ordinaire des lecteurs : « configuration d’un sens commun22 », manière de « manœuvrer le réel23 », « événement politico-religieux24 », « mode de connaissance et d’expérimentation » par immersion fictionnelle25, « raisonnement moral26 », « aventure morale et conceptuelle27 » – ces qualifications variées de ce qu’opère la littérature réhabilitent toutes, je crois, le premier degré d’une lecture qui ne se défierait pas d’emblée des formes d’adhésion que chaque œuvre sollicite de ses lecteurs.
38Dans les années 1960-1980, une telle adhésion était perçue comme un obstacle épistémologique à l’avènement d’une science des textes. Aujourd’hui, gageons que la prise en compte de cette adhésion sera l’occasion d’un double déplacement : d’une science des textes – située en surplomb des illusions supposées de la lecture ordinaire – à la description rigoureuse des prises textuelles offertes à l’expérience d’un lecteur ; d’une science des textes – modélisés comme des combinatoires de signes essentiellement verbaux, et aux référents inassignables – à une conceptualisation des façons dont les œuvres littéraires, dans des contextes où elles sont en outre aux prises avec des schèmes non verbaux (visuels, musicaux, kinésiques, etc.), contribuent à instituer les mondes dont leurs lecteurs reconnaissent pouvoir faire l’expérience, que ce soit sur le mode de l’imprégnation durable ou sur celui, plus fréquent, d’un fugace estrangement. Non seulement la vie, donc, mais des mondes devant soi.