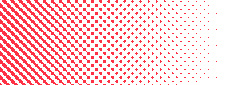La mélomanie porte-t-elle les écrivains à la « déclinologie » (et vice-versa) ? (Parcours à travers la littérature contemporaine, et mise en perspective)
1Sous sa forme élevée et crispée, Désenchantement de la littérature de Richard Millet (2007) représente l’exemple même de ces « tombeaux de la littérature » que, dans un contexte de multiplication des propositions déclinologiques répandues dans toute une série de domaines contigus ou enchâssés (l’histoire, l’art, la culture, l’identité française, l’esprit européen, etc.), l’on s’est mis à ériger à une vitesse accélérée ces dernières années. Or, dans cet essai, le dispositif d’écriture choisi pour la conclusion attire l’attention. Par deux fois, en effet, l’auteur en appelle à la musique pour caractériser cette position d’écrivain prophète et fossoyeur qu’il occupe – dit-il – malgré lui. Il commence par qualifier son « destin d’écrivain » de « musical ». Puis conclut son propos en le plaçant sous le signe de l’art « le plus haut à [s]es yeux, et dont les autres arts, y compris la littérature, semblent la dégénérescence » : la musique, donc, qui – fait selon lui singulièrement riche d’enseignement – « a voilà longtemps accompli son retrait aux modernes thébaïdes ». Les derniers mots de l’ouvrage sont dévolus à ce qu’il considère comme le « plus beau, sans doute, des genres musicaux », à savoir la « leçon de ténèbres », genre auquel « Charpentier, Couperin, Delalande, Bernier, Corrette, quelques autres encore » ont donné ses lettres de noblesse, et par l’entremise duquel le sort de la littérature moribonde semble in fine suspendu entre l’hypothèse de « la mort du Christ » et celle du « chant de l’aube »1.
2Il semble que les débats relatifs à la fin de la culture française ou européenne se sont essentiellement concentrés sur la littérature d’un côté et les arts plastiques de l’autre. On oublie que la musique a été prise dans un même type de configuration. On oublie surtout que, comme souvent, la littérature s’est très souvent appuyée sur l’exemple musical pour appréhender l’histoire de sa valeur propre et, dans un jeu de comparatisme interartistique, réfléchir en termes de destinée parallèle à l’évolution et à l’évaluation des deux arts. C’est ce que nous voudrions envisager ici en montrant tout d’abord comment, au cours du xxe siècle, le genre du tombeau musical tel que pratiqué par la littérature lui a certes d’abord permis d’orchestrer un programme de reconquête (conformément à la formule mallarméenne, la littérature serait venue reprendre un bien que la musique lui aurait dérobé), mais a par la suite peu à peu évolué, jusqu’à lui servir de moyen pour composer la partition de son propre deuil. Nous nous arrêterons alors sur un cas particulièrement représentatif du dernier quart du xxe siècle : Milan Kundera, par ailleurs l’un des premiers « professeurs de désespoir » (Nancy Huston2) contemporains à avoir déclaré la fin conjointe de quatre données consubstantielles : la modernité, la culture européenne, le roman et la musique. Nous nous attacherons ensuite à un autre écrivain tout à fait symptomatique de cette propension à l’époque la plus récente : Richard Millet. Dans les deux cas, nous effectuerons quelques extrapolations à plusieurs autres écrivains mélomanes dont les figures viennent s’étoiler autour de ces deux exemples archétypaux. Nous essaierons ainsi de montrer que cette tendance est particulièrement représentée chez les écrivains mélomanes français, puis tenterons alors d’effectuer deux mises en perspective. La première s’emploiera à montrer que cette obsession terminale associant le sort de la littérature et celui de la musique, métonymie d’enjeux plus fondamentaux, ne date pas de la fin de la fin du xxe et du début du xxie siècles, mais a été également fortement représentée chez les écrivains témoins et dénonciateurs, dans la première moitié du xxe siècle, de la « fin de l’esprit européen ». La deuxième mise en perspective, plus radicale, visera à mettre en lumière le fait que la propension déclinologique semble une constante des écrivains mélomanes. On se risquera alors à formuler quelques hypothèses sur les liens entre cette propension et la mélomanie.
Tombeau musical, littéraire et musico-littéraire
3Le genre du « tombeau » est par excellence de ceux qui se placent à la croisée de la musique et de la littérature3. Dans la seule sphère musicale, il connaît une première période de gloire avec les gambistes du xviie siècle (le Second Livre de pièces de viole de Marin Marais, édité en 1701, contient un Tombeau pour Monsieur de Lully et un Tombeau de Monsieur de Sainte-Colombe, cependant que Charles Dolle, Roland Marais et Antoine Forqueray rendent hommage à Marais père dans plusieurs de leurs œuvres). Le genre est réactualisé au début du xxe siècle (en 1917, Ravel rend hommage à Couperin dans son Tombeau de Couperin). Et l’on recense encore une forme de renouveau à la fin du xxe siècle, lorsque, par exemple, Pierre Bartholomée compose un Tombeau de Marin Marais (1967). Parallèlement, ces figures de Sainte-Colombe, de Couperin ou de Marin, et cette même esthétique du tombeau, offrent à Pascal Quignard de belles rêveries dans sa Leçon de musique (1987) et dans son roman Tous les matins du monde (1991). C’est que, régulièrement, les tresses de la couronne mortuaire offerte par les musiciens se mêlent à celles de l’hommage que confectionnent les écrivains mélomanes, et que, souvent, les deux arts finissent même par s’entrecroiser en un seul et même « tombeau ». Ainsi, les musiciens rendent hommage aux musiciens (Liszt à Wagner dans Am Grabe Richard Wagners, 1883, Maurice Ohana à Debussy dans Tombeau de Claude Debussy, 1962, Boulez à Maderna dans Rituel, in memoriam Maderna, 1975), mais aussi les poètes aux musiciens (« Hommage » de Mallarmé construit un tombeau ambigu autour de la dépouille de Wagner), et les musiciens aux écrivains (Stravinsky compose « Variations « Aldoux Huxley in memoriam » en 1964 ou « Introïtus T. S. Eliot in memoriam » en 1965, Berio célèbre Joyce dans Omaggio a Joyce, 1968, etc.). Les grandes revues mélomanes (La Revue wagnérienne et, surtout, La Revue musicale) ont multiplié les hommages de cet ordre, où, en vertu des langages qui sont les leurs, et dans un fécond dialogue entre les arts, poètes, musicographes, penseurs et musiciens, apportent chacun leur pièce à un bel édifice de commémoration (voir, dans La Revue Musicale, le numéro de 1936 consacré à Paul Dukas, et qui contient « Le Tombeau de Paul Dukas », À la mémoire d’Albert Roussel, en 1937, Hommage à Maurice Ravel en 1938, etc.).
4Le genre du « tombeau » est donc constant à travers l’histoire musicale et littéraire. Pour autant, on remarque l’existence de périodes privilégiées, et le retour de quelques figures essentielles. C’est d’abord le cas des grandes figures de la musique du xviie siècle français. À la lumière des exemples que nous avons donnés, on constate qu’elles interviennent dans le cadre d’une première modernité, celles des avant-gardes du début du xxe siècle, puis à nouveau, à la période contemporaine, au terme d’une deuxième modernité, que, par ce biais, elles semblent mettre en perspective par rapport à la première, et ce, parfois de façon critique. En effet, il semble que ce désir du « retour à », et cette sensibilité à la question de l’identité esthétique française ne soient pas anodins : nous verrons en effet plus bas qu’ils sont en prise directe avec cette « hantise de la fin » à laquelle nous nous intéressons ici, hantise doublée de la remise en question du grand récit moderniste et de ses différents paradigmes (le classicisme, la modernité, le progrès, la décadence, etc.). À ce titre, ce n’est pas pour rien qu’ils sont omniprésents dans les œuvres de Pascal Quignard ou de Richard Millet, auxquelles nous serons amenés à nous intéresser ici en particulier.
5La deuxième figure à avoir fait l’objet de multiples tombeaux est Wagner. Dans ce cas particulier, on constate que le genre du tombeau du musicien prend une inflexion particulière. Ainsi, si l’on prend l’exemple des hommages directs ou indirects dont le compositeur peut avoir fait l’objet (on trouve des « tombeaux de Wagner » dans la livraison du 8 Janvier 1886 de La Revue wagnérienne, dans l’Ode de Carducci consacrée à la mort de Shelley, mais aussi dans les romans de D’Annunzio (Le feu [Il fuoco, 1900]), Werfel (Verdi ou le roman de l’opéra [Verdi, der Roman der Oper, 1922]), et Carpentier (Concert baroque, [Concierto Barroco, 1974]), on remarque que le tombeau du musicien relève avant tout du prétexte. Il semble en effet avant tout destiné à régler des questions d’ordre littéraire. Avec Wagner sont en effet enterrés Hugo (dans l’Hommage de Mallarmé) ou Shelley (dans celui de Carducci). Il semble ensuite offrir une occasion d’effectuer quelque chose comme une purification de la littérature, qu’il s’agisse d’entériner avec la mort de Wagner le deuil du génie, du sublime, de l’utopie de la Totalité, et du xixe siècle dont il serait devenu le symbole, ou de purifier la littérature elle-même d’une maladie de civilisation, à laquelle on a donné le nom de wagnérisme. Il sert en outre à formuler, comme dans les textes de Mallarmé ou de René Ghil, une poétique trahissant une réticence à l’égard de la musique et du musicien, et contenant implicitement, pour la littérature, un programme de reconquête. Dans le cas de Wagner, le genre du tombeau musico-littéraire contribue donc essentiellement à une forme d’autocélébration de la littérature, capable d’orchestrer la mort du musicien en rivalisant avec lui sur son propre terrain. Ce programme de reconquête est à nouveau redoublé de considérations liées aux questions d’identités nationales, particulièrement lorsque un poète ou un compositeur français ou italien vient s’opposer à un artiste qui, à lui seul, semble résumer les caractéristiques de la germanité.
6Les figures qui forment le troisième groupe à avoir fait l’objet de tombeaux sont ces mêmes figures-clefs des avant-gardes européennes qui ont justement pratiqué ces « hommages » dont nous avons parlé plus haut, à savoir Debussy et Ravel, Stravinsky et Schönberg. On les retrouve par exemple dans des œuvres d’Anthony Burgess (Le mode du diable [The devil’s mode, 1989], Mozart et Amadeus [Mozart and the wolf gang, 1991]), Alejo Carpentier (Concert Baroque), Michel Butor (Description de San Marco, dédié « à Igor Stravinsky pour son quatre-vingtième anniversaire », 1963), et surtout Milan Kundera (Les Testaments trahis, 1993, et plusieurs romans dont L’Identité, 1997), Richard Millet (les œuvres sont trop nombreuses pour pouvoir être toutes citées) ou Benoît Duteurtre (dans les essais Requiem pour une avant-garde, 1995, ou Ma belle époque, 2007), autant d’écrivains qui vont occuper une place centrale dans notre réflexion. Considérés par ces écrivains comme des « accélérateurs » du récit moderniste pouvant potentiellement précipiter l’art vers sa fin, surtout quand cette première modernité est selon eux reprise et radicalisée par une deuxième modernité (principalement boulézienne) dont, par ce biais, on réapprécie l’héritage complexe, ces musiciens symbolisent en effet une modernité problématique, un âge d’or perdu ou le début d’un long crépuscule, une modernité dès lors désirée ou rejetée, et permettent d’appréhender en un large geste conclusif l’ensemble du récit de la modernité dans lequel ils s’inscrivent. Ce faisant, il semble que dresser leur tombeau ne soit plus conçu comme un moyen de proclamer le renouveau de la littérature, mais au contraire comme une façon de l’enfouir avec toute la culture dans un seul et même sépulcre. De genre circonscrit, le tombeau de la musique tel que pratiqué par les poètes et les écrivains va peu à peu se déporter sur la littérature, puis devenir, par effet d’enchâssement métonymique, un moyen d’exprimer une hantise de la fin dans son ensemble : fin de la musique, fin de la littérature, fin de la culture française, fin de l’esprit européen, etc. C’est ce qu’il nous faut considérer maintenant à partir de quelques exemples représentatifs.
Imaginaire musico-littéraire et « paradoxes terminaux » chez Milan Kundera
7Le premier des écrivains mélomanes à avoir fixé de façon éclatante le genre du tombeau de la littérature en ses termes actuels est Milan Kundera. Important en Europe occidentale cette modernité anti-moderne dont il fait le trait même, lucide et sceptique, de l’Europe centrale, et dont, de Kafka à Gombrowicz en passant par Musil et Broch, il reconstitue la généalogie fantasmatique, son modèle relie, sous le signe débilitant de l’« homo sentimentalis » triomphant et de l’essoufflement programmé du grand récit moderniste, plusieurs données intrinsèquement mêlées : mort du roman, culte kitsch de l’idylle musicale, et trahison des promesses de l’esprit européen. Rappelons brièvement les grandes articulations de ce modèle4.
8Ainsi qu’il l’explique dans L’Art du roman, si le spectre de la mort du roman se fait autant sentir, c’est tout d’abord que celui-ci a, selon Kundera, failli à sa mission première, qui était de résister, par sa nature même, polyphonique et humoristique, à cette tentation, particulièrement forte dans les temps modernes européens, de livrer une vision simplificatrice de l’être européen, soit par excès de rationalisme (culte enthousiaste du progrès), soit par excès de romantisme (culte mélancolique de la profondeur) et ce, dans un large mouvement lyrique et moral qui fait le lit des idéologies puis des totalitarismes. Là où les thuriféraires des sciences et de l’Histoire ont laissé planer l’utopie d’un sens, fût-il tragique, le roman aurait en effet maintenu pendant plusieurs siècles l’hypothèse souriante et scandaleuse de la relativité –à commencer par celle de l’être.
9Or, une fois l’Europe entrée dans l’ère de ce que Kundera appelle « les paradoxes terminaux », ère qui voit au cours du xxe siècle le projet rationaliste basculer dans une forme d’irrationalisme organisé (d’abord sous la forme de l’idéologie, puis sous celle, de l’« imagologie », caractéristique selon lui des sociétés démocratiques avancées), le roman, avalé par un monde où s’est installé de façon toute-puissante un régime de contrefaçon de tous les systèmes de valeurs possibles, s’est de moins en moins montré capable d’opposer cette force de résistance qui était pourtant sa raison d’être essentielle. Ainsi, le roman serait gagné par l’état du monde contre lequel il se construit, c’est-à-dire un régime de répétition du même ; il aurait perdu son sens de la complexité et de la continuité (ses valeurs propres) au profit de la simplicité et de l’actualité (qui sont les valeurs du monde). En outre, il aurait trahi tous ces « appels » qu’il symbolisait : l’appel du jeu (voir Sterne et Diderot), l’appel du rêve (Kafka), l’appel de la pensée (Musil et Broch) et l’appel du temps (Aragon et Fuentes). Un des signes de cette mort du roman serait le silence dans lequel il est entré depuis quelques décennies, en une apocalypse joyeusement discrète.
10Ce récit, Kundera le propose également dans le cadre de ses développements relatifs à la musique, particulièrement dans Les Testaments trahis. Pour lui, l’Europe a en effet vécu un temps musical idéal, symbolisé par Bach, temps qui, par-delà les emphases du romantisme qu’il dénonce, a été heureusement rejoué par une branche de l’avant-garde européenne du début du xxe e siècle, avant que l’accélération du récit moderniste due à la doxa progressiste ne précipite malheureusement celui-ci vers sa fin, l’enfouissant de surcroît sous la tonitruance indifférenciée de cette fausse idylle collectiviste qu’est pour Kundera le rock. Le modèle bachien de la fugue et du contrepoint, fréquemment cité dans ses œuvres, et représentatif d’un certain idéal brochien de l’artiste-artisan, donnerait en effet à contempler une « beauté extrasubjective de l’être », cependant que la mélodie romantique ferait plonger l’auditeur en lui-même, lui faisant intensément ressentir son moi, et le conduisant à oublier tout ce qui se trouve en dehors. Selon Kundera, Bach aurait été également le premier à avoir fait prendre conscience à la postérité de l’importance de la musique du passé et à avoir du même coup montré à quel point l’art est continuité autant qu’histoire. Ce faisant, la posture anti-moderniste de Bach, qui par là aurait montré que l’Histoire ne va pas forcément vers le plus riche, le plus complexe, et le plus cultivé, et que les exigences de l’art peuvent être en contradiction avec les exigences du jour, représenterait là aussi aux yeux de l’écrivain une modalité de résistance « contre l’Histoire »5. De son côté, le temps beethovénien (du moins celui de la symphonie) représenterait au contraire pour lui un temps ambigu pendant lequel l’Europe aurait basculé dans l’ère de l’« homo sentimentalis », caractérisée par un culte du génial et du sublime, un esprit de sérieux et une religion du sentiment aux virtualités morbides, bien propres à nourrir les grandes orgues de l’idéologie, avant de se dégrader, par excès de kitsch, en un geste trivial caractéristique des slogans publicitaires6.
11Si certains compositeurs d’avant-garde, à commencer par Stravinsky, ont tenté de renouer avec le temps bachien, de reconsidérer le passé afin d’en restituer le sens et la continuité, ce fut en vain. En inventant le dodécaphonisme, Schönberg (qui incarne l’autre pôle de la fameuse dialectique adornienne développée dans Philosophie de la nouvelle musique [Philosophie der neuen Musik, 1948]), a cru faire souffler sur la musique un incroyable vent d’audace et de liberté, mais il a en réalité « accéléré » l’histoire de la musique, et l’a précipité vers sa fin. Son temps, déjà séduit par les sirènes du « tout sonore », dont le poste de radio constitue un puissant symbole, n’était de toutes les façons plus prêt à l’entendre. Si bien que, si Bach, en un « immense effort de l’esprit et du cœur », a tiré la musique de cette « bêtise originelle consubstantielle à l’être humain », et a fait de cette musique une « histoire », c’est-à-dire le lieu de l’interrogation, de la réflexion et de la pensée, elle y est désormais retournée7. Cette fausse idylle collectiviste qu’est le rock, telle que mise en scène dans un passage célèbre du Livre du rire et de l’oubli (1978), en constitue pour Kundera l’évident symbole. Ici, tel roman (Le Livre du rire et de l’oubli) donne symboliquement à voir une scène durant laquelle une fugue de Bach s’envolant d’une fenêtre, est écrasée par les fracas des marteaux piqueurs ; ailleurs, tel autre (L’Identité) montre Schönberg se noyant dans le fleuve du « tout sonore » et, emporté par les flots tumultueux, obligé d’embrasser le cadavre de son frère ennemi Stravinsky. Dans le dictionnaire personnel qu’il propose dans L’Art du roman, Kundera vante d’ailleurs le mot « ensevelir » pour sa beauté sonore8.
12Les éléments de ressemblance et les effets de parallélisme entre les deux récits (celui du roman et celui de la musique) ne sont pas le fait du hasard. Fréquemment, Kundera s’adonne explicitement à des essais d’esthétique comparée dans lesquels, à travers telle et telle figure (par exemple Flaubert et Janáček9), où tel et tel aspect relevant de l’art de la « composition » artistique (la grande forme musicale et la grande forme romanesque au xixe siècle), il associe la destinée du roman et celle de la musique. Pour lui, les deux destinées sont d’ailleurs enchâssées dans une même « histoire » de la modernité. Kundera, on le sait, se dit amoureux de la modernité sous toutes ses formes, mais, ayant découvert la possibilité d’une idéologisation de la modernité (liée à l’unilatéralité du lyrisme révolutionnaire coercitif), il a créé une distinction entre une modernité cautionnée par la politique, et une modernité condamnée par elle : il n’aurait alors jamais cessé d’aimer la seconde, mais se serait détourné de la première. Il dit également avoir tenté, dans le roman, de tenir ferme les valeurs de la modernité contre leur récupération idéologique, et donc de maintenir leur vérité, leur ambiguïté, leur posture résistante.
13On sait surtout qu’il distingue, au sein de l’histoire de l’art, un premier pôle de la modernité représenté par des artistes comme Apollinaire, Maïakovski, Léger, les futuristes, les avant-gardes, Schönberg ou Varèse, qui aborderaient le monde moderne sous le mode de l’extase lyrique, s’identifieraient sans arrière-pensée au monde moderne, exalteraient la technique, et seraient fascinés par l’avenir. Puis un second pôle, représenté par Kafka, Musil, Broch, Gombrowicz, Beckett, Ionesco, Fellini, Janáček et Stravinsky, figures qui conçoivent davantage le monde moderne comme un labyrinthe où l’homme se perd, et observent face à celui-ci une attitude antilyrique, antiromantique, sceptique et critique. Kundera se dit bien évidemment proche de ce second pôle10. L’adhésion à ce second pôle de la modernité, celui de la modernité sceptique, antimoderne, s’intègre enfin dans un plus large bilan de la culture européenne, tout entier traversé par l’annonce de sa fin. Pour Kundera, le terme même d’« européen » peut d’ailleurs se définir ainsi : « celui qui a la nostalgie de l’Europe », c’est-à-dire de la culture11. Le miracle de l’Europe, dit Kundera, c’est d’avoir transformé son art en histoire. Pendant un temps indéfini, on a répété et on s’est satisfait de la beauté dans l’espace de cette répétition. Puis l’art est devenu histoire. Le problème pour celui qui a pris son envol (l’image est de Kundera) est qu’il peut à tout moment s’écraser, et qu’il est de toutes les façons inévitable qu’il finisse par atterrir.
La « leçon de ténèbres » de Richard Millet
14Richard Millet n’aime pas l’œuvre de Kundera12. Il est néanmoins l’exemple contemporain le plus évident d’un écrivain qui, dans son sillage, associe de façon organique mélomanie et scepticisme. Comme Nietzsche en son temps, et comme Quignard aujourd’hui, Millet déplore tout d’abord que la modernité engendre la mort inexorable des langues (le limousin en premier chef, le français ensuite), qui est aussi une mort de l’être, pris dans un corps que la langue façonne13. En corollaire, ses goûts musicaux le portent tout particulièrement vers certains compositeurs à tendance religieuse ou ascétique, et Millet loue cette « musique du silence », foncièrement économique et non bavarde d’un Brossard ou d’un Mompou (les modèles de Blanchot et surtout de Des Forêts, qui hantent Millet comme Quignard, s’expriment assez clairement ici), ou encore la pureté et la probité du Concerto à la mémoire d’un ange de Berg.Ce qu’il prise plus que tout dans ce type de musique est cet « abandon au sacré », « à l’obscur », cet exercice spirituel en forme de memento mori, qu’il décèle aussi dans la musique de Charpentier, Fauré, Messiaen, ou Grisey14.
15Ce qui donne son homogénéité à ces goûts, c’est le dénominateur commun de la nostalgie, terme dont on a vu l’importance chez Kundera. La musique est ainsi présentée par lui comme un entretien entre les vivants et les morts, qui a pour fin de résigner l’individu, par la méditation, à sa propre finitude. Celle-ci revêt l’aspect d’un retour à la terre, à la maison, à la chambre – à sa propre naissance.À ce titre, toute composition est peu ou prou « tombeau » (celui des autres, le sien propre) ; tout instrument authentique doit d’abord et avant tout être « capable d’évoquer les disparus » (la comparaison de l’alto avec un cercueil est au centre de La Voix d’alto) ; toute musique entretient de facto une relation avec le passé, la tradition : « Créer, écrit Millet dans Pour la musique contemporaine, c’est, peu ou prou, et sans rien renier de ce qu’on est, entretenir avec le passé, la tradition, certains compositeurs, un lien qui met au jour des affinités plus ou moins secrètes, quand ce n’est pas, vieux genre en vigueur dans la musique française du Grand Siècle, un funèbre hommage, une déploration légitime, une lamentation, un tombeau15. » On est musicien à la fois « par horreur des ténèbres » et par désir d’apprivoiser la mort, de s’adonner à un amor fati. Le souci ultime, alors, est d’habiter et de goûter le silence, qui n’est plus le contraire de la musique ou de la langue, mais son envers.
16Millet a beau se déclarer favorable à la musique contemporaine (voir Pour la musique contemporaine), il ne cesse, dans ses essais comme dans ses œuvres de fiction, de brocarder le militantisme, voire le terrorisme avant-gardistes, qui ont marqué l’époque de sa jeunesse. Tel est ainsi un des moments récurrents de ses biographies de compositeurs ou d’instrumentistes fictifs (L’Angélus, 1988, La Voix d’alto, 2001) : un jeune artiste provincial monte à Paris, autour de 1968, et vit comme un enfer étouffant et coercitif l’atmosphère soixante-huitarde de la capitale. Il se soumet d’abord à ses dogmes, en particulier la psychanalyse, la musique moderne, et le structuralisme, avant de se retourner contre eux. Ici et là, Millet (ou ses doubles fictionnels) affirme également son rejet du rock et de son « universalisme simpliste », de même que de ce qu’il appelle ses « dérivés rapeux16 ». Pour lui, le monde moderne, le contemporain, font preuve d’« une certaine surdité ». Ils ont asservi le sonore au visible, et l’époque moderne, avance-t-il ainsi, est une époque « envahie de bons sentiments et de mauvaise musique17 ».
17Millet, on le sait, entretient une relation particulièrement complexe à l’égard de deux tensions dialectiques qui caractérisent tout particulièrement ce monde : la tension entre global et local, et la tension entre ancien et moderne. Son éloge de la « francité musicale » témoigne de son refus d’une universalité de principe, qui, pour lui, est synonyme de standardisation, d’affadissement, de soumission à une doxa particulièrement coercitive, sous les atours hypocrites d’un pseudo idéal musico-politique universel et intemporel. Au contraire, toute manifestation nationale, lorsqu’elle est authentique et habitée, est pour lui intrinsèquement universelle, et ce, dans son particularisme même18. À ce titre, Millet revendique bien évidemment la posture de l’inactualité, de l’intempestivité. Dans l’éternelle querelle des Anciens et des Modernes, sa position est résolument celle d’un Ancien : « nous venons après » ne cesse-t-il de dire – après toute une généalogie de grands écrivains et musiciens qui ont donné à la francité un vêtement de gloire qui s’est depuis longtemps effiloché19 ». Et, plutôt que d’adhérer au culte de certaines idoles littéraires et musicales contemporaines, il préfère se dire le contemporain de Bossuet, Saint-Simon, ou Delalande.
18Le Sentiment de la langue recueille la somme de ses positions, et redéfinit les relations dialectiques qu’entretiennent les grandes notions de l’esthétique et de la philosophie de l’histoire modernes : modernité et tradition, avant-garde et classicisme, progrès et décadence, etc. Ce « traité du crépuscule » se propose ainsi de décrire la « perte de l’enfance, de l’innocence, des illusions héritées du xixe siècle », « la fin de la France, le déclin de l’Europe en tant que civilisation », « la nécessité de vivre dans l’idée de cette mort » ou de cette « décadence », et de voir comment, dans ce climat crépusculaire, la langue constitue tout particulièrement le « lieu de détresse » qui nous requiert20. S’y affirme alors un éloge du classicisme : « le classicisme ne fait question qu’en temps de détresse21 » ; un classicisme qui est aussi une anti-modernité, c’est-à-dire, comme pour Kundera, une autre modernité : « n’est « moderne », avance-t-il, que celui qui finit par reconnaître le destin classique de son art ». Ainsi, s’il aime à écrire sur les musiciens contemporains, c’est – au prix d’une formulation volontairement paradoxale – parce que « le sonore est la contemporanéité de l’immémorial22 ». Encore ne s’agit-il pas de n’importe quel contemporain. Les vrais contemporains sont pour lui, comme pour Duteurtre (et c’est bien là une mouvance caractéristique du monde musico-littéraire le plus récent), ceux qui n’ont pas uniquement cédé « au masque romantique de l’originalité » : la musique authentiquement contemporaine est celle qui entretient une relation privilégiée avec les œuvres du passé, non pas de nostalgie, de régression, mais qui tente de se ressourcer à la « puissance lumineuse de la tradition23 ». Ainsi, ses contemporains de prédilection sont tout particulièrement ceux qui contournent le sérialisme « en se ressourçant à Debussy, Bartók, Stravinsky et Janáček24 » (certains des compositeurs également élus par Kundera ou Duteurtre). Sa définition de la tradition – en forme d’éloge – est particulièrement limpide : « tradition ne signifie pas repli, ni regret, mais (pour détourner ici le vocabulaire guerrier à quoi appartient le mot avant-garde) redéploiement, recaptation, ressourcement, projection dans l’incertain du futur bien plus que dans l’imparfait présent25 ». Ainsi que le pense Duteurtre, l’avant-garde peut, pour Millet, se figer en académisme institutionnalisé. Dès lors, l’artiste intègre doit choisir la position de l’exil, qui est selon lui une « lutte de tous les jours contre le conservatisme » de l’avant-garde26.
19À cet égard, on peut considérer le compositeur fictif du court roman L’Angélus comme un véritable double de Millet, et son parcours comme un condensé des positions de l’auteur. Après avoir parachevé sa formation auprès des grandes figures de l’avant-garde parisienne, celui-ci finit en effet par s’en détourner violemment. « Détaché de l’avant-garde », il se tourne donc vers celui dont on a fait par excellence une figure de résistance à une certaine idée de l’avant-garde (en particulier boulézienne), une figure ouvrant d’autres voies à la musique française : Henri Dutilleux. Le catalogue des œuvres de ce compositeur fictif est tout à fait parlant, quintessence de l’imaginaire millettien. Ne citons que ces titres évocateurs : l’op. 1 est intitulé La Chambre des morts, l’op. 4, Tombeau, l’op. 5 est une Suite française sur des textes de Bossuet, Fléchier et autres écrivains religieux du Grand Siècle (« on y vit une “apologie de la francité et un hommage, sinon un retour à la musique de Charpentier, Delalande, Couperin” »), l’op. 6, enfin, est consacré à des Chants de Haute-Corrèze. Que l’auteur soit fort proche de son personnage, il suffit de lire les pages consacrées à Fauré dans Le Sentiment de la langue pour s’en persuader. Pour Millet, la rencontre de Fauré a donné lieu à tout un parcours initiatique, un « cheminement » au terme duquel est apparue une « délivrance27 ». Fauré permettrait en effet comme nul autre à Millet de « savoir ce qui, dans [la] musique, sans être de la langue, sonnerait français ». Les caractéristiques qui se dégagent de cette musique sont : « clarté, refus de l’excessif, du verbeux, de l’emphase28 ».
20Depuis le milieu des années 2000, les positions de Millet se sont radicalisées29. La référence à la musique vient plus que jamais jouer le rôle d’outil à caractère herméneutique visant non plus tant à définir un idéal d’une écriture musicale à visée rédemptrice qu’à problématiser le déclin des langues et du style (et donc de la littérature), cause et symptôme – en forme de métonymie – du déclin de la culture française et de l’esprit européen. Dans Désenchantement de la littérature, Millet est on ne peut plus clair :
Mon destin d’écrivain, si j’ose encore me définir ainsi, est musical en ceci qu’il suppose l’immédiateté insignifiante mais universelle de ce que j’écris et de ma propre personne, non pas par renoncement, mais parce que reposant sur la tradition et sur les morts. Mots dangereux. Mots magnifiques : ils disent l’absolu du perdu, l’enfance, l’amour, l’origine, l’innocence, l’obscur. L’attente de Dieu au sein même du vide laissé par la nouvelle de sa mort30.
21Au fil des différents propos de l’écrivain, on constate ainsi que les notions de rythme et de grande forme, transposées du domaine musical au modèle littéraire, deviennent pour lui les leviers d’un maintien – désormais rendu impossible – du système des valeurs dans l’art et dans la civilisation. L’aspiration au silence (que l’on retrouve chez Quignard, et paradoxale chez des écrivains aussi prolixes) est fantasmatiquement présentée comme la seule attitude possible pour l’écrivain « mécontemporain mais contemporain tout de même31 » qui fulmine contre la civilisation « rock », dont les méfaits se sont d’après lui répandus jusque dans l’écriture (même chez un écrivain comme Peter Handke, qu’il apprécie pourtant). C’est donc inévitablement sous le signe musical de la « leçon de ténèbres », nous l’avons vu, que Millet conclut son Désenchantement de la littérature.
Pascal Quignard et la « musique du silence » comme posture de résistance
22Notons que l’on trouverait chez Pascal Quignard (auquel Millet se réfère régulièrement) une configuration relativement semblable, mais exprimée avec plus de hauteur, de façon moins vindicative, et exempte des prises de position explicitement réactionnaires dont fait preuve l’auteur de L’Opprobre.
23Chez Quignard, en effet, l’appel au silence occupe également une position primordiale. C’est selon lui le moyen pour l’individu d’apprivoiser non seulement ce qu’il appelle son « jadis » animal, son lien ancestral avec l’espèce, mais encore cette « souffrance sonore » que constitue toute vie, loin du rapport fusionnel avec la mère, loin de l’âge d’or asexué de l’enfance. Le silence représente alors une attitude de résistance lucide à cet incessant fredon collectif par lequel, particulièrement à l’époque contemporaine, envahie par le bruit musicalisé, l’espèce humaine croit échapper à sa condition ancestrale et, de ce fait même, la rejoue avec une violence sans pareil32. Pour Quignard, la musique est à la fois ce qui, épuré par un travail idiosyncrasique constant, permet l’émergence de l’individu dans le silence de l’écriture, et ce qui, jusque dans ses formes les plus apparemment civilisées (le langage, le concert) entretient les activités haineuses de la collectivité, éternelle meute chasseresse33. Le manque d’attention porté à la musique dans le monde contemporain, sa simplification récente en un medium à la fois kitsch et brutal, et le fait que la toile de fond sonore propre à notre époque soit de l’ordre du bourdonnement incessant34, s’expliquent par ce biais : le contact fascinant de la meute avec sa rumeur, lancinante, assourdissante, n’a jamais été aussi intense qu’au moment même où, paradoxalement, le processus civilisationnel semble pourtant le plus vouloir la congédier. Dès lors, l’activité de l’écrivain s’apparente à une « dissidence », une « désobéissance », littéralement : un refus d’ouïr passivement cette dernière35.
24La musique au bord du silence, le silence lui-même, c’est en effet l’expression acceptée – et non pas niée, comme le fait l’espèce – du « jadis ». C’est la saisie la plus juste du temps, du passé, de la mort, autrement dit d’un temps qui « n’avance pas », mais « s’incruste, s’encercle, s’additionne sans avant ni après », et par lequel le chant de l’origine se met à primer sur celui de l’originalité. Pour Quignard, ceci est lourd de conséquences en matière de création artistique et invite à remettre en question le récit moderniste. Ainsi, Stendhal, écrivain admiré, ne serait pour lui pas Stendhal, mais Tacite XIV (comme on dit Louis XIV, avatar de Louis avant d’être irréductible à sa généalogie), Purcell ne serait pas Purcell, mais Monteverdi VII, etc. Et c’est bien cette voix-là, ressassante, qu’il faut savoir d’abord et avant tout entendre en ces grands hommes. Si l’histoire est une relation fausse à l’antérieur et le journalisme une relation fausse au présent, la musique seule représente la relation la plus juste au passé. Elle seule permet de rendre compte du désir, de cette jouissance en forme d’enchantement, qui est à la source de tout36. C’est en ce sens, a contrario, que Quignard s’en prend au progrès et à son corollaire, l’art moderne. À l’image de la lacération par l’obscur Richard Guillard, le 11 août 1932, de l’Angélus de Millet, la modernité serait pour Quignard un temps de violence caractérisé par la « mise en avant de soi », et dont l’ennemi déclaré est précisément ce « jadis », cette antériorité, dont on cherche – illusoirement – à se défaire du joug, de la dépendance37. C’est pour cela qu’en toute logique Quignard confesse se « renouve[ler] de jour en jour dans la nécessité d’imiter l’œuvre des anciens38 ».
25À la lumière de ces quelques données, on reconnaît dans l’œuvre de Quignard des points de débats similaires à ceux développés par Millet, à commencer par les propos anti-modernistes, l’éloge du silence musical comme attitude propre à l’écrivain solitaire résistant au harcèlement sonore propre à la société contemporaine, etc. Mais il faut cependant remarquer que les propos relatifs à la mort de la littérature, que celle-ci soit de l’ordre de la dynamique interne ou externe, pour être évidemment à l’horizon de sa conception du monde, n’y sont cependant développés que de façon latente.
La grande « déculturation » selon Renaud Camus
26Parmi les écrivains mélomanes portés à la déclinologie, mais porteurs d’une théorie et d’une conception du monde originales, il faut encore évoquer le cas de Renaud Camus (qui, parmi les contemporains, partage avec Millet ou Houellebecq le fait – dont nous ne commenterons pas ici la pertinence – d’avoir suscité de violentes polémiques où racisme, ou bien antisémitisme, ou bien encore islamophobie étaient en jeu).
27Depuis Du sens (2002) au moins, on sait en effet qu’une des propositions principales de l’essayiste et diariste consiste à déplorer la fossilisation du sens que crée, dans la société contemporaine, l’aspiration inextinguible au consensus, pensée comme une attirance pour la stabilité du « même » (ce qu’il appelle la « tyrannie du sympa »), moyen particulièrement efficace de conforter la puissance coercitive de la doxa, et comme rejet de tout ce qui relève du « relatif », de l’« écart », du « transitoire »39. Contre cette aspiration, Camus exprime dès lors le désir de maintenir le langage dans une perpétuelle dynamique entre « le sens qui est [toujours plus ou moins] miné par son contraire » et « ce contraire à son tour [miné] par son propre contraire, qui ne coïncide pas exactement avec ce dont est le contraire ce dont il est le contraire [etc.] »40, autrement dit de rester fidèle, contre le totalitarisme d’un sens univoque, à ce principe bathmologique mis en avant par Barthes d’un sens indéfiniment fragmenté qui serait pris dans la spirale de son correctif perpétuel, et dont l’équivalent dans l’écriture serait l’accumulation d’incises, de relatives et de parenthèses, ou encore la forme expérimentale de l’œuvre arborescente. Pour l’expliquer, Camus utilise lui aussi le modèle musical, et plus précisément celui de la « cavatine », qui lui permet, conformément à l’étymologie du terme (« cavare » : creuser), de formuler un idéal de « creusement » perpétuel du sens lorsque celui-ci fait du « sur-place »41. Là encore, l’activité d’écriture, qui élit la multiplication des possibles propres à l’instant (dont l’acte sexuel est une autre représentation privilégiée), est conçue comme une résistance individualiste et intempestive contre la toute puissance du temps biologique et social, nécessairement unifié et univoque. Dans ce cadre, il n’est évidemment pas étonnant que les goûts musicaux de l’écrivain le portent vers des œuvres dont le geste compositionnel a pour caractéristique bien connue de les avoir placées volontairement hors du récit moderniste, qu’il s’agisse de certaines pages devenues en ce sens tout à fait symboliques (et souvent citées de façon programmatique) de Tchaïkovski42, Grieg43, Richard Strauss, Elgar44, Bax, et surtout Brahms, dont il vante régulièrement (par exemple dans P. A.) la posture volontairement classique, et qui laisse entrevoir la possibilité de retrouver une forme d’âge d’or de la culture européenne45. Et qu’à l’inverse les compositeurs placés dans le panthéon de la geste moderniste ne fassent pas l’objet de sa plus vive admiration. Beethoven, ainsi, est accusé d’ouvrir une voie de la modernité dont Boulez (à la différence d’un Henze ou d’un Pesson) représente le dernier maillon important, et qui donnerait abusivement à la forme, poussée jusqu’à sa plus extrême complexité, sa précellence46.
28Comme les écrivains précédemment évoqués, Camus engage en effet une relation complexe à l’égard de la modernité. Pour être, tout comme Millet, le défenseur et promoteur d’un certain « contemporain » en art, il n’en est pas moins également le défenseur sourcilleux de la « haute culture ». Pour lui, la musique est ainsi sortie depuis quelques décennies du champ culturel, et s’est vue remplacer, en « novlangue », par « la musique », qui inclut donc également les « variétés, le music-hall, les divertissements, la chansonnette », etc.47 Sur un autre plan, il avoue sans équivoque son adhésion au confort d’écoute que procurent les nouvelles technologies et ne confesse aucune nostalgie, à la différence de nombreux écrivains mélomanes, à l’égard de la salle de concert et du disque vinyle48. Il convient cependant de ne pas se leurrer sur cette « technolâtrie » : s’exprime avant tout ici la possibilité nouvelle d’une pratique musicale qui trahit clairement une forme d’aristocratisme élitiste et individualiste49. Sur un autre plan, Camus déplore en revanche, en amont de la dégénérescence des langues à l’époque contemporaine, et en particulier du français, à la fois par « dilution » et « émiettement » du sens50 (que les élites, en outre, de moins en moins aptes à maîtriser les complexités de la langue, ne sont plus capables de préserver), une décadence du chant et de la musique qui serait due à la standardisation de l’interprétation à l’heure de la mondialisation. Comme Millet, Camus regrette que le sens de la « tradition » ait laissé la place à l’idéal consensuel du « métissage », qui impose, par une emprise directe sur la langue, l’idéologie du temps ; et la conséquence directe en est, perceptible dans maintes représentations lyriques, qu’un art du « bien chanter » français, auquel est lié un « bien dire » et un « bien écrire » français serait ainsi en train de se perdre. Comme nombre d’écrivains évoqués ici et amenés à désirer une forme de « renationalisation » de la musique, Camus en appelle dès lors à la nécessité d’ancrer à nouveau l’œuvre musicale dans un sol et une culture propres. Contre les méfaits de la mondialisation culturelle, Camus ne craint pas de défendre le principe d’un nationalisme musical51. Comme Millet ou Duteurtre, Camus peut avancer que « l’art qui naît universel n’est pas de l’art : au mieux il relève de l’industrie culturelle, au pis de la propagande52 ». Et comme eux, il vante une certaine façon d’incarner l’idée et l’être de la France dans sa langue, telle que l’incarnent les figures éminentes du Grand siècle ou encore Proust.
29L’essai La Grande Déculturation (2008) occupe dans l’œuvre et l’évolution de Renaud Camus la même place que Désenchantement de la littérature pour Richard Millet – et a d’ailleurs reçu le même accueil. Il est intéressant de noter que ce texte s’ouvre sur deux propositions qui étaient au centre de ce chef-d’œuvre de pamphlet réactionnaire mélomane que sont Considérations d’un apolitique de T. Mann(Betrachtungen eines Unpolitischen, 1918) : l’opposition entre le modèle de la « culture » et le modèle de la « civilisation ; l’évocation de la « culture » comme idéal universel et intemporel propre à la bourgeoisie, moins comprise comme une classe que comme un état de civilisation dont la culture est précisément l’un des signes caractéristiques. La proposition générale de l’essai est la suivante : mieux vaut, pour la survie de la culture, sa perpétuation héréditaire au sein d’un groupe circonscrit (cette bourgeoisie que l’on doit désormais presque considérer de façon « ethnique »), que cette dégradation et dilution que provoque l’utopie (faussement généreuse et en réalité très cynique, notamment quand il s’agit des immigrés – sujet polémique que Camus partage avec Millet) de la « culture pour tous » propre à l’ère de l’« hyperdémocratie », et dont la conséquence est, selon l’essayiste, un affaissement de la culture des élites et une prolétarisation généralisée. Pour Camus comme pour Kundera (et la plupart des écrivains représentés ici, tous plus ou moins dénonciateurs des politiques culturelles travaillées par l’utopie du « populaire » telle qu’elle s’est exprimée du TNP de Villeurbanne à l’ère « Jack Lang »), la notion de « culture » peut en effet, à l’opposé diamétral de ce dont il déplore la dégradation, représenter un slogan particulièrement efficace pour entretenir de façon insidieuse et néanmoins coercitive, avec bonne foi ou cynisme, des intérêts idéologiques ou commerciaux tout à fait représentatifs de ce « totalitarisme mou » (Millet53) qui, selon ces écrivains, serait propre aux sociétés démocratiques avancées. Ainsi, à contre-courant de l’utopie lyrique collective inhérente à la Fête de la Musique, aux Nuits Blanches, aux Journées du Patrimoine, etc., Camus invite à se construire une culture autre, authentiquement individuelle, qui constitue, comme pour Quignard, une sorte de résistance en forme de geste idiosyncrasique contre la rumeur indifférenciée et hypnotique propre à la masse contemporaine. Car la culture, contrairement à l’idée reçue, engendre pour Camus non seulement de la différence, mais aussi de l’inégal54.
Les « Requiems » de Benoît Duteurtre
30Dans le panorama de la littérature contemporaine, Benoît Duteurtre n’occupe pas la même place que les écrivains précédemment évoqués. Institutionnellement, elle est cependant loin d’être négligeable ; elle est surtout capitale dans le domaine musical, au sein duquel la parution de Requiem pour une avant-garde (1995, réédité en 2005) a initié une mutation paradigmatique fondamentale. En s’attaquant à l’école boulézienne et à ses soutiens institutionnels, il s’est posé contre une logique historique qui, selon lui, reposerait sur une forme de terrorisme théoricien dont le fondement est le culte du progrès en art, et qui aurait transformé l’anti-académisme en académisme, puis en académisme d’État.
31Comme Kundera, Duteurtre distingue deux modernités, qu’il n’envisage pas comme parallèles mais comme successives : la « bonne » modernité des avant-gardes de la première moitié du xxe siècle, riche de « possibilités infinies », et dans laquelle la France a joué une part essentielle, malheureusement sous-estimée, et la « mauvaise modernité » de la deuxième moitié du siècle, « répétition dogmatique de la première » pendant laquelle, sous le joug d’un systématisme fanatique hérité de l’école allemande (en particulier l’École de Vienne), « l’esprit moderne s’est effacé derrière le dogme moderne55 ». Ce faisant, par le jeu d’un comparatisme interartistique, Duteurtre élargit son propos au cinéma (en évoquant la Nouvelle Vague) et à la littérature (à travers l’exemple du culte d’une poésie supposée ésotérique, de Mallarmé à René Char56, et du Nouveau Roman). Dans les trois arts, il constate le même refus de plaisirs esthétiques premiers (en musique : la mélodie, la consonance, le rythme ; au cinéma et en littérature : l’intrigue) et la même quête d’une essence fantasmée de l’art, d’une profondeur, d’une pureté et d’une autonomie dont la conséquence est l’excès de rigueur formelle, une assise conceptuelle dont l’expansion est inversement proportionnelle à la générosité de la création artistique, et la coupure d’avec le public autre que celui des chapelles acquises à la cause. Comme terme annoncé à ce mouvement : rien moins que la mort de l’art, par effet de son dessèchement interne. Pour Duteurtre, la mort de l’art est en effet avant tout l’effet d’une logique interne dont les artistes sont eux-mêmes responsables. Dans le domaine musical, son geste anti-moderniste a eu pour effet (en grande partie favorable) de déverrouiller un système de valeurs particulièrement corseté et rigoureux, et de porter à l’écoute du public une série de répertoires injustement négligés. Si la parution de son pamphlet a créé une belle polémique (où la stupide accusation de propos fascisant, brandie plus d’une fois, a été retournée avec bonheur par l’écrivain contre ses auteurs), elle n’a cependant pas suscité de réponse théorique convaincante, et le paysage musical actuel rend bien compte des effets de cette mutation paradigmatique dont l’ouvrage est devenu le symbole. Notons cependant ceci : quand bien même l’essayiste a propension à manier le paradoxe (précisément en ceci qu’il aime à prendre la doxa à rebrousse-poil), la question de savoir si son anti-dogmatisme ne s’est finalement pas, à son tour, figé en dogmatisme, peut être posée. Surtout quand les fins appréciables (celles que nous avons dites) reposent sur des moyens contestables (propensions passéistes, démonstrations esthétiques reposant sur des principes de « naturalité » douteux, etc.)57.
32Les chroniques qui constituent Ma belle époque (2007), plus encore que la production romanesque de l’écrivain (qui en exemplifie telle ou telle donnée et repose pour une part sur le traitement caustique des travers de la modernité, sur la remise en question de ses fausses valeurs ; et pour l’autre sur l’éloge d’une forme de « belle époque » française fichée quelque part dans la première moitié du xxe siècle, et à la poésie anhistorique), constituent à ce titre un complément intéressant de Requiem pour une avant-garde. Elles livrent dans toute son homogénéité le territoire artistique et spirituel cher à Duteurtre, et c’est d’ailleurs cette homogénéité même, de même que le ressassement obsessionnel de certains thèmes (en particulier sur la musique légère brandie de façon militante contre l’avant-garde qu’il pourfend) qui transforment son anti-modernité souriante de néo-hussard insolent, en inclination passéiste non exempte de dogmatisme. À l’instar des héros des « romans de l’artiste » de Millet, et quand bien même il n’en tire pas les mêmes conséquences, Duteurtre aime à s’y afficher en moderniste précoce, pourtant revenu des errements de la modernité : « À quinze ans, je voulais être à la pointe de la modernité. Plongé dans les romans d’avant-garde et dans les musiques postsérielles, j’y trouvais quelques satisfactions fugitives… Mais ce goût élaboré ne parvenait pas à me satisfaire pleinement, comme s’il manquait toujours cette chose envoûtante qui passe par le récit, la narration, le rire, ce bonheur physique des sons et des rythmes58. » À l’inverse, il prône ce qu’il appelle un « conservatisme éclairé et généreux, opposé à ceux qui voient dans la destruction un pas en avant59 ». Il prône une émancipation par rapport au bon goût régi par la doxa moderniste, qui, selon lui, a toujours un métro de retard, et plébiscite donc pêle-mêle Debussy, Sacha Guitry, l’accordéon musette, les chansons de Fernandel, Marcel Aymé, Louis de Funès (et, au passage, Houellebecq), et fustige l’exception française, son anti-américanisme caricatural, la gauche moralisatrice, les errements de Boulez, l’obsession du style, caractéristique d’une avant-garde qui n’avait pas vu à quel point elle s’était ringardisée, etc.
33En réalité, cette conception du monde est plus complexe qu’elle n’y paraît. L’anti-modernisme de Duteurtre, par certains aspects authentiquement fécond (ainsi quand il offre quelques propositions pour sortir des « pièges » de la modernité60 et s’avère par là même effectivement « moderne »), a tendance d’une part à se figer en nostalgie passéiste, et d’autre part à se radicaliser en anti-modernité plus franche, dont les enjeux principaux ne sont pas si éloignés de ceux évoqués par Millet. À un épuisement de l’art dû à la logique moderniste interne, s’ajoutent en effet de façon insidieuse à travers ses chroniques des données extérieures qui en accentuent le processus. Ainsi, la « star academy » est-elle par exemple présentée par l’écrivain, en un propos et des préoccupations fort proches de Millet ou Camus, comme une uniformisation de l’art qui mène à sa perte la tradition du « chanter français ». Un texte consacré à l’abbaye de Saint-Wandrille permet de rêver à une sorte de Moyen Age chrétien intemporel qui serait « comme un refuge, une contradiction à l’angoisse du temps qui passe61 ». C’est alors l’occasion pour Duteurtre d’exprimer clairement une vision du monde résolument conservatrice. Ses propos relatifs à la perversion du projet moderniste sont fort semblables à ceux que développent Kundera, Quignard, ou Millet. Quant à ses interrogations sur l’identité française, elles reposent sur une rêverie où la Normandie vient jouer le même rôle mythique que le Limousin pour Millet, et où le sentiment de la langue et du paysage français (dont l’essence même est un certain chanter et une certaine musique, encore vivants il y a un demi-siècle) se serait perdu, dilué par les effets de la mondialisation.
Extrapolations et précisions
34Ces propos, développés à partir des prises de position de quelques écrivains français représentatifs (on aurait probablement pu évoquer également certains aspects de l’œuvre de Dominique Fernandez62), pourraient être élargis à plusieurs figures équivalentes dans les littératures étrangères, en particulier à des écrivains autrichiens tels que Thomas Bernhard (que Millet admire beaucoup) ou Elfriede Jelinek, ou encore le roumain Cioran, écrivains doublement caractérisés par le pessimisme et la mélomanie, et auxquels Nancy Huston accorde une place de choix dans sa galerie de « professeurs de désespoir ». On ne s’en étonne guère, d’ailleurs : Jacques Le Rider a bien montré comment ces écrivains rejouaient le scepticisme de la modernité viennoise et mittel-européenne de la première moitié du xxe siècle, et comment, par un jeu de transferts culturels dont Cioran et Kundera représentent précisément les derniers maillons importants, ce scepticisme particulier, en lequel Le Rider a vu l’un des traits majeurs de la post-modernité, a fasciné l’Europe de l’Ouest de la fin du même siècle, alors en pleine reviviscence des études et thématiques décadentistes63. Dans la littérature anglo-saxonne, un écrivain comme Anthony Burgess, malgré l’humour et le foisonnement baroque caractéristique de ses fables, qui le distinguent des figures précédemment citées, n’est pas loin d’illustrer la même veine64 (relayé dans une moindre mesure, aujourd’hui, par des écrivains également mélomanes comme Jonathan Coe, voire Julian Barnes, Graham Swift ou Ian McEwan).
35Est-ce à dire pour autant que tous les écrivains mélomanes contemporains sont des piliers du discours anti-moderniste, les principaux annonciateurs de la mort de la littérature ? Certainement pas. Sur le plan de la littérature internationale, nombre d’écrivains mélomanes sont en effet sortis de la problématique moderniste, ou n’y sont jamais entrés – ce qui ne les pas empêchés d’inclure explicitement les débats relatifs à la modernité dans leurs œuvres de fiction et de les envisager frontalement dans leurs essais. Parmi ces écrivains mélomanes ayant eu récemment une certaine audience internationale (et joui d’un bon accueil en France), citons entre autres Alessandro Barrico en Italie, Franck Conroy aux États-Unis, et plusieurs écrivains espagnols contemporains (Vásquez Montálban, Javier Marías, Felipe Hernández, etc.).
36À dire vrai, il semble que l’intrication entre mélomanie et discours anti-moderniste a pris une forme particulièrement aiguë en France, pays plus que tout autre hanté, on le sait, par la question de son affaissement culturel et, du même coup, identitaire. Pour autant, en France, la mélomanie active de figures comme Jean Echenoz, Christian Gailly, Tanguy Viel ou François Bon, pour ne citer qu’eux, est depuis longtemps connue, sans pour autant qu’on puisse leur imputer une quelconque participation à la geste néo-décadentiste. Avant eux, la mélomanie d’un Butor, d’un Robbe-Grillet, voire d’une Duras, était même assez évidemment partie prenante de l’assurance progressiste qui sous-tend toute l’histoire du Nouveau Roman. Il est même intéressant de constater que Robbe-Grillet, dans sa tardive trilogie autobiographique (Le Miroir qui revient, 1985, Angélique ou l’enchantement, 1988, Les Derniers Jours de Corinthe, 1994), pouvait, en s’appuyant sur la fable wagnérienne, produire de façon abondante et détaillée le même type de discours sur la « fin » (de la fiction, du sujet, des grands récits historiques, des idéologies, etc.), mais c’était alors pour en dégager, en un propos exempt de toute nostalgie, un paradoxal sentiment de liberté créatrice65. Dans ses écrits théoriques (Lettrines 1 et 2, En lisant en écrivant), Gracq utilise la figure de Wagner aux mêmes fins (en faire la figure type d’un xixe siècle, siècle des grands hommes et des grandes œuvres, des croyances naïves et de l’histoire, etc.), mais c’est au contraire pour placer son discours sous le signe de l’âge d’or perdu, de la nostalgie et de l’entrée en décadence66. Gracq (édité chez José Corti – mais son « inactualité » est-elle finalement si éloignée de celle d’un Millet à son époque « modérée » ?) et Camus (publié chez P.O.L.) mis à part, il est en réalité assez évident que l’on doit distinguer ici un pôle représenté par les écrivains mélomanes des éditions Gallimard (Quignard, Millet, Fernandez, Duteurtre, etc.) et les écrivains mélomanes des éditions de Minuit (Echenoz, Gailly, etc.), les premiers s’attaquant d’ailleurs régulièrement aux seconds. Dans son Requiem pour une avant-garde, Duteurtre souhaite ainsi liquider en un seul et même mouvement non seulement l’héritage de l’avant-garde sérialiste mais aussi les fondements mêmes du Nouveau Roman (comme le faisait d’ailleurs le même Gracq en son temps), cependant que Millet fait de la « petite musique » d’Echenoz l’un de ces traits caractéristiques de cette fausse modernité qu’il abhorre, une modernité caractérisée par un relâchement de la langue qui n’est rien d’autre, d’après lui, qu’une détérioration de son éthique67.
37Dans le même ordre d’idée, il convient également d’apporter ici une autre nuance à notre propos. Il est ainsi évident que la mélomanie et le scepticisme des écrivains mélomanes sceptiques ici évoqués ne sont pas entièrement comparables. Si Millet, Camus, ou même Fernandez déplorent dans une plus ou moins grande mesure la remise en question du système des valeurs en art (le premier regrettant fortement ce qu’il appelle le principe de « verticalité »68), Duteurtre cherche au contraire à accélérer le processus de transvaluation et de relativisation, en réhabilitant certains pans de la culture musicale, cinématographique et littéraire, que le culte de la profondeur hérité de la tradition romantique germanique avait ostracisés. Camus, qui vise ici assez clairement Duteurtre, trouve ainsi « comique de voir les hérauts de la chansonnette, qui sont les pires tenants des éternelles variations à la batterie sur l’éternelle marche militaire ou totalitaire fondamentale, s’ériger en champions de la modernité et rejeter parmi les vieilles barbes les admirateurs de Grisey, de Pesson ou Ferneyhough69 ». En corollaire, Camus insiste sur la nécessité de la hiérarchie entre les arts, mais aussi au sein d’un même art : « Cela étant, qu’il y ait une hiérarchie entre les arts n’implique pas qu’il n’y en ait pas à l’intérieur de chacun. Un grand compositeur de chansons peut être un meilleur musicien qu'un mauvais compositeur de musique savante. Cela n’implique pas que la chanson en bloc est un art aussi précieux que la musique savante en bloc70. » De même, entre la posture néo-hussarde des uns, le conservatisme académisé des autres, et les positions franchement réactionnaires des troisièmes, l’éventail ouvert par les anti-modernistes est relativement large, et leurs tenants et aboutissants ne se recoupent qu’imparfaitement.
38Mais si ces distinctions sont nécessaires, il faut dire aussi que la concordance des thèmes et débats en jeu construit cependant un important dénominateur commun. Ce sont : l’élection d’une série de figures communes, qu’elles soient musicales (Couperin et Debussy), littéraires (Gombrowicz) ou cinématographiques (Fellini), l’obsession de la disparition du genre romanesque (bien plus que de la poésie), le sentiment d’une perte des valeurs, l’échec des politiques éducatives et des politiques culturelles de masse, le thème de la première (bonne) et de la deuxième (mauvaise) modernité, la critique du militantisme avant-gardiste, la réévaluation dans tous les arts de formes esthétiques condamnées par les avant-gardes, le rejet d’une forme de « totalitarisme mou » caractéristique des sociétés démocratiques post-chrétiennes, et dans lequel le minoritarisme, le communautarisme et le consensus « politiquement correct » occupent une place importante, une critique des méfaits de l’urbanisation qui fait perdre le sentiment d’une langue ancrée dans un sol (référence récurrente aux cathédrales et paysages de France), une relation complexe aux liens qu’entretiennent la France et les États-Unis, un rejet de la culture rock et plus largement d’une ère du « tout sonore » qui empêche de jouir du jeu délicat de la musique authentique et du silence, un éloge de l’activité de l’écrivain en tant que pratique musicale silencieuse permettant la résistance individuelle à ce processus d’indifférenciation généralisée qui caractérise les temps présents, etc.
Première mise en perspective : la littérature allemande de l’entre-deux-guerres
39De toutes les façons, force est de reconnaître que cette manière d’articuler obsession de la fin et mélomanie n’est pas neuve. Elle était ainsi particulièrement représentée, durant l’entre-deux-guerres, parmi les écrivains de langue allemande, et c’est d’ailleurs souvent à eux que se réfèrent les écrivains évoqués ici. C’est Nietzsche qui, en amont, a scellé définitivement le sort conjoint de la musique et de la décadence, en faisant de la première, « manifestation tardive de toute civilisation », la fleur même de la seconde. La proposition est reprise par des écrivains comme Thomas Mann (Considérations d’un apolitique hantées par le thème du « finis musicae »71 comme métonymie de la fin en général, Le Docteur Faustus [Doktor Faustus, 1947]), Hesse (Le jeu des perles de verre [Das Glasperlenspiel, 1943]) et surtout Broch (l’ensemble des essais qui forment Création littéraire et connaissance [Dichten und Erkennen, 1955]), trois écrivains qui, parmi tant d’autres, n’ont cessé de traiter de concert ambiguïté musicale, devenir problématique de la germanité et déclin de l’esprit européen. La thématique du mal et le motif du démonisme permettent de « fictionnaliser » ces questions dans des œuvres où l’on quête toujours plus en amont dans l’histoire de la culture occidentale l’origine de sa chute, et où la « littérature de la fin » se met de plus en plus à coïncider avec l’hypothèse de « la fin de la littérature »72.
40Dans son essai sur Conrad (Vorwort zu Conrad’s « Geheimagent », 1925), T. Mann avance ainsi, en un propos que ne désavouerait pas, aujourd’hui, un Richard Millet, également sensible à la question de la perte du sentiment de la « grandeur » :
Avouons que le format manifestement plus frêle du xxe siècle ne l’emporte même pas par la finesse sur le format plus héroïque de son prédécesseur ! Chez Wagner, Dostoïevski, et même chez Bismarck, le xixe siècle unit le gigantisme à l’extrême raffinement, un raffinement ultime des moyens, auquel il est vrai est inhérente une nuance pathologique et barbare. Mais peut-être est-ce précisément le renoncement à cet élément de barbarie pathologique – on pourrait presque dire d’asiatisme –, déterminant le format plus élégant de l’esprit actuel, qui nous donne le sentiment qu’il nous est apparenté, fraternel, qu’il n’appartient plus à hier, à nos pères. À la base de notre manque de grandeur se trouve peut-être la volonté d’arriver à une humanité plus pure, plus claire, plus saine – on aimerait dire plus grecque- que celle qu’a connue la sombre monumentalité du xixe siècle73.
41Dans Le Journal du Docteur Faustus (Die Entstehung des Doktor Faustus, 1949), le carnet qu’il a tenu pendant la rédaction de Docteur Faustus, Mann dit également qu’il a voulu écrire le roman de la musique entendu comme le roman de la civilisation et de l’époque, un roman qui donnât « le sentiment de la fin dans toutes ses acceptions74 ».
42Un même type d’idée était déjà à l’œuvre dans le roman quasi fantastique de Hermann Hesse intitulé Le Loup des steppes (Der Steppenwolf, 1927). Le protagoniste Harry Haller est obsédé par l’idée de l’apocalypse, de la mort de la civilisation et des valeurs en lesquelles il croyait. Cette pensée, qui remet en question l’ère bourgeoise, les valeurs de l’État, de la religion, de la famille et de la patrie, passe par le truchement de la musique, et c’est pourquoi défilent dans le roman (en plus de Goethe) Mozart, Brahms, Wagner et bien d’autres. Le jazz lui apparaissant comme une musique de la décadence et Mozart comme celle de la civilisation, il est amené à se demander si cette civilisation, cette idée de culture, ne sont pas « des spectres morts ». « Le monde civilisé » prend pour lui la forme d’un cimetière où « Jésus-Christ et Socrate, Mozart et Haydn, Dante et Goethe n’étaient plus que des noms aveugles sur des tables de métal rouillées75 ». Mozart et Goethe sont présentés comme étant les derniers représentants d’un âge béni, depuis entré en décadence. La modernité post-mozartienne fait l’objet à la fois d’une fascination et d’une répulsion : quelle différence, se demande d’ailleurs Harry, du point de vue de leur choquante érotique musicale, entre Tristan et Isolde de Wagner hier, et le jazz aujourd’hui ? Il n’y en a pas : il s’agit de la même époque, de la même musique qui, pour avoir parfois libéré les corps, ont pourtant oublié l’immortalité de l’âme. Comme dans La Montagne magique (Der Zauberberg, 1924), la présence du phonographe témoigne d’une technicisation de la musique inquiétante et diabolique.
43La liaison entre musique et civilisation à son jugement dernier est encore plus fortement soulignée dans Le Jeu des perles de verre (Das Glasperlenspiel, 1943). Ce roman d’anticipation raconte l’essor et le déclin d’une province idéale, la Castalie, qui, à rebours d’un monde en déréliction, tire sa richesse spirituelle d’un jeu musical et mathématique presque magique : le jeu des perles de verre. Au début du roman, la naissance du jeu est en effet expliquée par un résumé de l’histoire de la musique et de la culture occidentale qui présente celles-ci comme une décadence, et que seul le jeu peut, a contrario, régénérer. Wagner n’est pas nommé, mais, à la lumière des principaux textes qu’Hesse a écrits sur la musique, on comprend qu’il constitue le centre et l’accélérateur de ce processus de décadence, celui qui a fait entrer la civilisation moderne dans l’ère des « pages de variété », du pathos, de l’hypersensibilité, de la virtuosité. C’est enfin, ainsi que l’on peut le comprendre à la lumière de l’évocation de légendes orientales, celui qui a précipité la civilisation dans l’ère de la « musique bruyante », signe d’une décadence de l’État et de la collectivité, de l’ébranlement forcené d’un cosmos qui a quitté l’idéal de l’harmonie des sphères. En effet, dans le premier chapitre de cette somme musico-européenne, « l’essai à l’introduction de l’histoire du jeu des perles de verre », il est signalé que la musique de l’époque classique constitue « l’essence de notre culture », mais qu’il faut, pour retrouver celle-ci dans toute sa pureté, remonter à la fin du Moyen Age, car, depuis, s’est manifesté « le caractère frelaté de la vie intellectuelle et culturelle ». La décadence est révélée par le penchant collectif à la « mélancolie », à la « neurasthénie », au « cynisme », au « pessimisme », à la fausse énergie et à la fausse grandeur, et, comme chez Mann, à la « prédominance du sensuel » sur le « serein » et le « résigné ».
44À l’inverse, dans l’utopie de la Castalie, le jeu des perles de verre propose un idéal collectiviste de l’anonymat, éloigné de la pensée romantique du génie. C’est une synthèse de la culture, une langue « mondiale et intellectuelle », qui s’opposent à la dégénérescence générale de la langue. À terme, le roman montre cependant à quel point l’idéal castalien est en réalité vicié de l’intérieur, en un monde qui, de surcroît, le considère comme un luxe vain, et qui remet en question l’idée même de la culture. La figure de Tegularius, génie déséquilibré qui, contrairement à Knecht, ne sait maintenir en lui l’équilibre entre instinct de conservation traditionaliste et ouverture d’esprit lucide au progrès, est la figure de cette déchéance annoncée qui menace la Castalie. Là encore, c’est la musique qui, chez Hesse, permet de dresser, sous la forme d’un roman d’anticipation, le procès de cette civilisation qui a mené à la catastrophe collective.
45Si, dans ses différents essais(Hofmannsthal et son temps [Hofmannsthal und seine Zeit] et « Quelques remarques à propos du kitsch » [« Einige Bemerkungen zum Problem des Kitsches »]), Broch dresse également le procès de l’œuvre de Wagner, c’est qu’elle est selon lui symptomatique d’une époque vide de toute valeur esthétique et spirituelle, et de ce fait, plongée dans le cercle infernal, antéchristique, du simulacre. Ce propos a beau être consacré à Wagner, il engage par ricochet la plupart des courants littéraires de la fin du xixe et du début du xxe siècles (de l’art pour l’art à l’expressionnisme), et c’est toute la production littéraire de l’époque, incapable de produire le mythe dont elle a pourtant tant besoin, qui est visée en premier chef. L’anti-wagnérisme (admiratif) de Broch tient à une pensée de la décadence dont il faut rechercher les racines bien en amont du xixe siècle : à l’aube de l’Europe moderne. C’est la Renaissance et particulièrement la Réforme, qui, selon Broch, sont en cause. La Réforme, en tant que moment de la naissance, en Occident, de l’individualisme bourgeois, est à la fois responsable de la grandeur et des misères de l’homme européen. La survalorisation de l’individu, l’exercice du libre-arbitre par lequel l’homme devient la mesure de la question religieuse, sont les raisons de l’affaissement des valeurs que fédérait autrefois la religion chrétienne. L’art médiéval, au contraire de l’art renaissant, était synonyme de perfection, d’harmonie et d’équilibre. La Renaissance, à l’inverse, est le signe d’un affaissement de cette complétude, un affaissement en quelque sorte par excès, par orgueilleuse démesure. Broch avance alors une hypothèse essentielle : « Ce temps de désagrégation est celui d’une certaine attitude appelée romantisme76. »
46Le romantisme n’est pas simplement une donnée historique, c’est aussi une posture transhistorique qui a trouvé dans le romantisme historique son plein épanouissement et en Wagner son temps de culmination. L’origine de l’affaissement des valeurs tient donc à ce transfert du divin de l’Eglise à l’homme, transfert qui est à l’origine d’un programme éthico-esthétique aussi grandiose qu’impossible à réaliser, et de ce fait même précaire et dangereux77. Ceci s’explique, dit Broch, par « l’impossibilité » propre à l’art romantique « de maintenir indéfiniment la tension cosmique »78. Qu’entendre par là ? Tout simplement l’incapacité, pour l’artiste devenu démiurge, de réaliser une tâche divine, de faire descendre ici-bas le sublime éternel des ciels étoilés, de donner irrévocablement la Beauté aux hommes. L’art ne peut assumer éternellement le rôle d’une ligne de haute tension cosmique et spirituelle. Contraint à l’idéal, au jouissif, à l’exaltant, il tente l’élévation divine, mais menace à chaque instant de revenir s’écraser sur le sol terrestre.
47Cette impossibilité aurait dû, selon la pensée de Broch, engendrer un système de valeurs ouvert, caractéristique des époques de transition. Or c’est exactement l’inverse qui a lieu : l’idéal de la beauté descendu dans l’œuvre d’art a clos le système. Par cette fermeture, le système ne devient rien d’autre que la copie de ce qu’il voulait être, le système chrétien. Ce pseudo-système, c’est, selon Broch, l’Antéchrist79. En lui, l’art s’est réduit à la pure esthétique tout en ayant l’apparence de cette éthique qui caractérisait le système chrétien : c’est l’apparition du Mal dans le système de l’art. Ce mal, ce n’est rien d’autre que le kitsch, un système clos sur lui-même, imitant la perfection du système chrétien, mais dont le centre est le vide des valeurs : rien d’autre que la mort. Ainsi, le style du xixe siècle est le non-style : un éclectisme qui revêt l’aspect du style. La « névrose », qui fait selon Broch le fond de cet art, et qui trouve son chef-d’œuvre le plus caractéristique dans le Tristan de Wagner, vient de la fermeture forcée de son système. Pour une importante partie des écrivains contemporains traités au début de cette étude, la pensée de Broch a certainement valeur de paradigme. Nul doute que, de L’Art du roman de Kundera (1986) à Désenchantement de la littérature de Millet, en passant par de nombreux essais hantés par le spectre de la « fin », le désir d’écrire un nouveau « Mal dans le système des valeurs de l’art » (« Das Böse im Wertsystem der Kunst », 1933), celui des temps présents, est très grand.
Deuxième mise en perspective : l’obsession décadentiste chez les écrivains mélomanes
48En définitive, il est une constante fondamentale et même fondatrice dans l’imaginaire et les discours de l’écrivain mélomane, et qui explique cette articulation particulièrement forte que l’on a pu recenser entre mélomanie et conception du monde hantée par l’obsession déclinologique : c’est l’omniprésence, exercée par lui tant à l’échelle de l’individu qu’au niveau de la civilisation dans son entier, du schème philosophico-historique suivant : âge d’or, marqué par la fusion / décadence, marquée par la division et la perte / espoir de régénération, avec une définition et une tentative de mise en œuvre des moyens pour y parvenir. La figure la plus représentative de cette disposition est évidemment Rousseau, mais on constate qu’elle est plus ou moins présente chez tous les écrivains mélomanes.
49Au niveau de l’individu, il s’agit d’une physiologie qui parcourt tous les âges de la vie. Tout éloignement par rapport à l’état prénatal (naissance, adolescence, etc.) est alors considéré comme une chute : chute loin d’un continuum musico-chantant idéalisé, chute dans le temps, dans le corps et dans le langage. À travers toute son œuvre, Quignard présente cette fable de façon spectaculaire mais on peut signaler qu’elle est déjà présente chez Rousseau ou Stendhal. Au niveau de la collectivité, cela relève de plusieurs données qui sont amenées à confluer. Il s’agit tout d’abord d’une philosophie de l’histoire. Son mythe est celui de l’âge d’or unitaire, total et fusionnel entre l’esthétique, le politique et le religieux, entre les arts, entre la musique et le langage, etc. Les fantasmes relatifs à la tragédie grecque, au mythe orphique, aux figures du nourrisson, du berger paysan, ou à l’androgyne, en sont les figures incontournables. Particulièrement présentes au xviiie siècle, elles sont reliées au mythe de la punition musico-littéraire par excellence : Babel80. On retrouve cependant encore la trace de telles considérations chez un Lévi-Strauss81.
50Après la philosophie de l’histoire intervient une sorte de « géopolitique » spirituelle, c’est-à-dire une tendance consistant à caractériser de telle ou telle manière les spécificités spirituelles supposées de tel pays ou tel ensemble de pays. Philosophie de l’histoire et géopolitique spirituelle sont logiquement liées. Ainsi, selon cette approche, le globe de la perfection musico-langagière originelle se serait éclaté sur le territoire européen, et chaque nation n’en aurait donc récupéré qu’une partie, avec un plus ou moins grand bonheur. On connaît les composantes du modèle rousseauiste, présentées par exemple dans L’Essai sur l’origine des langues. Elles sont largement répandues parmi les écrivains mélomanes, et l’on en a vu quelques aspects : en raison des effets des climats, incomberaient par exemple au Nord, la musique instrumentale, le langage sec et cassant, la philosophie, etc. ; au Sud, au contraire, la musique vocale, les voyelles, la poésie, etc. C’est une telle hypothèse qui permet à Stendhal de faire de Naples le « Greenwich » de la musique. Ce modèle est repris au cours du xixe siècle et au début du xxe siècle, dans l’opposition entre germanité et méditerranéité, culture et civilisation, etc. Ajoutons que, de Rousseau à Nietzsche (voir, de ce point de vue, les « récits » proposés dans La Naissance de la tragédie (Die Geburt der Tragödie, 1872) et la Quatrième inactuelle « Richard Wagner à Bayreuth » [Unzeitgemässe Betrachtungen IV « Richard Wagner in Bayreuth », 1876), l’hypothèse est sans cesse avancée que cette décadence philosophico-historique et, dès lors, géopolitique, continuerait perpétuellement son cours.
51À cette philosophie de l’histoire et cette géopolitique s’ajoutent encore différents domaines. D’abord une politique au sens large. Selon une tradition pythagoricienne à laquelle est venu s’ajouter par la suite tel ou tel imaginaire oriental (voir Hesse dans Le Jeu des perles de verre, ou Quignard), à tel état musical correspondrait tel état politique (et vice-versa). L’état avancé de décadence dans l’un serait le symptôme et l’agent de l’état avancé de décadence dans l’autre. Nietzsche ne dit pas autre chose quand il instruit le double procès de Wagner et de la germanité dans ses essais Le Cas Wagner et Nietzsche contre Wagner. Deuxième constante de ces modèles mus par un pessimisme philosophico-historique : la pensée musico-linguistique. Ainsi, la façon dont tel ou tel écrivain mélomane envisage l’articulation entre écrit, parlé et chanté, est également dépendante de l’omniprésence de ce schème – le passage de l’un à l’autre pouvant être envisagé comme étant le fait d’une sorte de dégradation. Il retourne donc souvent d’une théorie de la naissance (généralement présentée comme conjointe) du langage et de la musique, de leur séparation et dégradations respectives, et des hypothèses théoriques et pratiques pour permettre leur régénération. Il retourne également d’une théorie des passions, de leur articulation aux mediums artistiques, et des modalités de restitution des passions. L’idée est que la décadence d’un idiome originellement parfait (musical, langagier et gestuel tout à la fois) entraîne une insuffisante prise en compte des passions, voire leur distorsion ou perversion, préjudiciable pour l’individu, pour la collectivité et la civilisation. Il retourne enfin presque toujours d’une théorie de la relation entre les arts, déclinée en deux questions : leur origine est-elle commune ou séparée ? Et : qu’en doit-il être aujourd’hui ?
52La constitution du modèle musical de l’écrivain, effectué a priori (par l’auteur) ou a posteriori (par le critique), est donc fortement déterminée par ce schème philosophico-historique. Si bien que, tout comme la vision du monde, les principes organisateurs de l’œuvre artistique (esthétique, poétique, et pratique) sont en effet souvent sous-tendus par le fantasme régénérateur et l’inclination compensatoire. La mélomanie mène en effet souvent à un fantasme : la réinvention compensatoire du langage, du style, de la forme. Il s’agit de compenser les apories dont le langage semble faire preuve par rapport à la musique, et surtout de reconstituer ce langage premier idéal que l’on aurait perdu. Dès lors, le modèle de l’œuvre d’art rédemptrice, en tant qu’il engage souvent frontalement le questionnement musico-littéraire, et indépendamment ou non de la question religieuse, est fréquemment sollicité par les écrivains. On le trouve chez Proust, Eliot, Claudel, Joyce, Broch, et même – teinté de reflets diaboliques – chez T. Mann. Dans la deuxième moitié du xxe siècle, cette tendance s’estompe au profit d’un certain pessimisme, exprimé tantôt sur un mode tragique ascétique ou comique ludique. Ceci n’est pas sans conséquence sur la forme des œuvres. On peut ainsi citer comme exemples, partant pourtant dans des sens opposés, mais à partir d’un même constat de sédimentation de la culture et de la dissolution des êtres dans une collectivité hypnotisée : la multiplication des tentatives, chez un Burgess, d’adapter les formes musicales à la littérature, la place du thème et de la variation chez Kundera, l’écriture litanique d’un T. Bernhard, la place du fragment chez Quignard, etc.
53À ce schème est encore liée cette donnée constante que nous avons tenté de mettre en lumière dans cette étude : l’inclination anti-moderne des écrivains mélomanes, une inclination dont la relation avec la mélomanie ne serait pas de hasard, mais au contraire présentée comme logique et même organique. Cette donnée précède largement l’époque où la « musique savante », opposée aux musiques populaires, pourrait connoter son amateur en termes socioculturels – dans le sens d’un aristocratisme élitiste aux virtualités réactionnaires. Ainsi, chez Rousseau, l’anti-progressisme du Discours sur les arts et les sciences et le décadentisme de la Lettre sur la musique française confluent jusqu’à se superposer dans le Discours sur l’origine des langues. Chez Hoffmann, les discours tenus contre les Lumières, en tant que les Lumières auraient tué les valeurs romantiques, dont la musique constituerait par ailleurs la clef de voûte, abondent. À partir du romantisme allemand, la germanité commence d’ailleurs à se définir contre la civilisation française par le biais des notions d’apolitisme et d’idéalité musicale. Cette donnée s’intensifie chez Nietzsche et T. Mann. Pour ce dernier, à l’heure des Considérations d’un apolitique, germanité, apolitisme, inclination musicale, conservatisme, pessimisme, ironie, morbidité, réforme, sont des notions présentées comme synonymes, et violemment opposées à leurs homologues dans la civilisation méditerranéenne. Les propos de Stendhal comparant sa position par rapport à la Révolution française82 à la relation qu’il entretient à l’égard de la révolution rossinienne, ou ceux de Gautier évoquant les effets néfastes de la Révolution de 1848 sur le monde de l’opéra83, sont clairs : position esthétique et politique se rejoignent chez ces deux modernes anti-modernes en une certaine forme d’anti-progressisme. Ceci pourrait se retrouver chez la plupart des écrivains mélomanes, voire la plupart des « mouvements » artistiques mélomanes (le romantisme et le symbolisme sont ainsi, pour un Gracq, foncièrement mélomanes) qui disent entretenir une relation privilégiée avec la « tradition ». Et ce phénomène a tendance à s’accentuer dans la deuxième moitié du xxe siècle, avec des écrivains comme Kundera, Quignard, Burgess, ou Millet. A contrario, on peut avancer ceci que les avant-gardes de la première moitié du xxe siècle sont plutôt anti-musicales. Le cas de Breton et du surréalisme est de ce point de vue particulièrement éloquent (mais aussi, dans une moindre mesure, de Marinetti et de certains futuristes). Le symbolisme russe ou l’expressionnisme allemand partent quant à eux d’un modèle musical pour se retourner contre lui.
54Chez ces auteurs enfin, comme on l’a vu, l’histoire de la musique est considérée, depuis une forme d’âge d’or perdu, comme marquée par la décadence, une décadence parallèle à celle de la littérature. Et ces deux décadences sont considérées comme de bons miroirs pour observer la dissolution de l’identité française ou la décadence de la culture européenne. L’image négative que, dans sa relation à la musique, peut avoir la technique chez ces écrivains (le phonographe chez T. Mann, ou le poste de radio, de Hesse à Kundera) est leur corollaire. De cette anti-modernité de l’écrivain mélomane, Richard Millet livre certes aujourd’hui une image particulièrement éclatante, mais on remarquera que certains « écrivains rock » tels que Maurice G. Dantec ou Michel Houellebecq manifestent également, sous une forme d’ailleurs nettement plus violente que celle des éternels Hamlet de la mélancolie européenne, une semblable inclination réactionnaire. De façon globale, on remarque donc qu’un lien semble s’être depuis longtemps établi entre mélomanie et aspirations anti-rationalistes. En bien ou en mal, c’est ce que l’on se refuse de dire. Il est en effet difficile de faire la part des choses, chez ces auteurs (et les plus récents en particulier) entre lucidité critique, c’est-à-dire relation critique et constructive à la modernité, refusant tout dogmatisme et adhésion béate d’une part, et penchant plus franchement réactionnaire de l’autre. Chant du cygne ou chant de l’aube, on ne sait, mais, on l’aura compris, chant toujours.