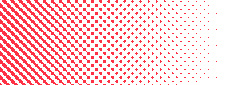« Usages du roman pour une littérature usagée » : l’instrumentalisation du roman au service de la fin de la Littérature
1« J’ai le surplomb vertigineux et dégrisant de l’outre tombe, qui est une des conditions de ma liberté1 » proclame la voix, le juge, Richard Millet, présence fantomatique face à l’assemblée réunie ici. Sur le banc des accusés, des écrivains, bien visibles. Parmi eux, Michel Houellebecq, la cigarette aux lèvres, un peu courbé sur son banc, il n’a pas pris soin de retirer sa veste difforme et souligne au marqueur quelques passages de La Philosophie pour les nuls2 ; près de lui, Will Self, tentant vainement de dissimuler le livre jaune qu’il tient à la main et enfin Julian Barnes qui vacille sous le poids de ses livres. On distingue toutefois Le Dictionnaire des idées reçues de Flaubert, posé négligemment sur une vieille Bible. Nulle défense derrière eux, mais un bon nombre de complices contre lesquels le juge multiplie les harangues. Ainsi se côtoient la démocratie, la publicité, le journalisme, la télévision, tous condamnés en bloc par le juge. Ce dernier, qui tient en main l’arme du crime, le roman, s’exclame : « au sein d’une civilisation rongée par le mensonge, le roman serait une des voies d’accès à la grammaire du monde3 ». Puis, au nom de « la nation, la langue, la grandeur, la pureté, l’élitisme, la permanence, le paysage, le christianisme, la faculté de juger, l’esprit critique, la méditation4 », il prononce sa sentence :
Je laisse aux misérables romanciers contemporains les « problèmes d’aujourd’hui », c’est-à-dire la contribution à la perte du sens et à l’enténèbrement du monde, et aux sociologues en mal de romanesque politique le soin d’entériner l’extraordinaire mensonge qui fonde les sociétés contemporaines5.
2Mais aucune réaction de la part des accusés qui poursuivent tranquillement leur lecture en attendant la fin de la séance.
3Cette représentation imagée, fictive et peut-être simpliste met en relief la situation actuelle de la littérature à partir de laquelle s’établira notre réflexion. En effet, Richard Millet, dans son triptyque composé du Dernier écrivain, de Place des pensées, et de Désenchantement de la littérature, augmenté de son Essai de démonologie, nous offre une vision de ce qui ne semble plus être qu’un champ de ruines, c’est-à-dire la littérature contemporaine, ainsi qu’une réflexion sur « la condition de l’écrivain dans ce nouveau millénaire : une réflexion inquiète (et en un sens, quasi thaumaturgique) sur sa disparition en tant qu’elle ne serait plus constitutive de sa démarche6 ». Nous tenterons de rendre compte de ce discours en prenant pour appui des œuvres pouvant constituer les cibles potentielles de Richard Millet, puisqu’elles cristallisent un certain nombre des accusations portées par l’auteur à l’encontre de la pratique littéraire actuelle. C’est donc par l’intermédiaire de l’interprétation et de l’exemplification que nous nous ferons les « continuateurs » de Richard Millet pour désigner les coupables de la fin de la littérature, ces romanciers qui instrumentaliseraient le roman pour mieux servir leur visibilité médiatique. Ceux-là même qui ne s’exprimeraient qu’à travers le recyclage des formes et des genres et qui n’auraient plus l’ambition de se confronter aux grands textes de la littérature mais bien de les oublier ou de les ternir. Cette première approche nous permettant en outre de dégager la cohérence de notre corpus.
4Mais, et c’est le sens de l’absence de réaction des coupables dans notre jugement fictif, si les œuvres peuvent justifier le postulat de Richard Millet, les auteurs ne sont pas seulement les victimes ou les dupes de la fin de la littérature mais aussi bien les porte-paroles. Contre la condamnation sans appel du juge, « il y a la littérature ou la mort78 », ils suppriment les guillemets, la majuscule ou l’italique qui protégeaient la littérature du monde. À la sacralisation figée de Richard Millet, nous opposerons donc une redéfinition de la littérature, une littérature d’après la Littérature. Cette dernière permettant ainsi de déterminer une nouvelle fonction de l’écrivain dans la société et le retour de la société dans l’œuvre, celle-ci cristallisant son malaise. Enfin cette redéfinition ne va pas sans une certaine mélancolie commune au juge et aux accusés; mélancolie paradoxale que nous ne manquerons pas d’étudier notamment par l’intermédiaire de la résurgence de la figure du « Terroriste », désormais devenu « tranquille ».
5Si chacun des auteurs constitue une cible potentielle pour Richard Millet, la mise en place d’un corpus comparatif se doit d’être justifiée. En effet, le parallèle entre deux auteurs anglais (Julian Barnes et Will Self) et un auteur français, Michel Houellebecq, ne relève pas seulement d’un choix arbitraire. Tout d’abord, ce dernier constitue une forme de double inversé de Richard, Millet puisque leurs constats se font écho tandis que leurs postures diffèrent radicalement. À Richard Millet qui s’enflamme pour « la France en voie de muséification et de commémoration perpétuelle d’elle-même [qui] devient pour l’écrivain un lieu d’ascèse jubilatoire, une thébaïde, une catacombe où redéployer l’espace littéraire comme un lieu d’une expérience intérieure9 », Michel Houellebecq semble rétorquer de manière moins emphatique et poétique : « Disons les choses plus crûment : est-ce que j’ai envie de voir transformer la France en un pays muséifié, mort ? En une sorte de bordel à touriste ? […] sans hésiter je réponds: OUI10 ».Cette approche comparatiste est motivée par les déclarations souvent virulentes de Richard Millet à l’encontre de la littérature anglo-saxonne en général et de la littérature britannique en particulier. Ainsi affirme-t-il : « Seule l’Angleterre existe encore, mais seulement par sa langue, dont les autres nations la dépossèdent littérairement11 ». Le questionnement sur la fin de la littérature s’effectuera par l’intermédiaire de romans qui offrent une vision spéculative de la société du xxie, tels Les Particules élémentaires12 et La Possibilité d’une île13 de Michel Houellebecq, mais aussi England, England14 de Julian Barnes. Interprétant les événements du présent comme les signes d’un déclin futur, les écrivains ne prophétisent pas seulement l’avenir de la littérature mais bien celui de l’humanité toute entière. Ce déclin dont le roman porterait les stigmates tout en continuant à en être le porte-parole. Si ces auteurs font face au présent pour envisager l’avenir, Will Self détourne le regard vers le passé pour réécrire Le Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde, vieux de près d’un siècle, laissant le mythe de l’éternel recommencement se charger de faire de Dorian, an Imitation15 le « nouveau roman fin de siècle » et nous permettre de placer Will Self au premier rang des accusés pour « délit de remake ». L’évocation de l’œuvre plus ancienne de Julian Barnes, A History of the World in 10 ½ Chapters16, sera pour nous l’occasion d’aborder ce que Richard Millet nomme péjorativement le « recyclage » de la littérature sans prendre soin d’encadrer l’expression par des guillemets faisant entendre que l’image n’est pas une simple métaphore de la situation de la littérature à l’époque contemporaine.
1. Le roman au service de la fin de la littérature.
Figure vs image
6Richard Millet relève que la littérature n’existe que dans « une extériorité non linguistique » et que la figure de l’écrivain se transforme en une image « photographique, toujours la même, interchangeable, inévitablement posée donc putassière17 ». De nombreux travaux ont mis en évidence la posture de Michel Houellebecq telle qu’elle découle de la porosité entre ses déclarations publiques et les thèses qu’il défend dans le domaine normalement protégé de la fiction. Dans la construction de cette posture, l’image de l’auteur et par conséquent sa photographie semble avoir une importance particulière. Ainsi, une simple couverture de roman devient le signe de cette « extériorité non linguistique » dénoncée par Richard Millet. L’édition « J’ai lu » des Particules élémentaires affiche la photographie de Michel Houellebecq, laissant la visibilité médiatique de l’auteur prendre le pas sur l’œuvre elle-même. En effet, il semble que par les scandales produits par ses œuvres et ses déclarations provocatrices, l’écrivain ait suscité l’attention autour de sa personne et de ses œuvres, et par ce biais ait accordé à ces dernières une valeur ajoutée de « politiquement non correct ». N’avons-nous pas son image fixée dans la mémoire ? Celle n’entame-t-elle pas cette part de mystère propre à l’écrivain ? Cette photographie, suivant le modèle du logo sur un produit de consommation, reste inchangée entre le roman Les Particules élémentaires publié en 1998 et la correspondance entre l’écrivain et Bernard-Henri Lévy. Dix ans plus tard, le blouson de cuir a remplacé le costume mais la cigarette est toujours là, négligemment posée dans le coin des lèvres révélant cette nonchalance propre à l’auteur, la photographie en noir et blanc ayant remplacé la coloration sépia. Cette dernière s’empare de l’œuvre et installe une confusion entre ce qui concerne la personne de l’auteur et ce qui appartient à la fiction. Nous assistons à une modification générique par le biais du recours à l’image. Richard Millet le souligne :
La question littéraire se réduisant à l’individualisme nihiliste et à la stratégie des prix littéraires, révélatrice de ce qui, là comme dans d’autres secteurs commerciaux, tend à substituer le logo (celui du prix en tant que label, la visibilité de l’auteur, i.e. son insignifiance) au déploiement du logos18.
7Dans l’édition « Penguin Books » de Dorian, une imitation, la photographie de Will Self se dévoile (seulement) sur la deuxième de couverture. Malgré tout on observe une manipulation de l’image caractéristique de la publicité tendant à mettre en avant le visuel au détriment de l’écriture. En effet, la couverture affiche une photographie de mauvaise qualité, dévoilant un homme nu filmé en train de danser, son sexe dirigé vers la majuscule du nom de l’auteur doublée de cette phrase du magazine l’Observer : « Brutal, savage, infinitely readable... it will upset people19 ». Le ton semble directement donné par cette première de couverture, c’est-à-dire le fait que l’œuvre va mettre l’accent sur une image viciée, d’où le choix de la photographie d’un écran cathodique, une image provocatrice qui annonce la part importante du sexe dans l’œuvre. Le logo n’est pas ici le prix littéraire mais le corps nu en tant qu’il s’offre à un lecteur à la recherche de politiquement non correct. Le choix de la même police aussi bien pour le nom de l’auteur que pour le titre du roman induit une équivalence entre les deux qui va de pair avec la superposition de la photographie de la première de couverture avec celle de l’auteur au verso. Ce qui doit rester de l’ordre de la stratégie commerciale provoque une première approche visuelle de l’œuvre qui n’est pas sans entraîner une modification du rapport au sens. À cette dimension imagée, Richard Millet oppose la figure de l’écrivain dont l’incarnation la plus exacte serait pour lui Maurice Blanchot et cristallisée dans le latinisme « vultuaire ». Cette expression pouvant être comprise à partir du mot « vultus » qui signifie « expression, air du visage, visage, physionomie » ou encore « figure » :
L’écrivain est toujours seul, pour peu qu’il voue sa vie à cette tâche dont il n’attend ni rétribution ni d’autre gloire que l’absence de figuration sociale où se joue son destin, ce refus de la dialectique entre le symbolique et l’économique étant fondateur d’une certaine modernité dont l’effacement physique, à tout le moins vultuaire, est la chance20.
8Le « vultuaire » serait donc cette image de l’auteur discernable essentiellement dans son écriture dans laquelle il se reflète et nullement appréciable par une photographie qui ne révèle rien sur l’écrivain. Le passage de la figure par le prisme du média produit une altération dont l’image sur la première de couverture de Dorian, an Imitation pourrait être le symbole ; la photographie d’un écran entraînant une image altérée tout comme pourrait l’être la figure de l’écrivain lorsque l’on tente de la fixer par l’intermédiaire d’un médium qui ne peut rendre compte de ce par quoi il se définit, c’est-à-dire l’écriture. C’est pourquoi Richard Millet affirme :
Naïveté certes juvénile, mais nullement illégitime, surtout aujourd’hui où je me persuade que, dans une ère où règne le faux, l’écrivain doit, pour trouver ce qu’il appelle sa vérité, se retirer de la sphère sociale, se dérober de la reproductibilité technique de son image, celle-ci n’étant que le devenir publicitaire de l’écriture, une confusion de valeurs, la captation de la représentation de soi par des moyens autres que ce qui rend possible la littérature21.
9L’écrivain existant avant tout dans son rapport avec l’écriture, se laissant capter par l’objectif de l’appareil semble ramener son œuvre à la matérialité de l’image, déportant ainsi la « captatio benevolentiae » sur l’objet livre et opérant sur la figure de l’écrivain une transsubstantiation désacralisée et incertaine vers l’image.
« Tout ça c’est de la littérature »
10La visibilité médiatique, dont la première de couverture ne serait qu’un élément métonymique, serait pour Richard Millet, le premier élément de la perte de royauté de la littérature et d’une forme de collaboration entre l’écrivain et la société. Mais corrélée au désir de se rendre visible, il semble que les écrivains tentent de rendre le livre lisible, non pas tant dans une acception positive mais dans cette idée paradoxale que l’écriture ne permettrait plus de se confronter au décryptage d’un sens. Ainsi, pour être lisible, le livre devrait s’ouvrir et s’adapter à une dimension spectaculaire au même titre que son auteur, faire fi de la particularité du discours littéraire au nom des exigences de la société actuelle. Une réflexion contemporaine à celle de Richard Millet dans le domaine des arts plastiques mise en place par Jean Clair dans son essai Malaise dans les musées22 propose des images en adéquation avec cette corrélation entre le lisible et le visible. Il évoque ainsi deux façons d’appréhender le visible : la première selon une esthétique du clos, serait symbolisée par la géode, caillou grossier qui renfermerait un bijou précieux dont les églises d’Orient et de Byzance seraient l’accomplissement ; la seconde, plus propre à l’Occident, ferait appel à une esthétique de l’ouvert que Jean Clair qualifie en ces termes : « le mur s’est effacé, l’intime s’est déplié, le secret s’est évaporé, mais l’intérieur n’est plus qu’un vide23 ».
11Extrapolée au domaine littéraire, cette métaphore nous renvoie à ce qui pourrait constituer la fin de littérature par la perte du caillou grossier qui protège les cristaux à l’intérieur de la géode, c’est-à-dire ses dichotomies autrefois fondatrices d’une certaine modernité. Désormais, la littérature semble se dresser sur un désir de mise à plat d’elle-même au nom de l’hybridation généralisée des valeurs caractéristique de la postmodernité. Le secret paraît donc s’évaporer de plusieurs manières : la géode que constituait le prologue du Portrait de Dorian Gray disparaît dans la réécriture de Will Self tandis que Michel Houellebecq exploite l’épigraphie au point d’en oublier sa spécificité et d’en perdre le sens véritable. Enfin, la démonstration conjointe de la textualité, de la religion et de l’histoire sous couvert de lisibilité conduit les lecteurs d’A History of the world in 10 ½ Chapters à une conclusion « in-sensée » : « tout ça c’est de la littérature ».
12La préface qui précède la narration du Portrait de Dorian Gray constitue une forme de pacte de lecture du roman et plus encore expose la conception d’Oscar Wilde sur la morale de l’art. Ce dernier étant parfaitement inutile24, seul compte la beauté de l’œuvre d’art ; ce que l’écrivain ne manque pas d’appliquer à la littérature : « il n’existe pas de livre moral ou immoral. Les livres sont bien ou mal écrits, c’est tout25 ». Cette préface entend éclairer le lecteur dans sa quête effrénée du Beau, dénué de toute morale, à travers le déploiement d’un raffinement décadent. Will Self, quant à lui, troque la préface contre une citation en épigraphe de Schopenhauer sur la substitution de l’apparence à la réalité, nous menant vers des considérations autrement moins artistiques. S’il considère pourtant qu’entre l’œuvre première et sa réécriture il existe un rapport qui serait de l’ordre de l’accomplissement d’une prophétie lancée par Oscar Wilde26, la voix de Richard Millet nous permettra de mettre à l’épreuve cette affirmation. En effet, dans son essai, celui-ci fait allusion au fait que la littérature se signale aujourd’hui par le biais de la reprise, du recyclage, du remake27. Délaissant alors les concepts de la littérature pour le vocabulaire cinématographique, nous pouvons noter que l’œuvre de Will Self n’est pas seulement une réécriture mais une remastérisation infidèle, c’est-à-dire que l’auteur, reproduisant l’original, ne se contente pas de rajeunir le décor par un recours aux caractéristiques de l’époque contemporaine mais pratique une refonte de l’œuvre et de ses symboles. En effet, l’absence de préface constitue une différence fondamentale car elle permettait d’apprécier le roman pour sa valeur intemporelle, comme une œuvre d’art où la question du bien et du mal sont abolies et où « l’artiste n’a pas de préférence éthique28 », donnant à la définition de l’inutilité de l’art toute sa valeur. Cette préface garantissait aussi le maniérisme de la langue puisque cette recherche effrénée du beau ne peut se faire que dans le développement d’une écriture extrêmement esthétisée et raffinée. En suivant l’affirmation de Will Self, on peut considérer que son œuvre est l’accomplissement de celle d’Oscar Wilde mais dans le sens d’« ouverture » que Jean Clair donne au visible. Ici, le caillou protecteur que constituait la préface se brise pour laisser à l’écrivain les moyens de forcer certains traits du réel simplement suggérés dans l’original, le raffinement de l’art étant oublié au profit d’un raffinement dans l’expérimentation des drogues et de la sexualité. Parallèlement à tous ces changements, le style et la langue sont conservés, produisant une étrangeté plus proche de l’incongruité que du ravissement. Ainsi, le commentaire de Dorian Gray dans le roman d’Oscar Wilde sur un livre décadent convient aussi bien à la réécriture de Will Self, un siècle plus tard :
Il était écrit dans ce style curieusement ciselé, à la fois scintillant et obscur, plein d’argot, d’archaïsmes, de termes techniques et de savantes périphrases, qui caractérise les œuvres des quelques-uns des plus parfaits artistes parmi les symbolistes français29.
13Cette définition de l’écriture décadentiste fonctionne comme un commentaire métatextuel du propre style d’Oscar Wilde à l’intérieur du Portrait de Dorian Gray et constitue le modèle à suivre pour Will Self notamment dans son choix d’une écriture marquée par le maniérisme d’une langue déconnectée de l’époque où se déroule le roman, c’est-à-dire la fin du xxe. Malgré tout, le travail de la réécriture ne s’arrête pas à l’imitation du style d’Oscar Wilde puisque l’auteur y ajoute un trait particulier de l’époque contemporaine : le goût pour le « trash ». Ainsi Dorian, an Imitation représente une curieuse mutation entre le raffinement d’une langue historiquement connotée et le développement des thématiques contemporaines de la violence et de la sexualité. Cette mutation semble plutôt relever de la friction que de la parfaite alchimie, puisque l’œuvre n’est plus protégée par cette préface qui justifiait le choix chez Oscar Wilde d’une langue extrêmement raffinée au détriment du réalisme. C’est pourquoi on peut s’interroger sur le non-sens qui caractérise l’œuvre de Will Self partagée entre le réalisme sombre du « trash » et un langage totalement détachée de la réalité contemporaine. Cet aspect est visible dès le premier paragraphe où le narrateur s’interroge : « Était-ce un siècle ou tel autre ? Portait-elle cette robe-ci ou ce tailleur-là ? Préférait-il cette vulve-là ou ce trou de balle-là30? » Les « savantes périphrases » toutes aussi prétentieuses s’affichent pour signifier le simple désordre d’une pièce : « ce studio était une sorte de royaume anarchique en pleine insurrection objectale31 ». La lisibilité du réel s’entrechoque avec l’illisibilité de la langue pour produire un non-sens, faisant de l’œuvre un objet bizarre et presque monstrueux. Il semble que dans cette remastérisation, le travail herméneutique de la réécriture ait laissé place à l’exercice de style propre au remake car si Will Self parvient à transposer l’œuvre à la fin du xxe selon un principe de rajeunissement nécessitant l’ouverture de l’original, la géode du style ne semble pas suffisante pour conserver ce qui pouvait constituer l’attrait de l’œuvre d’Oscar Wilde.
14La perte du sens est d’autant plus marquée dans A History of the world in 10 ½ chapters de Julian Barnes qu’elle se trouve explicitement développée et revendiquée dans chacune des histoires qui composent le roman. La littérature en vient à être définie et même dénoncée dans son aspect le plus négatif, c’est-à-dire comme ce qui est artificiel, peu sincère. Par l’intermédiaire de la définition d’un phénomène symptomatique d’une maladie psychiatrique, l’auteur distille ironiquement ce qu’il va développer dans toute l’œuvre, à savoir le non-sens de la littérature :
Bien, le terme technique est fabulation. Vous fabriquez une histoire pour recouvrir les faits que vous ne connaissez pas ou que vous n’arrivez pas à accepter. Vous gardez quelques faits réels dont vous retournez le sens en construisant une nouvelle histoire autour d’eux. Particulièrement en cas de stress intense32.
15Une possible définition de la littérature se dessine ici, non pas comme la recherche d’une vérité mais d’une réaction à un contexte d’agitation qui pousserait celui qui en est atteint à littéralement « se raconter des histoires ». Le rôle que s’assigne l’auteur semble donc être celui qui par le biais du pastiche des discours dévoile le mensonge propre à la littérature à travers un roman qui se livre lui-même comme mensonge. Cette idée n’est pas sans rapport avec ce que dénonce Richard Millet lorsqu’il relève « le déploiement d’une falsification qui n’a plus rien à voir avec “le vieux mensonge romanesque” mais qui est, selon un penseur contemporain, dans un spectaculaire système où le vrai n’est qu’un moment du faux33 ». Également symptomatique du non-sens de la littérature, la position de l’auteur ne s’affiche pas clairement et produit volontairement de la confusion dans « Parenthesis », le demi chapitre de l’œuvre où Julian Barnes propose une réflexion sur la place de l’amour dans la société, l’histoire et la littérature par le biais d’un « je » correspondant plus ou moins à l’auteur lui-même :
(Je dis « je » en sachant que vous chercherez à savoir dans un ou deux paragraphes si c’est Julian Barnes ou un « je » fictif; le poète seul peut flotter entre les deux ; donnant autant de crédit aux sentiments profonds qu’à l’objectivité.)34
16Cette sincérité revendiquée apparaît dans une œuvre qui joue principalement sur l’impossibilité de mettre en place la dichotomie entre le vrai et le faux. Ainsi ce demi-chapitre qui relève de l’aveu et de la confession d’auteur n’a aucun sens car les autres chapitres concourent à jeter le discrédit sur lui. À trop vouloir dévoiler la textualité de chaque parcelle d’écriture, Julian Barnes mène parfois sa pensée jusqu’à une certaine forme de nihilisme contribuant à l’idée de la fin de la littérature comme recherche de la vérité, de sa vérité, ce qui lui fait dire :
Nous savons tous que nous ne pouvons pas atteindre de vérité objective, que lorsque les événements se produisent il peut y avoir une multitude de vérités subjectives que l’on évalue et que l’on transforme en « histoire », dans des versions incluant un regard divin qui contrôle ce qui s’est « vraiment » passé. Ce regard divin qui surplombe l’histoire est un mensonge35.
17L’écrivain devient donc un simple affabulateur qui, en même temps qu’il démantèle le secret du roman et libère le lecteur du mensonge de la fiction laisse échapper le secret sous-jacent à l’acte d’écriture en le rendant parfaitement lisible.
18Dans le cadre d’une interview, Michel Houellebecq fait le point sur sa manière de « fabriquer » ses livres qui rejoint la définition précédemment soutenue par Julian Barnes :
Circonstance aggravante, lorsque je raconte une anecdote tirée de ma vie, il m’arrive souvent de mentir pour améliorer l’histoire ; je perds rapidement conscience de la modification initiale, et au fur et à mesure que je reprends la narration, je rajoute mensonge sur mensonge36.
19Le titre de l’article d’où est extraite cette citation est par ailleurs explicite car « c’est ainsi que je fabrique mes livres » nous renvoie à l’idée de l’écrivain, non plus comme penseur de la vérité mais comme simple artisan du mensonge. Paradoxalement, Michel Houellebecq est aussi l’auteur de romans fortement imprégnés par la démonstration scientifique tendant à démontrer la validité de certaines thèses sur la société contemporaine. Il se produit donc un choc entre ce qui s’expose comme un roman à thèse et les déclarations de l’auteur sur le caractère fabulatoire de sa réflexion. Liesbeth Kothals Altes souligne cet aspect dans son article « Persuasion et ambiguïté dans un roman à thèse postmoderne (Les Particules élémentaires) » :
Le roman de Michel Houellebecq prend soin de suggérer à son lecteur que c’est bien d’une analyse pertinente de notre monde familier qu’il s’agit, et pas simplement d’une fiction, grâce en particulier aux nombreuses références précises à des événements réels, à des phénomènes sociaux répertoriés, et à des connaissances scientifiques correspondant à l’actualité (et moins de l’ordre de la science fiction que l’on ne pourrait le souhaiter)37.
20Mais, au lieu de s’en tenir à cette analyse à froid de la société, il multiplie les voix narratives qui font vaciller la définition générique première du roman à thèse. Cette ambiguïté se ressent particulièrement dans ce qui précède à proprement parler le récit de La Possibilité d’une île. En effet, l’empilage de prologues et de préfaces, au lieu de délimiter la part de la fiction et de celle du réel, s’expose comme une entrée en matière paradoxale. En premier lieu, une voix quasi-prophétique s’adresse à des lecteurs en leur souhaitant la bienvenue « dans la vie éternelle mes amis38 », tandis qu’une instance narrative s’annonçant clairement comme celle de l’auteur dévoile une anecdote sur la genèse de son œuvre : « Ce livre doit sa naissance à Hariet Wolff, une journaliste allemande que j’aie rencontrée à Berlin il y a quelques années39 ». Ensuite s’expose une voix étrange, qui, après lecture du roman, se comprend comme étant directement extraite de la fiction. On reconnaît ainsi les paroles du néo humain Daniel 25 : « mon incarnation actuelle se dégrade ; je ne pense pas qu’elle puisse tenir encore très longtemps40 ». On passe encore une fois à une nouvelle instance narrative trouble puisque un « je » s’adresse au lecteur, probablement auteur de l’œuvre mais qui adopte le style prophétique que nous avons déjà souligné : « Je ne souhaite pas vous tenir en dehors de ce livre ; vous êtes, vivants ou morts, des lecteurs41 ». Ainsi préfaces et prologues se superposent-elles jusqu’à fusionner derrière un « je » réel, celui de l’auteur Michel Houellebecq mêlé à un « je » fictif, celui du personnage, tous deux subsumés ensuite dans un « je » sinon divin du moins se plaçant au-dessus de l’humanité.
21Michel Houellebecq revendique la précision de la méthode scientifique dans son analyse de la société contemporaine tout en faisant reposer ses thèses sur un dispositif fictionnel. Cette confusion entre la préface et le prologue révèle la difficulté qu’il y a à atteindre un équilibre entre ces deux pôles que l’auteur considère comme opposés. Il dénie ainsi la précision et la spécificité du discours littéraire et ignore la distinction entre la préface, domaine du réel, et le prologue, domaine de la fiction. Tandis que la voix de l’auteur se fictionnalise, celle du personnage se mue en une voix réelle portant le discrédit sur la véracité des thèses défendues. Ainsi le choix que fait Michel Houellebecq de considérer sa pratique romanesque comme une réflexion scientifique sur la société plutôt que comme une élaboration d’une écriture proprement littéraire le pousse-t-il à l’imprécision sémantique dans sa définition de la préface et du prologue – cela alors même qu’il semble au contraire rechercher l’exactitude scientifique. L’écrivain semble partagé entre la volonté de faire de sa pratique romanesque une démarche analogue à celle du scientifique et l’ignorance des dichotomies qui fondent la littérature. Il prend le chemin de l’entre-deux et par conséquent du non-sens puisqu’il délaisse ce qui, autant que faire ce peu, fonde la littérature comme science, pour ne plus faire que démasquer le mensonge qui la caractérise, oubliant que l’écrivain ne doit pas à être à la recherche de La vérité mais de sa vérité.
Sur le modèle télévisuel: la littérature comme déversoir
22La télévision opérant un nouveau mode d’accès à la réalité du monde, la littérature semblerait devoir s’aligner sur elle pour continuer d’exister. Pour la concurrencer, le roman devrait donc se faire le déversoir du monde en cherchant la dimension la plus spectaculaire et la plus sombre de la réalité pour la restituer dans des romans. S’opposant à ce constat, Richard Millet affirme :
Je laisse aux misérables romanciers contemporains les « problèmes d’aujourd’hui », c’est-à-dire la contribution à la perte du sens et à l’enténèbrement du monde, et aux sociologues en mal de romanesque politique le soin d’entériner l’extraordinaire mensonge qui fonde les sociétés contemporaines42.
23Ces « problèmes d’aujourd’hui » évoqués par Richard Millet sont notamment ceux que Michel Houellebecq s’attache à retranscrire dans ses romans où aucun détail n’est épargné au lecteur, tout comme la sexualité débridée des personnages de Will Self s’illustre crûment à travers des descriptions extrêmement précises dans Dorian, an imitation. À grand coup de scalpel, ces chirurgiens du réel opèrent donc des incisions dans la société, laissant se déverser dans leurs œuvres tout ce qui s’y trouve de plus noir, exploitant du même coup le filon du « trash », que la télévision hésite encore à traiter. Phénomène et indice de cette perpétuation mortifiante de la littérature – mortifiante car les moyens qu’elle use pour se renouveler sont aussi ceux qui la condamnent selon Richard Millet à sa propre mort –, la présence chez les auteurs du champ sémantique de l’odeur. D’une part on trouve Richard Millet qui jette expressément à la poubelle la littérature d’aujourd’hui et de l’autre, les écrivains qui tentent de faire sentir le réel et plus précisément « l’enténèbrement du monde ». Ainsi l’essayiste considère que la littérature est désormais un « tout-à-l’égout esthétique, intellectuel et moral de l’époque43 », tandis que Julian Barnes nous fait sentir l’odeur incommodante de l’histoire dans une prosopopée triviale de cette dernière :
(Et l’histoire se répète-t-elle, la première fois en tragédie et la seconde en comédie ? […] L’histoire émet seulement un rot dont nous subissons encore des siècles après les effluves nauséabondes de sandwich aux oignons.)44
24Tout aussi présente, et même démultipliée, l’odeur se lie chez Will Self à la thématique de la perversion qu’il tente de décomposer par une description précise des sensations des personnages se mêlant à la saleté de la pièce pour observer les moindres particules nauséabondes du réel :
Ils ressentirent tous – Dorian, Herman, Ginger – cette poussée de ténèbres dans les contours flous de l’espace au-dessus de leur tête, ce bouillonnement des sangs, cet éclatement des pores, qui mêla soudain la purée de leurs corps à la crasse, au fumier, à la merde ambiants dans la décoction d’un ultime fix : l’injection du passé délétère dans la veine du présent pour créer un mortel avenir45.
25Michel Houellebecq use volontiers d’un langage parfois ordurier à travers la bouche de ses personnages pour saisir la laideur du monde contemporain. C’est pourquoi il n’hésite pas à faire employer à un professeur de Français des comparaisons plus que triviales :
Songer à ces pétasses, songeait Bruno en retraversant le camping, c’est comme pisser dans un urinoir rempli de mégots ; ou encore c’est comme chier dans une chiotte remplie de serviettes hygiéniques : les choses ne rentrent pas, et elles se mettent à puer46.
26Cette manière de saisir le réel d’un bloc ne va pas sans rappeler la pratique journalistique et offre à Richard Millet les arguments pour déconstruire la littérature contemporaine en la plaçant au même niveau, c’est-à-dire dans ce qu’il nomme « un cône de déjection47 ». L’odeur se répand donc à toute forme d’écriture contemporaine, puisque « le journalisme fait puer les mots48 », son parangon, le roman, n’étant lui-même pas épargné par cette critique mordante. Osant une même métaphore, on pourrait dire que Richard Millet place tout ce qui a trait à la littérature contemporaine dans le même « sac poubelle », jusqu’à affirmer :
On est passé du critique littéraire au journaliste, puis à l’échotier, dernière étape avant le statut d’égoutier, contemporain du fossoyeur49.
27L’essayiste n’a donc pas de mot assez fort pour s’ériger contre la littérature contemporaine, partant du sublime de sa définition de la figure de l’écrivain dans le latinisme « vultuaire » jusqu’au grotesque de l’imagerie triviale de sa comparaison de « l’écrivain “citoyen” aussi obscène qu’un homme forniquant avec une dinde50 ». La littérature est donc selon lui bien morte de l’action conjuguée de la visibilité médiatique des écrivains et plus précisément des romanciers, alliée à la lisibilité insensée de leurs œuvres et de leur subordination au journalisme.
28Cette étude n’a été jusqu’à présent qu’un porte-voix pour Richard Millet, or ce juge, malgré sa position surplombante, n’est pas sans soupçon car il entretient une relation amoureuse avec la victime.
2. Le début de « la fin de la littérature ».
29La revendication de la position de dernier écrivain51 exprimée par Richard Millet est éminemment contestable puisque même si elle prend la forme d’une confession et d’une profession de foi, présupposant un pacte de vérité, la parole est souvent vindicative, belliqueuse et parfois vengeresse. Elle représente aussi un danger, celui de la fixation dans la sacralisation de la littérature menant à la répétition du même, comme en témoigne la superposition des arguments des quatre essais. Il est donc nécessaire d’oublier les guillemets protecteurs ou l’italique qui ne peuvent mener qu’au constat tragique de Richard Millet : « il y a la littérature ou la mort52 ». À son encontre, Dominique Maingueneau considère qu’« il faut bien comprendre que la littérature n’est pas menacée, ce qui est menacé, c’est la Littérature, c’est-à-dire la royauté de la littérature, avec tout ce que cela implique53 ». Maingueneau soutient que ce changement est dû à une nouvelle conception de l’écrivain, une position désacralisée dont Yves Citton nous donne l’explication dans son article « Il faut défendre la société littéraire » :
Le type d’activité à laquelle nous nous référons à travers le mot de « littérature » ne relève nullement d’une catégorie intemporelle, mais peut recevoir une date de naissance (vers le xixe siècle) et serait donc de droit susceptible de recevoir une date de mort (la fin du xxe siècle ? ) le nouage très particulier d’une aventure scripturaire, d’un certain statut social, d’une certaine prétention épistémologique, d’une certaine mission formatrice et d’une certaine vertu salvatrice – nouage qui constitue « la littérature », s’il n’était nullement donné en 1650, pourrait ne plus être opératoire en 200854.
30La mort de la « littérature » n’est plus alors un chant mélancolique relayé par les écrivains mais une réalité sociologique basée sur des études concrètes. Le système de valeurs auquel Richard Millet fait appel pour juger de la valeur de la littérature contemporaine relève donc d’une forme d’anachronisme qui le maintient à la fois au-dessus de son temps – position qu’il revendique, mais aussi en dehors de son temps, place qui ne lui permet pas de comprendre la nouvelle condition de la littérature d’après La littérature.
Le danger de la sacralisation : du triptyque au tombeau.
31Les essais de Richard Millet, qui sont à la fois des pamphlets, des confessions, des déclarations d’amour et de guerre, se sont maintes fois vus remettre en cause pour la position extrême de leur auteur. Si celui-ci offre le portrait du dernier écrivain qu’il pense être à travers son triptyque, son dernier essai « de démonologie » le fixe définitivement dans son tombeau. En effet, refusant de vivre en tant que citoyen, il n’en est pas moins un fervent défenseur de la royauté de la littérature, poussant sa dévotion jusqu’à se placer en première ligne d’une guerre qu’il mène « seul donc, dans la vérité de [son] corps et de [son] esprit55 ». Pour Richard Millet, la religion et la littérature sont reliées de manière intrinsèque, puisqu’elles sont les deux faces d’un même culte : le sacré. D’où ses nombreuses interrogations sur l’avenir de la littérature :
Si la littérature a pendant deux siècles remplacé Dieu, qu’est-ce-qui remplacera la littérature comme divin ? À quel athéisme se vouer qui ne soit pas une religion par défaut, ou au rabais ? Quelle religion qui ne porte pas la trame de sa déchéance dans la littérature ? Comment nommer un moment historique où la religion et la littérature soient la figure januaire d’une cause perdue, la verticalité de la langue56.
32Cette conception sacerdotale de l’écrivain conduit à la fixation d’un regard fatalement dirigé vers le passé tandis que ce qui se donne pour nouveau n’est que la répétition du même. On peut relever par exemple que la longueur des phrases, caractéristique de l’écriture de Richard Millet, entraîne non seulement une dissolution du sujet mais aussi des arguments, source deflou dans l’argumentation. Ainsi l’auteur s’attaque-t-il à « une époque qui est, elle, toujours sur le point de [le] réprouver », sujet relayé par des subordonnées où il prend pour cible « sa littérature » puis « une littérature », pour finir par « le roman57 ». Cet effacement progressif est symptomatique dans tous ses essais de la difficulté qu’il y a à donner corps au véritable adversaire de Richard Millet ou du moins de comprendre sa nature : sont-ce des écrivains, des œuvres, des idées, des entités ou même une époque tout entière ? Les phrases fonctionnent en vase clos et tirés de leur contexte, les arguments s’alignent de manière peu convaincante puisque l’auteur prend soin d’éviter d’exemplifier ses idées. L’invisibilité de l’ennemi conduit aussi à le diaboliser comme en témoigne le sous-titre de L’Opprobre : « essai de démonologie ». Sous couvert de démasquer le mal qui sévit aujourd’hui, il se nomme lui-même grand inquisiteur, affirmant sans ambages :
Diaboliser l’autre, tel est le travail de mes ennemis ; moi je lutte contre le Démon, même quand son visage semble du côté de la vérité et que cette dernière signale sa fausseté par la décomposition de l’expression littéraire58.
33Richard Millet construit peu à peu son propre tombeau en s’enfermant entre les « quatre planches » de ses essais, ruminant sa rancœur à l’égard du monde contemporain et de sa littérature, ressassant sa propre généalogie littéraire. Le cheminement de la pensée de l’essayiste prend la forme d’un cercle dans lequel il s’enferme volontairement et on ne peut qu’acquiescer à l’idée qu’il incarne « le dernier écrivain » selon la définition qu’en donne Yves Citton.
La fin de la « Littérature majuscule » comme condition de la perpétuation de la littérature.
34La mort du dernier écrivain et de la conception de la littérature qu’il portait en lui nécessite de s’interroger sur ce qui définit désormais l’activité scripturaire pour éviter l’écueil de la sacralisation mis en évidence dans le cas de Richard Millet. Pour ce faire, on peut observer la position adoptée par certains écrivains et développée par Jean Bessière dans son essai Qu’est-il arrivé aux écrivains français ? à propos de La Possibilité d’une île de Michel Houellebecq, non pas en donnant de nouvelles lettres de noblesse à la littérature mais en tirant partie de ses faiblesses pour construire une « littérature ultime » :
Il est une solution : celle de la littérature qui expose ses propres contradictions et se donne pour littérature ultime – par quoi elle est à la fois une littérature réaliste et une littérature qui est comme la négation de la littérature, bref une littérature qui répète les clichés de la littérature et mime cependant l’état social, état ultime, dicible par une littérature qui serait sa propre négation. Cela qu’illustre La Possibilité d’une île59.
35Emblématique de cette alternative à une littérature en royauté, la fiction développée dans les œuvres de Michel Houellebecq, Julian Barnes et Will Self ne cesse de se retourner contre elle-même et de mettre en évidence ses moindres contradictions. L’exemple qui nous est donné par Jean Bessière, celui de La Possibilité d’une île nous offre une première approche de cette question. Tout d’abord, la narration se déploie à travers le récit à la première personne de Daniel, dont la profession d’humoriste lui garantit une certaine verve. Pourtant le comique coexiste sans cesse avec le cynisme du personnage, laissant le lecteur en prise avec le ridicule des rires enregistrés qui fonctionnent comme un anesthésiant du rire : « moi aussi j’avais un télescope mais ce n’était pas pour regarder les étoiles, ha ha ha60 ». De l’ordre du détail, ce passage nous renvoie tout de même à l’idée d’une narration qui ne peut plus exister sans porter un jugement sur elle-même à mesure qu’elle s’écrit, le « rire jaune » appelé par le commentaire méta-textuel des « ha ha ha » renvoyant directement à une sensation de malaise qui efface un sourire qu’on n’a pas même eu le temps d’esquisser. Le doute est aussi jeté sur la qualité de l’œuvre puisque le récit prend la forme d’une autobiographie fictionnelle où le personnage principal, Daniel 1, divulgue les dernières années de sa vie en refusant à son récit la moindre qualité littéraire. Évoquant ainsi sa vie, il remarque : « aux relations que je croisais encore parfois au bar du Lutetia, je racontais que j’écrivais ; ils supposaient probablement que j’écrivais un roman, et ils ne s’en montraient pas autrement surpris, j’avais toujours eu la réputation d’un comique plutôt littéraire61 ». Quelques quarantaines de pages plus loin, il revient sur cette idée en affirmant : « en fait je n’étais pas un auteur du tout62 ». Ce commentaire livre un certain nombre d’interprétations qui peuvent aller au-delà du texte lui-même, notamment parce que l’on a souvent noté les relations étroites que Michel Houellebecq entretenait avec ses personnages, faisant ainsi éclater les limites de la fiction. Le choix du terme « auteur » plutôt que celui d’« écrivain » renseigne sur une possible négation du statut d’auteur chez Michel Houellebecq, qui refuse l’autorité que pourrait lui conférer la pratique de l’écriture et nie par là même la valeur de ses propres romans. En effet, au regard des descriptions de ses spectacles63 que nous offre le personnage du roman, le terme de « littéraire » prend un sens presque déplacé. D’ailleurs, le choix d’un humoriste pour assumer la narration n’est pas anodin pour démontrer le malaise de la littérature, le rôle de « l’observateur acéré de la société contemporaine64 », ne peut plus être attribué à l’écrivain qui n’a plus sa place dans la société. L’humoriste finissant symbolisant le malaise de cette société-spectacle où le cynisme est devenu une forme de conformisme. En témoigne l’utilisation significative de l’italique dans la formule citée précédemment qui enferme le personnage dans le seul rôle qui lui est assigné par la société sans possibilité aucune d’y échapper – et par voie de conséquence de permettre au roman de se libérer de son malaise –, si ce n'est par la mort.
36Les considérations de Jean Bessière sur Michel Houellebecq peuvent aussi être appliquées aux romans de Will Self et de Julian Barnes. En effet, Will Self distille une certaine forme de malaise dans sa manière de désymboliser la littérature dans Dorian, an Imitation tandis que Julian Barnes exploite le concept de simulacre et l’applique au roman England, England. Ainsi, dans son article « Dorian, an Imitation de Will Self : le mentir vrai de la fiction », Josiane Paccaud-Huguet souligne :
Le roman de Will Self, emblématique des années quatre-vingt, se distingue aussi par une réflexivité particulière quant au statut de la fiction littéraire dans le monde contemporain saturé d’images virtuelles où s’est perdu l’art du mensonge, comme le soulignait déjà Oscar Wilde dans « The Decay of lying »65.
37En ce sens, la fin de l’œuvre qui diffère de celle d’Oscar Wilde témoigne de cette victoire du réel sur la fiction. Là où Dorian Gray mourrait en s’attaquant au symbole que représentait son tableau, Will Self choisit le simple meurtre dans une pissotière. On pourrait rétorquer que ce dernier nous offre une réécriture similaire à la scène décrite dans l’œuvre première puisque Dorian Gray va tuer son image tout comme le premier plantait un couteau dans son tableau. En effet, on retrouve bien une ressemblance à la limite du plagiat entre la phrase « comme il avait tué le peintre il tuerait l’œuvre du peintre et tout ce qu’elle signifiait66 » tirée du Portrait de Dorian Gray et celle extraite de Dorian, une imitation : « Dorian prit le couteau à cran d’arrêt et l’ouvrit. C’était celui qui avait tué le créateur – il servirait aussi pour la création67 ». Mais cette « première fin » est déboutée par une seconde qui place Dorian Gray « debout dans la rigole pleine de pisse de l’urinoir68 », tandis que le réalisme prend l’ascendant sur le fantastique. Cette double mort s’explique par le retournement final de l’œuvre dans l’épilogue qui permet à l’auteur d’attribuer le roman à l’un des personnages, Lord Henry Wotton, et de créer ainsi un étagement de la fiction, c’est-à-dire ce qu’on pourrait appeler dans une répétition maladroite : « la fiction fictionnelle », réécriture presque exacte de l’œuvre d’Oscar Wilde, et la « fiction réelle » qui encadre la première et fait triompher le réalisme. L’ajout de l’épilogue fonctionne comme la propre signature par Will Self d’une œuvre que l’on aurait pu considérer comme un simple remake, puisque la passion du virtuel présente dans The Picture of Dorian Gray se mue en une passion malsaine du réel. Ainsi, le roman de Will Self dénie le pouvoir à la fiction par le biais d’une mise en abyme de la réécriture, l’obligeant à se refléter dans le miroir de ses propres contradictions.
38Dans son roman England, England, Julian Barnes dénonce la subordination de l’original à la copie dans la société contemporaine par le biais de la narration de la construction d’une île touristique qui reproduirait l’Angleterre pour la rendre plus attractive aux touristes en exploitant tous les clichés relatifs à ce pays. Le personnage de Martha Cochrane participe à ce projet en tant que « cynique en titre69 » et au fur et à mesure que les récits s’entremêlent, des points de convergences vont apparaître entre le destin de l’Angleterre originale et ce personnage. Ainsi, ce qui avait été une nation florissante régresse en un régime autarcique :
On avait supprimé l’ancienne division administrative en comtés et créé de nouvelles provinces en se basant sur les anciens royaumes de l’Heptarchie anglo-saxonne. Enfin, le pays avait proclamé sa séparation d’avec le reste du monde et le troisième millénaire en décidant de s’appeler désormais Anglia70.
39En parallèle, Martha Cochrane résume son propre destin à celui d’une courbe ascendante et descendante à la limite du fonctionnement cyclique : « Pourtant c’était une étrange trajectoire pour une existence : après avoir été une enfant si futée, puis une adulte si désenchantée, voilà qu’elle était devenue une vieille fille71. »
40Le rapprochement entre ces deux destinés est ici presque trop évident puisque l’exploitation du symbole sous-entendu par la mise en parallèle des deux récits reviendrait à faire de la femme le miroir de l’Angleterre et vice-versa. L’auteur renvoie le simulacre à ses propres contradictions en reproduisant ses effets dans la narration. Il nous offre ainsi un simulacre de récit cohérent qui tourne à vide, puisque l’effet dissonant produit n’est pas seulement présent dans l’ironie du texte mais dans la construction même de l’œuvre qui distille son propre malaise en refusant les propriétés d’une narration continue constituée d’intrigues hiérarchisées. L’auteur condamne donc volontairement son roman au non-sens du simulacre pour dénoncer le caractère fictionnel – ou textuel72– du discours économique de la société contemporaine par le biais de la déconstruction du roman lui-même.
41Chaque auteur offre par des moyens différents la possibilité à la littérature de retrouver le chemin de la société, non par la reconquête de la majuscule mais en prenant justement le contre-pied de cette littérature en majesté, désormais déchue.
Le choix de l’entre-deux.
42À travers cette pratique scripturaire s’esquisse une nouvelle conception de l’écrivain que l’on pourrait désigner comme « position de l’entre-deux » : celle de l’écrivain conscient de la mort de la « Littérature » sans pour autant joindre sa voix au chœur des Cassandre. C’est en effet une position à demi amusée d’écrivain qui prend part à la dimension spectaculaire de la société tout en la dénonçant,à laquelle il se soumet tout en conservant une posture surplombante discernable dans le lieu même de la fiction.
43Vanessa Guignery souligne ce premier aspect à partir du rapprochement entre le personnage de Franklin Hugues dans le chapitre « The Visitors » du roman A History of the World in 10 ½ Chapterset l’auteur lui-même, Julian Barnes : « il semble que Barnes et Hugues partagent les mêmes intentions quant au contenu de leur ouvrage “ Une histoire personnelle du monde qui pourrait rester pendant des mois sur la liste des best-sellers”73 ». Ce commentaire méta-textuel révèle que l’écrivain a conscience de la part économique sous-jacente à l’activité littéraire, et loin de la stigmatiser comme Richard Millet qui pointe du doigt cette nouvelle « stratégie des prix littéraires », il s’en amuse. Férocement développée par Michel Houellebecq, cette dimension commerciale est expliquée par son personnage dans La Possibilité d’une île à travers une vue généralisante de l’activité de l’humoriste :
Comme le révolutionnaire l’humoriste assumait la brutalité du monde, et lui répondait avec une brutalité accrue. Le résultat de cette action n’était pas de transformer le monde, mais de le rendre acceptable en transmuant la violence, nécessaire à toute action révolutionnaire, en rire – accessoirement, aussi de se faire pas mal de thune74.
44Cette définition n’est pas sans rappeler le propre « ethos » de Michel Houellebecq qui se dégage de chacun de ses romans puisque le rôle de « l’observateur acéré de la société contemporaine » semble calqué sur sa propre posture d’écrivain, provocant la société tout en jouissant des privilèges qu’elle lui dispense. La recherche de l’entre-deux est aussi perceptibledans le roman de Julian Barnes dans sa manière de faire exploser les limites du genre romanesque tout en préservant le plaisir de la lecture. En effet, A History of the World in 10 ½ Chapters, se présente comme un ensemble éclaté de récits dont l’auteur tient à nommer roman et pas recueil de nouvelles, comme il le revendique lui-même :
Je suis un romancier et si je dis que c’est un roman, c’est un roman... Et cela ne m’intéresse pas vraiment de jeter les gens hors du domaine de la fiction. D’accord, mais expulsez aussi Rabelais, Diderot et Kundera75.
45Malgré cet éclatement du genre romanesque, les attentes du lecteur sont préservées par la cohésion narrative de chacun des chapitres qui permettent à Julian Barnes de conserver son rôle de « storyteller ». La position de l’entre-deux se caractérise chez Michel Houellebecq par sa capacité à se diminuer dans la sphère publique tandis qu’il se grandit dans celle de l’écriture. Ce premier aspect est discernable dans la toute première lettre de l’échange épistolaire entre lui et Bernard-Henri Lévy où il prend le contre-pied de s critiques qui sont faites à l’encontre de ses écrits en se diminuant encore :
Nihiliste, réactionnaire, cynique, raciste et misogyne honteux : ce serait encore me faire trop d’honneur que de me ranger dans la peu ragoûtante famille des anarchistes de droite ; fondamentalement, je ne suis qu’un beauf. Auteur plat, sans style, je n’ai accédé à la notoriété littéraire que par la suite d’une invraisemblable faute de goût commise, il y a quelques années, par des critiques déboussolés76.
46Mais cette manière de se livrer en pâture à ses lecteurs, dans la posture de l’écrivain humilié tranche avec la figure d’écrivain ultime qu’il se donne dans le prologue de La Possibilité d’une île à travers la reproduction de la fable de la journaliste allemande :
Je suis dans une cabine téléphonique, après la fin du monde. Je peux passer autant de coups de téléphone que je veux, il n’y a aucune limite. On ignore si d’autres personnes ont survécu, ou si mes appels ne sont que le monologue d’un désaxé. Parfois l’appel est bref, comme si l’on m’avait raccroché au nez ; parfois il se prolonge, comme si l’on m’écoutait avec une curiosité coupable. Il n’y a ni jour, ni nuit ; la situation ne peut pas avoir de fin.
Sois la bienvenue dans la vie éternelle, Harriet.77
47Loin de le présenter comme un « beauf », cette préface donne de lui l’image ambiguë de l’écrivain ultime dont la pensée ne peut être comprise par certains que comme celle d’un fou, image caractéristique du génie incompris. Donnant toute son ampleur à cette fable, il choisit d’en faire le point de départ de son roman La Possibilité d’une île qui mettra en scène cette posture d’écrivain ultime à travers le néo humain Daniel 25. Comme nous l’avons déjà souligné, Michel Houellebecq semble volontairement entretenir le doute entre ce qui relève des caractéristiques de son personnage et lui-même, en croisant préface et prologue, auteur et narrateur, pour mieux légitimer son propre regard surplombant l’humanité, à la manière d’un « néo humain ». Cette position est d’ailleurs revendiquée par Michel Houellebecq lui-même, contredisant l’image première du « beauf » : « c’est seulement dans mes livres, la seule chose qui m’importe en vérité, que je tiens à conserver par rapport à l’humanité une certaine distance critique78 ». Tiraillée entre deux revendications, d’un côté être un écrivain médiocre, de l’autre garder une position surplombante face à l’humanité, la posture de Michel Houellebecq s’établit véritablement sur un entre-deux difficilement saisissable. Malgré tout, elle va dans le sens d’une adaptation de l’écrivain à la société, c’est-à-dire à sa dimension spectaculaire, sans pour autant que Houellebecq sacrifie dans ses écrits la position surplombante que son statut d’auteur lui confère et qu’il va transmettre aux narrateurs de ses romans, conduits à relayer à leur tour le jugement de l’auteur sur l’humanité.
48Si la position de Will Self est celle de l’écrivain humilié dont la fiction est déboutée par cette passion du réel, il va intégrer une dimension ludique à son œuvre par le biais d’une indéfinition générique. En effet, l’épilogue revient sur les motivations qui ont poussé Lord Henry Wotton à consacrer un roman au Portrait de Dorian Gray, roman qui se présente génériquement comme un roman à clés uniquement parce que son auteur a perdu les clés de sa voiture. Le dispositif narratif savamment composé du roman du personnage inséré dans un autre cadre fictionnel repose sur un détail anodin mais qui va multiplier les possibles de la fiction et provoquer une lecture à rebours de l’œuvre de Will Self. Ainsi comme le souligne Josiane Paccaud-Huguet : « la veuve de Henry Wotton remet à Dorian le manuscrit d’un roman à clés mais dont les clés se sont perdues, si bien qu’on ne peut pas franchir la porte entre la réalité et la fiction79 ». Cette pirouette finale réintroduit le rôle et l’autorité de l’auteur qui s’amuse du lecteur en le faisant se perdre parmi les différentes strates de la fiction.
49Tandis que le dernier écrivain écrit sur la fin de la littérature, l’écrivain ultime s’attache à poursuivre son activité scripturaire d’après la fin de la littérature, sans renier cette réalité sociologique, il en fait un point de départ et un terrain de jeu afin de redéployer la fiction.
3. L’écriture, en désespoir de cause.
Les « terroristes tranquilles ».
50Malgré l’apparente indifférence des écrivains face à la mort de la littérature, une certaine mélancolie relative à une perte de foi dans leur activité, se décèle dans leur roman ouvrant la voie à ce qui pourrait être une forme de « terrorisme tranquille ». Le premier terme de cette expression oxymorique nous renvoie tout d’abord sur la piste des écrivains terroristes auxquels Jean Paulhan a consacré son ouvrage Les Fleurs de Tarbes et dont Laurent Nunez reprend la définition dans Les Écrivain contre l’écriture : « La Terreur […], elle désigne l’ensemble des écrivains qui, pour être différents les uns des autres, ont en commun un dégoût et une suspicion sans bornes pour la littérature80 ». Il poursuit sur le fait qu’elle est construite sur deux postulats :
Le premier consiste à considérer que la vie est plus belle que l’écriture, la réalité vécue moins fictive, moins conventionnelle que la réalité lue. […] Une telle opinion, qui donne la préférence à la réalité sur l’art, conduit, quand ce n’est pas à la démission rimbaldienne au second postulat terroriste : l’écriture, pour être sauvée, devrait reproduire parfaitement le réel81.
51Par conséquent, « l’écriture ne vaut pour les terroristes que lorsqu’elle est inextricablement liée au réel, ou bizarrement, lorsqu’elle s’avoue fausse, d’où le succès du pastiche, puisque c’est un genre à proprement parler rhétorique82 ». Cette définition donne toute sa cohérence à la réunion des trois auteurs puisque d’un côté Michel Houellebecq tente d’adapter son écriture aux moindres courbes du réel et de l’autre Will Self et Julian Barnes choisissent l’option du pastiche. Dans sa recherche d’une écriture quasi scientifique, Michel Houellebecq en vient à renier un des premiers pouvoirs du romancier, c’est-à-dire sa capacité à raconter une histoire. C’est pourquoi il affirme sans détours : « ça m’a toujours fait chier de raconter des histoires, je n’ai aucun talent de conteur (de storyteller pour reprendre un mot plus récent). Quant au style, qu’on arrête de me bassiner avec ces conneries83 ». À l’opposé, les deux autres écrivains revendiquent le titre de pastiche pour leurs œuvres, jusqu’à l’afficher clairement dans leur titre même. Dans Dorian, an imitation et A History of the World in 10 ½ Chapters, l’article indéfini a est présent pour indiquer au lecteur la subjectivité et la relativité sur lesquelles s’appuient leurs romans. Le titre contient aussi en creux l’œuvre pastichée et la manière dont l’écrivain va appliquer la technique du pastiche. Will Self va donc reproduire une imitation du « Dorian » d’Oscar Wilde tandis que Julian Barnes détourne le projet de Sir Walter Raleigh en écrivant sa propre histoire du monde sous forme cette fois-ci d’une parodie.
52Malgré tout, le terme « terroriste » suppose un geste de violence des écrivains à l’encontre de l’écriture. Le rejet du style par Michel Houellebecq va dans ce sens mais sa perte de foi dans la littérature relève plus de la mélancolie que d’un acte guerrier. Le qualificatif « tranquille » apporte la nuance nécessaire pour saisir la spécificité de ces nouveaux terroristes qui ne peuvent plus dynamiter une littérature déjà morte. En ce sens, Michel Houellebecq avoue son sentiment face à sa pratique romanesque qu’il considère comme une forme de collaboration sans pourtant chercher à la rompre. Il confesse ainsi à Bernard-Henri Lévy : « Maintenant je suis entré dans le jeu, c’est le moins que l’on puisse dire ; maintenant je cherche désespérément un moyen qui me permettrait (tout en continuant, un petit peu, à être) d’en sortir84 ». Affichant un même dégoût pour la littérature que la généalogie des écrivains terroristes, Michel Houellebecq se distingue pourtant par sa passivité. Julian Barnes offre aussi un douloureux constat dans son demi chapitre de A History of the World in 10 ½ Chapters, celui de l’impouvoir de la littérature sur la vie :
L’art, tirant sa confiance du déclin de la religion, annonce sa transcendance au monde (et ça dure ! L’art a vaincu la mort !) Mais cette annonce n’est pas accessible à tous, ou lorsqu’elle l’est, elle est peu convaincante ou bienvenue. C’est pourquoi la religion et l’art doivent céder la place à l’amour. Notre humanité et notre foi dépendent uniquement de ce dernier85.
53À la question désormais récurrente de l’avenir spirituel de l’humanité et plus précisément de celui de l’Europe après la perte de vitesse de la religion puis de la culture, soulevée par de nombreux penseurs86, il répond par l’affirmation de la vie sur l’art et de sa foi dans l’amour à défaut de croire dans le pouvoir de la littérature. Le terrorisme ne conduit pourtant pas Julian Barnes jusqu’à ce que Laurent Nunez nomme la « démission rimbaldienne », néanmoins comme on a pu déjà le relever sa pratique d’écrivain consiste systématiquement à dénoncer le mensonge de la littérature, comme si l’un et l’autre n’étaient que les deux faces d’un même objet. Le terrorisme prend tout de même sa source dans une croyance, celle du pouvoir de la vie sur l'écriture, croyance qui permet à Julian Barnes d'affirmer la puissance du sentiment humain au détriment de toute tentative de transcription de l’amour par l’art.
54Or Michel Houellebecq ne semble pas vouloir offrir d’alternative à sa pratique littéraire, dynamitant le roman avec gratuité et désinvolture. Rita Schoeber, dans un article sur l’auteur propose une explication sur cette attitude : « Houellebecq, un cynique ? J’en doute. Plutôt un désespéré, qui voudrait être un croyant87. » Ce commentaire, jugement personnel de la critique, laisse pourtant entendre la mélancolie sous-jacente à l’acte d’écriture de Michel Houellebecq et qui se répercute dans la violence d’une parole belliqueuse à propos du style ou de l’écriture contrecarrée par la passivité de l’auteur et finalement son incapacité à produire une alternative à la littérature. À défaut de croire dans le pouvoir de la littérature, il tente de montrer toute la haine qu’il lui porte, sans pour autant que son geste prenne l’ampleur de celui d’un véritable terroriste. Il continue d’écrire, donc, en désespoir de cause.
Il faut être absolument Bartleby !
55Cette étude sur la participation du roman à la mort de la littérature révèle aussi une proximité à première vue difficilement observable entre Michel Houellebecq et Richard Millet, l’un pouvant être le revers négatif de l’autre. En effet, si l’un refuse de considérer que la littérature est un travail sur la langue, tandis que l’autre y voit, au contraire, la mission principale de l’écrivain, tous deux se rejoignent dans la figure littéraire de Bartleby, héros de Melville mais aussi peut-être nouveau modèle pour l’écrivain après la fin de la littérature. Ainsi, Richard Millet, évoquant le désespoir de la condition d’écrivain aujourd’hui, se construit une généalogie imaginaire autour des personnages de Melville, Hofmannsthal et Des Forêts qui ont porté le soupçon sur la littérature et le langage : « Nous sommes plutôt, écrivains venus après tant d’autres et de si nombreux désastres, des enfants de Bartleby, de Lord Chandos, du Bavard ; des fils impossibles et des pères incertains88. » Bernard-Henri Lévy a les mêmes mots pour qualifier la position qui est celle de Michel Houellebecq et qui nous permet de le relier à Richard Millet dans une parenté peu évidente au demeurant. S’adressant à l’écrivain, il lui fait part du rapprochement qu’il observe entre sa position d’écrivain et la démission de Bartleby à l’égard du monde :
Le problème, dans cette dernière lettre, ce n’est bien entendu pas votre côté abstention civique, inappartenance, faites comme si je n’étais pas là, je ne suis d’ailleurs plus là, je vais de bulle en bulle, d’un domicile privé à un autre domicile privé, je ne me reconnais dans aucune communauté, je me sens de moins en moins citoyen, de plus en plus dépolitisé et libre, un Bartleby lettré, un « I’d prefer not to » ouvrant trop grand la porte à la « possibilité d’une île » – pourquoi pas ? C’est peut-être là, en effet, une définition acceptable de l’écrivain89.
56Dernier écrivain contre écrivain ultime, chacun semble avoir pris une direction opposée, réconciliable dans le geste de l’effacement – Michel Houellebecq en choisissant d’observer la société de loin, retiré sur son île ; Richard Millet, en prenant le parti des morts, juché sur son panthéon littéraire. L’éloignement : telle est, semble-t-il, la condition que choisit l’écrivain d’après la fin de la littérature.
57De l’outre-tombe à l’île, en passant par les bas-fonds de la société, la fiction nous permet de comprendre les nouveaux enjeux d’une littérature détrônée par ses propres sujets, les écrivains, qui reconquièrent de manière détournée le pouvoir du roman comme connaissance du monde. Un espoir pourrait se dessiner dans un coin oublié de la littérature, caché par l’ombre de l’imposant roman. Un espoir qui serait de l’ordre de l’infime, du souffle, une parole irradiée telle une plante soumise à l’assèchement qui porte en elle la sève suffisante pour renaître, dans l’incertitude de la contingence qui pèse sur elle. Une parole poétique, présente dans England, England sous la forme de la parodie d’une prière par Martha Cochrane enfant, distillée à plusieurs endroits du roman dans l’absurdité d’une phrase insignifiante : « car tu es le rhizome, la pervenche et l’histoire90 ». Michel Houellebecq dévoile aussi un semblant d’espoir dans le mode de communication adopté par les néo humains dans La Possibilité d’une île. À ce propos, il rappelle son attachement à la poésie qu’il considère désormais comme morte mais qu’il garde tout de même en lui comme une alternative à sa pratique romanesque :
Jamais je n’avais aussi bien compris ce qui m’avait rendu aussi fier d’avoir, dans la troisième partie de La Possibilité d’une île, et pour reprendre les termes qu’avaient employés Sylvain Bourmeau dans sa critique, « fait triompher la poésie à l’intérieur du roman »91.
58Ce triomphe est aussi celui de la propre poésie de Michel Houellebecq, poète minimaliste avant d’être romancier, dont on reconnaît le style léger et sans prétention dans les quelques paroles des néo humains : « Les membranes alourdies / De nos demi-réveils / Ont le charme assourdi / Des journées sans soleil92 ». En cette période sombre de fin de la littérature, le romancier doit-il sacrifier le roman au nom de la reviviscence incertaine de la poésie ? Oui, la littérature est morte, alors vive la poésie !