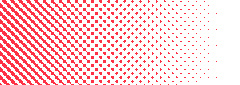Quand la mort n’a pas le dernier mot. Sur « l’agir de la littérature », avec Myriam Watthee-Delmotte
1Romain Bionda : Nous avons récemment appris la parution de votre essai Dépasser la mort. L’agir de la littérature (2019), dont nous ne connaissions pas le projet lorsque nous avons lancé l’appel à contributions pour ce numéro de Fabula‑LhT intitulé La Mort de l’auteur. Étant donné la forme singulière de votre livre, assez personnelle, il nous a paru qu’un entretien avec vous à son sujet serait la forme adaptée — et qu’un tel échange trouverait sa bonne place dans notre sommaire. Merci d’avoir accepté de vous prêter à cet exercice.
2Myriam Watthee‑Delmotte : Avec plaisir, je me réjouis de cette concordance d’intérêt.
*
3R. B. : Votre premier chapitre s’ouvre sur une anecdote personnelle — du moins, j’ai spontanément lu ce « Je » inaugural comme référant à vous‑même. Cette anecdote est celle de l’annonce, brutale (mais comment faire autrement ?), d’un suicide dans votre entourage : « Ce jour‑là, je me suis cognée dans les angles de mon impuissance. J’ai hurlé en silence, sans mots, parce que je n’en avais pas pour ça1. » Votre réponse, c’est Dépasser la mort ?
4M. W.‑D. : Ce livre découle de ma « réponse » immédiate à cet événement tragique. C’est la littérature qui m’a permis de sortir de la sidération, grâce à une phrase de Bernanos qui, même si elle a été écrite dans un tout autre contexte, exprimait exactement ce que je ressentais : « Il n’y avait pas de vieillard en [t]oi ». Mes amis m’ont su gré de cette phrase que j’ai lue aux funérailles, dans laquelle ils ont retrouvé ce qu’ils éprouvaient, et grâce à laquelle ils se sont sentis une communauté d’endeuillés unis par des affects similaires. Moi, j’en suis reconnaissante à la littérature. À partir de cette phrase qui a débloqué chez moi le retour à une parole possible, j’ai éprouvé combien la littérature agit sur nous. Sur le plan intellectuel, c’est une question qui m’a toujours intéressée : j’ai créé dans mon université un Centre de Recherche sur l’Imaginaire parce que je suis persuadée, comme le dit l’historien Jean‑Noël Jeanneney, qu’« une idée fausse est un fait vrai2 » et que la littérature contribue amplement à alimenter les vérités partagées. Mais à l’occasion du décès de mon ami, j’ai expérimenté l’agir de la littérature, ce qui est tout autre chose.
5Depuis lors, je me suis intéressée aux textes qui sont nés d’un rapport de l’écrivain à la mort, et je me suis vite aperçue que cela concerne un nombre phénoménal de textes. Il y a une infinité de nuances dont la littérature rend compte, et j’ai passé plusieurs années à explorer les modes d’efficacité littéraires (pas exclusivement en rapport à la mort) sur le plan scientifique, en alliant sémiologie, analyse du discours, anthropologie, ritologie. Le livre Dépasser la mort est un « livre‑bibliothèque » (le mot est de Jean Jauniaux ; je le trouve très judicieux) grâce auquel je tente d’expliquer un certain nombre d’occurrences possibles de cette efficacité. Chacun pourra, dans sa bibliothèque personnelle, trouver d’autres textes qui entrent en correspondance avec les dix chapitres que j’ai consacrés à des aspects particuliers de l’agir littéraire.
*
6R. B. : J’aimerais rebondir sur ce que vous appelez « l’agir de la littérature ». En exergue à votre livre, vous citez La Place des morts (1999) du sociologue Patrick Baudry : « Faire quelque chose est la seule réponse humaine à la question sans réponse de la mort3. » Dans ce « quelque chose » tient un éventail de possibilités innombrables — dont la littérature, et plus largement l’écriture. Sur la quatrième de couverture de votre livre, on lit : « C’est grâce aux mots que l’on cesse d’être seul face à la mort. Mais d’abord, ils manquent : quand la mort s’abat, elle abasourdit, elle frappe de mutité. C’est alors que les écrivains peuvent venir en aide et répondre au besoin de faire sens pour que quelque chose soit sauvé du gouffre. Face à la tombe, la littérature donne aux endeuillés une voix et le sentiment d’une communauté. Elle est ainsi au cœur de ce qui constitue le propre de l’homme, seul être vivant à honorer ses morts. » Je ne me risquerais pas à affirmer que les animaux sont indifférents face à la mort de leurs semblables et qu’ils ne font rien qui s’apparente à ce que nous pouvons faire. En revanche, il est vrai qu’ils n’ont pas la littérature…
7M. W.‑D. : De fait, pour les anthropologues, la présence de la tombe est la première trace indiscutable de la présence humaine en un lieu. Seule l’espèce humaine enterre ses morts. Patrick Baudry dit à cet égard que l’homme a la faculté de « transformer le cadavre en défunt » à la faveur des rites funéraires, et mon livre le montre dans l’action du travail littéraire. Les pratiques funéraires vont bien au‑delà de la simple fonction hygiénique, en apportant la possibilité de symboliser l’hommage aux disparus, et ainsi attestent de notre humanité. Il en va de même pour l’art et la littérature.
8C’est en ce sens que, si ce livre est une « réponse », pour revenir à votre suggestion initiale, c’est à l’idée communément partagée que la littérature n’a aucun rôle sociétal, qu’elle est fermée sur son propre objet, inoffensive et futile. Cette idée sournoise aboutit au dénigrement dont la littérature fait les frais aujourd’hui dans l’enseignement, au bénéfice de matières dites « utiles ». Or c’est là une vision bien limitative de ce qu’est l’« utile ». Elle est d’emblée remise en cause par les faits dès qu’il est question de la mort, car au moment de devoir organiser des funérailles, la majorité des personnes qui ne se reconnaissent plus dans les textes religieux se tournent spontanément vers les poètes. C’est qu’il y a une certaine utilité de « l’inutile », en ce sens que l’humanité a besoin de symboliser son vécu ; comme le dit Nancy Huston, elle est l’« espèce fabulatrice4 ». Et les écrivains qui pratiquent l’art du langage le symbolisent avec une finesse particulièrement révélatrice de la complexité de l’humain. En ce sens, mon ouvrage est proche de l’esprit de Nuccio Ordine dans L’Utilité de l’inutile, qui lui-même s’inspire de Ionesco : « Il y a des activités qui ne servent à rien et il est indispensable qu’il y en ait, car c’est précisément ce qui distingue l’humain de l’animal5 ».
*
9R. B. : Le sous‑titre de votre livre — L’agir de la littérature — me fait penser à Comment la littérature agit‑elle ? (1994), ouvrage dirigé en son temps par Michel Picard, où le théoricien de la lecture définit la littérature comme une « activité », à plusieurs niveaux6. Ce qui intéresse M. Picard, c’est notamment la manière dont une lecture individuelle « réagit », c’est‑à‑dire l’activité des lecteurs face à des textes agissant sur eux. Votre livre tient une position intéressante entre l’action et la réaction, ou plutôt « l’agir » et le « réagir ». Seriez‑vous d’accord de vous risquer pour nous à un commentaire ?
10M. W.‑D. : J’apprécie beaucoup le travail de Michel Picard, en particulier sa réflexion sur « la lecture comme jeu7 », qui rejoint mon analyse de la littérature comme rite profane. Ce qui ressort clairement de mes observations, c’est que la littérature fonctionne sur le mode d’efficacité rituel « don / contre-don ». Marcel Mauss a théorisé cette dynamique8 en soulignant que lorsqu’on fait un don, ce qu’on attend et reçoit en retour n’est pas de l’ordre de l’avoir, mais de l’être. Dans le cas de la littérature sur la mort, l’écrivain peut offrir aux lecteurs un texte qui propose des émotions et des valeurs à partager. La littérature nous autorise, grâce au pouvoir identificatoire, exaltant ou apaisant des mots, à « dans le champ du malheur, planter une objection9 », comme le disait Henry Bauchau. Nous lui offrons en retour la reconnaissance de sa puissance, et le lectorat offre à l’écrivain l’intégration dans une communauté. On peut comprendre ce terme de différentes manières : au sens large, comme une « communauté de destin » (terme avancé par Michel Maffesoli et affiné par le sociologue Denis Jeffrey10), puisque la mort de nos semblables est la situation la plus partagée du monde, même si, lorsque nous perdons un être proche, nous avons communément le sentiment d’être absolument seuls dans l’épreuve. Au sens symbolique, le lectorat qui adhère aux valeurs développées dans le texte constitue une communauté axiologique avec l’écrivain, qui rejoint ce que Dominique Maingueneau appelle une « communauté discursive11 », et Stanley Fish une « communauté interprétative12 ». Et au sens esthétique, les lecteurs entrent en empathie avec un texte pour sa saveur : si nous n’éprouvons aucun plaisir à lire un texte, il nous tombe des mains ; s’il nous éblouit, nous éprouvons au contraire le besoin de partager cet éblouissement, d’en parler, voire de recommander le texte, ce qui élargit la communauté des lecteurs. Cette communauté lectoriale est virtuelle, mais parfois bien réelle : les communautés d’amis de tel auteur ou de tel genre littéraire se manifestent de manière tangible. Dans mon essai, je tente de montrer ce qui, dans le dispositif textuel, induit à provoquer l’empathie.
*
11R. B. : Je repense ici au dernier spectacle d’Angélica Liddell, qui entend livrer avec Una costilla sobre la mesa : Madre (2019), suite au décès de « Madre », « une prière théâtrale, baroque et fervente, un requiem offert par une fille à sa mère, venant exprimer son amour et sa douleur de fille13 » (selon le texte de présentation de la pièce). Le spectacle, par ses effets et par sa charge, a laissé, me semble-t-il, les spectateurs dans des états fort divers : et plutôt qu’une communauté, ceux‑ci formaient une « assemblée », pour reprendre un terme cher à Denis Guénoun14, pour le coup assez divisée. Lors du premier long monologue, où A. Liddell dit sur scène son rapport haineux et amoureux à une mère sur le point de mourir, les réactions dans le public m’ont paru très diverses : tantôt bouleversées (il y a des sanglots), tantôt agacées (il y a des soupirs). C’est encore le cas lorsque, plus tard dans le spectacle, la mère est morte et qu’A. Liddell raconte vouloir, pour l’enterrement, enterrer la terre elle-même — et plus encore peut-être durant la longue scène centrale où quelqu’un ligote les deux bras de l’autrice et comédienne à une poutre, faisant de sa silhouette une croix, et qu’un chanteur se lamente… Au théâtre, la réception est immédiatement socialisée. C’est également le cas lorsqu’on écoute un texte lors d’une cérémonie, à la différence notable que l’on discerne en général nettement nos voisins (les lumières sont allumées) et que l’on ne doit pas attendre la fin de la cérémonie pour leur parler (ou alors c’est la pudeur qui nous retient de le faire, ou le respect à manifester à la personne qui lit, et non la politesse pour le travail des comédiens). Mais ce n’est généralement pas le cas lorsqu’on lit seul et silencieusement un texte dans un fauteuil…
Bref : ce souvenir réveille en moi deux questions.
1. Quelles significations et fonctions revêt pour les auteurs et les autrices endeuillé·e·s la publication de ces textes ? Vous écrivez par exemple que c’est une amie de Béatrice Bonhomme qui la convainc de faire éditer des poèmes écrits après la mort de son père (vous les citez en partie ; ils sont magnifiques). Un recueil paraît alors sous le titre Mutilation d’arbre, mais seulement « à cent cinquante exemplaires que l’écrivain préfère donner et non commercialiser15. » Il y a là une zone de négociation avec soi‑même qui me semble intéressante à interroger. Dans le cas de Mallarmé, vous rappelez que les pages rédigées en lien avec la mort de son fils Anatole « ne sont pas, pour celui qui les écrit, de la littérature et Mallarmé demande d’ailleurs à sa fille de les brûler après son décès16. »
2. Et pourquoi le faire sous la forme d’un livre (plutôt que sous celle d’un spectacle, par exemple) ?
12M. W.‑D. : Commençons par la première question. Cette situation est fréquente : l’écrivain considère souvent que les pages écrites dans la douleur immédiate de la séparation ne sont pas de la littérature, qu’elles ne font pas œuvre. Elles sont seulement la trace d’une souffrance qu’il n’a pas nécessairement envie de rendre publique. Il peut estimer, comme Henri Michaux à propos de Nous deux encore, écrit juste après le décès de son épouse suite à un incendie, qu’il y a quelque chose d’illégitime à divulguer ce qui s’est écrit sur une situation si profondément intime : c’est pourquoi il fait arrêter la diffusion de ce texte et interdire la vente de son vivant. À Paul Celan qui lui demande de pouvoir le traduire, l’écrivain répond : « un ensemble de gêne, de honte, depuis longtemps me tient, une impression de trahison, d’indécence, depuis “cela” mis en édition » . Ce n’est souvent qu’après un certain laps de temps, lorsque le deuil a pu s’effectuer, que les auteurs livrent un écrit d’une autre nature, qui a pu s’élaborer autour d’une blessure cicatrisée, et qui n’est plus de l’ordre du cri, mais de la commémoration. On voit la même chose chez Barthes : son Journal de deuil n’était pas destiné à la publication ; ce qui l’a été, c’est La Chambre claire où il a pu construire, avec du recul, un livre d’hommage d’une facture très subtile à sa mère disparue.
13On peut disserter longuement sur la légitimité qu’il y a à éditer un texte que l’auteur n’a pas souhaité publier lui-même. Si on avait toujours suivi les interdits, il est clair qu’on se serait privés d’œuvres majeures, comme celle de Kafka par exemple. En tant que lecteurs, nous sommes précisément touchés à vif par les textes qui traduisent les déchirements du deuil, parce qu’un écrivain écorché reste un écrivain : il trouve les mots justes, quitte à ce que ce soit, comme pour Mallarmé à propos de son fils, du langage en charpie. Ces textes restituent l’authenticité d’une douleur, et c’est en quoi ils contribuent à nous sentir moins seuls face à nos propres désarrois.
14Quant à la seconde question : le choix du support (livresque, scénique ou sur écran) et de la forme (poétique, narrative, dramatique, lyrique…) n’est pas toujours univoque ; il l’est même de moins en moins dans la création contemporaine. Pour ma part, j’ai voulu donner une place à des formes diverses dans cet essai, y compris des formes hybrides comme la prose poétique ou la littérature numérique. Pour ce qui est du travail scénique, j’évoque le théâtre d’Axel Cornil, qui met en scène les deuils douloureux, les deuils impossibles, la saturation à l’égard du « devoir de mémoire », le rapport sacré ou sacrilège au cadavre, l’immolation de soi, les mises à mort, etc., en soulignant que la tonalité globale est toujours celle d’une puissante énergie vitale.
15Je pense sincèrement, en particulier à partir du travail de Milo Rau, que tout, jusqu’aux situations les plus atroces, peut être abordé sur scène dès lors qu’on trouve une structure scénographique appropriée. Dans Five easy pieces, par exemple, Milo Rau fait jouer l’affaire Dutroux par des enfants : voilà qui, dans l’absolu, semble invraisemblable, voire indécent. Mais en réalité, le dispositif adopté favorise une mise à distance permanente à l’égard des faits réels évoqués, dans une structure de représentation dédoublée, détriplée, en cascade, qui permet à chacun, même aux enfants, de parler de l’événement, d’y jouer un rôle, et d’y insuffler une respiration, un sourire ou un rire, et ce faisant, de manifester ce qui reste indemne au sein des situations les plus noires. C’est un montage surprenant, subtil et magnifique, et cela mérite franchement les ovations debout des spectateurs qui ont suivi chacune des représentations.
16Il va de soi que le public est loin d’être toujours à l’unisson à l’égard de ce qui lui est présenté sur scène, qui peut susciter des réactions émotionnelles inverses, de sympathie, d’antipathie ou d’indifférence, ou d’ennui… Au théâtre, la co‑présence en salle (« l’assemblée ») de communautés d’empathie et de déconsidération peut être éprouvée comme perturbante. Mais l’ébranlement des certitudes est une des potentialités du théâtre sur laquelle son action repose depuis toujours, et c’est en cela aussi qu’il est un art vivant. J’aime beaucoup la phrase de Bachelard : « Il faut que toutes les valeurs tremblent : une valeur qui ne tremble pas est une valeur morte17 ».
*
17R. B. : Il est sans doute venu le moment d’entrer plus avant dans la manière dont Dépasser la mort est construit. De fait, son plan m’a beaucoup intéressé. Les trois premiers chapitres semblent suivre le parcours psychique d’une personne endeuillée. En voici les titres : « Faire face au choc », « Parler face à la tombe » et « Effectuer le chemin du deuil ». Pourriez‑vous nous en parler ?
18M. W.‑D. : J’ai été frappée par le fait qu’il y avait des textes pour chaque moment, chaque situation dans la confrontation à la mort. Et de fait, j’ai construit le propos de cet essai en suivant d’abord la trame chronologique par laquelle nous passons à l’égard de l’annonce d’un décès. Nous sommes par exemple fort démunis lorsque nous avons à prendre la parole au cours des funérailles, situation qui devient fréquente de nos jours, où la cérémonie funéraire tend à reconstituer les identités multiples du défunt en faisant parler les témoins de ses différents lieux d’appartenance (la famille, les amis, le travail, le club de loisirs…). Et nous puisons à loisir dans les formules littéraires qui sont une sorte de prêt‑à‑porter élégant du deuil. Des vers comme « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé » de Lamartine, ou « Et rose, elle a vécu ce que vivent les roses » de Malherbe, atteignent un tel degré d’universalité qu’ils peuvent toucher tout un chacun et devenir des « lieux communs » au sens noble, cohésif, de nos célébrations, accordant à nos deuils et à nos défunts un peu de l’immortalité de la formule.
19Dans le chapitre « Effectuer le chemin du deuil », j’ai montré l’action du langage, cet « art du temps » selon les mots de Lessing, qui consiste à accompagner rituellement le deuil dans la durée. Ainsi Le Portement de ma mère de François Emmanuel résonne comme un glas qui, peu à peu, fait admettre la situation d’abord impensable de la mort et entrer dans une communauté d’endeuillés. L’espace littéraire offre un lieu possible à ce qui ne peut s’accomplir que dans la longueur du temps. Ainsi les remords d’Albert Cohen à l’égard de ses manquements irréparables à l’égard de sa mère trouvent à se résoudre au long d’un récit rétrospectif qui s’appuie sur l’antécédent de Villon pour enjoindre au pardon ses « frères humains » qui, tous, sont injustes et fautifs comme lui. Ainsi encore de toute l’œuvre d’Henry Bauchau qui, de livre en livre, s’approche de la mort pour faire émerger des réparations symboliques par des élaborations imaginaires.
*
20R. B. : Et que se passe‑t‑il lorsque le défunt est une personne publique ?
21M. W.‑D. : J’ai voulu montrer aussi comment la littérature contribue à la constitution de la mémoire collective dans les lieux institutionnels. La ritualisation des funérailles est imprégnée de littérature. Les hommes de lettres sont amenés, au titre d’experts du langage, à jouer le rôle d’officiant dans les cérémonies funéraires. On se souvient de l’impressionnant discours d’André Malraux lors de la panthéonisation de Jean Moulin : captatio benevolentiae, pathos, rencontre du registre du sublime et de l’intime, interpellation directe du mort… Impossible de ne pas adhérer à un tel dispositif d’héroïsation du défunt. Et les formules cérémoniales mises en place par Bossuet au siècle classique, d’une imparable efficacité, se retrouvent toujours dans les hommages funéraires contemporains. Dans l’essai, j’analyse par exemple comment elles trament l’éloge de Victor Hugo aux obsèques de Balzac, copié ensuite par Anatole France dans son discours funéraire pour Zola. Elles sont toujours décelables dans le monde contemporain, y compris dans un contexte de peopolisation : aux funérailles de Johnny Hallyday, tant l’évêque Benoist de Sinety que le président Macron mettent exactement en jeu les principes discursifs hérités de Bossuet ; chacun parle au nom des valeurs qu’il représente ex officio — la religion catholique ou la nation française —, chacun tire à soi les aspects de la personnalité du défunt qui servent ses propres objectifs et vont rencontrer l’adhésion du public. Tout éloge funèbre est une réélaboration du sens qui doit pouvoir organiser la cohésion des endeuillés rassemblés autour du mort, et les stratégies rhétoriques proposées par Bossuet restent imperturbablement agissantes.
*
22R. B. : Ce que vous dites à l’instant de la cohésion des endeuillés me fait repenser par association d’idées à un exemple saisissant : celui de Gino Severini qui, sur l’abside qu’il achève de peindre en 1934 à Notre‑Dame du Valentin à Lausanne (sauf erreur la seule basilique du Canton de Vaud, en Suisse), a donné à l’Enfant, selon certains témoignages de l’époque, les traits de son fils mort. Au‑delà de la signification que ce geste prend pour le peintre, je me suis souvent demandé ce que cela voulait dire pour les fidèles de cette paroisse. Mais cela nous emmène ailleurs.
Revenons à Dépasser la mort. À partir du quatrième chapitre, sauf erreur, le livre ouvre sur des préoccupations plus directement littéraires, par une mise en perspective bienvenue avec le genre du Tombeau (dans le quatrième chapitre intitulé « Commémorer pour légitimer »). On se rend compte que tous les arts sont concernés… Existe‑t‑il selon vous des objectifs que la littérature (et peut-être est-ce ici l’occasion de clarifier la manière dont vous utilisez ce terme) réaliserait mieux que le théâtre, par exemple, ou le cinéma, ou encore la chanson ? Et avec quelles formes (genres, modes) cette littérature se rend-elle le plus souvent efficace ?
23M. W.‑D. : Dans cet essai, j’ai choisi l’acception de la littérature au sens large, c’est‑à‑dire toute utilisation esthétisée du langage. Pour moi, la littérarité est présente dans l’art théâtral, la chanson, le cinéma, la poésie visuelle et numérique, etc. J’ai voulu faire droit à une grande variété de genres poétiques, dramatiques et narratifs, qu’ils se déploient dans le livre, sur scène ou sur écran, qu’ils soient écrits ou oraux, qu’ils relèvent d’un mode d’expression et de diffusion collectif ou individuel. Les exemples commentés relèvent de ces différentes généricités.
24Ce qui m’intéresse surtout, en termes d’efficacité du travail de la littérature face à la mort, c’est sa capacité à occuper une position différente et complémentaire à l’égard des institutions sociétales. Considérons les lieux institutionnels de parole qui cadrent notre existence. Le discours historique se centre sur les réalités factuelles, et lorsqu’il s’agit d’expliquer des situations porteuses de mort, il en rend compte sous l’angle téléologique du déroulement temporel nécessairement marqué par l’action des vainqueurs en cas de conflit. Le discours juridique vise un idéal de justice : il doit rendre compte des faits mortifères avec objectivité, en vue de poser des jugements. Le discours médiatique a pour mission d’informer, ce qu’il fait habituellement sous un angle idéologique particulier, plus ou moins conscientisé. Tous trois concernent des réalités collectives imprégnées de valeurs sociétales.
25Par contraste, la littérature s’affirme comme un territoire possible pour les subjectivités, pour l’intériorité. La littérature prend en charge les affects qu’il est impossible de déployer en d’autres lieux. Ce phénomène joue pleinement aussi dans les genres littéraires populaires. Par exemple, la chanson joue un rôle non négligeable dans la préservation du souvenir. Lorsque Stromae compose un texte plein d’expressions à double entente à la mémoire de la Capverdienne Cesaria Evora, il sait qu’il lui offre un Tombeau symbolique qui fera le tour du monde. Idem pour la littérature hypermédiatique conçue pour une lecture interactive sur écran. Une œuvre numérique interactive comme Paroles gelées de Françoise Chambefort, qui part d’une citation de Rabelais pour évoquer les victimes des attentats récents, met en question, par son dispositif même, notre manière de nous remémorer les morts, et en particulier le temps que nous sommes prêts à accorder à leur mémoire dans notre vie, face à nos écrans18.
*
26R. B. : Si la littérature est un lieu pour l’intime, elle a aussi une action sur le monde. Pourrait‑on, dans le cas du deuil, caractériser cette action ?
27M. W.‑D. : La littérature sur la mort peut tenter de « réparer » le monde, pour reprendre l’expression d’Alexandre Gefen19, même si elle n’y parviendra jamais tout à fait, puisqu’il n’y a pas de réversibilité possible à l’égard de la perte subie. Mais elle peut modifier le regard porté sur l’irréversible et cicatriser les blessures du seul fait de rompre la solitude liée à la lucidité sur cette loi implacable du monde. L’écriture littéraire accueille et, par‑là même, surmonte les terreurs, les refoulements et les hantises : ainsi de Marguerite Duras pour son enfant mort‑né, évoqué entre les lignes de « La mort du jeune aviateur anglais ». L’espace littéraire peut aussi offrir un lieu possible au besoin de résilience qui n’a pu s’accomplir dans le vécu, comme on le voit dans le recueil poétique Lettre en abyme de Marc Dugardin qui accomplit une délivrance, ou dans Nantes de Barbara, qui transforme post mortem le dernier rendez‑vous manqué en hommage.
28Les écrivains qui évoquent la mort peuvent apporter la consolation, mais c’est loin d’être leur seul mode d’efficacité, ou leur seul objectif. Il est communément admis que la mort est le moment révélateur des vérités enfouies, et la littérature qui aborde les thèmes funèbres le montre abondamment. Elle révèle souvent l’envers du décor. Elle prend en charge les oubliés : ceux de nos histoires privées, comme le fait Yun Sun Limet qui ressuscite le fantôme de son oncle Joseph, avec qui l’enfant adoptée qu’elle est se construit une hérédité imaginaire plus vraie que vraie ; mais aussi ceux de la grande Histoire, comme l’opère Yannick Haenel dans Jan Karski et Drancy la Muette. Il s’agit de faire sortir de l’ombre les perdants, comme Louis Aragon qui a immortalisé le courage de Missak Manouchian. Ces textes‑là redonnent la parole aux morts. Ils les ventriloquent pour prendre en charge la violence ordinaire et extraordinaire du monde. Et s’ils consolent, c’est en opposant à cette violence l’estime qu’inspire la noblesse de certains êtres dont ils se font les témoins.
29Par son travail littéraire, l’écrivain peut aussi donner un lieu de visibilité à ce qui se tient occulté du fait de la honte. En ce sens, le privilège de la littérature est qu’elle peut faire entendre l’inavouable. Les positions moralement incorrectes, comme celle de la mort souhaitée, n’ont pas d’autre lieu sociétal que celui de la tragédie, ou de la fiction — ce que fait avec beaucoup de finesse Caroline Lamarche dans Enfin mort, qui laisse comprendre à mots couverts comment on peut atteindre la limite du tolérable dans la souffrance. La littérature ose avouer entre autres, contre le « devoir de mémoire » qui est une doxa contemporaine, le besoin de se délester du poids écrasant des morts, thèmes récurrents chez le romancier Laurent Gaudé et le dramaturge Axel Cornil, qui tous deux se mettent sous la bannière de la légende ou du mythe. La littérature seule peut faire entendre aussi, hors d’un contexte de jugement et en toute complexité, le point de vue des bourreaux, comme le fait avec un sens aigu des nuances Jérôme Ferrari dans Où j’ai laissé mon âme. Ces écrivains prennent le risque de n’être pas compris, mais ils obéissent à une nécessité intérieure et ils contribuent à nous éduquer en nous émouvant.
*
30R. B. : Dans votre livre, vous évoquez aussi les cas d’Édouard Levé et de Vickie Gendreau. Nous avons beaucoup parlé jusqu’à présent de la manière dont la littérature pouvait se rendre « utile » à faire face à la mort des autres. N’est‑elle pas aussi une manière parmi d’autres d’appréhender sa propre mort — qui interviendra à la suite d’un suicide (Levé) ou d’une maladie incurable (Gendreau) ?
31M. W.‑D. : Oui, bien sûr. Pour l’auteur, écrire permet de devenir le sujet, et non seulement l’objet de l’épreuve. C’est particulièrement admirable chez Vickie Gendreau, jeune auteure de vingt‑quatre ans qui prend en charge avec courage et non sans humour son agonie. À l’image de Villon aussi, elle écrit un Testament pour léguer à ses proches ce qu’elle n’a pas, ce qu’elle a perdu, et la seule chose qui lui reste, qui est la dignité jusqu’au dernier souffle. Quant à Édouard Levé, il livre à l’éditeur un ouvrage qui se présente comme le Tombeau littéraire d’un ami suicidé… juste avant de se donner la mort. Par le geste de l’auteur, cet écrit change de nature et devient aussi un texte testamentaire où l’on comprend que les dernières volontés du défunt sont de respecter son énigme. C’est évidemment un cas‑limite, mais cela reste dans l’esprit qui a caractérisé toute l’œuvre d’Édouard Levé, qu’elle soit littéraire ou photographique, qui a toujours joué sur la double entente possible des signes. De telles démarches traduisent une intégrité qui induit au respect.
*
32R. B. : Merci beaucoup d’avoir pris le temps nécessaire à la tenue de cet entretien qui, je l’espère, rend compte de la richesse de ce « livre‑bibliothèque » (le mot est en effet bien trouvé) qu’est Dépasser la mort. Outre le plaisir à suivre les réflexions qu’il livre, on y découvre beaucoup de beaux textes…
33M. W.‑D. : Avec plaisir. Je vous remercie d’avoir accordé une place, dans ce numéro de Fabula‑LhT consacré à La Mort de l’auteur, à mon essai qui tente de convaincre que grâce aux auteurs, la mort n’a pas le dernier mot…