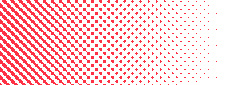1N. d. trad : Inédite en français, cette nouvelle a été publiée dans le recueil In società en 1962. Pour traduire un long passage situé vers le début (« Or il advint un beau jour qu’Ernest tira de l’urne les mots suivants (...) L’Infini de Leopardi »), nous avons dû nous écarter d’une traduction fidèle et procéder à une sorte d’adaptation. Cela est signalé par un changement de police du début à la fin de ce passage. Immédiatement après, dans la note n°2, nous expliquons les raisons de cette démarche.
2Un jour, la poésie prendra fin, pour cette même raison que le jeu d’échecs est fatalement destiné à s’épuiser, et donc parce que le nombre de combinaisons possibles de phrases, de mots, de syllabes est bel et bien limité quoiqu’immense (d’ailleurs ce raisonnement pourrait s’étendre aux beaux-arts restants, et à bien d’autres belles choses encore). Un mathématicien serait peut-être capable de calculer le nombre total de poèmes que l’on pourrait composer dans les différentes langues du monde ; une fois celles-ci composées, fût-ce dans des centaines de milliers d’années, on serait obligé de recommencer de zéro et, en somme, de reproduire bon gré ou mal gré les poèmes ou combinaisons précédentes, de recopier à l’identique, en d’autres termes, l’œuvre de nos prédécesseurs. (C’est pourquoi il est inutile que certains se donnent tant de peine : la poésie n’a besoin de personne pour mourir).
3Ainsi pensait, à tort ou à raison, le poète Ernest. Mais ce sont justement ces amères considérations statistiques qui lui avaient suggéré une idée ; sur le coup, faute de mieux, ou en attendant, celle-ci lui avait semblé bonne. En clair : le poète Ernest avait coutume de composer ses poèmes en tirant les mots au sort ; en les tirant, voulons-nous dire, véritablement et matériellement au sort, dans une grande urne à manivelle qu’il s’était fait construire exprès, pareille à celles qu’on utilise pour les loteries, ou à ces cylindres dans lesquels on grillait le café en des temps innocents, ou encore à un de ces braves batteurs d’antan. C’est là, inscrites sur des petits papiers, qu’étaient contenus non pas, grand Dieu, tous les mots de notre langue, mais enfin un nombre notable de mots poétiques et expressifs soigneusement choisis auparavant et, là aussi, selon des critères statistiques, c’est-à-dire selon leur fréquence dans les œuvres des plus grands poètes. Et il va de soi qu’Ernest se permettait ensuite d’aider l’urne à mettre bas, par l’insertion de conjonctions, de sutures, modifiant d’aventure un genre, une personne, une forme verbale ; bref, par ces petites retouches, qui seraient apparues indispensables ou lui auraient semblé plus opportunes (opération somme toute créative). Car il était en fin de compte un poète traditionnel : il pouvait accueillir une image audacieuse et insolite, mais il voulait qu’un poème ait d’une manière ou d’une autre un peu de sens commun. S’il sortait par exemple du batteur les mots Éclaire, Bleu, Éternité, qui en soi, disposés de la sorte, n’auraient voulu rien dire, il pouvait en tirer un vers tel qu’Éclaire (impér. ou ind. prés.) l’éternitébleue, ou bien J’éclairel’éternitébleue, ou enfin Je m’éclaire d’éternité bleue1 ; avec les mots S’endort, Lumière, Yeux : S’endortlalumièredetesyeux, ou même J’endorslalumièredetesyeux (toujours Tes, car le poète s’adresse toujours à une bonne femme) et ainsi de suite.
4Or il advint un beau jour qu’Ernest tira de l’urne les mots suivants, dans cet ordre :
51. Toujours
2. Cher
3. Mont
4. Solitaire
6Et ici, notre poète s’arrêta, jugeant ces quatre mots plus que suffisants pour le vers initial ; il s’agissait maintenant de les faire tenir ensemble. Eh bien, les deux premiers s’unissaient tout seuls : Toujours cher, nulle hésitation à avoir. De même les deux suivants : Mont solitaire. Mais quel lien entre ces deux couples ? Voyons : Toujours cher est cemont solitaire. Pas mal, mais il manquait une syllabe pour arriver à dix et obtenir un décasyllabe. Pourquoi ne pas remplacer ce par notre : Toujours cher est notre mont solitaire ? Ernest n’était pas convaincu. Mieux valait garder ce, et changer plutôt le verbe. Toujours cher était ce mont solitaire. Guère mieux. En revanche, l’idée de conjuguer ce premier vers au passé n’était pas mauvaise : on pouvait écrire Toujours cher fut ce mont solitaire. Ce qui n’était pas très joli, et ne faisait toujours pas un décasyllabe. Et puis, Cher, pour commencer, à qui ? Bon, sur ce point, pas de discussion : à moi ; le poète rapporte tout à lui-même. Donc : Toujours cher mefut ce mont solitaire... Ou mieux : Toujours mefut cher ce mont solitaire... Le début coulait mieux, et la rime intérieure ne gâtait rien. Enfin, on y était. Satisfait, Ernest entreprit d’extraire les mots suivants. Il lui parut certes entrevoir en ce vers à l’instant composé un je-ne-sais-quoi de familier, mais dans le feu de la création, il passa outre. L’urne offrit à présent ces autres mots :
71. Haie
2. Yeux
3. Dérober
4. Lointain
8La haie. Ou plutôt cette haie, qui fait partie du même paysage familier au poète que ce mont. Le démonstratif était pour ainsi dire de rigueur. Mais la question de l’article se posait davantage devant les yeux. Les yeux, ou plutôt Mes yeux, pour la même raison que me fut ? Certes, le poète rapporte tout à lui-même, mais il aime aussi être universel. Pourquoi ne pas opter pour un nos yeux qui aiderait le lecteur (après tout, les poèmes sont aussi faits un peu pour lui) à se projeter dans ce paysage qui lui serait comme familier ? Allez, va pour nosyeux. Restait à les relier à cette haie, de manière évidente : grâce au verbe dérober. Ce qui donnait : Cette haie dérobe nos yeux. Ou encore : Nosyeux dérobent cette haie. Mais hélas, cela ne voulait pas dire grand-chose. Et que faire de lointain ? Ce n’étaient pas deux, mais quatre possibilités qui s’offraient : cette haie lointaine dérobe nos yeux ; cette haie dérobe nos yeux lointains ; nos yeux dérobent cette haie lointaine ; nos yeux lointains dérobent cette haie. Non, décidément, ça ne collait pas : le poème prenait un tour absurde qu’Ernest ne goûtait guère. Mais, après tout, pourquoi les deux noms auraient-ils dû être réunis par une relation de sujet à complément direct ? Il suffisait de faire des yeux un complément indirect pour qu’enfin apparût une image sensée : celle d’une haie faisant obstacle au regard. Cette haie dérobe à nos yeux... quelque chose. Quoi donc ? Ernest le saurait bien vite en examinant les futurs mots dont l’urne accoucherait. Parmi lesquels il serait drôle de ne point trouver un objet susceptible de se dérober au regard. Mais en attendant, que faire de lointain, qui ne qualifiait convenablement ni cette haie ni nos yeux ? Voyons... Si l’on y réfléchissait un peu, le quelque chose qui attendait d’être tiré au sort ne pouvait être que lointain, et même inaccessible car cette haie le dérobait à nos yeux. Il fallait donc garder lointain pour plus tard, et n’utiliser que haie, yeux et dérober pour le deuxième vers. Dont le sort était ainsi presque scellé : le troisième vers lui donnerait tout son sens. Avant cela, toutefois, il fallait déjà le relier au premier. Toujours me fut cher ce mont solitaire, / Cette haie dérobe à nos yeux : non. La logique imposait une relative : cette haie qui dérobe à nos yeux. Et si l’on ajoutait une inversion : Cette haie qui à nos yeux dérobe ? Parfait, se dit Ernest. Gratuit, mais parfait. Dernier détail : si une simple virgule à la fin du premier vers faisait l’affaire syntaxiquement, métriquement, là, le compte n’y était pas. La solution était simple comme la plus banale des conjonctions monosyllabiques, et, qui transformait le vilain ennéasyllabe en beau décasyllabe : Toujours me fut cher ce mont solitaire, / Et cette haie qui à nos yeux dérobe. Le voilà, notre deuxième vers ! L’enthousiasme échauffait Ernest, qui donna un autre tour de manivelle, extrayant ainsi :
91. Grand
2. Pan
3. Horizon
10Il s’arrêta là, puisqu’il avait sa précieuse dose de quatre mots (en comptant son lointain laissé pour compte). Mais il s’arrêta surtout parce qu’il avait été frappé. Frappé, oui, en pleine poitrine, de stupeur, de joie émerveillée, de ravissement, par quelque chose s’approchant fortement, à bien y regarder, de l’inspiration. Les quatre mots prenaient place d’eux-mêmes, presque malgré lui, dans la relative précédente, en un énoncé non seulement très cohérent en lui-même, non seulement relié impeccablement aux deux premiers vers, mais (ce qui comptait le plus) étonnamment clair et musical : D’un grand pan du lointain horizon. Alors, certes, ce n’était pas un décasyllabe, mais il était facile d’y remédier ; si facile qu’un collégien aurait pu le faire... C’est ainsi qu’Ernest, au comble de sa joie, relut : Toujours me fut cher ce mont solitaire, / Et cette haie qui à nos yeux dérobe / Un si grand pan du lointain horizon.
11Il relut ; puis, aussitôt, sans se reposer sur ses lauriers, il se remit à l’ouvrage. Mais pour ne pas assommer le lecteur, nous le laisserons à sa joie (las, ô combien éphémère), sans rendre un compte précis de ses opérations suivantes, de ses alchimies, de ses tentatives exténuantes quoique victorieuses, qui peu à peu le menaient au pied de la perfection, que ce fût celle de chaque vers, ou du poème entier comme idée, comme image et comme symphonie. Jusqu’à ce qu’il aboutisse triomphalement au vers final de sa composition : Et mon naufrage est doux en cette mer.
12En somme, presque à son corps défendant, notre poète avait composé... L’Infini de Leopardi2.
13Ah, certes, cet état de grâce, légèreté, félicité, concorde et inéluctabilité tout à la fois, que tout vrai artiste a connu au moins une fois dans sa vie, avait bien été traversé, ou survolé, par une ombre, qui semblait s’épaissir à mesure que le poème avançait ; une ombre, un obscur et froid sentiment de malaise. Mais comment Ernest aurait-il pu s’arrêter, pour donner corps à ces ombres, ou les mêler à ses fulgurances, telle la glace à la flamme ? Maintenant, une fois retombés le souffle de l’imagination et l’ardeur de la vision, il voyait bien d’où venaient l’ombre et le froid que l’inspiration elle-même n’avait pas dissipés. De son travail acharné, de ses tourments, de son sang, Ernest n’avait rien tiré : un autre l’avait précédemment écrit, son poème (à lui, Ernest) le plus beau ! Un autre : un pauvre comte, un petit bossu de Recanati ; quand lui-même avait fait moins que rien. Ou trop, si l’on veut ; car là où tout poète, relisant à tête froide sa composition, en déplore intérieurement les manques, lui se trouvait à en déplorer l’excellence. Mon Dieu, que ne fût-il pas moins beau, son poème (à Ernest), pourvu qu’il ne fût pas le sien (au petit bossu !)... Mais foin d’ergotages ; dans un sens comme dans l’autre, les faits restaient têtus. Et pourtant, comment était-ce possible ? En particulier, comment était-il possible que la loi vulgaire selon laquelle le mieux est l’ennemi du bien s’appliquât jusque dans les sphères éthérées de la poésie, et que le mieux équivalût même au rien ? Et maintenant? Aurait-il dû renoncer à la fière et enivrante paternité de ce poème pour cette seule raison qu’un autre, par surprise, subrepticement, l’avait composé avant lui ? Non, ce poème était le fruit de ses entrailles, il était à lui et à personne d’autre, comme aurait suffi à le démontrer sa méthode de composition. Oui, il ne pouvait même pas s’être agi de réminiscences inconscientes ; le sort inflexible, qui comme chacun sait est personnel, en avait décidé ainsi. Mais, tout doux : à vouloir être juste, le poème était aussi, d’une certaine manière, au petit bossu. Que penser alors de toute cette affaire ? Élucubrations désormais inutiles, se dit Ernest, qui ne servaient qu’à lui confondre les idées, qui les lui avaient déjà assez confondues. Toutefois, il restait au moins le problème pratique : comment convaincre les gens que le poème était bien le sien, quoiqu’incidemment composé, auparavant, par un autre ? Comment recueillir sa part de gloire ? Et le problème pratique, de nouveau, comportait inévitablement la solution du problème théorique, en tout cas sa formulation correcte. Il fallait obligatoirement essayer d’y comprendre quelque chose, à ce maudit micmac, pour savoir au moins à quoi s’en tenir. Sa situation était la plus absurde et effrayante dans laquelle poète se fût jamais trouvé ; une situation inédite, pour ainsi dire. Eh bien, il fallait au moins la regarder en face, la mesurer dans toute son horreur ; et, si son courage ou son jugement n’en étaient point capables, ou si la panique enténébrait son esprit, quelqu’un peut-être aurait pu l’aider. Quelqu’un... Mais qui ?
14L’ami auquel Ernest s’adressa en premier exerçait la profession de critique ; c’était donc un homme des plus sombres. À cause d’une aphonie naturelle, par exemple, ou pour donner plus de gravité à ses mots, il parlait d’une voix si basse et sourde qu’il était difficile de le comprendre ; il s’escrimait, c’est vrai, avec l’index de sa main droite, que tantôt il dressait entre ses mains jointes sur la table tel un membre viril, tantôt il faisait vaguement tournoyer (c’est-à-dire sans lien apparent avec ce qu’il disait) tel un fleuret ; il avait aussi coutume d’entrecouper ses phrases de longs regards dans le vide, perdus, hagards, comme un animal au moment de la digestion, ou bien vers son interlocuteur, comme s’il attendait de sa part quelque secours, ou l’invitait à plaindre son triste sort de critique et d’être humain (il était de ceux qui font claquer au vent la bannière de l’humanité et la suivent en chantant de mélancoliques refrains). Avec toutes ces belles particularités, indices certains d’un esprit profond, le bonhomme, par ailleurs, une fois mis au courant, ne put que déclarer son incompétence ; non sans avoir donné quelques précisions d’un certain intérêt, que nous nous efforcerons de rendre intelligibles.
15« Bien, bien », dit-il. « Ici, avant tout, il faut distinguer le “côté épître” du “côté évangile” (évidemment le critique citait quelqu’un, Belli peut-être3), c’est-à-dire ce qui te concerne, toi précisément, de ce qui concerne les autres. En premier lieu : ne te sens-tu pas un peu mortifié à cause du mode de composition que tu as adopté, du fait d’avoir en somme tiré les mots au sort, comme si cela devait te placer en position d’infériorité à l’égard de ton prédécesseur ? »
16« Eh bien, oui, j’avoue que... »
17« Nous y sommes. Et tu te fourres le doigt dans l’œil : chacun est libre de composer ses poèmes, ses tableaux ou ses musiques comme bon lui semble. Un certain peintre regardait à travers un tesson de bouteille le paysage qu’il voulait peindre, un autre copiait les images des vieilles boîtes d’allumettes, ou s’en inspirait, et leurs démarches respectives étaient légitimes. Du reste, et sans parler de ton travail d’ajustement, qui sait si Leopardi ne composait pas lui aussi ses poèmes en tirant les mots au sort ? Ce qui compte, c’est le résultat. »
18« Mais justement, là, il s’agit du résultat... », objecta Ernest.
19« Passons plutôt au second côté », reprit le critique, ignorant l’interruption ; « car, si j’ai bien compris, ce qui te tient à cœur à présent n’est pas tant le problème dans l’absolu, qu’un misérable problème tout relatif de reconnaissance, et d’autre part, moi, sur le premier côté, je ne saurais rien ajouter d’autre. Alors, alors, pour mettre d’emblée le doigt sur la plaie : tu affirmes avoir composé ton poème dans un état d’inconscience... Bon, sans te rendre compte que tu composais en réalité L’Infini de Monsieur Giacomo Leopardi, sans penser le moins du monde à ce dernier, en ayant, comment dire, perdu jusqu’au souvenir de son existence ? »
20« C’est ça. »
21« Soit, mais qui pourrait te croire ? En plus : quand bien même tu réussirais à démontrer que tu n’as jamais lu L’Infini et que tu n’en as jamais entendu parler, tu en serais au même point, car L’Infini est dans l’air, comme on dit, dans le patrimoine que chacun, même involontairement, porte en soi. »
22« Et alors ? »
23« Alors rien. Ce n’est certainement pas de cette façon que tu pourras revendiquer ta gloire ; méritée, cela va de soi. De quelle autre, alors ? Hélas, je ne saurais te le dire. Je ne le saurais pas, pour la bonne raison que je ne sais pas et que je ne peux pas savoir ce qu’il en est exactement, quel rapport il existe entre la première composition et la seconde, et en vertu de quelle loi, de quel mécanisme, est arrivé ce qui arriva : ce n’est pas de ma compétence. Y voir clair, avant tout et toujours4, y voir clair, mon pauvre ami ! Mais je ne peux pas t’aider... Écoute, il n’y a d’après moi que deux personnes, deux types de personnes, qui pourraient t’éclairer de quelque manière : ou bien une femme amoureuse, ou bien un astronome, un mathématicien, que sais-je, ou tous deux convergemment (si tu me permets cet adverbe). Mais la femme amoureuse, garde-la en dernier : ça reste une bonne femme. »
24Et sur ce conseil (d’ailleurs moins bizarre qu’il n’y paraît), le critique se replongea dans ses textes ardus.
25Le mathématicien était par contre, imprévisiblement, un homme grassouillet et exagérément joyeux, et comique même, avec son rire à pleines dents (cariées) et sa jovialité débordante. Derrière lui, dans son bureau, était accroché non pas un tableau abstrait, mais une scène idyllique du dix-neuvième ; d’une manière générale, on voyait mal comment il pouvait se dépatouiller avec l’algorithme, dont le nom seul fait froid dans le dos. Pourtant il connaissait son affaire (étant, entre autres, professeur d’université). Si bien qu’il ne s’étonna de rien, comprit tout de suite de quoi il retournait, et dit sans ambages :
26« Mon cher jeune homme, de mon point de vue, l’affaire est plutôt simple ; je veux dire l’affaire en soi, sans ses possibles implications, sur lesquelles je ne serais pas en mesure d’émettre la moindre opinion. Donc, essayons de nous expliquer : pour composer votre poème, vous vous en êtes remis au hasard. Excellent, et je vous dirai même que c’était a priori la meilleure méthode pour obtenir un poème ou une combinaison véritablement originale ; en d’autres termes, il apparaissait extrêmement improbable que sorte de l’urne un poème déjà écrit, en l’occurrence ce poème de Giacomo... ».
27« Leopardi. »
28« ... Leopardi (poème à proprement parler ou succession ordonnée de mots, cela ne change rien aux visées de mon raisonnement). Toutefois, improbable ne veut pas dire impossible... Avez-vous une idée de la loi des grands nombres, du calcul des probabilités, ce genre de choses ? ».
29« Heu, oui... en fait non. »
30« Peu importe. Prenons un exemple facile, le jeu de la roulette : le fait qu’à la fin des temps, les rouges et les noirs doivent être sortis en nombre égal ne démontre pas que les rouges, ou les noirs, ne peuvent pas sortir tous ensemble, c’est-à-dire en une série ininterrompue, pour ne plus sortir jusqu’à la fin des temps. Me suis-je fait comprendre ? En somme, vous avez précisément joué au hasard, et vous avez commis la même erreur qu’un joueur misant tout sur une combinaison (simple) en se fiant au fait que la combinaison opposée est déjà sortie de nombreuses fois... Dieu du ciel, c’est plus compliqué à dire que dans les faits. Tenez, quelle est la série maximale enregistrée dans les permanences de Monte-Carlo ? »
31« Je ne saurais dire. »
32« Ah, dans ma jeunesse, les permanences de Monte-Carlo, nous les connaissions sur le bout des doigts ! Mais bon, disons soixante rouges. Eh bien, après soixante rouges, vous commenceriez à miser sur le noir, non ? »
33« Oui... Je crois que oui. »
34« Et vous auriez tort. Enfin, entendons-nous bien, vous auriez raison dans la pratique, mais tort en théorie. Vous avez compris ? »
35« Jusqu’à un certain point. »
36« Mais voyons, mais c’est élémentaire ! Après soixante rouges, il est presque sûr qu’un noir sortira, d’accord ? Presque, cependant : en réalité, les rouges peuvent continuer à sortir une année d’affilée, sauf qu’ensuite les noirs devront rétablir l’équilibre. Oui, mais quand ? Peut-être dans cent mille ans, ou avant cent mille ans ; avant la fin des temps, en fait, car il n’y a pas d’autre obligation. L’application à votre cas, maintenant, est simple : vous imaginiez que ces combinaisons spéciales appelées poèmes ne pouvaient pas commencer à se reproduire, sinon après avoir été épuisées ; vous avez tout misé sur cette supposition arbitraire ; et vous avez perdu. Voilà tout. Vous avez joué de malchance, et assurément vous devez avoir une nature de perdant, car toutes les probabilités (qui n’étaient cependant pas des certitudes) étaient, comme je vous l’ai dit, en votre faveur. Mais qu’y faire ! La seule différence, à la limite, c’est que votre roulette était, pour ainsi dire, à l’envers. Au jeu, on mise sur un numéro pour qu’il sorte, ou plutôt il s’agit de deviner le numéro qui sortira ; mais vous, vous misiez sur, ou tentiez de deviner, les numéros qui ne sortiraient pas (loin d’être sot, je le répète à nouveau, car les numéros qui ne sortent pas sont innombrables, à chaque coup, et à l’inverse, il n’y en a qu’un seul qui sort). Mais essayez de vous représenter une roulette où la banque paierait, avec des gains évidemment dérisoires, justement les numéros qui ne sortent pas, et non celui qui sort, et tout se tient. Est-ce clair ? »
37« À vrai dire, professeur... »
38« Hein ? Oh, je suis affreusement désolé, j’ai cours dans peu de temps... Bonne journée, mon cher, et condoléances ! »
39Des beaux discours de la sorte, on le comprend, n’étaient guère utiles à Ernest, bien que chacun eût le mérite d’éclairer le problème sous un certain angle. Ou éclairaient plutôt, à vrai dire, les données du problème que le problème en lui-même, car ils n’offraient pas une bribe de solution, comme c’était du reste prévu. Et à mieux y penser, l’examen de ces données était-il au moins correct et complet ? Il lui semblait confusément que non, quoiqu’il n’eût pas su voir où était le défaut. En tout cas, l’histoire des consultations d’Ernest ne s’arrête pas là : il voulut entendre en effet un conseiller à la cour de cassation, jadis ami de son père (qui ne parut pas prendre la chose trop au sérieux et l’invita en riant à bien prendre en compte les « circonstances de fait »), puis un prêtre et je ne sais plus qui ; et à chaque fois, son insatisfaction augmentait, comme si à la mosaïque idéale qui se composait petit à petit, il manquait toujours une pièce, et même la principale. Quelle pièce ? Notre poète en vint à tout reprendre lui-même depuis le début, et n’en tira que de perdre un peu plus la tête. Que voulait-il, en fait ? Que les gens lui disent : Ne t’inquiète pas, mon ami, si quelqu’un d’autre a déjà écrit ce poème, il est à toi et c’est ton plus beau poème et ta gloire littéraire est assurée pour les siècles des siècles ? Cela ne pouvait être ça (car enfin, cela eût été une prétention absurde), ou du moins pas seulement ça. Et sinon ? Lui-même devait avouer qu’il ne savait pas vraiment ce qu’il voulait. Ou peut-être voulait-il se convaincre que de toute manière, et quoiqu’en pensent les gens, il y avait en lui assez de force poétique pour produire un Infini ? Non, ça, il en était convaincu depuis le début. Il soumit à une analyse méthodique et exigeante le concept même d’art, ceux de paternité littéraire, de priorité, etc., il débattit longuement et précisément sur la question de savoir si quelque relation avec les autres était implicite dans une œuvre, voire si c’était un élément essentiel et constitutif ; et ainsi de suite. Et il ne retira aucun résultat appréciable de tout cela, ou plutôt tout ce qu’il en retira paraissait lui être défavorable. Etait-il possible, d’ailleurs, qu’une vulgaire question de paternité ou de priorité eût tant d’importance dans son affaire, qui était... Oui, c’est cela, une autre affaire ? Comment les « circonstances de fait » du magistrat pouvaient-elles influer à tel point sur un rapport aussi délicat ? Ou peut-être le mathématicien avait-il raison, et ce n’était qu’une question de chance, et voilà, tout simplement, le seul élément qui lui échappait ? Pour finir, il se découragea, s’avoua vaincu, et se dit, de plus en plus hébété, qu’il ne valait pas la peine d’insister, ni dans ses enquêtes, ni dans l’exercice même de la poésie ; jusqu’à ce qu’il se rappelât le conseil du critique, et décidât à la bonne heure de s’adresser à sa fiancée. Qui était alors chez ses parents dans une autre ville, de sorte qu’il fallut prendre un train.
40« Mais qu’est-ce que tu me racontes, mais vraiment tu plaisantes, mais c’est toi qui as raison ! », lui dit tout de suite la jeune femme, une petite intellectuelle à l’esprit vif.
41« Comment ça, raison ? »
42« Mais oui, ce poème est le tien, il n’y a aucun doute. »
43« Et pour quelles raisons exactement ? »
44« Quelles raisons ? On n’a pas besoin de raisons. Je le... Je le sens. »
45« Mais il est aussi à l’autre ? »
46« Cela, je n’en sais rien, et je ne me soucie pas d’en décider. Il est à toi, voilà tout. Peut-être qu’ensuite, dans un second temps, il pourra aussi être à l’autre ; en attendant, il est à toi. »
47« Hé non, pas dans un second temps : dans un premier temps, c’est là tout l’imbroglio. »
48« Mais voyons, comme si à propos de poésie, on devait s’occuper de chronologie ! Je te l’ai dit, je ne sais pas, s’il est à l’autre, et je m’en fiche. Du reste, qu’est-ce que peut te faire toute cette histoire ridicule, et qu’importe, à la limite, si tu t’es trompé une fois, si ça s’est mal passé (dis comme tu voudras) ? C’est une erreur, à la rigueur, qui prouve ta force. Nan, nan : laisse tomber ces doutes puérils et travaille au contraire, recommence sans te soucier de rien, fais ton devoir, et trêve de broutilles. Tu verras que si ça s’est mal passé une fois, ça ira mieux la deuxième ; en supposant que ce se soit mal passé. Allez, je ne veux plus rien entendre : dans trois jours, amène-moi ton nouveau poème, allez, vas-y... »
49Les femmes ! Néanmoins, Ernest sortit revigoré de cet entretien, et laissant son problème comme il était, il entreprit une nouvelle création.
50Le silence, la paix nocturne, son brave batteur. Ernest, d’une main tremblante, tourna la manivelle, extrayant :
51Vous.
52Vous : parfait. Un mot magnifique, non préjudiciable en tout cas : aucun risque de plagier qui que ce fût en écrivant Vous. Tout poète a le droit de commencer un poème de la sorte, car si on doit dire Vous, on ne peut dire que Vous. Et au fait, qu’était ce Vous, un vrai pluriel ou un faux pluriel ? Fallait-il s’adresser à une femme, une gente dame, ou vraiment à plusieurs personnes ? Bof, trop tôt pour décider.
53Écouter.
54Rien à comprendre, pour le moment. Poursuivons.
55Rimes.
56Rimes : hé oui, les amies du poète. Mais voyons le quatrième mot.
57Épars.
58Aïe ! Échaudé par sa précédente expérience, Ernest, disons, tendit l’oreille : là aussi, il y avait quelque chose, quelque chose de... Que diable arrivait-il ?
59Par le ciel, il n’était pas difficile de s’en rendre compte : de quelle manière pouvaient désormais se modifier et s’associer ces quatre mots, sinon plus ou moins comme ceci : Vous qui écoutez en rimes éparses... ? Il était même inutile d’extraire le prochain mot, de toute façon, on savait déjà ce que ça serait. Toutefois, en guise d’expérience oisive et lasse, il soumit l’urne à un tourbillonnant mélange, y plongea la main : le mot Son, ponctuel, apparut. Et donc : « Vous qui écoutez en rimes éparses / Le son... » Oui, oui : de ces soupirs dont j’ai nourri mon cœur5. On a compris.
60Et c’est là que commence, dans la vie d’Ernest, une période de désordre, de confusion, ou, pour user du terme adéquat, de folie ; qui d’ailleurs continue encore. Vu, se dit-il, que tout est perdu, et vu que j’ai le curieux talent de polariser le hasard d’une certaine manière, de faire sortir les mots qui ne devraient pas, et plus généralement de faire advenir des événements indésirables, pourquoi ne pas exploiter d’une façon ou d’une autre cette aptitude ? Exploiter dans un but lucratif, pensait-il tout bonnement, songeant implicitement, le malheureux, aux vertus thérapeutiques de l’argent (qu’un vrai poète ne devrait pourtant ne pas connaître, et cela montre bien à quel point son esprit était tourneboulé). Bref, ne pouvant être poète, et se rappelant un des propos du mathématicien, Ernest décida de devenir au moins joueur de roulette... Néanmoins, jouer est une chose, gagner au jeu en est une autre ; et inutile de préciser que là où la gloire avait fait défaut, l’argent aurait dû apporter une compensation. Mais procédons par ordre.
61L’application de ses talents à l’activité projetée ne se présentait pas, en vérité, très facilement ; et il interpréta peut-être mal les mots du mathématicien ; ou peut-être que non, ou peut-être autre chose, nous ne saurions dire. Quoiqu’il en soit, à titre d’exemple : le fait qu’il eût réussi à tirer d’une urne, sur des millions et des milliards de combinaisons possibles, justement L’Infini ou le premier vers du Chansonnier, qu’est-ce que cela voulait dire précisément ? Qu’à la roulette, il devinerait les nombres destinés à sortir, ou qu’il ne les devinerait pas du tout ? Posée ainsi, la question admettait plusieurs solutions, sur lesquelles nous passerons. Il suffira désormais de savoir qu’Ernest réfléchit tant et plus au moindre aspect, pour finalement, à tort ou à raison (mais avec une apparence de bon sens), se résoudre à procéder comme suit. Quand il aurait acquis, par intuition ou par calcul, la certitude ou quasi-certitude que sortirait tel numéro, alors il jouerait tous les autres. En agissant ainsi, bien entendu, il se trouva bientôt face à une nouvelle difficulté, car, comme nul ne l’ignore, à la roulette, la banque se réserve, c’est-à-dire compte en sa faveur, l’un des trente-sept numéros. Et donc, à jouer comme ça, on finirait au mieux à égalité ; ce qui fait qu’Ernest, au lieu d’un numéro unique, dut envisager des groupes de numéros ou secteurs. Mais, même de cette manière, le système ne fonctionnait pas : pour cette simple raison que, comme à le faire exprès, notre ex-poète devinait au contraire tous les numéros ou secteurs, ou plutôt il ne devinait pas du tout ceux à écarter... Mon Dieu, nous nous apercevons qu’entre les précisions techniques et les complications verbales, nous fatiguons notre lecteur ; mais que faire, lorsqu’on veut dire le vrai ?
62La première fois, pour mieux nous expliquer. À un moment du jeu, le 14 devait forcément sortir ; Ernest joua donc tous les autres numéros. Eh bien, le croiriez-vous ? Le 14 sortit. Et ainsi de suite à chaque fois avec tous les numéros. Évidemment, à la fin, Ernest voulut changer de système : au lieu de s’évertuer à deviner le numéro ou secteur qui sortirait (afin de ne pas le jouer), il essaya de déterminer celui qui en aucun cas ne sortirait (pour le jouer). Mais comme cela non plus, ça ne marchait pas : car, de même que le numéro devant sortir précédemment, maintenant c’était celui ne devant pas sortir qui ne sortait pas. La bille a des yeux, comme on dit ! Et pour conclure, Ernest devint peu à peu, au-dedans comme au dehors, un joueur de roulette ordinaire : en d’autres termes, il fut définitivement perdu.
63Oui, telle est la triste conclusion de cette trop longue histoire : à l’heure où nous écrivons, Ernest, pauvre comme Job, hâve, tremblotant, continue à errer tel un spectre dans les tripots. Il perd toujours ; s’il n’était pas riche, et si un vorace administrateur ne lui versait pas ses rentes au compte-goutte, il serait dans une belle dèche. Il tire bien, certes, quelques maigres revenus des conseils donnés aux autres joueurs, qu’il invite à observer son jeu pour ne pas l’imiter, recevant des petits pourboires en cas de victoire. Sa fiancée, bien sûr, l’a quitté depuis longtemps pour un homme plus concret et raisonnable.
64La morale, pour être sincère, je l’ignore, mais si je la connaissais, je crois que je me garderais bien de la divulguer : elle pourrait s’avérer dangereuse. Et en définitive, de quoi s’agit-il : d’une histoire de poésie, ou de jeu, ou d’un simple divertissement intellectuel ? Au lecteur le soin d’en décider.
65Traduction publiée avec l’aimable autorisation de Landolfo Landolfi, héritier de Tommaso.