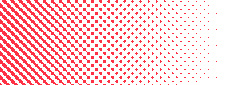« Sous le masque de Pierre… ». Discours de réception du prix Valery Larbaud
Michel Lafon a prononcé le discours suivant lors de sa réception, le 5 juin 2009, du prix Valery Larbaud, décerné à Une vie de Pierre Ménard par l’Association internationale des amis de Valery Larbaud : ce prix récompense chaque année « un écrivain ayant publié une œuvre qu’aurait aimée Larbaud, ou dont l’esprit, le sens et la pensée rejoignent celle de Larbaud ».
Nous remercions Ana Lafon de nous autoriser à le reproduire ici, ainsi que Benoît Peeters, qui a le premier édité ce texte dans le volume collectif d’Hommages à Michel Lafon qu’il a réunis (Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2015, p. 56-62).
1Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les membres du jury,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Rien ne pouvait davantage me toucher ni m’honorer que de voir mon premier roman associé aujourd’hui au nom d’un des écrivains français que je chéris le plus, par le biais de ce Prix dont vous êtes tous, jury, Association internationale des amis de Valery Larbaud et Ville de Vichy, les garants très fidèles, très aimants et très exigeants.
2Je me souviens que le premier livre que j’ai offert à ma femme, au temps de nos fiançailles, ce furent les Œuvres de Valery Larbaud dans la Pléiade. Elle m’avait demandé de lui faire un cadeau « qui serait aussi important pour moi que pour elle ». Nous communiions dans une même admiration – une même affection – pour Fermina Marquez et pour Enfantines. Dès mon adolescence, j’ai opté, je crois, pour cette ligne d’écriture claire, ce « courant d’une onde pure » où se désaltèrent Montaigne, La Fontaine, Diderot, cette voix presque consolatrice et toujours si musicale, ces rigueurs un peu nostalgiques que je retrouvais chez quelques autres écrivains français proches de Larbaud et non moins chers à mon cœur, tels Gide ou Valéry – et que je n’ai cessé de rechercher, et de reconnaître parfois, jusque dans d’autres langues, d’autres littératures, pour débarquer un jour en Argentine.
3J’écris à chaque instant dans la mémoire de ces lectures premières, dans l’écho de ces phrases, de leurs ombres et de leurs clartés, de leur douceur et de leur force. Un mot lu il y a des décennies, un mot même oublié, déformé, remplacé par un autre, suffit à faire naître sous la plume de qui se souvient ou de qui divague ses mots à lui, ses mots amants fidèles ou infidèles de ces mots d’autrefois, de ces mots fondateurs. On écrit pour continuer une histoire, pour dire sa tendresse à des écrivains disparus mais si présents, pour chanter une dette de phrases et de récits, pour raviver l’amour de livres enfuis ou rêvés… On écrit pour retrouver son enfance et les premières images, les premières pages qui l’ont enchantée, dont la mémoire devient paradoxalement plus aiguë au fil du temps… On écrit pour susciter chez d’autres, chez tous les autres, la saveur de ces conciliabules, de ces retrouvailles, de ces réconciliations…
4J’ai traduit, Cervantès et des Argentins, dont César Aira, j’ai publié des essais – sur Jorge Luis Borges, sur la littérature argentine, sur les formes brèves, sur la traduction, sur l’écriture en collaboration –, j’ai édité les Cours de littérature anglaise de Borges et l’ensemble des romans d’Adolfo Bioy Casares, j’ai préfacé deux fois L’Invention de Morel, je tiens avec mes amis écrivains de Buenos Aires – où je me trouvais il y a à peine trois semaines – un dialogue quasi quotidien qui est un des grands bonheurs de ma vie, je rêve parfois de retraduire certains poèmes et certaines fictions de Borges, tant il reste à faire pour les donner enfin dans leur pureté et dans leur surprise aux lecteurs francophones… Mais j’ai surtout inventé et écrit des histoires, depuis toujours, bien avant de savoir que j’allais m’engager dans un métier, à l’université, où l’écriture et la lecture seraient, en quelque sorte, mon pain quotidien.
5Une vie de Pierre Ménard est le plus ancien de tous les romans qui m’accompagnent depuis trois décennies, et je me suis rendu compte, il y a environ deux ans, que j’avais envie qu’il existe vraiment, qu’il sorte de chez moi, qu’il laisse enfin la place à d’autres romans que ses atermoiements empêchaient d’avancer. Ce premier roman est né de ma fascination pour le Jardin des Plantes de ma ville natale, Montpellier, et de mon désir adolescent d’« exprimer poétiquement le paysage de ma ville », pour le dire avec des mots de Larbaud évoquant la poétisation de Buenos Aires par Borges, et encore de donner à cette ville, Montpellier, que je trouvais si oublieuse de ses fils, à la différence de la vôtre, si peu littéraire et finalement si vide, et d’où je m’étais à l’âge de 19 ans définitivement éloigné, un considérable et ironique destin littéraire. Ce Jardin fut le lieu de rencontre et de promenade d’André Gide, de Paul Valéry et de Pierre Louÿs, dans les années 1890, il fut l’Eden de leurs amitiés naissantes et ô combien nourrissantes ; Larbaud lui-même l’a chanté ; il ne me restait qu’à ajouter à ce début de liste d’initiés quelques autres grands noms (Poe, Mallarmé, Conrad, Borges, Fabre, Toulet…) et à motiver de la plus mystérieuse des manières la présence de tous ces esprits savoureux et de tant d’autres dans un même lieu, au fil du temps… Ainsi naquit l’idée d’un Congrès séculaire et souterrain et d’un immense dessein, pas moins que la fondation de la littérature moderne, via Borges et quelques autres écrivains insignes, aimantés par la conjuration languedocienne… Ainsi naquit de conserve l’idée d’un génie invisible, manoeuvrant le Congrès à sa guise mais surtout se payant l’héroïsme de sacrifier son œuvre possible à celle de disciples dont il pressent que le talent est supérieur au sien, et que c’est grâce à eux, en les aidant à accoucher de leurs œuvres et en se résignant à n’exister qu’à travers eux, qu’il passera à l’éternité – et de l’autre côté du miroir…
6Larbaud, oui, comme je le disais, fréquenta ce Jardin et chanta l’allée Cusson, dont il fit son vert cabinet de lecture : « C’est un admirable lieu de lecture, cette allée surélevée au cœur du Jardin des Plantes, entre deux murs de verdures variées : yeuses, pins, ginkgos-bilobas, bambous épais, arbres de Judée, que dépassent les cimes d’autres pins et des micocouliers géants. » (écrit-il dans Septimanie, en 1925). J’ai essayé de mettre mes pas dans les pas de Valery Larbaud et de Paul Valéry, dont le Cimetière marin illumine mes propres nostalgies méditerranéennes et dont une page de Monsieur Teste chante aussi ce jardin d’« absents », « cet antique jardin (…) à pensées, à soucis et à monologues », j’ai voulu revisiter ou réinventer le Jardin immémorial de tous les écrivains qui le parcoururent et continuent de le hanter, depuis son fondateur, Pierre Richer de Belleval, énigmatique mandataire du roi Henri IV surgi du néant, en passant par Edward Young, qui y aurait enterré à la dérobée sa belle-fille Elizabeth, alias Narcissa, dans une tombe qui est vite devenue le cœur secret de ce royaume pétrifié, jusqu’à tous ceux, si proches et si chers, dont j’ai à l’instant cité les noms…
7Larbaud m’attendait au bout de chaque allée, au débouché de chaque tunnel, autour des bassins surhaussés emplis de nelumbos en fleurs, au pied des escaliers de pierre et de lierre, « au bord des tombes » : le voyageur immobile fuyant « le vain travail de voir divers pays », le lecteur insatiable, l’inappréciable collaborateur de La NRF, le polyglotte, le traducteur, le fondateur d’une poétique ou plutôt d’une érotique de la traduction, sous l’invocation de laquelle tout honnête traducteur devrait placer son entreprise, le critique bienveillant, l’hypermoderne touchant au vif des ouvrages les plus novateurs de son temps, le frère des écrivains du monde, l’anglophile et l’hispanophile, l’ami de Chesterton et de Güiraldes, de Joyce et de Gómez de la Serna, le premier argentiniste, le découvreur européen de Borges, capable dès 1925, à la seule lecture d’un médiocre recueil d’essais de l’Argentin, Inquisitions, d’y discerner, avec une prescience qui m’émerveille, « le début d’une nouvelle époque ».
8Mais aussi Larbaud inventant son double émancipateur, notre cher Barnabooth, et entreprenant d’écrire ses œuvres complètes, et de les éditer, ce qui n’est certes pas le geste le moins moderne ni le moins révolutionnaire de sa production tellement en-dehors du temps, des publicités, des répertoires et des modes.
9Et encore Larbaud l’enfantin, le poète des premières amours et des sous-bois enflammés, cultivant la nostalgie fertile des matins de sa vie et de leurs paysages attendrissants.
10Et le Larbaud final, que son état contraint à se tenir un peu à distance de soi et des autres, et de leurs livres, néanmoins toujours aussi amicalement considérés et admirés.
11Comme il ressemble à Pierre Ménard, ce Valery Larbaud patient et clairvoyant, perçant le génie des autres quasiment dès l’enfance de leur œuvre et y sacrifiant un peu de sa vie, un peu d’une vie non moins sereine et apaisée ! En y repensant, qu’ai-je fait d’autre, en sollicitant les virtualités romanesques souterraines d’une nouvelle de dix pages, en incarnant un personnage entrevu dans une fiction ancienne, en instituant Ménard en découvreur et en inspirateur de Borges et de tant d’autres de ses jeunes contemporains, en écrivant son œuvre – ses poèmes, son roman d’île, son Jardin des Plantes de Montpellier, ses pensées, sa correspondance, ses aveux, ses regrets… –, en le consacrant en le plus invisible et le plus influent, le plus abandonné et le plus aimable des maîtres, en lui donnant la plus inguérissable des enfances méditerranéennes, qu’ai-je fait d’autre, disais-je, que de réinventer Larbaud ? Alors, sous le masque de Pierre, le sourire énigmatique de Valery ? Comme vous le voyez, il m’aura fallu faire le voyage de Vichy pour tirer ce fil de mon labyrinthe de verdure montpelliérain…
12Je remercie chaleureusement la ville de Vichy et son maire de leur accueil si émouvant, ainsi que tous ceux qui, chez Gallimard, à commencer par Jean-Marie Laclavetine, ont aimé mon roman et l’ont défendu. Quant à vous, Mesdames et Messieurs les membres du jury, comment vous dire ma gratitude, à vous qui m’avez accompagné dans les allées du Jardin de mon adolescence (du Jardin du Roi à l’École Systématique, du Labyrinthe des plantes aquatiques à la Bambouseraie, via l’allée des cyprès florentins ou le bosquet de Narcissa…), à vous qui y avez rencontré et aimé les mêmes écrivains que moi, relu ou réécrit les mêmes livres, envisagé les mêmes vers, cultivé les mêmes simples, guetté les mêmes orages, entraperçu les mêmes invisibles ? Merci d’être descendus avec Ménard et peut-être avec Larbaud jusqu’à la salle souterraine où siège depuis plusieurs siècles le Congrès, merci de vous être installés à mon invitation autour de la table un peu solennelle, un peu vaine où fut réinventée la littérature, merci d’avoir partagé ce rêve et d’avoir écouté cette musique, et merci de me donner, ce soir, une des plus belles joies de ma vie.
13Merci, du fond du cœur, merci.