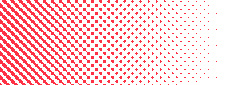Pierre Ménard, metteur en scène du Quichotte ? La mise en scène des classiques, ou l’existence simple des textes dramatiques
1Autour de 1900, lorsqu’il s’agit de mettre en scène au théâtre ce qu’il est convenu d’appeler des textes dramatiques classiques, on trouve en France l’émergence d’une curieuse pratique — curieuse car probablement nouvelle dans son ampleur : celle de ne pas toucher au texte, ou à ce qu’on nomme communément sa « lettre ». Pour les pièces de Shakespeare, comme le rappelle Bernard Dort, elle naît avec André Antoine :
La pratique traditionnelle du théâtre ne repose pas sur le respect du texte, contrairement à l’idée que l’on s’en fait aujourd’hui. Paradoxalement, c’est avec l’avènement du metteur en scène moderne que ce respect a été promu au rang d’impératif. En France, par exemple, la première représentation shakespearienne à utiliser une traduction intégrale fut celle du Roi Lear monté par Antoine en 1904. Auparavant, c’étaient toujours des adaptations ou des versions tronquées de pièces de Shakespeare que l’on jouait1.
2Le paradoxe relevé par B. Dort ne fait-il pas écho, d’une certaine manière, à celui que Jorge Luis Borges met en œuvre dans « Pierre Ménard, auteur du Quichotte », où le personnage éponyme produit (sans copier) des fragments de texte « verbalement identique[s] » à certains chapitres du Don Quichotte de Miguel de Cervantès, mais, selon le narrateur de la nouvelle, « presque infiniment plus riche[s]2 » qu’eux — si bien que nous avons peut-être affaire à un même texte (le Quichotte),mais à deux œuvres (celle de Cervantès et celle de Ménard). Le théâtre n’aurait-il pas eu ses Pierre Ménard ambitionnant de « créer » dans une mise en scène le texte préexistant d’un écrivain et dont la création a néanmoins été perçue comme originale en regard de l’œuvre écrite antérieurement ? On m’excusera de ne pas les chercher. C’est que je formule une hypothèse qui rend cette recherche inopportune : sur scène les modalités de représentation — ou plutôt de (re)production — et donc d’existence du texte font qu’il diffère fondamentalement de lui-même. On se demandera alors plutôt s’il est bien vrai que « [l]a mise en scène est une écriture sur une écriture3 » (selon la célèbre formule d’Anne Ubersfeld) et on tentera de débrouiller ce que la métaphore — qui séduit encore4 — a emmêlé : les textes, justement, qui n’en sont peut-être pas tous au même titre.
***
3Réfléchissant à la place du texte dramatique au théâtre dans la création et la critique depuis la fin du XIXe siècle, Patrice Pavis énonce le constat suivant, qui sera notre point de départ :
Dans la tradition occidentale, le texte dramatique reste une des composantes essentielles de la représentation. Longtemps même, on l’a assimilé au théâtre par excellence, en n’accordant à sa représentation qu’un rôle accessoire ou facultatif. Les choses ont toutefois radicalement changé avec la reconnaissance, vers la fin du XIXe siècle, de la fonction du metteur en scène reconnu capable (ou coupable ?) d’imprimer au texte mis en scène la marque de sa vision personnelle. Pour le théâtre de mise en scène, il est alors logique de faire porter l’analyse sur l’ensemble de la représentation, au lieu de considérer cette dernière comme dérivé du texte. Les études théâtrales, et notamment l’analyse du spectacle, s’intéressent à l’ensemble de la représentation, à tout ce qui entoure et excède le texte. Par contrecoup, le texte dramatique a été réduit à une sorte d’accessoire encombrant, laissé, non sans mépris, à la disposition des philologues. On est ainsi passé, en l’espace de cinquante ans, d’un extrême à l’autre, de la philologie à la scénologie.
Peut-être est-il temps de rétablir un peu plus d’équité, et si possible de subtilité : non pas de revenir à la vision purement littéraire du théâtre, mais de reconsidérer la place du texte dans la représentation ; non plus de discuter à l’infini, si le théâtre est littérature ou spectacle, mais de distinguer le texte tel que nous le lisons dans la brochure et le texte tel que nous le percevons dans la mise en scène5.
4Distinguer le texte du texte avec P. Pavis ? Essayons.
Le texte et le texte… et sa lettre
5Un texte, dit P. Pavis, n’est pas seulement mis en scène : il est également « émis en scène », c’est-à-dire qu’il est produit dans la mise en scène. P. Pavis distingue donc deux approches dans l’analyse des spectacles : étudier « comment un texte (préalable) a été mis en scène » et « comment le texte est émis en scène, à savoir rendu audible ou visible6 ». Le spectateur n’a accès qu’au texte tel qu’émis en scène :
Dans le cas où il interprète un texte, le spectateur doit prendre soin d’examiner comment le metteur en scène et les acteurs ont lu ce texte et l’on inséré dans une représentation. On n’a donc pas accès au texte en soi, tel que nous le lirions dans la brochure (qu’elle soit ou non publiée, que nous la connaissions ou non), mais à une lecture particulière, concrétisée dans la mise en scène7.
6En effet :
Lorsque nous parvient la voix de l’acteur, il y a déjà eu mise en voix, mise en scène vocale du texte : le spectateur reçoit une copie vocale du texte qu’il n’a donc pas à activer lui-même, comme le fait le lecteur8.
7Or justement, si le spectateur ne peut pas avoir accès au texte « en soi, tel que nous le lirions dans la brochure », pourquoi parler de la « mise en scène vocale du texte » comme d’une « copie vocale du texte » ? De quel texte exactement le spectateur reçoit-il une « copie » ?
8P. Pavis remarque que « toute mise en scène s’approprie quelque chose du texte dramatique, elle déplace et crée à sa manière le sens, elle parodie toujours un peu l’objet de départ9. » Même lorsque elle « veut se faire passer pour invisible », elle « est toujours présente » : « il n’y a pas de lecture neutre, universelle et immédiate : le public entendra certes la lettre du texte, mais le sens n’ira jamais de soi10. » Or la lettre du texte ne va pas de soi non plus. Si on la définit non en opposition à son esprit (sens littéral vs sens profond) mais, comme semble le suggérer P. Pavis, en opposition à son « sens », si donc la lettre du texte correspond à son expression formelle (qu’est-ce exactement ?) ou aux modalités de sa (re)présentation (ponctuation noire, orthographe, caractères…), sa transmission dans la représentation théâtrale paraît sérieusement contrariée. Peut-on vraiment l’entendre ? Ne devrait-on pas plutôt la montrer au moyen de pancartes, d’une projection comme dans PLACE ! (2014) d’Adina Secretan – La Section Lopez, ou d’écrans comme dans El Triunfo de la libertad (2014) de La Ribot11 ? Et encore, dans ces cas, le format du texte et la vitesse de son défilement imposent à une hypothétique version imprimée une transformation significative.
9Au sujet de la matérialité du texte, P. Pavis cite Pierre Voltz :
il faut lui inventer [au « texte de théâtre »] une consistance matérielle que ne possède pas le livre, appuyée sur la physique du corps et de la voix, car le texte est sans doute littérairement une « forme esthétique », mais théâtralement il n’est qu’un « matériau »12.
10Ailleurs, P. Pavis explique :
La matérialité du texte, c’est d’abord sa matière sonore, sa musicalité, sa rhétorique, tout ce qu’on rassemble sous le terme de textualité, voire de texture. C’est également ses microstructures, sa facture verbale concrète, son mode d’énonciation13.
11Cette dimension phonique, le texte mis en scène et le texte émis en scène la partagent peut-être dans la mesure où, dans l’étape de la lecture déjà, graphè et phonè se laissent mal distinguer : le lecteur n’entend-il pas d’une certaine manière — voire : ne dit-il pas — le texte qu’il lit14 ? Il n’empêche que si l’on entend au théâtre la lettre du texte dont la « consistance matérielle » gestuelle et vocale ainsi que le sens sont sinon inventés, au moins réinventés sur scène par l’énonciation, il reste à définir précisément laquelle, et à se demander de quoi parlent les metteurs en scène et les critiques quand ils disent cette lettre respectée. Étudier « comment le texte est […] rendu audible ou visible15 » sur la scène, c’est avant tout se confronter au processus de transformation d’un certain mode de (re)production et de (re)présentation à un autre.
La métaphore textuelle : un imbroglio en plusieurs actes
12Lorsque P. Pavis dit du texte qu’il est sur scène « rendu audible ou visible », il faut sans doute comprendre que le texte dialogué écrit est dit (rendu audible) tandis que le texte didascalique est montré(rendu visible)16. Du point de vue du spectateur, P. Pavis fait par ailleurs une différence entre « texte seulement entendu » et « texte entendu et vu », dont le « contexte a été matérialisé visuellement et scéniquement17 ». Or il faut bien considérer que le texte rendu visible et le texte vu18 (au moins) ne sont des « textes » qu’au sens métaphorique… et admettre que cette métaphore génère autant de difficultés qu’elle en résout.Peut-être faut-il alors rouvrir une discussion que Donald Francis McKenzie jugeait « désormais inutile19 » il y a quelques années déjà, qui concerne l’usage étendu de la notion de « texte ».
13Il faut dire que la métaphore textuelle est bénéfique à plusieurs égards pour l’analyse du spectacle puisqu’elle permet de décrire la relation qu’entretiennent tous les « textes scéniques » entre eux, comme A. Ubersfeld a pu le faire avec le succès que l’on sait. La sémioticienne a d’ailleurs beaucoup contribué à la fortune de ce qu’elle appelle la « représentation comme texte20 » :
le texte verbal (code linguistique) est une part du texte général de la R.T. [représentation comme texte], ce texte défini par ses lois propres et soutenant des relations précises avec les autres textes scéniques21.
14Or cet usage multiple du terme de « texte » ne va pas sans générer quelque confusion. Même : il complique la situation dès qu’il s’agit de rendre compte de cas particuliers. En l’absence de dialogue sur la scène, A. Ubersfeld convoque par exemple indistinctement une sorte de métatexte (non imprimé) ainsi que le texte didascalique (imprimé) pour justifier l’impossibilité d’une « représentation sans texte, même s’il n’y a pas de paroles22 » — raison entre autres pour laquelle elle peut affirmer ailleurs que « le texte de théâtre » a « exactement [le statut] d’une partition23 ». De quel « texte » s’agit-il alors précisément ? C’est plus flou encore lorsqu’elle commente la phase d’élaboration du spectacle dans lequel s’effectue un brouillage entre textuel et scénique24:
D’où, pour la représentation, la nécessité d’une pratique, d’un travail sur la matière textuelle, qui est en même temps travail sur d’autres matériaux signifiants. Mais le travail sur le texte suppose aussi la transformation en texte, par le praticien de théâtre, des signes non linguistiques, par une sorte de réciprocité25.
15Dans la mesure où je ne suis pas certain de l’acception du mot « texte » dans ce contexte, je ne saisis pas bien la « sorte » de « réciprocité » dont il est question ici26. Arrêtons-nous là : ne faut-il pas, à ce stade, se demander si la métaphore textuelle aide vraiment à clarifier la situation ? Si, selon la mise en garde formulée par A. Ubersfeld elle-même, « refuser la distinction texte-représentation conduit à toutes les confusions27 », refuser la distinction texte/non-texte peut aussi générer de la confusion, surtout dans les études théâtrales où il y a souvent trop de « textes » pour que l’on sache toujours de quoi on parle.
La mise en scène du texte : T → T’ → P
16Reprenons maintenant la célèbre équation d’A. Ubersfeld, qui propose une synthèse du problème de la place du « textuel » dans la représentation théâtrale et en cela sert de fondement aux trois tomes de Lire le théâtre :
T + T’ → P28,
17soit : T = « le texte de l’auteur (en principe imprimé ou tapé à la machine) » ; T’ = « un autre texte, de mise en scène », « cahier de mise en scène, écrit ou non écrit » ; P = « la représentation ». T’ « s’inscri[t] dans les trous de T » et est
par nature assimilable à T et radicalement différent de P, dont la matière et les codes sont d’un autre ordre : la partie linguistique du fait théâtral est composée des deux ensembles de signes de T + T’29.
18Sauf erreur, cette formule n’a rencontré que peu de résistance — peut-être parce qu’elle rappelle le modèle de la linguistique de l’énonciation : phrase + énonciation → énoncé ? Dans le deuxième tome de sa trilogie, A. Ubersfeld précise :
à partir du moment où à un scripteur S se superpose un praticien P (metteur en scène, scénographe, comédien, etc.), au texte T du scripteur s’ajoutera le texte T’ du praticien, que ce texte soit le cahier de mise en scène ou du régisseur, le canevas commenté du scénographe, les notes du comédien ou de la scripte. Il n’est pas indispensable que ce texte soit écrit. Il peut être oral ; il peut être centralisé par la voix du metteur en scène ou être éclaté, pluriel, dans le cas d’une création collective. Il peut inscrire le duo du metteur en scène et du scénographe. Il peut être en contradiction ou en prolongement par rapport au texte T. Il peut s’inscrire dans les trous du texte ou lui superposer un autre discours, faire entendre une autre voix30.
19C’est là, à mon sens, que l’équation révèle son inexactitude : T’ ne s’additionne pas à T, mais lui imprime suffisamment de modifications pour qu’on puisse dire qu’il le remplace. À bien y réfléchir, cela semble assez attendu : disparition des didascalies, modifications presque inévitables du dialogue (en termes de ponctuation, a minima), voire ajouts, coupes, reconfigurations.
20Entre le texte dramatique écrit et le « texte » émis en scène sont élaborés en effet un ensemble de documents qui opère la théâtralisation du texte dramatique. Sauf à considérer que la représentation théâtrale est un texte, le terme d’« avant-texte du spectacle » que la génétique aurait pu imposer s’avère ici impropre. Disons donc, dans le cas de la mise en scène des classiques, qu’il s’agirait plutôt de désigner cet ensemble de documents par le terme d’après-texte. On se gardera de confondre ce dossier génétique avec le texte de l’auteur dramatique qu’il modifie (souvent), complète, coupe, reconfigure et intègre dans un système qui l’excède — en cela, l’après-texte n’est peut-être déjà plus un texte —, mais aussi avec le « texte » finalement dit sur scène, ce dernier étant agrégé à toute la matière sonore (voix, bruits, musique) et intégré tel au « texte » montré que constitue la représentation théâtrale — à la place duquel je ne suis pas certain qu’il faille « préfère[r la notion de] partition31 » comme le suggère P. Pavis, dans la mesure où il s’agit d’une nouvelle métaphore — et dont il me paraît artificiel et de toute manière difficile de l’abstraire. Ce « texte » finalement dit en représentation pourrait être écrit après coup : il ne l’est dès lors pas encore, alors qu’on croit habituellement qu’il l’est déjà.
21La plupart du temps, on a touché et on touche non seulement à ses « trous », mais encore au texte. A. Ubersfeld le reconnaît : « verbal ou scriptural, un texte T’ s’interpose nécessairement, servant de médiateur entre T et P32 ». Faut-il donc modifier la formule (qui ne vaut que dans le cas de la mise en scène des classiques, c’est-à-dire dans les cas où un texte préexiste au projet de mise en scène) ainsi ?
T → T’ → P,
22« T’ » étant ici notre après-texte33— car effectivement, je l’ai déjà dit, il n’est pas certain qu’il s’agisse encore d’un texte. Si l’on aimait les formules mathématiques, il faudrait alors trouver une nouvelle lettre.
Typologies des mises en scène de classiques
23Le rapport de la mise en scène au texte du dramaturge a motivé plusieurs typologies de la mise en scène des classiques. Dans la seconde édition de L’Analyse des spectacles (2012),P. Pavis propose une « typologie historique34 ». Il traite ensuite « les mises en scène des classiques » à part et présente six catégories : « la reconstitution archéologique du spectacle », « l’historicisation », « la récupération du texte comme matériau brut », « la mise en scène des sens possibles », « la mise en voix » et « le retour au mythe ».
24Cette typologie se fonde sur la conception selon laquelle la mise en scène est issue, implicitement ou explicitement, du texte dramatique : s’attache-t-elle à sa lettre, à la fable racontée, aux matériaux bruts qu’il livre, aux sens multiples qu’il permet, à la rhétorique qui l’anime, au mythe où il prend racine ?35
25P. Pavis propose ensuite, après avoir signalé le caractère problématique des catégories trop détaillées, une distinction entre la mise en scène « autotextuelle », « idéotextuelle » et « intertextuelle »36 et examine les propositions de Hans-Thies Lehmann et de Robert Abirached37. Il ne mentionne pas la typologie assez précise qu’il avait élaborée en 1984 dans un article nourri par ses recherches doctorales38, pourtant reprise et expliquée en détail dans la seconde édition de La Mise en scène contemporaine (2010)39. Il distinguait alors « la reconstitution historique », « l’historicisation », « la récupération », « la pratique signifiante », « la mise en pièce(s) », « le retour au mythe » et la « dénégation »40. Il faut ici remarquer qu’une telle typologie donne prise au développement d’une véritable casuistique. D’ailleurs la « reconstitution historique » — qui, comme la reconstitution archéologique (dans L’Analyse des spectacles), « s’attache [...] à la lettre du texte » — est par exemple qualifiée par P. Pavis d’« imposture » ou de « distraction inutile » passant souvent à côté de « l’essentiel41 ». En examinant le rapport de la mise en scène au texte dramatique, peut-être les typologies révèlent-elles surtout le rapport de leurs auteurs au « texte » comme notion et comme symbole.
26En tout cas, toutes ces distinctions décrivent un processus : la théâtralisation du texte. Elles mettent en évidence le fait que le texte n’est pas le texte : il subit une transformation dans la mise en scène. « Le texte dramatique […] devient scénique et théâtral dès que la mise en scène le fait passer à l’acte42. » En ce sens, la « récupération du texte comme matériau brut », que P. Pavis tient pour « la plus radicale » des manières de mettre en scène un classique, partagerait peut-être avec les moins radicales d’entre elles de « modifie[r] la lettre du texte43 » en l’utilisant.
L’existence simple du texte dramatique
27Quel est donc le mode d’existence du texte dramatique ? A. Ubersfeld croit en décider en ces termes :
Le texte de théâtre est présent à l’intérieur de la représentation sous sa forme de voix, de phonè ; il a une double existence : d’abord il précède la représentation, ensuite il l’accompagne44.
28Si l’on peut se demander si l’œuvre de l’écrivain a une « double existence » écrite et phonique, il me semble inexact d’affirmer que le texte dramatique a une « double existence » : il peut bien précéder la représentation théâtrale (ou la suivre), mais il n’est pas certain qu’il puisse jamais l’accompagner. Il me semble en fait que l’existence du texte dramatique est soit simple, soit infinie, soit nulle. Nulle parce qu’il est entendu que « le texte n’existe pas45 », infinie parce qu’il y a autant de textes que de lecteurs46 « qui les recréent en les lisant47 », simple parce que le texte dramatique imprimé ne peut pas être confondu avec le texte tel qu’« émis en scène ». La solution la plus économique, me semble-t-il, est de reconnaître à ces deux « textes » une existence pleine répondant d’ailleurs à des logiques différentes48 et présentant des enjeux spécifiques49. Cela ne signifie pas qu’on nie leur fréquente interdépendance : cette proposition n’invalide en rien les recherches qui concernent cette relation50.
29Tout cela ne signifie pas non plus que le texte de l’écrivain n’est pas en partie « audible » dans la représentation théâtrale, même s’il n’est pas aisé de déterminer quel texte l’on crée dans une mise en scène51 : en une certaine manière, le texte dialogué, comme l’a dit A. Ubersfeld « sera présent, scéniquement, sous forme phonique52 ». Mais le futur du verbe est ici important : A. Ubersfeld n’examine pas là le texte dans son mode d’existence propre. Rappelons-nous la leçon de Roger Chartier :
Elles [certaines comédies de Molière] sont, d’abord, données à Versailles au sein de fêtes de cour où elles se trouvent enchâssées dans d’autres divertissements et d’autres plaisirs, puis elles sont représentées sur le théâtre du Palais-Royal, dépouillées de leurs ornements (chants, musique, ballets), et, finalement, elles sont transmises par l’imprimé (en des éditions très différentes) au public de leurs lecteurs. Un « même » texte, donc, mais trois modalités de sa représentation, trois rapports à l’œuvre, trois publics. L’étude de ses significations ne peut pas ne pas prendre en compte ces différences53.
30Les guillemets de R. Chartier — « un “même” texte » — sont à mon sens la marque prudente d’une gêne à prendre au sérieux54.
31On se souvient que P. Pavis invite à « penser séparément l’étude des textes écrits et celle des pratiques scéniques comportant des textes55. » Que faire du texte dramatique, qui est l’un des multiples « états » du texte de théâtre56, ou plutôt de l’œuvre dramatique57, qu’on dit souvent destiné à s’insérer dans une œuvre scénique (ou qui en est issu) ? Même s’il s’agit là d’un autre sujet, il faut bien constater que la question de l’œuvre théâtrale58 mine toute tentative de réflexion sur ce qu’on appelle confusément le « texte de théâtre ». Quel statut a un texte dans deux mises en scène différentes (voire : dans deux représentations d’une même mise en scène) ? A-t-on un texte et une œuvre ou trois textes et trois œuvres ? Plus compliqué : a-t-on trois œuvres mais un seul texte, ou trois textes et une seule œuvre ? Gageons que les diverses configurations du rapport entre l’identité des textes et des œuvres se retrouvent dans les discours sur le théâtre, et que l’on pourrait s’amuser sans doute à en faire l’histoire et la cartographie.
Ménard & famille
32Revenons maintenant au paradoxe du Quichotte de Ménard. Peut-il illustrer avec une réelle pertinence ce qu’on pourrait appeler le paradoxe de la mise en scène des classiques, selon lequel le metteur en scène est censé proposer une œuvre à la fois conforme à celle de l’écrivain (il ne touche pas au texte : il tente de le faire entendre) et originale (il touche au texte : il le fait entendre d’une certaine manière) ? Relisons Henri Gouhier :
[…] il s’agit d’une situation paradoxale : Louis Jouvet, metteur en scène et acteur, doit être fidèle au texte de l’École des femmes dont il assure la re-création. Mais dans « re-création », il y a « création » : Louis Jouvet représente l’École des femmes telle qu’on ne l’avait jamais vue59
33On a dit que Pierre Ménard est une figure du lecteur60 ; on aurait pu dire qu’il est une figure du metteur en scène de classiques (même si, au contraire du lecteur et du metteur en scène de classiques, Pierre Ménard ne travaille pas sur la base d’une lecture) et ainsi lire la relation entre l’œuvre dramatique et l’œuvre scénique sous le signe du « problème de Borges61 ». Mais il faut finalement reconnaître que l’analogie ne fonctionne pas bien. Le texte écrit et le texte dit sur scène ne sont nullement comparables terme à terme comme le sont les deux Quichotte62: ils ne partagent pas une même matière, ils sont produits et reçus (activés) différemment l’un de l’autre, et l’examen de la relation qu’ils entretiennent ne peut se passer d’une étude génétique qui, au cas par cas, se penche sur la manière dont s’opère la théâtralisation du texte dramatique. Bref : Pierre Ménard n’a pas été metteur en scène : il n’aurait tout simplement pas voulu l’être.
34Il est alors temps de remarquer que Borges a omis, quand il a présenté Pierre Ménard, second auteur du Quichotte, de nous parler de ses cousins Paul, traducteur du Quichotte, et Jean, éditeur du Quichotte63(il vaut mieux oublier leur cousin Martin, historien du Quichotte64). On se serait alors mieux convaincus qu’ils auraient dû suivre l’exemple paternel (Jacques Ménard) en embrassant la carrière mieux rémunérée de chef d’orchestre65. Il aurait été pour moi plus simple de montrer qu’aucun d’eux n’a été metteur en scène (je disposerais d’archives), mais qu’ils ont sans doute été en mesure d’incarner chacun à leur façon — Jacques, Pierre, Paul ou Jean (ou Martin) — l’un des multiples avatars du metteur en scène de textes classiques idéal — idéal variable, à la fois dans la diachronie et la synchronie66.