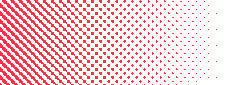« Qu’aux heures immobiles l’œil accueille ce qui arrive »
1Puisse-t-il alors co-naître.
2Se laisser le temps de mieux voir, se déprendre d’une intention initiale, attendre de trouver l’angle (de l’image) juste : il est des vertus passives qui permettent les films. Arts de les voir, les imaginer, les réaliser. Sur scène ou sur l’écran, déjà, l’interprète1 Pierre Carniaux avait senti le nécessaire abandon de soi le temps du jeu. Derrière l’appareil photo ou la caméra, on peut se le représenter aspirant au « réveil devant le fait2 », soit le satori propre au haïku, ainsi que le définit Barthes dans L’Empire des signes, livre de chevet sinon de voyage pour le cinéaste.
3Le Japon, d’où il nous parle ici, Pierre le connut tôt via Motoi Miura3 ou Oriza Hirata4 notamment, qui l’ont fait jouer autant qu’aidé à être et devenir. De ces îles pour nous lointaines émergèrent les photographies d’Isolements5, ainsi que son premier long métrage, Last Room6. À la rencontre d’un monde qui se découvrait alors, et avec quelle pudeur, le jeune faiseur d’images croisait des gens qui devinrent parfois des amis et souvent les « sujets » de son travail. Très riches heures qui lui permettent de dire comme et avec Barthes que « le Japon l’a mis en situation d’écriture7 » et de création encore récemment, à l’automne 2014.
4Pierre Carniaux a bien voulu jouer le « jeu » de l’entretien, espace dialogique incertain et lieu possible pour une « parole paisible8 » où tout le texte n’est pas tout à fait sous contrôle, où il s’agit de laisser aller – « pour voir », et non sans plaisir certes. Là travaillent la parole et l’écriture, cette dernière n’excluant pas quelque douleur pour l’artiste, parfois : un plus souple cadre, ici permis par l’échange et la plurielle relecture-réécriture, l’aura rendue, semble-t-il, plus aisée9.
5Quelles sont les « vertus passives » qui lui semblent à l’œuvre dans et pour l’œuvre photographique et cinématographique ? Comment ressent-il la force d’inertie qui constitue la matière enregistrée et agie par un opérateur qui n’en est pas l’absolu ou le seul animateur ? Résistance, travail et inactualité de ces post(ur)es d’attente : quels enjeux au cœur de la si nécessaire et paradoxale passivité créatrice ?
6Conversations préalables :
7Comme pour un film, plusieurs « prises », et du montage. Les premiers mots écrits envoyés le furent de Tokyo, durant le passage des typhons Phanfone (5-6 octobre 2014) et Vongfong (12-13 octobre), puis de Kyoto, 64-22 Kitashirakawakubota-cho, Sakyo-ku (21 octobre). Il y eut aussi un très hivernal 1er décembre à Evreux, à une commune table de travail, afin de mieux voir comment coller les mots et les images. D’autres fois encore, de janvier à mars, par ph(r)ases écrites ou échanges de paroles. Nombre de mails, enfin, qui forme une amicale correspondance entre P.C. et N.G. – autant de moments pas forcément faciles à dater, mais qui comptèrent et permirent de « tisser10 ».
« Vertus passives » : deux mots d’abord
8P.C. : Le premier mot qui me fait réagir, c’est le second. Dans le paysage actuel, il apparaît au milieu d’une nuée de connotations négatives. Comment pourrait-il en être autrement lorsque entre l’enfance et la vieillesse, on a remplacé l’âge adulte par la vie active ? Nous évoluons dans des sociétés ou l’activité est une religion d’État dont toutes les prières sont tournées vers sa croissance. Malheur aux inactifs, donc, qui ne sont que des impies et auront bien mérité leur châtiment. Mais l’association des vertus à la passivité fait éclater un paradoxe. Les physiciens l’ont révélé, un synonyme de la passivité, l’inertie, possède une force. Et le premier terme de l’expression d’Ossola suggère que cette énergie requiert de l’exigence, de la constance, du travail. On oublie trop souvent que, dans un dialogue, pour qu’une personne parle, il en faut une autre qui écoute, et que c’est tout aussi physique et intellectuel. Mais si le locuteur monopolise la parole sans écouter le silence de l’interlocuteur, ce dernier peut développer une « passivité hostile11 » à son égard. Ainsi le pouvoir peut se sentir menacé par la passivité, car elle est potentiellement le creuset d’une rébellion. Dans ma construction personnelle, la pratique de la scène constitue une expérience majeure autour de ces questions. On a tendance à associer spontanément cet espace à celui de la parole ou de la performance. Mais ce que la scène m’a donné de plus précieux et de plus exigeant est l’apprentissage sans fin de l’écoute et du silence.
(Dé)prises | faire un film
9N.G. : Explorer le medium cinéma passe par un renoncement qui relève en fait d’une lutte : c’est contre la dictature du scénario (d’un certain logos, finalement) qu’il s’agit de situer le film(age) au travail. Cette ouverture aux possibles du réel « comme » de l’inconscient, vous en ressentez le besoin en temps que spectateur même : nul « punctum12 » n’émergera dans l’ennui que peut susciter le (pré-)découpage perçu dans l’œuvre finie, c’est-à-dire l’agencement narratif supposé intangible dès avant le tournage.
10P.C. : Je n’aime pas « faire des images ». J’aime aller à leur rencontre. De la pratique de la photographie, je garde un goût prononcé pour l’errance et le surgissement de l’imaginaire dans le réel. Je peux préparer cette rencontre, lui donner a minima des dimensions temporelles et spatiales. Mais quel que soit le travail en amont, je tâche de préserver l’incertitude de ce qu’elle va donner. Comme l’affirme Bachelard : « On veut toujours que l’imagination soit la faculté de former des images. Or elle est plutôt la faculté de déformer les images fournies par la perception13. » Ainsi je ne visualise pas, ne séquence pas, ne découpe pas les images avant le tournage. J’attends qu’elles se révèlent (ou non) avec leurs mouvements, leurs durées, dans la relation au présent. En écho à mon expérience de la scène, j’ai un sentiment très physique de l’acte de filmer. Comme jouer ou danser, il y est question d’écoute, d’accueil, de présence au monde, à l’autre. Andrei Tarkovski décrit le poète comme « un homme qui a l’imagination et la psychologie d’un enfant. Sa perception du monde est immédiate, quelles que soient les idées qu’il peut en avoir. Autrement dit, il ne “décrit” pas le monde, il le “découvre14”. » La plupart des films que l’on peut voir en salles sont si écrits et « décrits » qu’ils ne me donnent plus aucun sentiment de découverte, tout comme d’autres et parfois les mêmes, gouvernés par la volonté de dire quelque chose, de transmettre un message. Godard15 : « les messages c’est pour les PTT », et à notre époque, où la culture et la communication sont réunies dans un même ministère, ils sont de toutes natures et sur tous nos écrans quotidiens. J’ai le sentiment que de nombreuses inspirations cinématographiques sont asphyxiées par les productions littéraires préalablement exigées. Écrire un film ne va pas de soi. Et cela ne semble pas poser question. Les déclarations de Robert Kramer dans Pour vivre hors-la-loi, tu dois être honnête (1993) ne m’abandonnent jamais :
Les films reflètent l’état des choses, cette bizarre impasse du Pouvoir lui-même. Reste que les questions essentielles, mystérieuses, celles qu’il convient de se poser, sont justement celles qui sont écartées du design (de plus en plus inévitable) du produit filmé habituel. Les questions essentielles, mystérieuses sont précisément celles auxquelles nous ne connaissons pas les réponses. Ou peut-être ce sont celles que nous ne savons même pas pouvoir poser. Ou peut-être ne savons-nous pas comment les poser. Parce que, si nous les posons dans la forme familière (peut-être la seule forme dont nous disposons vu le langage que nous parlons et que nous utilisons pour voir), les réponses tendront toujours à venir de la même manière, les mêmes réponses familières. Or ces questions (si nous parvenons à imaginer comment les poser) sont celles qui se pressent aux murs de notre prison16.
11N.G. : L’image sidère « sans que je sache pourquoi17 » : ainsi pourrait parler aussi le cinéaste qui crée des dispositifs dont il ne sait volontairement pas ce qu’il en adviendra. L’image à venir nécessite de la patience – et pour élaborer, tourner, monter et diffuser Last Room, il en fallut, non moins que d’autres vertus passives.
12P.C. : La naïveté, l’innocence ont accompagné la joie de commencer ce projet et de lui donner ma vie, mais elles m’ont conduit, par exemple, à faire confiance à de mauvais interlocuteurs, à m’endetter lourdement, sans me poser de questions, sans penser aux éventuelles conséquences sur ma santé en cas de problèmes. Qui n’ont pas manqué de se présenter avec une brutalité que je n’avais jamais imaginée.
13L’humilité, le détachement, sans lesquels ma perception de l’existence aurait pu se noyer durant certaines périodes dans un sentiment médiocre de tragédie ridicule au regard de souffrances subies par tant d’êtres humains.
14L’abandon, d’un combat contre le premier producteur du film qui aurait brûlé toute mon énergie et réduit déjà plusieurs années de travail à ce moment-là à l’état de cendres.
15La résilience enfin, dont les définitions dans des domaines aussi divers que la physique, l’écologie, la biologie et la psychologie me paraissent correspondre à ce que j’ai traversé... Cela ne me semble pas un phénomène sur lequel l’action ou le volontarisme puisse grand-chose... Je ne pouvais que m’en remettre au temps et espérer qu’il travaille pour moi.
Vacances | temps morts – d’une paradoxale productivité
16N.G. : Les Vacances du cinéaste18 de Johan van der Keuken est un album d’images entre film de famille et retour sur l’œuvre passée, croisant moments intimes et rencontres avec des paysans de l’Aude. Cette réalisation, comme libérée des attentes et contraintes habituellement liées au « cinéma », presque en roue libre, s’ouvre, comme le haïku selon Barthes, à la « saisie de la chose comme évènement19 ».
17P.C. :Je suis particulièrement attaché à l’œuvre de Van der Keuken pour une raison très simple. J’avais 18 ans lorsque j’ai vu pour la première fois un de ses films. Amsterdam Global Village a été une véritable révolution dans mon parcours de cinéphile. Je ne savais pas à ce moment-là qu’un documentaire pouvait être aussi libre qu’un poème ou une composition musicale. J’avais également été très impressionné par la dimension de ce film qui me semblait embrasser l’humanité entière à travers les (presque) seuls canaux d’Amsterdam. Quand je suis sorti de la salle, Van Der Keuken était là. Timidement, je lui ai témoigné mon émotion, et spontanément, je lui ai proposé mon aide pour son prochain film. Il m’a remercié très gentiment et m’a demandé comment j’imaginais que le film avait été réalisé. Devant mon silence, il m’a dit qu’il tenait la caméra et que sa femme tendait la perche...
18Au printemps dernier, j’ai dû mettre entre parenthèses un projet d’écriture entamé plusieurs mois auparavant. Ma compagne m’a alors encouragé à la filmer avec un caméscope totalement périmé selon les critères industriels dans son village de campagne, avec sa fille, des amis, la nature, le soleil et la nuit. J’ai filmé sans objectif, avec le seul désir d’être présent. Si tu veux faire du cinéma, prends une caméra...
19Cet automne, je suis retourné au Japon pour de multiples raisons... Je suis parti avec l’idée de réfléchir et développer plusieurs projets et d’en réaliser un. J’ai une caméra, un titre, traduit d’un proverbe bouddhiste « Tout ce qui a une forme est appelé à disparaître », le texte de Paul Claudel À travers les villes en flammes sur le séisme de 1923 et l’invitation de Yusuke Oba, un ami acteur, à séjourner chez lui à Tokyo pendant ses quelques jours de vacances. Quelques jours de vacances qui nous ont permis d’errer, de nous égarer, au gré des intuitions. Les images sont apparues presque sans volonté, sans force... Aujourd’hui le film existe, Claudel a disparu, le titre est toujours le même et les images portent la respiration du tournage. Certains projets peuvent demander des années ou une vie. En attendant, si l’on peut, il n’est pas interdit de prendre des vacances et d’y tenter des solos, des duos, de petites formations.
20N.G. : Si le montage est choix, moment singulier d’un pluriel complexe, le travail du « filmeur20 » semble donc s’apparenter à « l’esprit de l’homme parfait » qui est « comme un miroir : il ne saisit rien mais ne repousse rien21 ». La vie, dans le réel comme au cinéma, se loge-t-elle dans les temps morts dont la narration cinématographique « classique » se méfie quand elle ne les instrumentalise pas ?
21P.C. : Dans l’inversion des valeurs proposée par l’expression qui nous intéresse et du point de vue que je défends, les « temps morts » deviennent effectivement la vie même. Henri Michaux m’a souvent accompagné dans mes pérégrinations cinématographiques : « les heures importantes sont les heures immobiles. Ces fractions du temps arrêtées, minutes quasi mortes sont ce que tu as de plus vrai, ce que tu es de plus vrai, ne les possédant pas, n’étant pas par elles possédé22. »
22Dans le contexte du cinéma industriel, dans lequel j’inclus également la très grande majorité du cinéma dit d’« art et d’essai », et qui ne voit que très rarement d’un bon œil les projets dits « documentaires » ou « du réel », il est très difficile d’en faire des films. Tout simplement parce qu’on y est très largement persuadé que ces temps ne deviendront pas de l’argent. Bien souvent, dans le paysage audiovisuel actuel, comme on peut l’entendre dans Adieu au langage (Jean-Luc Godard, 2014), « ce qu’ils appellent image, c’est le meurtre du présent ». Sur toute la planète, on shoote.
23Dans la famille nombreuse quoique modeste à laquelle appartiennent Van der Keuken et Kramer, je pense aussi Jonas Mekas23, il y a des héros qui n’ont pas fait du cinéma sur, ni même du cinéma contre, mais du cinéma avec. Avec leurs familles, avec leurs amis, avec les autres, avec le monde, avec rien.
Laisser donner du temps
24N.G. : Dans sa démarche même, Last Room donne du temps aux amis, gens filmés qui sont aussi des gens « filmant ». On semble loin de l’image du réalisateur (autre mot à interroger « en fait ») prétendant au « contrôle de l’univers24 »… La place et la force de l’effacement apparaissent ici comme décisives.
25P.C. : Lors du tournage, j’essaie de donner aux personnes, à l’image la même liberté que j’essaie de me laisser. Je définis un cadre, des règles du jeu, mais je souhaite qu’ils s’en emparent, les explorent à leur guise, et s’ils en ressentent le désir, qu’ils les brisent. Dans Last Room, si je suis l’auteur des images, la plupart des récits appartiennent aux acteurs, à leur histoire personnelle, parfois à leur fantaisie et leur espièglerie. Pour cette strate du film, le contexte de la culture japonaise, où parler de son intimité est chose peut-être encore plus délicate qu’ailleurs, m’a amené à les laisser dans des chambres d’hôtels, seuls face à la caméra, libérés de la tension de mon regard. Dans ces chambres, chacun a décidé pour lui-même de la capsule temporelle qu’il offrait aux rushes. Certains ne se sont exposés que pendant quelques minutes, lorsque d’autres se sont livrés des heures durant. Après, comme le disait Fabrice Aragno, à propos de Godard dont il est l’« apprenti-sorcier25 », je les ai « dirigés au montage26 ». À travers cette série de portraits, j’ai aussi esquissé mon propre autoportrait... Et veillé à ne pas coudre de fil narratif définitif dans le tissu des images, afin que le spectateur soit lui aussi invité à recomposer une identité sans cesse interrogée, que le film s’offre à la fois comme un miroir et une fenêtre sur l’autre.
De quelques vertus passives japonaises
26N.G. : « Dans le Vide, il y a le bien, et non le mal27 » : cette assertion mystérieuse de Musashi incarnerait assez bien les images éventuellement stéréotypées que l’on peut avoir de l’Orient extrême, si l’on songe par exemple au Tao Tö King, par exemple.
27P.C. :Le vide évoqué par Musashi résonne en moi, fait écho aux « heures immobiles » de Michaux citées plus haut... Il est peut-être vrai que le concept est plus étranger à « notre » culture puisque « au commencement était le Verbe »... Néanmoins, il me semble que tous les grands courants spirituels de par le monde se rejoignent autour de ce centre vide, de cette absence, de ce silence.
28N.G. : Le « détachement » (Abgeschiendenheit) prôné par Maître Eckhart est en effet « proche du néant28 », puisqu’il s’agit de laisser toute place à Dieu, de se mettre en capacité de le recevoir. Le vide, le blanc ou le silence temporaire entre les lettres hébraïques est « le cœur du sens car il est la possibilité du sens29 », ce dernier n’existant qu’au pluriel.
29P.C. : « Écoutez le silence ». C’est avec cette douce impériosité que mon expérience japonaise a débuté. J’avais 20 ans en 1999 et la première pièce de théâtre dans laquelle j’ai été engagé « professionnellement30 » était Tokyo Notes31d’Oriza Hirata, dans une co-mise en scène de l’auteur et du metteur en scène Frédéric Fisbach32. Ces deux artistes et cette aventure théâtrale franco-japonaise (ou l’inverse) ont été décisifs dans la construction de ma pensée (ils sont ainsi pour beaucoup dans mes réponses à cet entretien), ma conscience et mon rapport au monde, et les chemins que j’ai empruntés par la suite. C’était la première fois qu’une pièce de cet auteur, alors déjà considéré comme majeur dans son pays, était traduite et jouée en français.
30Oriza, qui a aujourd’hui 52 ans, et qui s’est fait connaître au Japon avec un livre dans lequel il raconte un tour du monde qu’il a fait à vélo à l’âge de 16 ans, s’est engagé dès le début de sa vie d’homme de théâtre dans une voie à contre-courant de la scène contemporaine japonaise très influencée par l’Europe. Contrairement à ces spectacles dominés par les émotions extraverties, « les tripes », et parfois l’hystérie, il a construit et ce jusqu’à aujourd’hui un « théâtre calme » selon son expression (ou « en creux » dirait Frédéric) bien plus en dialogue avec la culture et le quotidien de ses compatriotes. La signature majeure de son écriture théâtrale réside dans une orchestration chorale de la parole (nombre de ses pièces compte une vingtaine de personnages), une parole quotidienne, mineure, qui apparemment ne dit « rien ». Les conversations s’y juxtaposent, s’y croisent, s’y répondent et s’y délitent pour toujours revenir, parfois plusieurs minutes, au silence. Parce que de la même manière que Bresson recommande de bâtir son film « sur du blanc33 », Oriza construit son théâtre autour du silence. Il y est travaillé de manière scientifique et (méta)physique. Ainsi l’essentiel de sa direction d’acteur réside dans la création et l’écoute du silence, à la minute ou à la seconde près. Bernardo Montet34, chorégraphe très marqué par le Japon ayant été le disciple de Kazuho Ohno35 (grand maître de butoh), et qui m’a fait danser dans Bérénice (2000-2001 dans une co-conception avec Frédéric Fisbach), me ramenait lui aussi, sans cesse, au silence... Je pourrais écrire un livre entier sur mon expérience avec le Japon. J’essaie désormais d’en faire des films en ce moment même... Mais il n’y a pas de vertu plus essentielle transmise par cette terre qui (au sens propre comme au sens figuré) me fait trembler, que celle de la pratique du silence.
31N.G. : Quand Agamben théorise le dispositif, il pense par définition(s) « stratégie36 », tout en envisageant la possibilité de la « profanation37 », « c’est-à-dire la restitution à l’usage commun de ce qui a été saisi et séparé en eux38 ». Si vous n’aimez guère le premier terme en raison de ses échos martiaux, c’est que vous préfèrez proposer des règles du jeu aux participants du film, tout en leur laissant la possibilité de déjouer. Rien de sacré, donc ? En tout cas, il semble falloir se rendre capable de saisir au vol ce qui arrive…
32P.C. : … quand cela arrive. En japonais, il y a un mot (hitsuzen) qui est le contraire du hasard (guzen), mais qui ne correspond ni à notre destin, fatalité ou providence. Cela se traduirait par « ce qui arrive par nécessité ». Je suis très attaché à cette notion... Si j’élabore en effet des dispositifs, je n’entretiens avec eux aucun rapport systématique ou dogmatique, ils ne restent que des hypothèses « tôt vouées à se défaire39 », les points de départ d’un processus dans lequel le réel va travailler autant que moi.
Spectateur « œil lucide40 »
33N.G. : Last Room, c’est 60 heures de rushes, 76 minutes de film, 60 minutes d’autres plans. L’on touche ici au travail du dérushage, puis du montage : non seulement il y eut une version de 1h50, mais c’est aux 8 heures de monologues face à la caméra que vous pensez encore aujourd’hui. Ces 60 minutes sont donc l’objet incarné de la négociation du cinéaste avec lui-même.
34P.C. : Ces 60 minutes d’autres plans font partie de la nébuleuse de rushes d’un peu plus de deux heures qui ont durablement imprimé ma rétine et qui ont été maintes fois pliés et dépliés au montage. Tout le monde sait ou peut imaginer à quel point il peut-être délicat d’arrêter de travailler. J’ai le sentiment comme cinéaste d’avoir vécu sur ce sujet une expérience singulière. Je savais que la matrice d’images au cœur de l’élaboration du film respirerait indépendamment, parallèlement et simultanément à sa forme linéaire. Car la rencontre avec Thierry Fournier41 (un des pionniers de l’art numérique en France) à Tokyo en 2002 a inauguré une relation de travail qui a abouti quelques années plus tard au dialogue de son œuvre interactive Dépli avec mon film Last Room. Édité sur tablette (iPad et ultérieurement Android), Dépli peut être expérimenté dans une salle de cinéma, en exposition ou individuellement. Cette oeuvre propose une navigation sensible à travers la nébuleuse de rushes mentionnée plus haut. C’est une proposition de « cinéma jouable » et sensuel, où le toucher devient le vecteur d’une écriture filmique. On pensera peut-être que je suis hors-sujet par rapport à la question des vertus passives. Bien au contraire, à travers Dépli, je donne mes images, à un autre artiste, aux spectateurs. Je renonce en quelque sorte à mes « droits d’auteur ». J’abandonne d’une certaine manière mon « pouvoir » de cinéaste et la « propriété » de mes images.
35N.G. : Vous faites des films, mais vous en montrez aussi42, faits par d’autres dont vous vous sentez proche, avec le plaisir d’inviter des publics variés à partager des émotions esthétiques d’abord éprouvées par vous. Le spectateur de cinéma vit une expérience spécifique, qui appelle des vertus passives bien particulières.
36P.C. : Dans l’expérience du cinéma en salle, il me semble que des vertus passives comme le silence ou la patience, en raison notamment de la connexion permanente à d’autres écrans, sont parfois en souffrance de nos jours...
37Je parle parfois de « miracle » devant l’image en pensant aux premiers spectateurs de L’Arrivée du train en gare de La Ciotat. Une vertu passive qui me correspond est la naïveté. Voir le réel ainsi réfléchi sur une toile a gardé pour moi toute sa force de sidération qu’il m’est intimement impossible de banaliser... Je ne m’explique toujours pas, après que le verbe se fut fait chair, comment on a pu ainsi se saisir du réel et le faire image, d’abord photographique, ensuite cinématographique. Ensuite, ayant moi-même éprouvé dans ma chair le combat que cela peut être de mener un film à son terme, je parle du miracle qu’un ou plusieurs spectateurs le voient et qu’ainsi, il existe.
38N.G. : Tout film est-il une île ? Un monde fini ? Last Room est à certains égards un film de speculative fiction, comme Alphaville de Godard ou Playtime de Tati. Il y semble question de notre monde, de gens qui pourraient être nos proches, de lieux pourtant lointains, mais aussi, plus que d’un cosmos unique et certain, de multivers. L’exploration à laquelle on nous invite ne relève aucunement de la conquête : on nous propose d’entrer dans une « zone43 » qui est un « dépays44 ».
39P. C. : Comme aime à le dire, et moi avec lui, mon ami Jean-Christophe Ferrari (à lire dans Positif45), on peut habiter un film de Béla Tarr46 ou de Tsai Ming Liang47 (et pour citer un autre nom qui est récemment devenu incontournable pour moi et qu’on entendra de plus en plus dans un futur proche, un film de Lav Diaz48) plutôt que de simplement le « voir ». Ou se laisser habiter par ces oeuvres, ce qui implique un « détachement » de la volonté d’analyse ou de compréhension.
40N.G. : Barthes dans une logique réciproque vante « l’art (…) de la disponibilité49 » comme vertu de l’œuvre. Ce génie-là, ajoute-t-il, n’est pas une « vertu mineure50 »…
41P.C. : Il me semble fondamental que le spectateur accepte un abandon à dimensions multiples51. Abandonner d’abord ses a priori, ses attentes... La glose autour des œuvres est désormais tellement imposante qu’il devient très difficile de les voir sans avoir eu connaissance auparavant des analyses qui en ont été faites. Cette culture de l’exégèse dont parle si bien George Steiner dans Réelles présences conduit bien souvent le spectateur à penser qu’il doit comprendre et penser quelque chose en même temps que l’expérience, ce qui en réalité le sépare de l’expérience52... C’est particulièrement vrai pour les spectateurs de cinéma, majoritairement atteints d’une névrose de la compréhension ou d’une psychose de la non-compréhension. Pourtant les mêmes spectateurs ne se rendront certainement pas malades de cette manière devant un tableau où à l’écoute d’un concerto... Pourquoi ? Parce que la production cinématographique vit majoritairement sous le joug de l’écrit et de la parole. On accepte très bien que la peinture et la musique se passent des mots. Je souhaite vivement que nous réalisions plus amplement qu’au cinéma aussi on peut tendre à l’indicible.
« La lenteur est le rythme de l’amour, de la tendresse, de la conversation, de l’attention à l’autre, de l’érotisme, de la jouissancedu fait d’exister53 »
42N.G. : Présentant Last Room, vous parlez avec force du « temps éternel et silencieux de l’image immobile54 ».
43P.C. : Il s’agit de la photographie. Et je dis que sa pratique irrigue mon travail de cinéaste. L’écriture cinématographique peut se composer et résonner de toutes les écritures artistiques. Dans la mienne je tâche de donner de l’espace à la puissance du silence inhérente à la photo, à ces fragments de danse immobile... Je l’avais oublié, mais cela vient de me revenir, c’est aussi une des célèbres notes de Robert Bresson : « Sois sûr d’avoir épuisé tout ce qui ce qui se communique par l’immobilité et le silence55 ». Sur le sentiment mystique, la définition que j’en retiens est la suivante: celle de ressentir l’âme du monde. C’est alors effectivement un sentiment auquel j’aspire avec ma « caméra-bâton de sourcier ». Comme je le disais auparavant, pour entendre les vibrations, il m’est nécessaire d’être au présent. Ce présent dont j’ai appris sur les bancs de l’école qu’il était l’éternité en actes.
44Il me semble vital, à une époque ou les moyens de transport annulent les distances, où les outils de communication fragmentent le temps en une multitude exponentielle d’échanges en tous genres, et où une majorité de la population vénère par conséquent la vitesse et l’instantanéité, il me semble vital que des voix s’élèvent pour faire l’éloge de la lenteur. C’est grisant, la vitesse, le mouvement perpétuel. Mais comme je l’ai éprouvé physiquement avec le chorégraphe Bernardo Montet, on peut danser aussi au sein de l’immobilité. Il y a une grande jouissance à naviguer sur les rives de l’extrême lenteur, car ce temps si différent du nôtre au quotidien et qui est pourtant le même, nous apparaît alors comme décuplé, infini. Dans un contexte urbain où comme on dit « on court dans tous les sens », j’ai le sentiment que le cinéma, le théâtre, qui imposent une durée, un rythme, sont parmi les rares îlots où l’on peut encore faire cette expérience. Et quand j’ai de la peine avec la frénésie de nos activités, je sais que certains films dits « lents » (car ce n’est aussi qu’une question de perception aliénée à des normes) peuvent m’offrir un « havre de paix », un paysage à contempler, un visage, une âme, dont tomber amoureux.