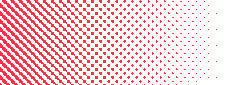Montaigne et la mystique : tensions entre deux modèles possibles de vertu passive au xvie siècle.
Prologue : dead letters ou gnamas, deux regards possibles sur les « vertus passives » de la littérature
1De quelle passivité fait-on l’éloge lorsqu’on met en lumière les « vertus passives » dont certains livres conservent la formule ? L’expression de « vertus passives » contredit l’héroïsme viril que la tradition des auteurs antiques, et de la Renaissance à leur suite, entendait résonner dans le mot de vertu – uirtus, qu’elle faisait dériver de uir : l’homme, le mâle. Les « vertus passives » prennent donc source dans le renoncement à une prétention traditionnellement masculine de s’élever au-dessus du commun des mortels par des actes héroïques. Or il s’agit de voir quel sens donner à ce renoncement, qui nous paraît pouvoir s’orienter vers deux fins différentes : se perdre, ou se garder.
2« Se perdre », ce serait l’histoire du clerc de notaire Bartleby inventé par Melville1, personnage incarnant un précipité sublime de toutes les pertes de langage, de mouvement, d’identité, au point de mériter une avalanche d’attributs médicaux à préfixe privatif : apathique, anorexique, aphasique, amnésique, presque anonyme et presque déjà mort comme ce courrier égaré – dead letters dans le texte – qu’il trie obstinément dans un coin de bureau aveugle. « Se garder », à l’inverse, ce serait dans notre esprit le facteur Fleury décrit dans les premières pages des Cerfs-volants de Romain Gary, livre anti-amnésique puisqu’il est dédié par son auteur « à la mémoire », sans complément ; surnommé le « facteur timbré », Fleury est le représentant d’une famille qui veut bien perdre un peu la tête, mais à condition de ne pas perdre la mémoire et le sens de la vie simple et paisible :
On considérait en général qu’il était revenu « sonné » de la guerre ; on expliquait ainsi son pacifisme et aussi cette marotte qui consistait à passer tout son temps libre avec ses cerfs-volants : avec ses « gnamas », ainsi qu’il les appelait. Il avait découvert ce mot dans un ouvrage sur l’Afrique équatoriale, où il signifie, paraît-il, tout ce qui a souffle de vie, hommes, moucherons, lions, idées ou éléphants2.
3Alors que Fleury et Bartleby sont tous deux les représentants d’une passivité défiant les limites de la santé mentale, ils paraissent opposés par le caractère des objets auxquels ils se consacrent, ces morceaux de papier qui mettent en abîme à l’intérieur des deux récits une image de la littérature : « souffle[s] de vie » pour le facteur rural et « lettres mortes » pour le clerc new-yorkais, autrement dit répétition vitale et répétition morbide. Tout au long du roman de Gary, le symbole du cerf-volant qu’il faut « tenir ferme3 » pour empêcher qu’il ne s’arrache et ne se perde dans le ciel traduit la recherche d’une liberté rattachée à un point d’ancrage, d’une envolée retenue au seuil de la disparition, bref d’une philosophie réconciliant le sens du sacrifice et celui de la survie. L’obstination de Bartleby décrit au contraire une marche sans répit vers l’anéantissement. En tant que lecteur, on n’aurait évidemment pas intérêt à choisir un des deux personnages au détriment de l’autre : pourquoi se priver d’une de ces magnifiques lectures ? Mais à partir du moment où, en tant que commentateur ou critique, l’on invite implicitement à pratiquer certaines vertus recueillies dans les livres, il faut alors préciser que ces deux genres de vertu passive sont susceptibles d’entrer en contradiction dans la pratique, contradiction qui, si elle devient intenable, peut imposer une forme de choix, ou au moins de modulation.
La contradiction effacée : mystique et vertus passives chez Ossola et Barthes
4La lecture du court essai de Carlo Ossola intitulé En pure perte4 peut faire ressentir le besoin de réaffirmer cette contradiction entre une passivité de la perte et une passivité de la préservation de soi : comme le titre l’indique, Carlo Ossola promeut les vertus passives comme un chemin pour parvenir à la « pure perte de soi ». Après avoir décliné les réalisations littéraires de cet esprit de détachement, où Bartleby figure sans surprise en bonne place5, Ossola lui donne comme modèles contemporains deux hommes que rapproche leur pensée mystique6, l’un prêtre et ermite, Charles de Foucauld, l’autre laïc et diplomate, Dag Hammarskjöld. Le lien entre les personnages littéraires et les hommes du xxe siècle est tissé par la récurrence d’un langage mystique qu’Ossola prélève dans l’œuvre de Maître Eckhart ou dans un dictionnaire influent publié en 1640 que nous évoquerons plus loin dans cette étude, la Pro theologia mystica clauis (Clé pour la théologie mystique) du jésuite Maximilian van der Sandt7. Une telle présentation, de la part du titulaire de la chaire de « Littératures modernes de l’Europe néolatine » au Collège de France, ne manque pas d’éveiller cette question : si les vertus passives découlent d’une aspiration à se perdre, d’un désir de pureté réalisée dans la perte de soi, et si la mystique constitue la « clé » ultime des valeurs de renoncement et de gratuité, quelle place donner aux acteurs de ces mêmes « littératures modernes » (autrement dit les auteurs du xvie siècle) qui choisissent la passivité précisément parce qu’ils voudraient éviter de se perdre, et parce qu’ils voient d’un œil inquiet la pureté et l’intensité de l’engagement mystique ? Doit-on écarter d’une anthologie littéraire des vertus passives toutes les pages où le rêve d’une préservation modérée éloigne le désir d’un abandon « en pure perte » ?
5Alors que dans l’interprétation par Ossola de l’esprit des vertus passives, l’idéal de la perte occulte celui de la préservation, et la pensée mystique les philosophies du juste milieu, la tendance de Barthes lui-même au moment où il amorce une réflexion sur le passif est de réunir, dans un geste d’une bienveillance désinvolte, ces traditions de pensée divergentes, suivant un projet de critique désengagée qui contraste fortement avec l’engagement spirituel d’Ossola8. Le cours sur le Neutre9 est l’occasion pour Roland Barthes de proposer un parcours éthique entre des modèles différents mais qui ont en commun de déjouer les clivages traditionnels (ce que Barthes appelle le « paradigme10 », le foyer d’opposition entre deux pôles de sens ou de valeur) : ainsi, au moment de traiter du Silence (manière d’exprimer sa lassitude des discours dogmatiques), Barthes décrit l’attitude du sage pyrrhonien face à la parole, avant d’aborder sans transitions l’expérience mystique chrétienne11. Il faut dire que ceux des littéraires qui connaissent l’adjectif « pyrrhonien », renvoyant au philosophe grec Pyrrhon et à ses idées sceptiques, le doivent habituellement au fait d’avoir entendu un cours sur Montaigne, ou sur la réponse de Pascal au « pyrrhonisme » ou scepticisme de Montaigne sur les questions de foi et de religion. C’est donc Montaigne et les mystiques qu’on a l’impression de retrouver côte à côte dans ce passage du cours de Barthes. Ce même Montaigne qui met pourtant des mots assez forts sur la réticence à se perdre dans l’anéantissement mystique : « Ces humeurs transcendantes m’effraient, comme les lieux hautains et inaccessibles12. » Ces mots, ajoutés par la main de Montaigne au bas de l’avant-dernière page des Essais, à la fin du chapitre « De l’expérience » (III, 13), nous serviront de point de départ pour parler de la contradiction que l’auteur souligne entre une passivité mystique tendue vers le dépassement de la nature et l’union à Dieu, et une autre passivité dans laquelle l’homme se contente de se préserver, de se garder dans la jouissance tranquille de ses facultés naturelles.
6Nous disons bien contradiction, ce qui suppose dans notre idée la prise en compte de ces deux types de passivité, la reconnaissance de leur existence et de leurs singularités ; car si depuis longtemps les commentateurs de Montaigne mettent en évidence le parti-pris « naturaliste » qui le détourne des préoccupations surnaturelles13, rares sont ceux qui prennent la peine de montrer que ce parti-pris n’est pas un simple manque d’intérêt pour l’expérience mystique, mais s’affirme au contraire par une réflexion sur cette expérience14, que nous pouvons reconstituer en repérant les ajouts15, les notes de lecture que Montaigne fait sur ce sujet dans les dernières années de sa vie, alors qu’il annote son exemplaire des Essais pour en préparer une nouvelle édition. Nous voudrions montrer que Montaigne, au milieu des nombreux sujets qui occupent sa vieillesse, continue de réfléchir à l’expérience mystique, de se pencher sur les produits de cette passivité – extase et révélations intérieures –, pour mieux exprimer sa préférence personnelle pour les expériences ordinaires et communes qui constituent son propre fonds de vertus passives.
Les extases de Socrate : le rejet de la mystique néo-platonicienne
7Les allures ordinaires de la vie font l’objet d’un vibrant éloge qui court tout au long des dernières pages des Essais ; parmi les nombreuses déclarations éloquentes qui le ponctuent, nous ne citerons que celle-ci, par laquelle l’auteur avoue son manque de goût pour les « les plaisirs purs de l’imagination », qui semblaient pourtant devoir faire les délices d’un lettré adonné à la solitude et à l’écriture comme lui :
Mais moy, d’une condition mixte, grossier, ne puis mordre si à faict, à ce seul object, si simple : que je ne me laisse tout lourdement aller aux plaisirs presents, de la la loy humaine et generale. Intellectuellement sensibles, sensiblement intellectuels16.
8L’auteur exprime ici une sagesse épicurienne avide de simplicité, une simplicité qui n’est pas synonyme de pureté (« ce seul objet, si simple »), mais de mélange ; comme le souligne le chiasme « intellectuellement sensibles, sensiblement intellectuels », l’acceptation des plaisirs banals de la vie réalise l’union indistincte de toutes les facultés qui composent l’être humain, inaugurant un bonheur « neutre » au sens où l’entend Barthes. C’est le miracle ordinaire d’un laisser-aller qui ne se soucie ni de raffinement, ni d’originalité : « tout lourdement », ainsi vont les vertus passives auxquelles se voue Montaigne en se présentant comme un être « grossier ».
9Cet éloge s’accompagne d’un blâme adressé à toutes les attitudes qui empêchent de profiter décemment du bonheur d’être en vie : le mépris pour le corps, et la recherche des états psychiques extraordinaires garants d’une élévation de l’existence, à commencer par les expériences intellectuelles et spirituelles les plus intenses. Toute cette représentation de la vie comme tendue entre la hauteur des perceptions de l’âme et la bassesse des perceptions du corps, et la conviction que l’homme doit s’efforcer d’accéder à la hauteur en libérant son activité psychique du cours normal et pesant des opérations corporelles, telles sont les composantes de la « théorie de l’extase17 » que Michael Screech a patiemment reconstituée pour expliquer le dernier mouvement du livre, en faisant dialoguer l’œuvre de Montaigne avec les textes de la Renaissance qui assurent la réception des philosophies antiques.
10À partir de leur croyance en une division interne de l’être humain entre esprit (ou âme) et corps, la plupart des hommes du xvie siècle considèrent que toute expérience qui desserre les liens entre l’esprit et le corps permet à l’individu d’entrer en contact avec des vérités transcendantes ; puisque la mort est vue comme la séparation définitive au cours de laquelle l’âme, quittant le corps, rejoint l’au-delà des apparences pour être confrontée à la vérité ultime, toutes les crises qui détachent momentanément l’âme de son enveloppe corporelle peuvent être productrices de vérités. « L’extase » est le nom générique que l’on peut donner à ce genre de crises, dans lesquelles Montaigne voit la manifestation d’« humeurs transcendantes », au double sens du mot « humeurs » : caractères tournés vers la recherche d’expériences suprasensibles, états mentaux générés par ces caractères. L’intensité de la crise extatique n’est pas sans risque : « hors de soi », selon une expression récurrente dans les textes philosophiques de l’époque, le sujet en extase peut verser dans le délire et perdre la raison18. Cet effondrement est aussi vertigineux que l’ascension vécue dans l’extase quand elle se termine bien, pour ainsi dire. Mais pour tous ceux qui admettent que les pensées les plus précieuses sont issues d’une expérience limite, d’un bouleversement du sujet, le voisinage de la folie et de l’illumination du vrai ne diminue en rien la fascination pour l’extase. La « théorie de l’extase » fonde ainsi, chez un grand nombre de penseurs du xvie siècle, la valorisation des expériences mystiques – expériences de fusion avec Dieu, de détachement de l’âme possédée par la vérité de l’amour divin, d’où peuvent découler des révélations importantes –, mais les insère dans un vaste ensemble d’expériences extraordinaires productrices d’une inspiration qui enrichit non seulement la vie religieuse, mais tous les domaines du savoir (philosophie, poésie, médecine…).
11Le discours de Montaigne intervient sur cette « théorie de l’extase » pour la priver de son pouvoir de fascination. Contre la culture d’une séparation de l’âme et du corps, il promeut les attitudes qui favorisent une pensée incarnée, un investissement agréable dans la vie physique. Ce faisant, on peut dire qu’il se confronte aux expériences mystiques, mais au sens large, telles qu’elles se donnent comme but de toute philosophie de la « sortie de soi », sans distinction entre la vie religieuse et d’autres formes de sagesse. Il conteste ainsi le désir d’élévation qui dynamise la vie chrétienne, mais les exemples qu’il prend pour appuyer sa critique ne se limitent pas à des figures de l’histoire dévote, comme on le voit en lisant les quelques lignes introduisant le propos cité sur les « humeurs » :
Nostre esprit n’a volontiers pas assez d’autres heures à faire ses besongnes, sans se desassocier du corps en ce peu d’espace qu’il luy faut pour sa necessité. Ils veulent se mettre hors d’eux et eschapper à l’homme. C’est folie : au lieu de se transformer en anges, ils se transforment en bestes ; au lieu de se hausser, ils s’abattent. <Ces humeurs transcendentes m’effrayent, comme les lieux hautains et inaccessibles. Et rien ne m’est fascheux à digerer en la vie de Socrates, que ses ecstases et ses demoneries. Rien si humain en Platon, que ce pourquoy ils disent, qu’on l’appelle divin19.>
12C’est la figure du philosophe antique que Montaigne prend pour cible en nommant Socrate et Platon. Ce choix est d’autant plus marquant que la vie de Socrate et sa manière singulière de philosopher accèdent au rang de modèle achevé de la philosophie montaignienne dans les deux derniers chapitres du livre, « De la physionomie » et « De l’expérience » : Socrate est l’incarnation d’une vertu faite de modestie, de sociabilité, de franchise, de rudesse, qu’il a mûrie en s’intéressant de près aux choix moraux qui scandent la vie pratique des hommes20. Lorsque Montaigne avoue son agacement à l’égard d’un comportement de Socrate, il ménage donc une exception dans le concert de louanges qu’il dédie au penseur athénien21, ce qui confère de l’importance à cette opposition d’« humeurs » sur le point discuté : en dépit de sa vie simple, Socrate a cultivé des extases, ce qui a pu laisser croire à la postérité que la sagesse consiste en un dépassement de la vie corporelle. En quelques lignes, Montaigne passe de la critique du mangeur distrait de son repas par de nobles pensées (« se désassocier du corps en ce peu d’espace qu’il lui faut pour sa nécessité », c’est-à-dire durant le peu de temps dont il a besoin pour s’alimenter), à la critique des inspirations transcendantes, qui en la personne de Socrate sont censées se faire entendre par la voix de son démon – la divinité personnelle qui le retient de prendre de mauvaises initiatives –, d’où le nom de « démoneries ». Extases et « démoneries » constituent deux manières de se laisser passivement saisir par la vérité divine.
13Les dialogues de Platon sont la source principale d’allusions aux « voix » entendues par Socrate ; la pensée platonicienne, de façon plus générale, pose les fondements philosophiques de la « théorie de l’extase » en mettant l’accent sur l’infériorité du corps et le parcours d’élévation qui seul permet à l’âme de se purifier au contact des réalités éternelles imperceptibles aux sens ; dans cette mesure, l’influence de Platon n’est pas étrangère aux efforts des contemporains de Montaigne pour « se transformer en anges », en une tentative de purification religieuse ou intellectuelle22. Prolongeant cette philosophie, le récit de la vie de Platon qui se transmet depuis l’Antiquité attribue au penseur des expériences de révélation mystique. C’est par égard pour ces expériences de contact avec la vérité divine qui auraient inspiré la pensée platonicienne que Platon lui-même s’est vu décerner l’épithète de « divin ». Montaigne attaque le prestige de cette mystique en renversant, par la figure de l’antithèse, les hiérarchies qu’elle suppose : de même que le désir d’élévation a pour effet un abaissement bestial, la divinité des philosophes antiques trahit la vanité typiquement humaine de leur existence.
14Ainsi, à la frayeur ressentie devant les « hauteurs » de l’extase qui voisinent avec les abysses de la folie, se rajoute une gêne devant une certaine histoire de la philosophie qui relie la pensée antique païenne au christianisme en soulignant la continuité des inspirations divines accordées aux philosophes : dans les deux cas, l’indignation montaignienne s’oppose à une troisième personne collective et anonyme, « ils veulent…, ils disent… ». En ce qui concerne la réputation « divine » de Platon et l’insistance sur le versant mystique de son œuvre, il n’est pas difficile de mettre un nom sur ce « ils » : Marsile Ficin (Marsilio Ficino en italien), philosophe et médecin florentin du xve siècle, dont les traductions et les commentaires de Platon en langue latine fournissent le medium à travers lequel les lecteurs européens de la Renaissance s’intéressent majoritairement à cette pensée. Le titre même d’une célèbre édition du corpus platonicien suffit à exhiber au lecteur la figure du philosophe inspiré : Toutes les œuvres du Divin Platon dans la traduction de Marsile Ficin23. En structurant le trajet vers la sagesse autour des quatre formes d’élans qui projettent le sujet hors de lui-même – les « fureurs » de l’âme24 décrites par le personnage de Socrate dans le Phèdre –, Ficin réserve à l’extase une place déterminante dans le progrès humain.
15Or, tandis qu’il joue les premiers rôles dans la reformulation des idées de Platon à la Renaissance, Ficin est aussi celui qui écrit l’histoire du platonisme en la faisant aboutir dans la mystique chrétienne. C’est un autre auteur traduit par Ficin qui marque cet aboutissement : le Pseudo-Denys l’Aréopagite25, dont les écrits élaborent le langage néo-platonicien manié par une grande partie de la théologie mystique du xvie siècle26, et finalement classé et commenté par van der Sandt dans la Pro theologia mystica clauis (1640) citée par Ossola. En présentant la voie sacrée de la philosophie grecque comme la chaine des prédécesseurs et disciples de Platon qui font fructifier l’inspiration divine du maître – parmi lesquels sont rangés les Pères de l’Église, saint Augustin en tête –, Ficin édifie un néo-platonisme chrétien qui promeut l’expérience mystique à la fois comme point de départ et d’arrivée de la philosophie. Cette doctrine, qui fait correspondre les révélations de saint Paul et celles de Socrate27, la « fureur » amoureuse et la charité chrétienne, marque profondément les lecteurs de la Renaissance en quête d’un christianisme sensible et dispensateur d’une expérience intime de Dieu28. Or, le discours néo-platonicien bénéficie d’un intérêt renouvelé sous le règne d’Henri III29, durant lequel Montaigne publie Les Essais. Dans ces années, les passeurs de l’œuvre de Ficin sont tentés de nuancer la réputation divine du maître Platon, mais ils n’exaltent pas moins l’élan vers Dieu qui entraîne la pensée de l’Académie jusqu’au langage mystique du Pseudo-Denys ; voici comment s’exprime Guy Lefèvre de La Boderie dans la préface à sa traduction française du commentaire du Banquet par Marsile Ficin, qui paraît deux ans avant la première édition des Essais :
Et vueille Dieu, que non plus en memoire de la naissance et du trespas de Platon30, jadis vrayement digne, si quelque autre Philosophe l’a esté, de tant honorable tesmoignage : mais bien en souvenance et recordation de la Naissance et Mort admirable du parfait autheur et d’Amour et de vie, se puisse à iamais perpetuer ceste louable façon de discourir, non de l’origine d’Amour à la Platonique seulement, ny des quatre sortes de ravissement d’esprit dont est faite mention en ce Traité : mais de l’origine eternel et temporelle naissance du vray Amour à la Chrestienne, et de la parfaicte extase et ravissement de Pensee, par lequel les Ames fidelles enamourees sont abstraictes et eslevees iusques au baiser sacré du parfait Amant : duquel le Roy qui porta le nom de Pacifique entre les Hebrieux31 chantoit jadis en ceste maniere : Qu’il me baise, et qu’il me touche, du sainct baiser de sa bouche. Des effects et de la puissance merveilleuse de cest Amour divin, à l’imitation […] de nostre Sainct Denys en mes Cantiques Spirituels j’ay quelque fois chanté32…
16L’auteur du Banquet est délicatement relégué au second plan derrière le « parfait autheur et d’Amour et de vie », le seul à mériter vraiment l’épithète « divin », le Dieu créateur en personne. La sensualité de l’union mystique de l’âme à la personne du Christ, permise par un élan d’amour sublimant la « fureur » décrite par Platon, se dit dans un lyrisme nourri des Psaumes et de la lecture du Pseudo-Denys (« nostre Sainct Denys »). Le point central assigné à la vie chrétienne est bien l’expérience mystique de « la parfaite extase et ravissement de Pensée », expression qui exonère le langage érotique de ce passage d’une référence directe, moralement suspecte, aux jouissances du corps. C’est cette passivité des âmes « abstraites et élevées » jusqu’au ciel que pouvaient évoquer, dans la culture lettrée des contemporains de Montaigne, les extases de Socrate démythifiées aux dernières pages des Essais. Mais en dissipant l’auréole mystique des penseurs de la Grèce ancienne, Montaigne se contente-t-il d’humaniser ces penseurs33 et de « laïciser » leur œuvre34, ou bien cherche-t-il à discréditer toute spiritualité tendant vers la mystique ?
Les limites imposées à la dimension mystique de la vie chrétienne
17D’abord, on peut montrer que la relecture critique par Montaigne du néoplatonisme chrétien s’accompagne d’un intérêt en éveil pour les phénomènes d’extase intervenant en contexte religieux proprement dit. En effet, parmi les notes manuscrites dont il enrichit son livre dans les dernières années de sa vie, se signale cette anecdote figurant dans le chapitre très polémique « De la force de l’imagination » (I, 20), où Montaigne fait de l’imagination humaine le facteur explicatif d’une grande partie des miracles rapportés par l’histoire chrétienne :
On dict que les corps s’en-enlevent telle fois de leur place. Et Celsus recite d’un Prebstre, qui ravissoit son ame en telle extase, que le corps en demeuroit longue espace sans respiration et sans sentiment. <Sainct Augustin en nomme un autre, à qui il ne falloit que faire ouir des cris lamentables et plaintifs, soudain il defailloit et s’emportoit si vivement hors de soy, qu’on avoit beau le tempester et hurler, et le pincer, et le griller, jusques à ce qu’il fut resuscité : lors il disoit avoir ouy des voix, mais comme venant de loing, et s’apercevoit de ses eschaudures et meurtrissures. Et ce que ce ne fust une obstination apostée contre son sentiment, cela le montroit, qu’il n’avoit cependant ny poulx ny haleine.> Il est vray semblable que le principal credit des miracles, des visions, des enchantemens et de tels effects extraordinaires, vienne de la puissance de l’imagination agissant principalement contre les ames du vulgaire, plus molles. On leur a si fort saisi la creance, qu’ils pensent voir ce qu’ils ne voyent pas35.
18L’exemple ajouté, introduit par le lexique de la « sortie de soi » (« s’emportait si vivement hors de soi »), décrit particulièrement bien la syncope36, l’absence du sujet à son propre corps qui est une donnée récurrente de l’expérience mystique ; sauf que, dans ce cas, il ne s’agit pas d’une possession divine : les seules voix entendues par le prêtre sont celles, lointaines et étouffées, de l’entourage qui a tenté de le réveiller. Le caractère spectaculaire de l’anecdote (l’anesthésie totale de l’extatique, son arrêt respiratoire qui éloigne tout soupçon de simulation) contraste à la fois avec la petitesse relative de l’élément déclencheur (des cris de lamentation) et avec la tranquillité de la conclusion sceptique qui clôt la séquence – les « effets extraordinaires » proviennent du pouvoir d’autosuggestion de l’esprit humain. On comprend alors que le verbe pronominal « s’emportait » désigne une véritable action du sujet sur lui-même. Cette syncope volontairement déclenchée est extraordinaire mais pas miraculeuse ; elle s’avère d’autant plus intéressante pour ce chapitre, on le comprend, qu’elle advient en la personne d’un prêtre, tandis que la responsabilité du témoignage revient à un saint et Père de l’Église (Augustin). Au moyen de cet exemple, le questionnement sur le surnaturel est incarné par des « autorités » ecclésiastiques et rapproché du contexte de la dévotion chrétienne : il me semble que la réponse extatique aux cris de lamentation pourrait s’observer de nos jours dans certaines assemblées chrétiennes évangéliques ou « charismatiques », et sans doute pouvait-elle évoquer aux lecteurs de Montaigne des cas de phénomènes mystiques liés à la pratique religieuse de leur temps.
19Or, la source de cet ajout montaignien n’est pas directement Augustin, selon toute vraisemblance, mais bien Marsile Ficin : c’est précisément dans le chapitre de la Théologie platonicienne (XIII, 2) où sont évoquées les inspirations de Socrate et Platon que Marsile Ficin rapporte cette anecdote du prêtre de la ville de Calama (Guelma dans l’actuelle Algérie), en indiquant qu’elle provient d’Augustin37. Dans ce chapitre, Ficin entend démontrer la supériorité de l’âme sur le corps en rappelant les extases des grands philosophes, poètes, prêtres, devins et prophètes ; il en vient alors à établir une typologie des sept genres de uacatio, de vacance de l’âme qui éprouve son autonomie en se soustrayant aux instincts et aux sensations du corps : parmi ces « vacances », qui comprennent le songe et la chasteté, figure la syncope, ou quasi-mort, que Montaigne lui-même a expérimentée lors de l’accident de cheval dont il fait le récit au chapitre « De l’exercitation38 ». On peut penser que la vieillesse et la pensée de sa mort prochaine ramènent Montaigne à méditer sur ces « absences », et à y répondre en affirmant son besoin de se sentir en vie, comme il le fait dans les dernières pages de son livre :
Me trouvé-je en quelque assiette tranquille, y a il quelque volupté qui me chatouille, je ne la laisse pas friponner aux sens39 ; j’y associe mon ame. Non pas pour s’y engager, mais pour s’y agreer, non pas pour s’y perdre, mais pour s’y trouver […]40.
20C’est justement parce que l’âme peut perdre contact avec les sensations du corps qu’il faut qu’elle réagisse en s’en emparant, en les faisant siennes. Cette réflexion sur la perte et la ressaisie de soi motive les interrogations de Montaigne sur les pratiques philosophiques et religieuses.
21Sauf qu’avant de faire entendre sa répulsion pour la passivité mystique de Socrate, Montaigne a pris soin, quelques lignes plus haut, de limiter l’éclat de son mouvement d’« humeur », en conférant à la vie religieuse proprement dite un statut d’exception :
Je ne touche pas icy et ne mesle point à cette <marmaille> d’hommes que nous sommes et à cette vanité de desirs et cogitations qui nous divertissent, ces ames venerables, eslevées par ardeur de devotion et religion à une constante et conscientieuse meditation des choses divines, <lesquelles, preoccupant par l’effort d’une vifve et vehemente esperance l’usage de la nourriture eternelle, but final et dernier arrest des Chrestiens desirs, seul plaisir constant, incorruptible, desdaignent de s’attendre à nos necessiteuses commoditez, fluides et ambigues, et resignent facilement au corps le soin et l’usage de la pasture sensuelle et temporelle.> C’est un estude privilegié. <Entre nous, ce sont choses que j’ay tousjours veues de singulier accord : les opinions supercelestes et les meurs sousterraines41.>
22Doit-on reconnaître à la « méditation des choses divines » mentionnée dans ce passage un caractère mystique ? Le lexique de la trajectoire ascendante et de l’intensité de l’engagement psychique (« âmes… élevées », « vive et véhémente espérance »), rappelant les termes de la préface à la traduction française de Ficin, autorise à le faire. Mais c’est un véritable résumé de la vie spirituelle que Montaigne livre dans ces lignes : en effet, l’expérience mystique apparaît comme le résultat d’une ascèse au cours de laquelle l’âme des chrétiens se libère peu à peu des préoccupations du corps, de ces « nécessiteuses commodités » de la nourriture et de la sexualité42. C’est dire que la mystique n’est pas le règne de la passivité : « l’ardeur de dévotion et de religion » implique à la fois, chez les croyants, la capacité de se maîtriser, notamment par l’abstinence et la chasteté, et celle de s’abandonner dans l’oraison – actif et passif s’entrelacent dans une même tension vers Dieu. Et Montaigne précise, en décalage avec les propos analysés jusqu’ici, que ceux qui négligent leur corps pour se livrer pleinement à la dévotion chrétienne sont à l’abri de son blâme épicurien.
23Ce n’est pas le moindre des paradoxes : dans la philosophie épicurienne antique, en effet, le soin de la nature telle qu’elle se manifeste dans les besoins du corps est à opposer aux préoccupations religieuses exorbitantes, qui oppriment la vie des hommes en les tenant dans la crainte des dieux. Montaigne est bien conscient de cette opposition : il a souligné, dans son exemplaire du De natura rerum de Lucrèce, le célèbre éloge d’Épicure délivrant l’humanité des frayeurs religieuses, en marge duquel il a inscrit cette annotation lapidaire : « religion cause de mal43 ». En exprimant sa déférence à l’égard de la « constante et consciencieuse méditation des choses divines » (dont la gravité est accentuée par le groupe binaire d’épithètes antéposés, formés sur un même préfixe), Montaigne tente alors de formuler, comme d’autres humanistes l’ont fait avant lui, un épicurisme chrétien44, d’autant plus respectueux des exercices religieux que ceux-ci engendrent, non une frayeur ou une inquiétude, mais bien un plaisir garanti pour les facultés spirituelles des individus. La nourriture du corps (« pâture sensuelle et temporelle »), que l’auteur fait passer avant les « humeurs transcendantes » dans le premier passage cité, sert ici de terme de comparaison pour comprendre la valeur d’une autre sorte de nourriture, échappant à la décomposition organique (« seul plaisir constant et incorruptible ») : la contemplation de Dieu. C’est l’avantage de l’épicurisme chrétien : intégrer cette contemplation à une sagesse attentive aux plaisirs permet de sauver et la contemplation et les plaisirs ; les sensations de l’âme en prière et celles du corps à table sont pareillement justifiées. Telle est la solution philosophique fournie par l’ajout manuscrit de l’auteur, et certains de ses lecteurs dévots sauront l’apprécier : l’éloge des vertus passives traversant le livre III leur apparaîtra, sous cette lumière, compatible avec une morale chrétienne authentique45.
24Mais cette réponse ne lève pas toutes les contradictions introduites par cette page. Comment comprendre en effet la dénonciation de la dernière phrase : « Entre nous, ce sont choses que j’ai toujours vues d’un singulier accord : les opinions supercélestes et les mœurs souterraines » ? La polémique condense l’antithèse : « les opinions supercélestes », c’est-à-dire l’intérêt pour les réalités les plus élevées, pour la métaphysique la plus haute, iraient de pair avec « les mœurs souterraines », c’est-à-dire les vices les plus abjects. Montaigne saperait-il d’un coup l’éloge des contemplatifs qu’il vient de prononcer ? Les commentaires de Michael Screech aident à résoudre cette difficulté, en éclairant le sens du complément initial « entre nous46 » : il ne s’agit pas d’un modalisateur annonçant le ton de la confidence (« entre nous soit dit »), mais bien d’un complément de lieu – chez la moyenne des hommes dont nous faisons partie, au sein de « cette marmaille d’hommes que nous sommes », par opposition au petit nombre des « âmes vénérables ».
25Telle est la particularité de l’épicurisme chrétien qui s’affirme ici : vie religieuse et vie mondaine ont beau être réconciliées par une même philosophie du plaisir, elles ne sont pas proposées universellement à tout homme de bonne volonté. Montaigne pose l’existence d’un fort déterminisme qui différencie la minorité de ceux qui possèdent un naturel apte à la pratique religieuse intensive d’une part, et de l’autre, l’écrasante majorité des inaptes : dans leur cas, tout effort d’ascèse et de contemplation ne ferait qu’empirer leurs vices. D’où la conclusion de Montaigne sur la vie religieuse : « c’est un étude privilégié », autrement dit, cette pratique est un privilège, et ce privilège n’est accordé par Dieu qu’à quelques-uns, seulement. Les autres feraient mieux de se méfier d’eux-mêmes, et de ne pas désirer les émotions mystiques. Montaigne parvient donc à diminuer l’exemplarité de la vie des saints sans passer par l’irrévérence ou la polémique. Il se tient sur une position neutre, au sens où il valorise à la fois la constance des dévots et la simplicité des autres hommes, mais ce neutre est loin du sens barthésien cette fois : en effet, ce passage ne fait que renforcer l’opposition bipolaire entre élévation mystique et sagesse ordinaire47.
26Les derniers mots des Essais scellent cette opposition. Au terme de son parcours « De l’expérience », Montaigne résume son idée de ce qu’est une vie réussie et son espérance de pouvoir l’expérimenter jusqu’au bout ; cet espoir, il l’énonce dans une prière à Apollon tirée de la poésie lyrique d’Horace :
Les plus belles vies, sont à mon gré celles, qui se rangent au modelle commun et humain avec ordre : mais sans miracle, sans extravagance. Or la vieillesse a un peu besoin d’estre traictée plus tendrement. Recommandons la à ce Dieu, protecteur de santé et de sagesse : mais gaye et sociale :
Frui paratis et ualido mihi
Latoe dones, et precor integra
Cum mente, nec turpem senectam
Degere, nec Cythara carentem48.
27C’était déjà Apollon que Montaigne faisait parler à la conclusion du chapitre « De la vanité » (III, 9). Le dieu du temple de Delphes commandait alors à l’homme de se connaître lui-même, dans toute sa vanité, sous toutes ses limites49. Cette fois, l’homme répond au dieu, pour demander non pas la lucidité sur soi-même, mais la capacité de vivre avec soi et les autres, « sagesse […] gaie et sociale » qui offrirait de la vertu des philosophes un visage plus « tendre », plus consolateur, plus adapté aux faiblesses d’un vieillard. Il s’agit toujours d’accepter les limites de l’humanité, de ne pas vouloir se hausser au-dessus du « modèle commun et humain », mais c’est sans mauvaise conscience, doucement, au son de la « cithare », que le lecteur est invité à se couler dans ce modèle. Outre le fait que cette prière païenne se substitue à un geste de dévotion proprement chrétien, le refus des expériences extraordinaires (« sans miracle, sans extravagance ») fait résonner la crainte des crises mystiques qui pourraient faire délirer le vieil homme50 ; de fait, dans le recours à la citation d’Horace, la jouissance poétique désirée n’implique ni la fusion avec Dieu, ni la « fureur » ou l’inspiration sacrée, mais la décence et la santé mentale : integra cum mente, « en pleine possession de mon esprit », il s’agit encore une fois, pour reprendre les mots de Montaigne, de se trouver et non de se perdre.
La médiocrité de Montaigne : une anthropologie à contretemps ?
28La conclusion des Essais répète inexorablement l’importance de se régler sur les comportements du commun des mortels, au point que Pierre Manent ait pu y voir l’éloge décourageant d’une vie informe51. Dans ses déclarations d’intentions au moins, Montaigne accepte d’être « comme tout le monde » ou de ne pas être à contretemps. Sa frayeur devant l’intensité des crises extatiques et sa conception de la santé pourraient d’ailleurs être raillées comme l’équivalent d’une réaction « sécuritaire » ou d’un souci « bourgeois » du confort, qui s’accommoderait mal à la douce folie idéaliste des personnages de Romain Gary que j’évoquais en introduction. La volonté de conservation, dont j’ai fait le critère de définition des vertus passives selon Montaigne par opposition à la passivité mystique, résume tout ce que Nietzsche exècrera comme étant le signe d’un âge décadent, recroquevillé sur sa santé mesquine au lieu de s’ouvrir aux élans de la « grande santé52 ». À l’inverse, la description nietzschéenne de la santé véritable comme décharge d’énergie accumulée sous tension pourrait conduire à valoriser l’expérience mystique, jusque dans ses effets potentiellement destructeurs pour la raison humaine53. Nul doute qu’un lecteur de Nietzsche reconnaîtrait dans la position de Montaigne ce « jésuitisme de la médiocrité54 » propre à l’espèce des savants qui s’acharnent à désamorcer tous les conflits de la volonté de puissance pour imposer la norme écœurante du « bien-être55 » à une humanité grégaire.
29Mais au-delà du possible manque d’attrait de cette « médiocrité » pour certains lecteurs actuels, il est difficile de voir dans quelle mesure les réserves de Montaigne vis-à-vis de la mystique allaient à l’encontre des opinions de ses contemporains. Son interprétation des vertus passives était-elle plutôt majoritaire ou minoritaire, étant donné ce que nous savons de la sensibilité religieuse de son époque ?
30Commençons par les faits qui indiquent une conformité entre la position de Montaigne et les tendances idéologiques de la période où il écrit.
31La fin des guerres de religion est une période de méfiance accrue envers les inspirations mystiques, dont on redoute les effets politiques dévastateurs. En effet, outre l’invocation récurrente de signes extraordinaires dans l’appel à la violence, c’est la violence religieuse même qui tendait à être vécue comme une expérience mystique, une expérience d’abandon à une impulsion divine56.
32Bien plus, le mouvement de Contre-Réforme catholique issu du Concile de Trente tend à vouloir encadrer la définition de la sainteté et les signes équivoques du surnaturel, favorisant ainsi une attitude de réserve et de soupçon par rapport aux expériences mystiques, attitude qui est certes une donnée constante de la réception de la mystique à toutes les époques, mais qui se fait particulièrement ressentir dans ces années de déplacement des angoisses politico-religieuses57 ; la pastorale qui accompagne ce mouvement réhabilite, dans une certaine mesure, l’expérience de l’union de l’âme et du corps, en mettant l’accent sur une dévotion à l’œuvre dans la vie civile58.
33Dans ce contexte, le néoplatonisme mystique est de plus en plus critiqué pour la place démesurée qu’il accorde aux états passifs de l’âme. Voici la manière dont le théologien Jean Silhon pourfend le « christianisme platonisé » dans un traité adressé au cardinal de Richelieu :
À ce que j’entends on en barbouille la devotion de ce temps, et on fait entrer le Platonisme dans la composition de la vie Mystique, et de la Theologie à la mode. Cette doctrine est fort atraiante, et elle a des affeteries qui s’insinuent aisement dans les imaginations vives et molles comme sont celles des femmes […]. Elle est pourtant fort dangereuse si elle n’est dispensée par quelque habille main, et plus capable de produire des illusions que des miracles, et quelque heresie que la saincteté. Que ceux qui en usent se souviennent que les serpens se cachent sous les fleurs : que l’arsenic ressemble au sucre, et qu’Origene en fut empoisonné. Qu’ils ne croyent pas que pour avoir dans la bouche beaucoup de noms qui se trouvent dans sainct Denis, ils en ayent tousiours l’intelligence dans l’esprit. Qu’ils ne prennent pas pour des ravissemens de sainct Paul, tous les transports de l’imagination extraordinairement esmeuë […]. En un mot qu’ils sçachent que la Theologie Mystique n’est ny seure ny profitable, qu’en tant qu’elle est dépendante de la scolastique, et soumise à son authorité et à sa censure59.
34Dans les lignes qui précèdent cet extrait, l’auteur vantait les mérites de la doctrine de l’âme présente chez Platon, mais afin d’en souligner les excès comme l’avait fait Montaigne : « Il a trop voulu affranchir l’Âme de la société du corps60. » Outre l’opacité du langage mystique tiré du Pseudo-Denys qui cherche à dire les envolées de l’âme, l’héritage néo-platonicien véhicule une fascination pour les crises extatiques qui ne fait qu’encourager les chrétiens trop impressionnables (et surtout les chrétiennes, selon une représentation sexiste) à prendre leur trouble émotionnel pour un contact extraordinaire avec Dieu.
35Cependant, ce dernier passage permet aussi de cerner l’originalité du discours montaignien.
36En effet, alors que Silhon entend rétablir la suprématie de la raison à travers le contrôle exercé par la théologie scolastique, Montaigne persiste à se défier du pouvoir de la raison humaine d’énoncer l’existence ou les propriétés de Dieu. Pour preuve, le passage des Essais où il donne le plus l’impression de reprendre à son compte la « théorie de l’extase » est un ajout manuscrit à l’Apologie de Raimond Sebond destiné à insister, dans un geste sceptique, sur la faiblesse de cette raison humaine61. Aussi n’est-il pas étonnant que Silhon s’en prenne autant à Montaigne qu’à la théologie mystique62 : quand Montaigne critique la passivité mystique, il le fait bien pour promouvoir son propre éventail de vertus passives, et non pas pour redonner du prestige à l’activité cognitive de l’esprit humain.
37Comme le suggère l’expression de « théologie à la mode » employée par Silhon, le tournant des xvie et xviie siècles est aussi un moment de renouveau spirituel où se cherchent les moyens d’une oraison qui rapproche intimement de Dieu, dans la tension vers les transports mystiques des « saints » au sens large63. L’installation du premier Carmel à Paris en 1605 traduit le rayonnement de la sainteté mystique de Thérèse d’Avila, relayé dans la capitale française par l’engagement du cercle de Barbe Acarie, elle-même affectée de crises extatiques spectaculaires64. Sophie Houdard ouvre son livre sur les conflits entourant la mystique dans la France du xviie siècle en citant les railleries du mémorialiste Pierre de L’Estoile sur cette installation65 ; il faudrait pour cette étude citer un autre passage du journal de L’Estoile où il commente plus sérieusement, mais tout aussi agressivement, le renvoi d’une des premières carmélites de Paris en septembre 1608 :
Le mardi 9e de ce mois, sortist de la religion des Carmélines (ou Badines) sœur Claude de Benevent, bonne fille et douce, mais séduite (comme beaucoup d’autres) par quelques esprits abuseurs de nostre temps, qui, sous une ombre de dévotion, les précipitent en un abisme de superstitions et de folies. Ils la mirent dehors (en quoi Dieu lui fist du bien, malgré qu’elle en eust, en sortant avec grand regret), pour n’avoir (disoient-ils) l’esprit assez fort pour la méditation, c’est-à-dire pour l’imagination et conception de leurs idées et resveries66.
38Le violent commentaire de L’Estoile traduit la conviction que la « méditation » n’est qu’une école d’autosuggestion, une fausse passivité de l’esprit qui se manipule tout seul. On voit que c’est au sujet des méthodes de contemplation que se négocie la question de savoir si la mystique doit rester une expérience anormale réservée à quelques individus à part ou si elle peut servir de modèle67 aux pratiques d’une multitude de croyants.
39En somme, ni marginales ni consensuelles, les réticences de Montaigne face aux expériences mystiques valent moins par leur capacité à jouer « à contretemps » que parce qu’elles font sentir, par le contraste de leur médiocrité, le prestige qui demeure attaché à la perte de soi.