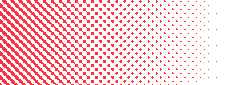Littérature et esthétique de la consommation
1Dans les études littéraires et d’histoire de l’art dominantes, la réflexion esthétique tend à se concentrer sur les objets artistiques, en associant le questionnement esthétique et le questionnement artistique. Cette confusion, qui a été très bien décrite par Jean-Marie Schaeffer (2000), revient non seulement à limiter la réflexion sur l’esthétique à un certain type d’objets (les œuvres d’art), mais à glisser du sujet sentant au monde de l’art. Lorsqu’elle s’inscrit dans cette perspective, l’esthétique ne s’intéresse pas tant à un mode d’appréhension des objets qu’à un type particulier d’objet (les œuvres d’art).
2Depuis quelques décennies cependant, on assiste à un mouvement inverse, visant à saisir à nouveau l’esthétique comme un mode particulier d’attention aux objets, les appréhendant à partir du plaisir ou du déplaisir qu’ils nous procurent. Comme le remarque Jean-Marie Schaeffer (2015), ce qui caractérise l’expérience esthétique, c’est une relation attentionnelle dépragmatisée qui engage une dynamique de « saturation attentionnelle », puisque l’objet n’est pas considéré pour son usage, mais pour les émotions qu’il produit en nous. Outre les travaux de Jean-Marie Schaeffer sur l’expérience esthétique et ceux de Gérard Genette (1997) avec lesquels il dialogue étroitement, on citera les recherches engagées par des chercheuses comme Yuriko Saito (2007) et Katya Mandoki ([2006] 2007) dans le cadre de ce qu’on a appelé l’« esthétique du quotidien [everyday aesthetics] », qui réhabilitent les expériences courantes et soulignent leur dimension sociale. On citera encore les questionnements d’orientation pragmatiste de Richard Shusterman autour d’une soma-esthétique, invitant à penser la relation esthétique comme une expérience saisie dans un corps (1992 et 2015).
3L’une des conséquences de ces différents travaux est de considérer que, puisque l’esthétique désigne une conduite attentionnelle, tout objet peut donner lieu à un mode d’appréhension esthétique : pour Richard Shusterman, cela peut être par exemple l’expérience de la musique hip-hop, pour Yuriko Saito, celle d’étendre son linge ou de prendre le thé ; pour Katya Mandoki enfin, chaque cadre social (la famille, l’école, la religion, etc.) tend à définir les conditions de possibilité favorisant certaines expériences esthétiques, largement déterminées par ces contextes instituants.
4Délivrées de l’expérience d’un objet esthétique qui primerait, ces relations peuvent en outre apparaitre comme beaucoup plus vagues et fugaces, puisqu’elles sont immergées dans le flux des activités quotidiennes – même si certains théoriciens de l’esthétique du quotidien, comme Katya Mandoki, prennent soin d’associer cette expérience à une forme d’épiphanie (mais l’épiphanie désigne surtout un mécanisme attentionnel de retour sur ses propres émotions). C’est sur ces expériences plus flottantes que portent les travaux de Gernot Böhme ([2001] 2020) sur les atmosphères ou ceux de Bruce Bégout (2020) sur les ambiances. Comme le souligne Gernot Böhme (2017), un tel déplacement conduit à mettre en évidence le rôle central, à l’époque contemporaine, de dispositifs médiatiques et marchands visant à solliciter une telle relation esthétique superficielle, afin de séduire indirectement le consommateur : publicité, design, emballages et lieux marchands sont conçus pour solliciter un rapport esthétique aux objets – et Böhme voit dans ce tournant esthétique un trait caractéristique des sociétés capitalistes avancées. Dans le prolongement des travaux de Böhme, Yves Michaud (2021) souligne, pour le déplorer, le déplacement esthétique qui s’opère, à l’époque contemporaine, du domaine de l’art à celui de la séduction marchande. Quand l’art et l’esthétique tendent à divorcer, parce que l’art vise de moins en moins à susciter le plaisir du public, les producteurs des industries médiatiques et marchandes tendent à multiplier les dispositifs cherchant à solliciter l’attention esthétique, jusqu’à toucher l’ensemble de nos expériences quotidiennes.
5Derrière ces dernières analyses, on retrouve un certain nombre de critiques anciennes formulées contre les productions de la culture de masse, visant la fétichisation de la marchandise. On pense par exemple au concept de « valeur-signe » développé par Jean Baudrillard ([1972] 1977), substituant la séduction des signes à la valeur d’usage1. On pense aussi aux réflexions de Wolfgang Haug, dans Critique of Commodity Aesthetics (1987), sur le caractère nécessairement trompeur de l’esthétisation des biens dans la culture marchande. Les productions de la société de consommation déplaceraient l’attention du consommateur de la valeur d’usage de l’objet vers des séductions plus superficielles, le conduisant, par une telle manipulation, à associer sa décision d’achat à des traits inessentiels, donc illusoires, des objets. En réalité, comme le montre encore Gernot Böhme (2017), plutôt que de tromperie, il faudrait parler d’un déplacement du besoin vers le désir, faisant basculer la relation aux objets d’un rapport à la valeur d’usage vers une relation esthétique. Ce sont en effet les propriétés formelles des objets (leur design, leur emballage, leur dimension décorative) qui font leur séduction. Et certes, on peut soupçonner que ces propriétés formelles séduisent en partie pour des questions de prestige ou d’ostentation mais, comme le montre encore Gernot Böhme (2017) discutant les analyses de Thorstein Veblen et de Jean Baudrillard, rien ne permet de réduire l’appréciation de ces objets à cette valeur symbolique. Bien sûr, l’acte d’achat remet en cause le caractère désintéressé du rapport à l’objet, mais en amont et en aval de cet acte, l’appréciation redevient esthétique : ce qui me plait dans l’objet décoratif ou designé, ce sont aussi leurs propriétés formelles, précisément parce qu’ils ont été conçus pour susciter mon plaisir esthétique ; et la société de consommation est ainsi faite que quand l’objet cesse de me procurer un tel plaisir, je le remplace par un autre objet, plus à la mode ou plus en phase avec mes goûts du moment.
6Ce n’est de toute façon pas dans cette perspective critique que je situerai mon propos. Je voudrais plus simplement aborder les productions de la culture médiatique, et en particulier les productions littéraires, en les ressaisissant dans la banalité des expériences consuméristes courantes. Après tout, les productions littéraires sont liées à la culture marchande, soit parce qu’elles sont vendues, soit parce qu’elles sont financées par la publicité. On n’oubliera pas qu’originellement la première marchandise commercialisée en masse, c’est-à-dire à plus de 10 000 exemplaires par jour, c’est le journal (Thérenty et Vaillant, 2001), financé par ailleurs par la publicité et que le livre a toujours été aussi – et souvent avant tout – un bien de consommation. Ce lien transparait dans bien des termes employés pour désigner des marchandises imprimées. Quand on parle, en littérature, de « dime novels », de « penny dreadfuls », de « romans à 2 sous » ou de « best-sellers », on désigne explicitement le prix de l’objet et la dynamique de vente, c’est-à-dire qu’on en dénonce implicitement le caractère de bien de consommation (Letourneux, 2021).
Sortir du « white cube »
7Cette critique de la dimension consumériste s’inscrit dans la conception moderniste de la littérature, bien décrite par Andreas Huyssen (1986) à travers la notion de « great divide2 ». Plutôt que de rejouer cette opposition entre culture de masse et haute culture, qui a représenté l’un des mythes structurants de la culture au xxe siècle, je voudrais proposer une autre distinction, qui se ferait entre des objets ou des activités destinés à produire une expérience esthétique particulièrement forte à travers des dispositifs spécifiques d’une part et d’autre part des objets pris dans le flux du quotidien, liés à des dispositifs qui ne visent pas à produire une rupture aussi forte. Les premiers, qui ne m’intéresseront pas ici, correspondent à des expériences esthétiques engageant une certaine idée du « monde de l’art », et mettant en place des dispositifs visant à produire de l’aura en matérialisant une rupture avec les expériences courantes. On pense à des dispositifs de type white cubes expositionnels (O’Doherty, 20083) ; mais on pourrait trouver leur équivalent dans d’autres médias (couvertures blanches des éditeurs légitimes, salles de concert solennelles des musiques savantes, organisation des tables et rayons des librairies de centre-ville). On pense aussi aux dispositifs mis en place dans les œuvres mêmes (austérité de certaines stratégies filmiques, abord aride de certaines œuvres expérimentales, etc.). De tels dispositifs tendent à faire de la relation à l’œuvre une expérience ascétique, parce qu’ils l’arrachent, par leur forme même, au flux des sollicitations quotidiennes. On sait que cet écart nourrit certaines définitions de l’esthétique, souvent marquées par une dimension historique, comme celle de Jacques Rancière (2004), qui s’oppose en cela aux perspectives de Jean-Marie Schaeffer.
8Mais que se passe-t-il si, tirant les conséquences des nouvelles manières d’aborder l’esthétique au quotidien, on questionnait à la place les interactions esthétiques faibles qu’engagent les productions qui visent à favoriser une telle expérience esthétique prise dans le cours des activités courantes ? Pour prendre quelques exemples, la radio de flux, parce qu’elle permet une consommation en continu, souvent à l’arrière-plan d’autres activités, ne peut-elle pas être pensée à partir de l’esthétique des atmosphères ou des ambiances ? Le recours à des musiques pour danser, travailler, bricoler, ne gagne-t-il pas à être interprété à partir des cadres sociaux de l’esthétique du quotidien, ou de la soma-esthétique de Shusterman ? Et n’a-t-on pas intérêt plus largement à déplacer la focale de l’intensité de l’expérience de l’œuvre isolée par des dispositifs de type white cubes, vers des dispositifs visant à s’inscrire dans le flux du quotidien, et à se mêler à d’autres activités ? Quand on parle de la littérature « de gare », des lectures « de plage », de téléfilms de Noël ou de la Saint-Valentin, de séries télévisuelles « pour passer le temps » ou « pour se vider la tête », de musiques dansantes ou « ambient », on évoque soit des dispositifs visant à s’insérer dans un écosystème culturel plus large (Noël, une fête), ou des pratiques (travailler, se détendre) identifiant ces dispositifs comme répondant à des attentes situées.
Dispositifs esthétiques du quotidien
9Un mot sur cette notion de dispositif esthétique que j’ai employée à plusieurs reprises sans la définir encore. Dès lors qu’on déplace la relation esthétique de l’objet au sujet, alors tout peut donner lieu à un mode d’appréhension esthétique : un coucher de soleil autant qu’une œuvre d’art. Mais si l’attention esthétique peut se porter sur des objets naturels, ou qui ne sont pas destinés à introduire une relation de cet ordre (un paysage, un bâtiment industriel), il existe un très grand nombre d’objets qui visent à solliciter ce type de posture attentionnelle, à travers des dispositifs explicitant cette dimension esthétique. C’est le cas des œuvres d’art (à travers des dispositifs expositionnels ou des conventions de représentation), de l’ensemble des œuvres de fiction (les conventions de la fiction déterminant une relation dépragmatisée), mais aussi d’un très grand nombre d’éléments de la culture marchande (design, marketing, mode, publicité, architecture d’intérieur, etc.), qui correspondent à un ensemble de dispositifs visant à solliciter l’appréciation des objets. Ces dispositifs fonctionnent comme des cadrages communicationnels destinés à favoriser une certaine posture attentionnelle par l’emploi de certains codes culturels : par exemple la sollicitation du regard et des sens, l’emploi d’un vocabulaire (verbal, pictural, musical) spécifique, de stéréotypes faisant système, de conventions correspondant à un consensus (qui peut être massif ou de niche) sur ce qu’on juge beau, plaisant, agréable, séduisant… On le voit, par-delà l’objet, le message ou l’œuvre particulière, ces dispositifs engagent également les fonctions culturelles associées au média, les modes d’expression employés, le contexte communicationnel situé dans lequel ils s’inscrivent, les usages qu’ils semblent indiquer pour le public, etc. C’est pour cela qu’un dispositif de type white cube expositionnel ou éditorial définit une posture attentionnelle de nature différente des dispositifs commerciaux ou médiatiques s’inscrivant davantage dans le quotidien, comme un magazine ou un programme télévisé, voire un emballage commercial ou une publicité. Et Marcel Duchamp a été le premier à montrer qu’un dispositif expositionnel pouvait modifier en profondeur la relation esthétique à l’objet.
10Il va de soi que tout produit commercial ou médiatique n’est pas nécessairement conçu comme un dispositif esthétique : nombre d’entre eux sont presque totalement dominés par leur dimension fonctionnelle (à l’instar de certaines publications spécialisées ou certains objets techniques). À vrai dire, un objet commercial ou médiatique n’est que très rarement conçu pour engager uniquement, et même avant tout, une relation esthétique. Même très designée, une cafetière sert avant tout à faire du café, et même dramatisé à outrance, un article de vulgarisation historique repose sur un pacte de lecture informationnel. En ce sens, ce que j’appelle dispositif esthétique ne correspond pas tant à un type d’objet qu’à un ensemble de procédés conventionnels visant à solliciter l’attention esthétique du consommateur, non seulement au moment de l’acte d’achat (suivant des stratégies de séduction), mais dans sa relation postérieure à l’objet – lesdits procédés venant souvent se surajouter aux caractéristiques utilitaires de l’objet.
11Ainsi, à côté des dispositifs artistiques cherchant à affirmer l’exceptionnalité de la relation artistique, un très grand nombre de productions culturelles déploient leurs dispositifs esthétiques dans l’espace quotidien. Quand le musée, la galerie d’exposition, la salle de concert de musique savante ou l’édition de diffusion restreinte privilégient des dispositifs visant à isoler l’expérience esthétique du flux des expériences courantes, les dispositifs esthétiques pris dans le quotidien sont saisis à partir des activités situées qu’ils accompagnent : écouter la radio en prenant son petit-déjeuner, lire un magazine people dans le train ou un polar sur la plage, regarder une série en faisant la cuisine, privilégier une musique pour danser sont autant d’expériences esthétiques mobilisées par des dispositifs adaptés à la situation donnée : chroniques brèves pour le petit-déjeuner, articles de presse futiles et plaisants permettant de fragmenter librement la lecture en fonction de l’humeur, transparence stylistique et efficacité narrative du roman répondant aux attentes de divertissement, musique rythmée avec des effets de crescendo suscitant l’émotion collective pour la danse, etc. Nombreux sont les types d’œuvres à tenir compte de ces spécificités de la consommation jusque dans la forme et la nature de leurs récits. On sait par exemple que le mode de narration des séries télévisées a intégré très tôt les activités annexes du public (par exemple en répétant les informations clé ou en sollicitant régulièrement l’attention du public menacé à tout moment d’être détourné du visionnage par des événements extérieurs). On sait également que le roman-feuilleton adoptait un mode de communication reposant sur un principe d’accentuation et de suspens constants qui répondaient au mode de lecture superficiel qu’engage le journal.
12Mais on sait aussi, en retour, que les pratiques culturelles sont modelées par les dispositifs, dès lors que ceux-ci s’imposent massivement après avoir stabilisé leurs usages : on évoquera par exemple le rapport au temps collectif imposé par la presse (et bien décrit par Marie-Ève Thérenty, 2007) ; on pourrait citer aussi le rituel de l’écoute collective de la radio, puis du visionnage de la télévision en famille, les transformations profondes induites dans l’affirmation d’une culture de jeunesse par le transistor et le Teppaz (Sohn, 2001), ou encore la façon dont les transformations du système de vente ou l’apparition de formats de livres bon marché ont profondément modifié le rapport à la littérature (comme le craignaient les contempteurs du livre de poche du reste). Ce sont autant de dispositifs qui définissent des pratiques esthétiques socialisées, liées à des normes collectives et à des axiologies qui sont aussi des normes médiatiques. On peut ainsi décrire les dispositifs à partir des moments de la vie personnelle qu’ils visent à accompagner (réveil, voyages, travail, loisirs, courses, activités accomplies seul ou en groupe, etc.), mais qu’ils codifient également. La culture médiatique se caractérise en effet par une incidence des dispositifs sur les rythmes collectifs vécus dans le temps intime (lecture du quotidien, privatisation de certains modes de consommation, etc.). Autrement dit, il faut penser les dispositifs esthétiques de manière élargie, comme des formes débordant les modalités d’écriture et les conventions, pour toucher aux cadres médiatique, social et culturel qui, à leur tour, déterminent de nouvelles conventions de représentation et de nouvelles normes attentionnelles, affectant le regard des spectateurs.
Séduire, plaire et s’adapter aux usages
13N’étant pas isolés du flux des expériences quotidiennes et se retrouvant du même coup en concurrence avec d’autres sollicitations dans une économie de l’attention de plus en plus saturée, les productions culturelles tendent à adopter différentes stratégies de séduction, moins contradictoires que complémentaires. Il s’agit d’abord de capter l’attention, à travers des procédés que l’on rencontre aussi bien dans la culture marchande que dans les productions médiatiques. C’est le rôle dévolu par exemple aux procédés sensationnalistes (Vérilhac, 2023), aux logiques attractionnelles, au barnumisme (Cook, 2001), aux mises en scène ostentatoires (Assouly, 2004), à l’érotisation des messages (Haug, 1987), ou encore au jeu sur l’exhibition et la dissimulation pour produire de la curiosité (Cochoy, 2011), et si les procédés attractionnels ne se limitent pas à engager une relation esthétique (ils peuvent par exemple annoncer des révélations fracassantes, des offres extraordinaires, etc.), cette promesse de plaisir esthétique tient de plus en plus une place capitale dans leurs stratégies de captation du public. De fait, ces pratiques visent le plus souvent à installer d’emblée le consommateur dans une relation esthétique à l’objet, même si celle-ci négocie avec d’autres usages (pratiques en particulier). Les théoriciens de l’organisation des commerces ont compris dès la fin du xixe siècle qu’un espace plaisant affectait les choix du consommateur, et qu’il y avait lieu de miser sur la séduction de l’objet, en faisant basculer le choix de la question de l’utilité à celle du goût (Leach, 1994). De même, un magazine sensationnel annonce certes un ensemble d’informations exclusives, mais la mise en page, la promesse d’émotions ou le jeu avec les intertextes de la fiction définissent aussi un objet destiné avant tout à procurer du plaisir au lecteur. Le dispositif esthétique tend à surajouter à la question des usages pratiques celle d’un plaisir esthétique.
14Si de telles pratiques ont largement été expérimentées dans le domaine des spectacles forains et des techniques commerciales, elles trouvent des équivalents dans certaines techniques littéraires et éditoriales. Ainsi en est-il des procédés des récits sensationnels, qui surjouent l’émotion pour solliciter celle du consommateur, du barnumisme de la presse à scandale, qui tire une partie de son pouvoir attractionnel de ce que le lecteur soupçonne toujours une tromperie sur la marchandise, dans un jeu qui se pense largement en termes esthétiques (puisque ce sont les séductions du genre qui attirent, autant, et sans doute plus, que les promesses de révélations), de l’importance de certains paratextes éditoriaux visant à produire une tension narrative avant même le début de la lecture, etc. Pris dans la fugacité des expériences, les dispositifs doivent attirer l’œil, capter l’attention, pour l’emporter dans une concurrence des sollicitations – phénomène bien décrit par Jonathan Crary (2000) ou Ben Singer (2001). En ce sens, l’économie de l’attention qu’évoque Yves Citton (2014) mobilise largement des stratégies de séduction qui surajoutent aux considérations pratiques (s’informer, acquérir un bien dont on a besoin) un rapport esthétique aux objets.
15De tels dispositifs ne se limitent pas à des procédés de captation de l’attention, ils visent aussi à déterminer une relation esthétique à l’objet bien après l’acte d’achat. Le design d’un produit s’offre durablement à l’appréciation de son propriétaire, faisant du style de vie une question esthétique. De même, la plupart des productions de la culture médiatique sont conçues pour être évaluées aussi en termes de plaisir, à tel point que ce souci domine les choix des créateurs (ce que formulent bien des termes comme ceux d’infotainment ou d’edutainment) : les procédés de fictionnalisation, l’importance de l’ambiance dans les programmes télévisés, la charte graphique des imprimés, les procédés des magazines à scandale visant à susciter une émotion décontextualisée sont autant de stratégies manifestant une volonté de mettre l’accent sur une telle relation esthétique.
16Structurés pour correspondre à des usages situés, les dispositifs esthétiques tiennent fréquemment compte du caractère superficiel des interactions recherchées par le destinataire, ou de leur fugacité. C’est ce qui explique l’importance des dispositifs qui se prêtent à une consommation distraite, comme le format fragmentaire et imagé du magazine, lié au feuilletage, l’économie attractionnelle de la brièveté adaptée au scrolling sur les réseaux sociaux ou les contraintes de reprise et de relance des comic strips. Dans tous les cas, les dispositifs esthétiques articulent une puissante sollicitation sensationnaliste et une logique de brièveté qui intériorise la concurrence d’autres dispositifs esthétiques dans l’économie de l’attention.
17Pris dans le quotidien, tous ces dispositifs associent des éléments de séduction esthétique à des considérations pratiques, liées à des usages situés. Autrement dit, la relation esthétique qu’ils peuvent induire n’est pas nécessairement pure (au sens kantien), mais se mêle souvent à d’autres types de relations, plus utilitaires. C’est vrai non seulement des dispositifs strictement commerciaux (design, marketing, publicité) qui invitent le consommateur à associer une relation esthétique, dépragmatisée, à des usages d’ordre pratique ou, pour reprendre la dichotomie de Böhme, à associer besoin et désir (c’est-à-dire à la fois promesse d’usages pragmatiques et de plaisirs esthétiques), mais c’est vrai aussi d’un très grand nombre de dispositifs visant à la fois à instruire et distraire, ou à rendre plaisantes certaines activités. Je pense aux périodiques de vulgarisation, aux ouvrages pratiques ou documentaires adoptant résolument des stratégies de séduction, à une part importante des productions pour la jeunesse, éducatives ou édifiantes, aux « beaux livres » mêlant fonction d’usage et séduction esthétique. Dans ce jeu entre usages instrumentaux et relation esthétique, on soulignera que la dimension pragmatique ne s’oppose pas au nécessaire désintéressement de la relation esthétique. Lorsque, décidant de faire un footing, je lance sur Spotify une playlist motivationnelle, les morceaux rythmés me donnent certes du courage pour courir, mais mon appréciation esthétique est indépendante de cette relation pragmatique (j’apprécierais ou non la chanson par ailleurs). Cela vient de ce que tout dispositif esthétique engage un jugement hédonique, sur le plaisir ou le déplaisir, qui arrache le consommateur à la seule relation d’usage. Ainsi, l’importance des cadrages esthétisants habillant les programmes télévisés (y compris politiques ou journalistiques), de même que ceux de la presse d’information et de divertissement, manifestent cette oscillation constante de notre appréciation entre des considérations esthétiques et des considérations pragmatiques : j’aime telle émission, tel magazine, parce que j’y trouve des informations intéressantes, mais aussi parce qu’ils m’amusent, me surprennent, me divertissent, etc. Loin d’être une dégradation de la relation esthétique véritable (ou pure), ce type de relation correspond au régime normal, quotidien, de conduites attentionnelles qui négocient toujours avec les contraintes associées à d’autres activités, favorisant l’existence de productions dominées par un principe d’impureté fondamentale.
Sollicitations quotidiennes et socialités esthétiques
18Parce qu’elles s’insèrent dans les différents événements de la vie, les relations esthétiques courantes prennent toute leur portée culturelle, mais à bas bruit, puisqu’elles accompagnent ou sont sans cesse concurrencées par d’autres préoccupations. Cherchant à solliciter notre attention esthétique, elles connotent en termes de plaisir et de déplaisir, et plus largement de coloration émotionnelle, nos activités. Enfin, elles nourrissent une bonne partie de nos conversations, non sous la forme de jugements critiques développés, mais à travers des considérations superficielles et fugaces. Une part importante de nos discussions porte sur des objets esthétiques, mais dans la mesure où il s’agit de caractériser des expériences banales, ces discours restent eux-mêmes désinvoltes. On a pu étudier ce vocabulaire esthétique du quotidien (cool, marrant, mignon…) et les catégories équivoques qu’il détermine (Harris, 2000 ; Ngai, 2015). Et de fait, l’intérêt tout relatif que connotent des termes comme « cool », « sympa » ou « marrant » intériorise le caractère fugace et superficiel de l’expérience esthétique. De même, des expressions comme « génial », « super » ou le verbe « adorer », en apparence opposés au précédent registre, tendent à substituer la force sensationnelle des émotions à toute élaboration discursive. Il existe ainsi tout un système évaluatif des expériences esthétiques courantes qui tente implicitement de rendre compte au quotidien de leur spécificité, et qui occupe une bonne partie de nos échanges, fournissant le carburant de nos sociabilités. On retrouve un système évaluatif similaire dans une part considérable de la critique médiatique (Letourneux, 2021), qui propose aussi ces catégories d’un jugement stéréotypé et peu étayé, suivant une logique de flux. Reste que si la superficialité des propos manifeste la relative faiblesse des implications esthétiques, elle exprime aussi l’omniprésence des sollicitations, favorisant les jugements rapides et de surface : on juge vite, parce qu’on juge beaucoup. La mollesse des jugements relativise l’efficacité des dispositifs attentionnels visant à captiver le public à coups de techniques de séduction. Comme l’a montré encore Yoan Vérilhac (2023), l’exagération des procédés sensationnels est le corolaire d’une faible implication de consommateurs qu’il faut sans cesse remobiliser.
19Mais il s’agit de comprendre que si la multiplication des sollicitations esthétiques affaiblit la portée de chacune d’entre elles, collectivement, elles jouent un rôle capital dans nos existences, nourrissent nos conversations, dessinent nos affinités, enfin elles déterminent des normes et des usages, ne serait-ce que par leur importance au quotidien. Reste que, malgré la sophistication des dispositifs attractionnels et leur influence à une échelle collective, leur efficacité singulière est tributaire des usages en contexte – usages contextuels qu’ils cherchent souvent à programmer du reste. Comme toujours, dans le cadre de la relation esthétique, c’est la disposition concrète de celui qui éprouve qui rend ou non possible l’expérience esthétique – qu’il ait l’esprit ailleurs ou soit à la recherche d’autres propositions esthétiques, et l’objet ne suscitera guère son intérêt. Qu’il favorise exclusivement un rapport pragmatique à ce même objet (chercher des informations dans un journal, négliger le design du produit pour se concentrer sur sa fonction), et tous les efforts des concepteurs resteront inopérants. Cela explique qu’au quotidien, la plupart des dispositifs esthétisants ne produisent aucun effet sur nous parce que nos préoccupations nous empêchent d’y prêter attention, ou parce que nos habitus nous en détournent. Rien de plus atterrant qu’un magazine de gossip lu dans un mauvais contexte, rien de plus ennuyeux qu’un roman ou un film de genre quand on n’est pas disposé à les apprécier, rien de plus agaçant qu’un produit dont le design va contre l’usage. C’est bien la rencontre d’un dispositif et d’une disposition située qui produit l’expérience esthétique. Et dans le flux des expériences qui caractérise notre quotidien, le tri se fait à très grande vitesse, suivant la situation.
20Ce rôle capital de la réception explique l’importance qu’ont les usages dans l’histoire des productions esthétiques du quotidien, de leurs transformations sérielles au gré des succès ou des échecs. Ce sont les usages des publics, leur manière d’être sensibles ou non aux sollicitations qu’on leur offre, d’en privilégier certaines, d’en rechercher d’autres, qui ont favorisé l’émergence de nouveaux types de publications, de nouveaux genres littéraires ou de nouvelles formes de films ou de séries télévisées. On songe à la façon dont le développement de la VHS a favorisé celui de certains genres de films (horreur, pornographie), liés aux pratiques sociales qui se sont inventées autour de ce nouveau support. On peut aussi évoquer la façon dont les médias numériques ont transformé la critique et l’écriture amatrices (non seulement en faisant émerger de nouvelles formes en leur donnant un rôle culturel inédit). De telles pratiques ne pouvaient être anticipées par les acteurs industriels et culturels. Autrement dit, les dispositifs médiatiques et marchands tentent de favoriser des modes d’appréhension, mais les publics imposent leurs sensibilités. Il ne s’agit pas tant ici d’évoquer les luttes politiques ou sociales pour la signification des objets culturels sur lesquels insiste par exemple une bonne part des recherches en cultural studies, que de noter les ajustements constants qui se produisent, entre les logiques de séduction des producteurs et les usages des consommateurs. Ainsi, dans l’économie de la séduction et du plaisir qui caractérise nos sociétés, la relation esthétique est un rouage capital des ajustements culturels et sociaux. Cela vient bien sûr de ce que ce qui détermine le plaisir ou le déplaisir est pris dans les préoccupations collectives, et ce, de manière d’autant plus forte que le caractère omniprésent des sollicitations esthétiques fait de celles-ci un lieu de négociation central de notre culture.
21Cette centralité s’explique précisément par la question du plaisir et du déplaisir qui est en jeu ici : qu’est-ce qui nous séduit ? Quelle place accorde-t-on au plaisir dans un certain contexte, quelles situations rendent au contraire difficiles l’adoption d’une posture esthétique face à certains objets ? Ce sont des questions centrales, qui nécessitent de prendre en compte l’ensemble de nos relations à la culture, aux valeurs, aux normes, bien au-delà de l’esthétique, puisqu’elles mettent également en jeu des considérations politiques, sociales ou morales. Pour ne prendre qu’un exemple : au xixe siècle, les critiques contre la presse, le roman-feuilleton, la publicité ou le divertissement revenaient aussi à commenter les transformations collectives de ces normes, au moment même où de nouveaux territoires s’ouvraient au plaisir ou au déplaisir, avec le développement d’une consommation à bas coût en période de démocratisation politique et culturelle. Et le « great divide » entre haute culture et culture de masse qui en a découlé un demi-siècle plus tard a eu des conséquences fondamentales sur la manière d’apprécier les œuvres. Le concept de lectures honteuses, qui a traversé le xixe siècle et s’est étendu, au xxe siècle, à un ensemble de productions audiovisuelles illégitimes ou indignes, a par exemple joué un rôle majeur pour définir une vaste gamme de plaisirs transgressifs (pratiques buissonnières, honteuses ou affichées de manière provocante). Et en retour, ces modes de consommation ont favorisé l’émergence d’une multitude de dispositifs les esthétisant : livres qu’on peut dissimuler, genres exploitant dans leurs conventions la transgression des normes se produisant dans l’acte de lecture, productions performant la transgression de manière provocatrice ou encore formes ironiques qui exhibent leur propre illégitimité.
Élargissement du périmètre de la littérature
22On voit les conséquences, pour la définition de la littérature, d’un tel déplacement de l’expérience esthétique dans le flux des interactions quotidiennes. Alors que les définitions qui ont eu tendance à prévaloir au xxe siècle font de celle-ci une expérience de l’écart par rapport au langage commun, rien n’empêche dans la perspective qui est la nôtre d’élargir considérablement son périmètre, d’une façon qui correspond du reste au mouvement continu de redéfinition caractéristique de ces cinquante dernières années. Les débats qu’a engendrés dans les années 1990 le concept de paralittérature pour définir, au sein des productions de fiction, la part des récits présentés comme dépourvus de littérarité (c’est-à-dire ce qu’on appelait auparavant la littérature populaire) ont mis en évidence le peu de pertinence d’une telle opposition, puisqu’aucun trait discriminant ne permettait d’établir de façon satisfaisante une frontière – je renvoie sur ce point aux analyses de Jacques Migozzi (2005). De même, les travaux sur l’écriture journalistique ont démontré le caractère central de la presse dans l’histoire de la littérature depuis le xixe siècle (Kalifa, 2011). Ceux sur la littérature de jeunesse (Perrot, 1999) ont quant à eux imposé l’idée d’intégrer les productions iconotextuelles dans le champ de la littérature. Alexandre Gefen a bien décrit ce processus d’élargissement dans son Idée de littérature (2021).
23Si elle s’inscrit dans ce mouvement, ma perspective n’est pas exactement la même, puisqu’elle ne cherche pas tant à définir un périmètre élargi de la littérature, qu’à poser la question d’un élargissement des questionnements littéraires à de nouveaux objets, sans nécessairement les définir comme littéraires. Il s’agit alors de se donner la possibilité d’examiner n’importe quel dispositif textuel ou verbal engageant une relation esthétique. Cela recouvre une vaste gamme de productions : d’abord bien sûr toutes les productions fictionnelles qui mettent par nature en jeu une relation dépragmatisée ; ensuite, les chansons (dont la dynamique lyrique vise à susciter une adhésion fictionnelle aux émotions) ; également toutes les productions liées à la culture comique, puisque les mécanismes du rire mettent à distance le réel. On pense encore, sur le marché audiovisuel, aux chroniqueurs de radio et de télévision, et aux émissions sur prompteur. On pourrait citer aussi tout une partie des productions de la presse, puisque l’écriture journalistique développe généralement des stratégies de séduction qui excèdent largement la dimension informationnelle et invente des formes d’écriture qui multiplient les effets : c’est particulièrement vrai des journaux de divertissement et des journaux populaires en général, qui cherchent avant tout à séduire le public, mais aussi des chroniques, des éditoriaux ou des formes mettant l’accent sur la singularité d’une voix. La même remarque pourrait être faite pour la plupart des essais et des ouvrages non fictionnels à destination du grand public, dont l’intérêt tient autant à leurs logiques de séduction qu’à leur contenu informationnel, depuis la vulgarisation jusqu’aux beaux livres de cuisine et de voyage. Ces stratégies de séduction nous invitent également à interroger un certain nombre de productions directement liées à la culture de consommation dans une perspective esthétique : de même que les vitrines, les dispositifs marchands et les produits commercialisés dans les boutiques fonctionnent très largement sur des logiques de séduction esthétique, de même, la publicité et les paratextes éditoriaux sont des dispositifs esthétiques. On voit, par élargissements successifs, que la plupart des productions textuelles et verbales engagent une relation esthétique, depuis l’édition traditionnelle et ses variations numériques, jusqu’aux productions diffusées sur les réseaux sociaux ou sur internet, les arts de la parole diffusés en flux sur les médias de masse et les productions iconotextuelles de la séduction marchande.
24Cette liste un peu longue a pour seule vocation de montrer combien la bascule du côté d’une esthétique du quotidien ouvre le questionnement littéraire bien au-delà du périmètre des objets traditionnels de notre discipline. C’est à tel point qu’on pourrait se demander quelle serait alors la spécificité de l’approche littéraire par rapport à celles d’autres disciplines comme la linguistique (et l’analyse des discours) ou les sciences de l’information et de la communication, qui se sont emparées de longue date des productions des médias de masse. Mais par rapport à ces disciplines, c’est un changement de perspective qu’offre l’approche littéraire, puisqu’il s’agit d’interroger précisément cette dimension esthétique. Et en ce sens, il ne s’agit que de déplacer sur de nouveaux territoires des perspectives qui caractérisent les études littéraires.
25Mais un tel déplacement modifie considérablement la nature de notre réflexion. D’abord, parce que l’ouverture à de nouveaux objets tend à déporter l’attention des auteurs (comme singularités) vers les dispositifs. Or, en tant que formes culturelles dans lesquelles se coulent les acteurs de la création, de tels dispositifs supposent de penser l’auctorialité de manière élargie, en tenant compte, à côté des scripteurs, des éditeurs, producteurs et acteurs industriels. Cela signifie aussi que l’analyse tend à glisser de la singularité des pratiques à leur dimension collective, en s’intéressant aux dynamiques sérielles, aux pactes de lecture architextuels et aux encyclopédies stéréotypiques des genres (scénarios intertextuels et réservoir de topoï). Les processus de singularisation peuvent être envisagés, mais dans leur dialogue avec ces conventions culturelles et sociales qui les portent. En effet, dans la communication de flux qui caractérise l’esthétique du quotidien, l’originalité tend naturellement à se penser sur fond de protocoles standardisés qui définissent les conditions de possibilité de la communication. Le caractère collectif et routinisé de la communication fait moins de ces productions esthétisées l’expression de positions singulières que le résultat de discours sociaux, de leur sédimentation et de leurs mutations. C’est bien parce qu’ils recourent massivement à des procédés conventionnels visant à susciter une relation esthétique chez leur destinataire que ces dispositifs sont efficaces.
26Dès lors, la question des émotions sollicitées par ce type de productions est essentielle si on l’envisage dans une perspective culturelle. En se plaçant sur le terrain esthétique, l’étude des dispositifs est révélatrice de ce que, collectivement, on associe au plaisir et aux émotions (quels types de discours, de sujet, de style ou de contexte sont conventionnellement conçus pour les susciter), et de la manière dont lesdits dispositifs négocient avec les préoccupations du temps (valeurs partagées, inquiétudes collectives, formes culturelles que peut prendre le désir). L’évolution des dispositifs et des discours qu’ils suscitent est en outre révélatrice de la façon dont on confronte collectivement l’appréhension esthétique à des questions d’un autre ordre – moral, religieux, politique. Les notions de « mauvaises lectures » ou de « lectures honteuses », la question de ce qu’on considère être du temps perdu, de ce qui est de bon ou de mauvais goût, de ce qu’on veut interdire ou non, de ce qui peut donner lieu à une approche dépragmatisée, de ce qui choque, émeut ou fait rire, la façon dont on connote émotionnellement certains sujets, certains discours, tout cela évolue au fil du temps, et est révélateur des discours sociaux et des imaginaires d’une époque. C’est d’autant plus vrai que, généralement plus ambigües dans leurs usages que les productions littéraires dans leur acception classique, en ceci qu’elles articulent émotion esthétique et usages pragmatiques, les productions qui nous intéressent donnent souvent lieu à des débats qui font jouer ces deux niveaux, esthétiques ou sociaux : on pense aux jugements que suscitent dans la société la pornographie, les récits ultra-violents, les pratiques de la presse à scandale, les paroles du rap, les chroniques d’humoristes, la dramatisation des médias, etc. La dimension culturelle du goût explique que l’expérience esthétique ne puisse être détachée de son contexte – à la fois celui, collectif, de la société tout entière et de ses normes, et celui lié à la situation particulière des consommateurs qui abordent l’œuvre. Dès lors, les normes de goût apparaissent comme un lieu de conflit entre les valeurs collectives et singulières.
27On voit combien la perspective que j’envisage déplace les enjeux de l’analyse littéraire, sans remettre en cause ceux qui prévalent globalement dans notre discipline, mais en proposant une autre voie, parallèle à la première. Une voie qui engage enfin des questionnements historiques, articulant ici encore les problématiques culturelles et industrielles. Il existe par exemple des liens profonds entre l’histoire de la consommation et celle de la place accordée à la littérature de consommation, et le « great divide » n’en est qu’un moment clé, après celui du flâneur et de la lectrice de journaux et avant celui du livre de poche au moment où s’impose la consommation de masse. Dès lors, on peut s’intéresser à la manière dont les dispositifs et les sensibilités esthétiques peuvent être analysés en relation avec les systèmes économico-médiatiques qui les portent : la culture et l’esthétique fordistes des années 1920-1970, la culture postfordiste qui se développe à partir des années 1980, la confusion croissante, au xxie siècle, entre les logiques d’œuvre ou de monde fictionnel et les logiques de marque dans les plaisirs esthétiques contemporains, sont quelques exemples des négociations entre la structuration sérielle des systèmes économico-médiatiques et leur reconfiguration dans les dispositifs esthétiques, les formes qu’ils induisent et les usages collectifs qui en sont faits, tous contribuant à orienter notre manière d’apprécier les objets culturels, et favorisant des conduites attentionnelles mettant en jeu une relation esthétique4.
Pour une bascule vers une esthétique de la consommation
28Il est évident que dans le cadre de cet article, il n’est possible que d’effleurer les questions que pose une telle bascule dans une esthétique du quotidien tentant de saisir le flux des sollicitations médiatiques et marchandes. Il n’empêche que nous pouvons déjà souligner quelques-uns de ses enjeux. D’abord, en appréhendant la masse des sollicitations quotidiennes, il s’agit de ressaisir la dimension culturelle et sociale du cadrage de nos expériences esthétiques. Ensuite, à travers la question des dispositifs, il s’agit d’en étudier les mécanismes, les logiques, dans une perspective qui se situerait à l’intersection des questionnements techniques, poétiques et culturels. Cette contextualisation suppose en outre une approche historique, situant ces pratiques dans des cadres sociaux, politiques et moraux, qui rendent acceptables ou non lesdits dispositifs et les pratiques qu’ils visent, et qui révèlent aussi ce qui est l’objet des émotions à l’époque – conflits, angoisses, désirs. Les dispositifs supposent enfin qu’on les ressaisisse dans le contexte concret des usages – non seulement ceux qu’ils visent, et qui les conduisent à déployer un ensemble de stratégies de séduction, mais aussi ceux qu’ils suscitent, parfois à l’opposé des usages induits, faisant ici encore de la réception et des usages, l’un des enjeux culturels et sociaux de l’esthétique. Dans une telle perspective, les approches poétiques et esthétiques de la littérature et des études esthétiques pourront s’ouvrir, au sens fort, aux problématiques culturelles.