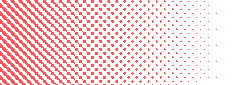De l’érudition considérée comme l’un des beaux-arts
1On commencera par poser ici que la question de la pluralité des postures des enseignants-chercheurs n’est pertinente que depuis le XIXe siècle ; entendons-nous : pertinente comme problématique, puisque la double pratique de l’érudition et de la création littéraire – sans être partagée par tous les auteurs anciens – est largement attestée, et était considérée comme non problématique chez nombre d’entre eux : les poètes alexandrins, bien des écrivains médiévaux de Boèce à Dante, les humanistes à partir de Pétrarque et, bien sûr, presque tous les philosophes des Lumières attestent suffisamment de la porosité des postures d’écriture avant l’instauration par l’université allemande de procédures faisant résolument entrer dans le domaine de la pratique scientifique les travaux que l’on a pris aujourd’hui l’habitude de classer sous le label des « sciences humaines ». Les progrès du scientisme n’ont certes pas été synchrones dans toutes les nations européennes : l’Allemagne ouvre la marche à l’époque napoléonienne, la France et l’Italie ne prennent le virage qu’un quart de siècle plus tard, l’Angleterre et la Russie plus tardivement encore.
2La séparation tranchée des deux postures provoque même dans l’Allemagne de la fin du XIXe siècle l’émergence d’un genre romanesque que l’on a appelé le « roman de professeur » (Professorenroman), que l’on caractérise tantôt par la mise en scène du monde universitaire, tantôt comme un type de romans historiques très marqués par l’érudition ; dans tous les cas, il est écrit par des universitaires conscients de la transgression que représente, dans leur cas, un positionnement en porte-à-faux dans le champ littéraire. On a souvent considéré Umberto Eco, à notre époque, comme un représentant typique du Professorenroman, et les noms ne manqueraient pas, en fait, pour grossir la liste contemporaine de ses successeurs, de David Lodge à Michel Zink, en passant par Manuel Vazquez Montalban dans son atypique Erec et Enide1.
3Mais revenons au XIXe siècle. En France, un Ernest Renan, héraut d’un scientisme calqué sur le modèle allemand, est encore à la croisée des chemins, alternant textes purement scientifiques (Histoire des origines du christianisme, Histoire des langues sémitiques) et textes de vulgarisation, voire de pure création (Dialogues, Drames philosophiques). Son ami Hippolyte Taine, en revanche, renforce sa position scientifique en professant un déterminisme presque absolu et, significativement, laisse inachevé son roman Étienne Mayran (Taine, 1991). Le cas des médiévistes, poussés à vulgariser leur matière davantage que d’autres érudits, est, dans le contexte du positivisme triomphant, particulièrement intéressant. Paulin Paris, premier professeur de littérature médiévale au Collège de France, est encore un érudit pré-scientifique : compagnon de route de l’école romantique, dont il écrit une Apologie, il publie de nombreuses traductions et adaptations de littérature médiévale, dont un Roman de Renart (Paris [1861], 1993) véritable ouvrage de création dans la mesure où il a nécessité l’unification d’une matière originellement disparate : la « langue traductrice » qu’il y forge, ni trop archaïque, ni trop moderne, est déjà celle qu’emploiera – avec le succès que l’on sait – Joseph Bédier dans son Roman de Tristan et Iseut (Bédier [1900], 2012). Le fils de Paulin Paris, Gaston, sera – en opposition avec son père – le véritable promoteur de l’étude scientifique de la littérature médiévale en France. Il publiera certes des articles de vulgarisation et même une adaptation de la chanson de geste d’Huon de Bordeaux (Paris, 1898), mais n’en maintiendra pas moins une position scientiste qui fera apparaître ses pas de côté comme autant de simples concessions au grand public.
4J’en arrive à l’érudit qui a décidé de ma propre carrière universitaire : Joseph Bédier. De prime abord, son parcours n’est pas différent de celui de son maître Gaston Paris : on lui doit aussi quelques articles de vulgarisation et des adaptations de littérature médiévale, mais le statut de celles-ci est sans commune mesure avec celui du Huon de Bordeaux de Gaston Paris. Son Roman de Tristan et Iseut (1900) de Bédier, qui est en effet une recréation et une adaptation à la sensibilité symboliste du jour de la légende de Tristan à partir de sources très diverses, est au moins aussi original que le Roman de Renart de Paulin Paris, et son immense succès populaire, qui a fait de cet ouvrage un véritable bestseller du roman d’amour du XXe siècle, traduit dans une quarantaine de langues, a fortement infléchi l’image même de l’érudit Joseph Bédier (par ailleurs auteur d’une adaptation théâtrale, beaucoup moins connue, de la chanson de geste des Enfances Vivien).
5C’est ici que j’aimerais immiscer mon immodeste personne. Je crois en effet que ma vocation de médiéviste remonte à la contemplation dans la bibliothèque de mon grand-père d’un vieil exemplaire du Roman de Tristan et Iseut de Bédier offert à ma grand-mère comme cadeau de fiançailles en 1932. Je ne l’ai pas lu tout de suite, mais le prestige de ce texte exerçait sur moi un charme puissant entourant le nom de Bédier d’une aura de romancier qui fut encore renforcée lorsque, vers l’âge de quinze ans, je découvris l’admirable cantate Le Vin herbé du compositeur suisse Frank Martin, l’autre grande version musicale (avec, bien sûr, l’opéra de Wagner) de la légende des amants de Cornouailles, précisément écrite sur des extraits du roman de Bédier, texte dont Frank Martin écrivait :
Le texte de Bédier, comme je crois aucune prose, me servit et me porta par son sens extraordinaire du rythme, des proportions et du juste mouvement psychologique. Je pus le prendre intégralement, sans changement, ce qui est une preuve non équivoque de son extrême perfection. (Martin, 1977, p. 36)
6On comprendra que cet éloge appuyé ait pu marquer le musicien et compositeur en herbe que j’étais à l’époque !
7En arrivant, quelques années plus tard, à l’Université, j’ai découvert que Bédier n’était pas un écrivain, ou plus exactement qu’il avait d’abord été un érudit, philologue, et que ce que j’avais pris pour son activité principale n’était qu’un à-côté de son travail proprement universitaire. La chose m’a suffisamment frappé pour que – encouragé par un séminaire que le grand dix-neuviémiste qu’était le professeur Jean Borie avait consacré à Gustave Lanson, à partir du livre, alors récent, que lui avait dédié Antoine Compagnon (1983) et où il avait dit, comme en passant, qu’« un professeur d’université n’était qu’un écrivain raté » – je consacre mon mémoire de fin d’études à une comparaison du Roman de Tristan et Iseut de Bédier et de ses sources, travail que je développai jusqu’à soutenir, en 1996, une thèse en Sorbonne sur l’ensemble de l’œuvre de Bédier : Joseph Bédier, écrivain et philologue (Corbellari, 1997).
8Comme je l’ai déjà dit, au début de mes études, je ne me voyais pas encore faire carrière dans l’Université, mais bien plutôt dans la musique. Et en l’occurrence je dois peut-être doublement mon salut à Frank Martin, en ce que d’une part j’eus vite l’impression qu’il avait déjà composé la musique que je voulais écrire, et parce que, d’autre part, comme je viens de l’évoquer, il avait grandement contribué à m’aiguiller vers Bédier. Je lui ai d’ailleurs payé ma dette en lui consacrant il y a quelques années une petite biographie (Corbellari, 2021a).
9Autrement dit – et je pense qu’on l’a compris –, mon intérêt pour Bédier venait de ce que je reconnaissais en lui la « double postulation » (pour parler pompeusement comme Baudelaire) que je sentais à l’œuvre en moi. J’ai donc construit ma thèse sur Bédier autour de l’idée-force que l’œuvre complète des universitaires méritait d’être étudiée sous le double angle de la science et de la littérature. Évidemment, une telle approche est plus ou moins intéressante selon les chercheurs étudiés : peu gratifiante à propos des positivistes qui n’ont jamais éprouvé de tentation littéraire et dont l’écriture se refuse à tout effet, elle devient par contre passionnante, et même, sans doute, nécessaire pour ceux qui ont mené parallèlement une activité (plus ou moins) littéraire et/ou dont l’écriture ne s’interdit pas les prestiges du style.
10Jouant les avocats du diable, je demandais au début de la préface de ma thèse (pour y répondre évidemment positivement) : « Après les œuvres, doit-on lire les critiques ? après les critiques, devrons-nous supporter les glossateurs des critiques ? » (Corbellari, 1997, p. XI). Le fait est que je n’inventais pas de toutes pièces cette interrogation lassée : elle m’a été plus ou moins implicitement posée lors de l’élaboration de ma thèse, et même plus tard ; et je soupçonne l’une de mes expertes (aujourd’hui décédée, paix à ses cendres), particulièrement réfractaire à ce type d’approche, qu’elle considérait comme une perte de temps, d’être la responsable du fait que je n’ai pas obtenu, à ma soutenance, les félicitations du jury. Que l’on se rassure : cela ne m’a pas empêché de faire une carrière dont je serais vraiment ingrat de me plaindre. Il est vrai que j’ai toujours travaillé en Suisse et n’ai jamais essayé de m’insérer dans le tissu de l’enseignement supérieur français. Mais c’est aussi qu’en vingt-huit ans les choses ont changé et que l’histoire de la critique a fini par trouver sa place dans les programmes et la recherche universitaires. Aurai-je la fatuité de dire que j’y suis pour quelque chose ? Le fait est que j’ai été le premier à soutenir en France une thèse sur l’histoire des études médiévales ; d’autres chercheurs n’ont pas tardé à me rejoindre (voir en particulier Ridoux, 2001 et Bähler, 2004) et nous formons maintenant une petite communauté florissante, qui a d’ailleurs eu la chance d’être soutenue par Michel Zink (sur les activités d’écrivain de qui je reviendrai), lequel avait fondé au Collège de France un groupe de recherche sur l’histoire de la philologie romane. Il faut aussi rappeler que, dans la foulée de l’Éloge de la variante de Bernard Cerquiglini (1989)2, quelques médiévistes américains avaient lancé, autour de Stephen Nichols et d’Howard Bloch, le mouvement de la New Philology, qui tentait de renouveler les études médiévales entre autres par la réflexion sur l’histoire de la discipline, mouvement auquel j’ai eu la chance d’être, et avant même la soutenance de ma thèse, très vite associé3.
11Enfin, la vague de fond, alors émergente en France (mais qui avait déjà porté des fruits en pays germaniques et anglo-saxons), du médiévalisme, c’est-à-dire de l’étude des résurgences de la culture médiévale dans la Modernité me requérait également : j’y apportais ma conviction que l’étude de la réception profane du Moyen Âge devait nécessairement être couplée à l’étude de sa réception érudite, la figure de Joseph Bédier, indissolublement philologue et écrivain, apportant la preuve, à mes yeux, que les deux champs ne pouvaient être séparés4. En outre, et je me rapproche ici de la question de la « plume savante », cette figure tutélaire me permettait de documenter un moment particulièrement intéressant de l’histoire de l’université française, Bédier faisant en effet partie de la première génération à avoir cherché, tout en se réclamant des nouveaux paradigmes scientifiques désormais incontournables, à assouplir quelque peu les rigueurs de la méthode positiviste. Ainsi, écrivant dans la Revue des deux mondes un article passablement publicitaire sur les accomplissements de la « Société des Anciens textes français », Bédier n’hésitait pas à railler ses collègues trop inféodés à l’idéologie scientiste : « Ils savent, ces érudits, aussi bien que personne, que le monde des idées générales est le seul qui vaille qu’on y vive, — et ils se sont interdit d’y pénétrer. » (Bédier, 2010, p. 130) Plus tard, professeur installé, Bédier renouvellera la méthode de l’édition des textes en contestant la reconstructibilité des textes originaux de la littérature médiévale et en stigmatisant l’arbitraire de ses collègues trop persuadés de la légitimité d’une telle ambition. Proclamant que « dès lors, il faut bien convenir, avec les anciens humanistes, qu’on ne dispose guère que d’un outil : le goût » (Bédier, 1929, p. 71), il scandalisera certains de ses collègues, dont l’un n’hésitera pas à taxer sa méthode de « dadaïsme érudit » (Pasquali, 1929, p. 420). On ne connaît pas la réaction de Bédier à ce propos, mais je me plais à croire qu’il en fut secrètement flatté.
12Pour Bédier, en effet, la littérature médiévale n’était pas seulement un objet d’étude, mais aussi un objet de dilection qu’il ne fallait pas avoir honte d’avouer comme tel ; et il fait peu de doute que le succès de son Roman de Tristan et Iseut résulte précisément d’un amour qu’il ne pouvait faire taire pour l’art littéraire du Moyen Âge, et dont l’écriture de son roman n’était que le prolongement naturel. Bédier représente ainsi à mes yeux le prototype de la figure que nous cherchons ici à cerner : immergé dans un monde universitaire qu’il ne peut renier, il manifeste par ses foucades, ses provocations et son émancipation littéraire un désir de lui échapper qu’il ne peut évidemment pousser à ses ultimes conséquences ; philologue par vocation, écrivain par passion, Bédier illustre parfaitement la position malaisée de l’érudit dont la fierté ne se satisfait totalement d’aucune de ces deux déterminations.
13J’ai continué pour ma part de m’intéresser aux érudits présentant cette double caractéristique d’être aussi des écrivains.
14Ainsi avais-je hésité un moment à consacrer ma thèse à Romain Rolland, dont me fascinait le fait qu’il fût, outre le célèbre auteur du premier roman-fleuve français, Jean-Christophe, le premier professeur de musicologie de la Sorbonne, fait que l’on sait beaucoup moins, et qui me ramenait à mes amours musicales. Bien après avoir finalement consacré ma thèse à Bédier, qui avait sur Rolland l’avantage de me ramener à cette littérature médiévale dont j’ai fait ma carrière, j’ai tout de même écrit sur l’auteur de Jean-Christophe un livre qui détaillait son rapport à la musique et qui constituait une nouvelle pierre de l’édifice des études sur les érudits-écrivains (Corbellari, 2010).
15J’invoquerai aussi bien sûr le grand écrivain romand Charles-Albert Cingria (1883-1954), dont j’ai contribué à coordonner la nouvelle édition des Œuvres complètes aux éditions L’Âge d’homme. Connu surtout pour des textes cours, fantaisistes, vagabonds, d’une folle originalité d’écriture, Cingria est, à première vue, un pur écrivain. Si l’on y regarde de plus près, cependant, on s’aperçoit qu’un bon tiers de son œuvre est consacré à des problèmes historiques, et même purement érudits, comme son très savant travail sur le chant grégorien, encore aujourd’hui considéré comme pionnier (voir Corbellari, 2018). M’a ainsi fasciné chez lui ce mélange de postures qui lui a permis, entre autres, d’être l’un des grands avocats, au XXe siècle, de la lyrique des troubadours, dont il a su dire tout le potentiel de nouveauté et de modernité que recelait leur poétique. Je me perdrais à détailler ici l’éloge de Cingria, mais je remarquerai tout de même que, bien qu’apparemment moins rigoureuse que celle des philologues professionnels, son œuvre a plus fait que celle de bien de ces derniers pour nous faire aimer la littérature du Moyen Âge. De ce point de vue, son apport peut être considéré comme parallèle et complémentaire de celui de Bédier. Que Cingria ait été un passionné de musique et que Bédier ait en revanche ostensiblement peu goûté cet art, n’empêche pas Bédier d’avoir insisté, comme Cingria, sur la nécessité de publier les chansons des troubadours et des trouvères médiévaux avec leurs musiques : encore aujourd’hui, la collaboration de Bédier avec des musicologues pour ses publications de textes lyriques reste un phénomène rare dans l’édition des textes médiévaux (voir Corbellari, 2016).
16Les cas de Romain Rolland et de Charles-Albert Cingria sont certes extrêmes, car la posture de l’écrivain y éclipse celle du savant, mais il peut être également très intéressant de traquer la littérature chez des érudits qui n’en ont jamais fait ouvertement profession. Ainsi, la plupart des savants qui ont retenu mon attention l’ont volontiers fait en vertu de qualités d’écriture où je me suis plu à déceler une irrépressible pulsion littéraire refoulée. Paul Aebischer, longtemps professeur à l’Université de Lausanne, m’a par exemple séduit en parsemant ses articles de confidences autobiographiques, d’intitulés drolatiques, comme « Paléozoologie de l’equus clavileñus cervant. » (Aebischer, 1962) ou de remarques telle celle-ci qui, dans son édition de la chanson de geste du Voyage de Charlemagne tourne en bourrique les prétentions de la critique positiviste sans pour autant manquer de bon sens : constatant qu’on en avait proposé, pour dater le texte, les dates extrêmes de 1060 et de 1175, Aebischer avait en effet demandé à une machine d’en calculer la moyenne et en concluait que la machine « nous répondrait que Le Voyage de Charlemagne à Jérusalem et à Constantinople a été terminé le 30 juin 1112. Avouons qu’après tout ce ne serait pas si sot. » (Aebischer, 1965, p. 29)
17Je n’étonnerai personne en avouant que cette désinvolture, qui n’est en rien un refus de la rigueur, j’en ai moi-même usé chaque fois que je l’ai pu et que cela ne m’a nullement – du moins à ma connaissance (!) – empêché d’être pris au sérieux par mes collègues5.
18Actuellement je travaille à un livre sur Paul Zumthor, le médiéviste du XXe siècle le plus exemplaire, sans doute, des doubles postulations que je traque, puisque son œuvre se partage entre une abondante production érudite, qui a durablement marqué le études médiévales, en particulier à travers ses volumes parus dans la mythique collection « Poétique » du Seuil, et une importante production littéraire (plusieurs romans, recueils de nouvelles, plaquettes de poésie et même une pièce de théâtre de jeunesse), nettement moins fréquentée. La place me manque ici pour détailler les raisons que j’ai d’aimer cet illustre ancien collègue, qui a su, comme sans doute aucun autre d’entre eux exprimer les raisons de sa double postulation dans Parler du Moyen Âge, le livre qu’il écrivit au moment où l’on peut lever tous les masques, c’est-à-dire lors de son départ à la retraite :
Par-delà les demi-mensonges intéressés que colporta le XIXe siècle et encore une bonne moitié du nôtre, nous voici dorénavant placés devant une sorte d’évidence : l’identité profonde du discours critique et de la poésie. Les manifestations de l’un et de l’autre émanent du même élan désidéral, du même appétit et aboutissent à la même coupure, au même retranchement, à la même co-naissance, selon le calembour claudélien, l’un et l’autre fondateurs des seuls mythes dont nous ayons vraiment besoin pour vivre. (Zumthor, 1980, p. 102)
19Il faudrait également citer, parmi les médiévistes d’aujourd’hui, Michel Zink, ancien professeur au Collège de France et auteur à ce jour de cinq romans qui ont sans nul doute contribué à son élection à l’Académie française. Chez lui encore, comme chez Bédier et Zumthor, la pulsion littéraire n’est pas seulement présente dans les œuvres explicitement d’imagination, mais elle irrigue toute son œuvre scientifique. On n’en citera comme preuve que son beau livre sur Les Troubadours, une histoire poétique (Zink, 2013), qui se donne pour but de relire les poètes provençaux du Moyen Âge à la lumière des commentaires d’époque qui leur ont été consacrés, les fameuses vidas et razos qui accompagnent leurs copies dans les chansonniers du XIVe siècle, et permettent de réenchanter leur lecture par un surcroît d’imaginaire émanant directement de leur ancien commentaire. De ce point de vue, Zink marchait d’ailleurs sur les traces de Cingria, qui avait été également fasciné par les vidas et les razos, n’hésitant pas à dire de ces derniers qu’ils contenaient
toutes sortes de choses : un peu de philosophie scolastique ou scotiste, un peu de politique angevine ou le contraire, des saillies et des mots pour rire, enfin un petit état des événements du jour qui ne peut être appelé autrement que le journal. (Cingria, 2014, p. 187)
20Je me permettrai pour conclure de revenir sur mon cas personnel, puisque j’ai moi-même publié un roman d’anticipation (Corbellari, 2006) ne contenant pas d’allusion explicite au Moyen Âge mais baigné dans une atmosphère à la Gracq ou à la Jünger qui véhicule les souvenirs métaphoriques d’une imprégnation médiévale. Mais j’ai également, plus récemment – toutes hontes bues, puisque ma réputation universitaire est désormais faite –, publié deux opuscules, que j’intitulerais volontiers (à la suite de Gide qui donnait cette appellation aux Caves du Vatican) des soties et qui sont des parodies plutôt irrévérencieuses de l’histoire littéraire universitaire : une Petite histoire de la littérature médiévale à la manière de Pierre Desproges (Corbellari, 2021b) et un Dante & Co (Corbellari, 2023), qui en est la suite et qui mord sur la Renaissance. Ce type d’exercice est, je crois, plutôt rare : si en effet nous ne manquons pas d’érudits-écrivains, je n’en ai pas encore rencontré qui ait rédigé comme moi, ce qu’il faut bien appeler des contre-manuels de littérature6, dont je ne manque pas de déconseiller formellement l’achat à mes étudiants s’ils prétendent s’en servir pour réviser mes cours, ce qui est une manière comme une autre d’en faire la publicité…
21Je conclurai ces réflexions sur une profession de foi : sans avoir la prétention d’être un musicien de l’érudition, j’ai tâché de toujours pratiquer mon activité érudite comme un gai savoir et d’y mettre toute ma peine, en soignant mon écriture et en m’y impliquant personnellement, comme si c’était une activité artistique. Ainsi ai-je repris à mon compte une expression qui figurait déjà dans le sous-titre de mon article sur Paul Aebischer (Corbellari, 2009) et dont je n’ai pas eu de scrupule à faire le titre même de la présente communication, car c’est là quelque chose que je crois profondément : si l’érudition et le travail sur la littérature ne sont pas pratiqués comme l’un des beaux-arts, nous manquons à notre devoir, car la beauté à laquelle nous attachons nos commentaires doit, dans la mesure du possible, être approchée par des moyens eux-mêmes créateurs de beauté. Le plaisir et la joie que nous éprouverons ainsi à faire notre métier – et si possible à le transmettre – est à ce prix.