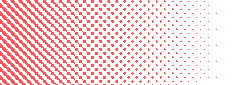Encodage et instructions de lecture dans les écrits de la Première Modernité (XVIe-XVIIIe siècles)
1« Écrire la lecture »1 : après Roland Barthes, qu’est-ce à dire ? Pour répondre à cette question, notre propos fait le choix d’emprunter des chemins de traverse. Premier pas de côté : il comprend la « lecture » non dans son sens herméneutique, comme processus interprétatif et évaluatif, mais dans sa dimension proprement diamésique, comme pratique matérielle engageant divers modes d’appropriation des supports écrits – appropriation visuelle en régime de lecture silencieux vs auditive en régime vocalisé. Deuxième pas de côté : il conçoit « l’écriture de la lecture » non pas seulement sous l’espèce des scènes de lecture – privées vs publiques – représentées dans les textes et documentées à l’envi par les historiens du livre et de la communication littéraire, mais aussi sous celle, moins travaillée, des instructions de lecture, explicites ou implicites – et, dans ce dernier cas, déductibles de la mise en texte et de la mise en page des manuscrits et imprimés – se donnant pour tâche de programmer un mode d’appropriation préférentiel (par l’œil ou par l’oreille). Troisième et dernier pas de côté : il formule enfin l’hypothèse que l’encodage, par les scripteurs et les éditeurs, des pratiques de lecture au cœur des textes ne constitue pas une préoccupation strictement contemporaine mais s’inscrit, tout au contraire, dans le temps long de l’histoire de l’écrit et de la textualité, et qu’il a connu des développements singuliers sous l’ancien régime littéraire. Cette contribution se situe dans le droit fil des travaux conduits dans le cadre du projet ANR « EcoLe » (anagramme de « s’ÉCOuter LirE »2). Si ce programme vise l’élaboration d’une grammaire des pratiques de lecture (vocales, visuelles et multimodales) qui, en France, ont coexisté et connu une intense période de co-variation entre le début du Moyen-Âge central (xiiie s.) et la fin de l’Ancien régime (xviiie s.), la présente contribution se propose, beaucoup plus modestement, d’en illustrer la pertinence et l’opérativité avec quelques exemples empruntés à la seule période de la Première Modernité (xvie-xviiie s.). Son objectif, in fine, est d’évaluer le rendement des enquêtes matérielles et historiques qui sont les siennes pour les approches qui, dans la mouvance des propositions barthésiennes originelles, se présentent comme des approches herméneutiques des scènes de lecture contemporaines.
1. Position du problème
2Dans Une faim de loup, lecture du Petit Chaperon rouge, Anne-Marie Garat apparente le conte de Perrault à un « chef-d’œuvre de l'oralité » qui, programmant sa propre vocalisation, ne saurait se lire qu’à voix haute :
[R]aconter, et lire, c’est manger. Et Perrault ne l’ignore pas, signalant dans sa Préface, que pour transmettre aux enfants les vérités solides et dénuées de tous agréments […], il faut, si cela se peut dire, les leur faire avaler… Au propre, la lecture s’accomplit en la gorge et s’ingère ; vocalisation du sens, elle est affaire de corps, ce qui en sort et ce qui y entre, double mouvement de don et d’accueil […]
Ainsi, les multiples sens de lecture passent de bouche à oreille, de la voix maternelle à la cochlée délicieuse de notre pavillon auriculaire, en ce réduit où se déposent les annonciations divines, comme les poisons shakespeariens. Tous les savants effets et les combinatoires verbales font de ce texte un rare chef-d'œuvre de l’oralité. Il chante et chantonne, enchante de sa rythmique empruntée aux comptines et formulettes, les diminutifs variés multipliant le jeu de volubilité, l’alternance des voix et du récitatif répétant en leitmotive toutes les tournures et les clés du langage. Il est un rite de passage, en son texte réglé comme portée musicale, à la note près, à la virgule près. On ne dira jamais assez qu’il faut lire Le Petit Chaperon rouge à voix haute, et surtout le dire comme on interprète un poème, avec respect, avec joueuse révérence. C’est à cette condition que, si horrible soit l’histoire, l’absorption finale qui choque les esprits tièdes se mue magiquement en son contraire, une échappée positive, la feinte dévoration apprenant à l’enfant quelle libération est la lecture. À cette condition, nous assumons de transmettre à l’enfant l’existence du Mal, au lieu de lui en épargner la nouvelle et de réparer le monde à sa place3.
3Les propos tenus par l’autrice présupposent l’existence d’une adéquation entre un certain type de textes – ceux relevant de l’opération de contage – et une certaine modalité de lecture – celle de la haute voix. Autrement dit, ils font l’hypothèse que les genres de discours, en fonction des mises en texte et des mises en page qui leur sont historiquement associées, sont dotés d’un mode d’appropriation préférentiel, par l’œil ou par l’oreille, et que le passage d’une pratique de lecture à une autre, du visuel au vocal et réciproquement, comporte toujours une part de risque, qui doit pouvoir être mesurée en termes de dénaturation vs accomplissement du sens.
4C’est aussi ce que suggère Jan Baetens dans son essai A voix haute. Poésie et lecture publique (2016), qui retrace l’histoire des mauvaises pratiques de lecture, non pas cette fois des contes de l’âge classique, mais de la poésie moderne et contemporaine : « Dans bien des cas », explique-t-il, « un poème est diminué par le saut de la page à la scène4 » notamment s’il relève d’un régime « grammatextuel » ou « bruitiste ». Baetens invite ainsi à penser la réussite vs faillite des lectures à voix haute à partir de la textualité des objets discursifs qui en constituent le corpus, et non plus (seulement) à partir des scènes socioculturelles qui les favorisent.
5La présente contribution se propose de mettre cette proposition à l’épreuve de la diachronie.
2. Méthode
6On sait, grâce aux travaux des historiens du livre5 et de la communication6, que différentes pratiques de lecture, oralisées, silencieuses, ruminées, subvocalisées, déclamées, ont coexisté en France tout au long de l’ancien régime littéraire. Pour autant, dans bien des cas, et pour bien des genres de discours, les témoignages externes manquent, et on est bien en peine de savoir comment les écrits de cette période, manuscrits ou imprimés, étaient effectivement lus. Il existe bien quelques récits de scènes de lecture, que les historiens du livre et de la communication ont d’ores et déjà identifiés, et qui permettent d’éclairer les modes d’appropriation de tel ou tel genre de discours, mais le nombre de textes, ou de types de textes dont on ne sait absolument pas comment ils étaient lus est considérable. L’objet du présent article (et, plus largement, de l’ANR EcoLe), est de reconstituer, sur la base d’indices internes, de type linguistique, typographique, et iconographique, pour chacun de ces écrits, des pratiques de lecture probables. Il s’agit ainsi d’étudier la manière dont les textes de la période ont pu encoder, via une forme de séquençage syntaxique et de structuration textuelle spécifiques, le mode d’appropriation (par l’œil, par l’oreille) auquel ils étaient préférentiellement destinés. Autrement dit, il s’agit d’étudier la manière dont ces écrits, par leur mise en texte et leur mise en page, ont pu programmer indirectement leur modalité de lecture.
7Pour parvenir à ce travail de reconstitution, relancé pour chaque nouveau témoin manuscrit et pour chaque édition nouvelle du même texte, la méthode adoptée est une méthode convoquant le principe de l’analogie. Elle repose dans un premier temps sur le repérage et la description du système de marques propre aux rares genres de discours pour lesquels le mode de lecture préférentiel (par l’œil, par l’oreille) a pu être connu, car il était explicité par des formules méta-discursives du type « lu à haute et intelligible voix », ou à l’inverse, « contemplé tout d’une vue ». Elle s’appuie dans un second temps sur la comparaison de ces systèmes de marques avec ceux des textes dont le mode d’appropriation n’a pu être documenté par les historiens du livre et de la communication, faute de témoignages externes.
2.1 Constitution de corpus vocaux, visuels et multi-modaux
8Pour l’époque prémoderne (xvie-xviiie s.), nos enquêtes préliminaires ont permis de faire émerger trois ensembles de documents écrits, en fonction de leur mode de lecture préférentiel – vocal, visuel, ou multimodal. Leurs éléments composants ont été répartis selon un principe de catégorisation graduelle : ont été regroupés, en leur centre, au sein d’un même « corpus noyau », les textes et/ou genres de discours équipés d’instructions de lecture explicites ; ont été placés en leur périphérie des textes et/ou genres de discours dépourvus de consignes de lecture manifestes, mais dont la plus ou moins grande affinité avec le régime vocal, le régime visuel ou le régime bi-vocal pouvait être inférée des connaissances d’univers (sur le contexte de production, d’énonciation et de circulation des écrits en cause). La catégorie, transitoire, de « collections flottantes » a accueilli quant à elle l’ensemble des écrits sans consignes de lecture avérées, et pour lesquels nos connaissances d’univers ne suffisaient pas à reconstituer le mode d’appropriation (par l’oreille ou par l’œil) dont ils faisaient l’objet. Soit, en figure :
9Le genre juridique des « cris », ensemble longitudinal d’actes administratifs, courant du xvie siècle au xviiie siècle, et lus en place publique par des jurés crieurs avant d’être placardés, s’est imposé comme une manifestation prototypique du corpus vocal, du fait de son dispositif textuel tout aussi routinier que spécifique, dont l’ordonnance ci-dessous offre une illustration.

Recueil factice. Registre d’affiches et publications des jurés-crieurs de la ville de Paris, vol. 7 (1692-1698), France, Châtelet de Paris, s.l.n.d.
Source : BNF Rés G-F-15 (1692-1698), Gallica
10La fin de l’acte, avant la signature du juriste et celle du greffier, consigne, au futur de l’indicatif, l’ordre de « crier » – ie de lire à voix haute – le contenu du texte de loi en place publique :
Et à ce qu’aucun n’en pretende cause d’ignorance, sera la présente Ordonnance leuë & publiée à son de Trompe et Cry public en ladite Foire saint Laurent, & affichée.
11En retour, la déposition hors-texte du juré crieur (en italiques en bas de la page), certifie, cette fois au passé composé, que l’injonction d’une lecture publique vocalisée a été respectée :
L’Ordonnance cy-dessus a esté leuë et publiée à haute & intelligible voix, à son de Trompe et Cry public, en tous les lieux & endroits accoûtuméz, par moy Marc-Antoine Pasquier, Juré Crieur Ordinaire du Roy en la Ville, Prevosté et Vicomté de Paris […] le Samedy 9 Août 1692, à ce que personne n’en prétende cause d’ignorance ; Et affichée ledit jour esdits lieux.
12Ce dispositif métadiscursif en miroir, qui fait communiquer l’horizon d’une lecture à voix haute et la certification de sa réalisation, relève de la routine discursive en ce qu’il est reconduit pour chaque acte du genre de discours considéré, pendant toute la période considérée. Il permet de corréler avec certitude un certain type de texte (en l’occurrence, celui du type, juridique, des « cris ») avec la modalité de lecture à haute voix.
13 Par différence, dans le même temps, les textes préfaciels des Dictionnaires encyclopédiques de la seconde moitié du XVIIe s. mettent en scène le caractère tout à la fois privé et visuel du mode d’appropriation des articles qui s’y trouvent. Les extraits suivants :
Préface de « L’autheur au Lecteur » : « [L]es parties les plus étendues d’icelles [les Histoires] sont resserrées et disposées par ordre, pour estre contemplées tout d’une veüe, comme en un tableau raccourcy.
[…]
Le Lecteur donc verra que j’y ai exprimé non seulement les simples mots […] Mais d’abondant j’y ai adjoint […] une entière et véritable instruction des choses. (Juigné de la Broissinière, Préface du Dictionnaire théologique, historique, poétique, cosmographique, et chronologique, 1644).
Préface : « Quelquefois, je fais de petites dissertations, pour éclaircir les difficultés de chronologie, & pour terminer les controverses historiques. Ces Dissertations sont ordinairement marquées par une main de cette façon
(Louis Moréri, Préface de Le Grand Dictionnaire historique, ou le mélange curieux de l’histoire sainte et profane, 1674).
Préface : « D’autres n’ont pas le loisir de consulter la cinquantième partie des volumes qu’ils achètent. Ceux qui en ont le loisir seraient bien fâchez de se lever à tous moments, pour aller chercher les instructions qu’on leur indique. Ils aimeraient mieux rencontrer dans le livre même qu’ils ont sous les yeux, les propres paroles des Auteurs qu’on prend pour témoins. […] Ainsi, […] j’ai fait en sorte qu’ils vissent en même tems les faits historiques, et les preuves de ces faits, avec un assortiment de discussions et de circonstances qui ne laissât à moitié chemin la curiosité. (Pierre Bayle, Préface du Dictionnaire historique et critique, 1697).
14sont de facto saturés par le champ lexical du regard (« le lecteur verra » ; les parties [...] sont […] disposées […] pour être contemplées tout d’une veüe » ; fai[re] en sorte que les [lecteurs] vissent en même tems […] » ) et ne comprennent aucune référence à celui de l’écoute. Ils adossent par ailleurs la structuration des articles à un mode de présentation iconique (la manicule de Moréri). Enfin, en rapportant la lecture des ouvrages encyclopédiques à la pratique de la « consult[ation] », terme glosé dans les dictionnaires d’époque par celui d’« examen7 » lui-même défini, dans les mêmes sources, comme le fait de « regarder attentivement8 », ils postulent que la lecture des textes encyclopédiques par les yeux – autrement dit, la lecture silencieuse – en constitue le mode d’appropriation naturel.
15La mise en page, en quatre dimensions, du Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle, dont l’image ci-dessous donne un exemple, confirme la congruence du genre encyclopédique avec la modalité de lecture visuelle et son appropriation tabulaire :
Pierre Bayle, Dictionnaire historique et critique, Rotterdam, R. Leers, 1697, T.2, 2e partie, p. 721. Source : BNF Gallica
16Typiquement, l’entrée consacrée à Marcel PALINGENIUS, qui se lit tout à la fois horizontalement – pour le corps du texte –, verticalement – pour les parties de commentaire, plus fournies que le texte lui-même, et se déployant en deux colonnes sous le texte – et latéralement – pour les manchettes et notes marginales gauches et droites –, ne se prête pas à une lecture vocalisée, tant le jeu des renvois (du texte à son commentaire, du texte aux manchettes, des deux colonnes de commentaire à ses notes marginales gauches et droites) sont incompatibles avec la trajectoire linéaire et continue de toute lecture à voix haute.
17Le troisième ensemble, multimodal, est constitué de textes se prêtant, suivant les circonstances et moyennant quelques adaptations de mise en texte et de mise en page, à différents modes d’appropriation. Son noyau est constitué de pièces de théâtre – typiquement, certaines pièces de Molière – dont on sait qu’elles ont pu faire l’objet d’une triple destination : (i) la scène, où ces pièces étaient « déclamées » ; (ii) le cabinet de travail où, comme le signale a contrario la préface de L’Amour médecin (« Tout le monde sait que les comédies sont faites pour être jouées, et je ne conseille de lire celle-ci qu’aux personnes qui ont des yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu du théâtre »), elles pouvaient faire l’objet d’une lecture silencieuse ; (iii) les salons littéraires, où elles pouvaient être lues publiquement « à haute voix », ainsi que le montre la représentation picturale de Jean François de Troy au début du xviiie siècle :
Jean François de Troy. Lecture de Molière, 1728.
Source : https://www.repro-tableaux.com/a/de-troy-jean-francois/la-lecture-de-moliere-1.html ©The Bridgeman Art Library
2.2 Système de marques
18Demeurent des ensembles de textes non assignés, dépourvus de toute instruction de lecture explicite, appartenant à des genres de discours différents (lettres privées, missives diplomatiques, gazettes, contes, fables, romans…), et dont les historiens du livre et de la lecture ont échoué à décrire, faute de témoignages, comment ils étaient lus. Tout l’enjeu des enquêtes conduites dans la présente contribution comme dans l’ANR EcoLe est de parvenir à documenter les lectures probables des éléments des collections « flottantes », par confrontation de leur architecture textuelle avec celle des écrits composant les trois corpus principaux : « vocal », « visuel » et « multimodal ».
19Le corpus vocal, illustré exemplairement par l’ensemble longitudinal des « cris » couvrant toute la période de référence, a fait apparaître certaines caractéristiques de mise en page et de mise en texte qui le distingue du corpus visuel : (i) phrases longues à l’agencement périodique ; (ii) foisonnement des éléments de liaison à l’intersection des propositions (connecteurs – tel comme aussi dans l’exemple de l’ordonnance de 1692 – ; et/& dits « de relance » après un signe de ponctuation ; adverbiaux, tel le pareillement du même texte ; jeux sur les anaphores lexicales et leurs variations – telle la suite « FAISONS défenses », « faisons défenses », « DÉFENDONS », encadrée par la formule initiale « Il est enjoint », elle-même reprise par la formule finale « ET ENJOIGNONS ») ; (iii) primat, au sein des chaînes de référence, des reprises nominales terme à terme sur les anaphores pronominales destinées à éviter les répétitions (« il est enjoint à tous Marchands » / « FAISONS défenses à tous Marchands » / « Et ENJOIGNONS aux Marchands » ; « venir à la Foire Saint Laurent » / « faire porter leurs Marchandises & Denrées en ladite Foire » / « à tous Marchands & autres frequentans ladite Foire » / « faire acheter en ladite Foire aucune Marchandises & Denrées »/ « porter en ladite Foire aucune Armes »/ « ET ENJOIGNONS aux Marchands de ladite Foire S. Laurent »/ « Les rues et le préau de ladite Foire » / « sera la présente Ordonnance leuë & publiée à son de Trompe et Cry public en ladite Foire saint Laurent » ) ; (iv) mobilisation de binômes (quasi) synonymiques venus marteler le dire et constituant les éléments du dit en référents saillants (« Marchandises et Denrées » ; « leuë et publiée » ) ; (v) mise en page compactée (sans paragraphe ni alinéa), au parcours linéaire.
20Par différence, le corpus visuel, ici illustré par le massif des dictionnaires encyclopédiques de la seconde moitié du XVIIe siècle, se signale à l’attention de son lectorat par (i) l’usage de phrases courtes, recourant préférentiellement au format « sujet, verbe complément » (telles les deux premières phrases de l’article consacré à Marcel Palingenius dans le Dictionnaire historique et critique de Bayle : « PALINGENIUS (Marcel) est connu par un poème intitulé Zodiacus vitae. Il y travailla plusieurs années, et le dédia à Hercule Est II du nom Duc de Ferrare. ») ; (ii) par l’usage de l’asyndète, couplée à une segmentation du discours priorisant sur les éléments de liaison (connecteurs, conjonctions…) les signes de ponctuation noire (virgules et points) ; (iii) par le recours, dans les chaînes de référence, aux pronoms et déterminants anaphoriques, aux dépens des reprises et répétitions nominales (« PALINGENIUS (Marcel) est connu par un poème intitulé Zodiacus vitae. Il y travailla plusieurs années, et le dédia à Hercule Est II du nom Duc de Ferrare. Quelques-uns disent qu’il fut médecin de ce Prince ») ; (iv) par la progression thématique rapide et économique, se passant des binômes synonymiques ; (v) et par la mise en page non compactée (ie, avec paragraphes et alinéas) et non linéaire, observant une architecture multidimensionnelle, tout à la fois horizontale, verticale et latérale.
21Comme ont pu le montrer les enquêtes en cours de l’ANR EcoLe, le système de marques des deux corpus visuel et vocal contraste avec celui du corpus multimodal, ne présentant pour sa part pas de spécificités remarquables du point de vue de la longueur des phrases, des types d’enchaînement, de la gestion des chaînes de référence et qui, moyennant quelques adaptations de mise en page et de ponctuation, se prête, en vertu précisément de son format non-marqué, à tous les modes d’appropriation (par l’œil et par l’oreille)9.
22La partie suivante se propose de tester l’opérativité de cette modélisation – corrélant, à la croisée des questions de mise en page et de mise en texte, un type d’architecture textuelle et une modalité de lecture préférentielle – pour l’identification des pratiques de lecture probables d’une collection « flottante » longitudinale, remarquable par l’ampleur de ses développements diamésique, diatopique, diastratique et diachronique : celle des différentes versions, manuscrite et imprimées, des contes (en prose) de Perrault, dont on ignore, faute de témoignages externes, comment ils étaient effectivement lus.
3. Étude de cas : « Écrire la lecture » du Petit Chaperon rouge aux xviie et xviiie siècles
23 Nous ne reviendrons pas ici sur le détail des très nombreuses versions, manuscrites et imprimées, savantes ou non, de ces contes – dont la recension, à ce jour, n’est au demeurant pas encore achevée10. Sans documenter ces éléments de bibliographie matérielle, nous voudrions montrer, à partir de la sélection de quelques cas choisis pour leur représentativité, que le corpus longitudinal des Contes de Perrault ne se conforme que partiellement à l’hypothèse de lecture d’Anne-Marie Garat et à son injonction de haute voix. Ce dernier fait en effet émerger, tout au long de la période prémoderne, un système de marques proche du prototype multimodal, quand les éditions de la fin des xviiie, des xixe, xxe et xxie siècles, savantes ou non, en appellent toutes à un format de mise en page et de mise en texte programmant, de manière stable, un type de lecture spécifiquement visuel. Afin de dialoguer avec Anne-Marie Garat, nous travaillerons sur « Le Petit Chaperon rouge », en ne priorisant, faute de place, que deux entrées – l’entrée typo-orthographique et l’entrée de la ponctuation –, afin de documenter les variations observées et ce qu’elles nous disent des pratiques de lectures visées.
24 Le corpus analysé dans le cadre de cette contribution comprend six versions : (i) celle du manuscrit d’apparat, manuscrit allographe et prestigieux, destiné à Elisabeth-Charlotte d’Orléans, la nièce du roi Louis XIV, alors âgée de 19 ans (1695) ; (ii) celle de l’édition princeps, édition savante très soignée, ayant connu deux états, de l’éditeur parisien Claude Barbin (1697, 1er et 2e état) ; (iii) celle d’une édition hollandaise du tout début du xviiie siècle, parue à Amsterdam sous l’enseigne de Jacques Desbordes, enseigne de petit renom, souvent utilisée pour des éditions pirates, et aux affaires peu florissantes (1708) ; (iv) et (v) celles de deux éditions parisiennes de la fin du siècle. L’une est savante, elle est dotée d’un texte préfaciel de seize pages, et elle est intitulée Le Cabinet des fées. Elle réunit les contes en vers et en prose de Perrault, un conte de Marie-Jeanne L’Héritier, attribué au xviiie siècle à Perrault, et les contes de la comtesse de Murat ; elle est parue à Paris sous l’enseigne de l’hôtel de Serpente en 1785. L’autre est une édition grand public, pour enfants. Elle constitue un pot-pourri de contes de Perrault, de Madame le Prince de Beaumont et de Madame d’Aulnoy. Cette édition illustrée, en date de 1800, parue à Paris chez le libraire-éditeur Gustave Barbat, porte le titre de Le Cabinet des fées. Nouveau livre des enfants. Elle fait partie de la collection du « Panthéon populaire des chefs-d’œuvre illustrés de la littérature ». A quoi s’ajoute (vi) une édition de colportage, destinée aux peu lettrés, sans date, mais avec une reliure du xviiie siècle, parue à Orléans chez Letourmy entre 1774 et 1812.
25Cet ensemble tout à la fois limité11 et hétérogène, mais qui donne un premier aperçu de la diversité des publics et des usages auxquels étaient destinés les Contes de Perrault, est significatif au sens où il permet d’aborder la question de la variation des pratiques de lecture sous plusieurs dimensions : la dimension, diamésique, des supports (manuscrit vs imprimé) ; la dimension, diatopique, des lieux éditoriaux (France vs Pays-Bas ; Paris vs Province) ; la dimension, diastratique, des publics visés (savants vs peu lettrés ; adultes vs enfants) ; la dimension diachronique enfin. C’est par elle que nous commencerons.
3.1 Variation diachronique. Stabilisation d’un format visuel à la fin du xviiie siècle
26À la fin du xviiie siècle, le format visuel approprié à une lecture par les yeux, et donc, à une lecture silencieuse, est uniformément mobilisé, quel que soit le lieu éditorial (Paris vs Province), le degré d’éducation du public visé (public savant vs grand public vs public peu lettré), ou encore sa classe d’âge (public adulte vs jeune public). En attestent la mise en page et la mise en texte des trois éditions retenues, toutes postérieures à 1775, et dont nous reproduisons ici un même extrait :
[…] Le Loup ne fut pas long-
tems à arriver à la maifon de la mère grand’ ;
il heurte, toc, toc. — Qui eſt-là? — C’eſt votre
fille le petit Chaperon rouge, dit le Loup en
contrefaiſant ſa voix, qui vous apporte une ga-
lette & un petit pot de beure que ma mère vous
envoie. (« Le petit Chaperon rouge », Le Nouveau Cabinet des fées, Édition de Paris, rue Serpente, 1785, p. 2)
[…] Le Loup ne fut pas longtemps à arriver à la maifon de la mère-
grand ; il heurte : toc, toc .
— Qui eſt-là?
— C’eſt votre fille le petit Chaperon rouge, dit le Loup en contre-
faiſant ſa voix, qui vous apporte une galette & un petit pot de beure
que ma mère vous envoie. (« Le petit Chaperon rouge », Le Cabinet des fées. Nouveau livre des enfants, Paris, Gustave Barba, 1800, p. 69)
Le Loup ne fut
pas long-tems à arriver à la maifon de la
Mere-grand ; il heurte : Toc, toc, qui
eſt-là ? C’eſt votre fille, le petit Chape-
ron rouge, dit le Loup en contrefaiſant
ſa voix, qui vous apporte une galette &
un petit pot de beure que ma Mere vous
envoie. (« Le petit Chaperon rouge », Contes de Perrault, Orléans, Letourmy, entre 1774 et 1812, p. 76)
27Le dispositif éditorial de ces trois extraits appelle plusieurs observations.
28Premier commentaire : la séparation du récit et du discours rapporté est visuellement consommée par un signe de ponctuation fort, placé avant ou après l’onomatopée « toc, toc », de statut amphibie, suivant qu’on considère qu’il s’agit d’un élément du récit ou d’un élément du discours. Dans les éditions de 1785 et 1800, ce signe est placé après l’onomatopée « toc, toc ». Il s’agit du point. Dans l’édition peu lettrée de colportage (édition Letourmy, sans date), il est placé avant l’onomatopée. Il s’agit des deux points. Mais partout, il y a bien une segmentation visuelle du texte permettant d’articuler récit et dialogue.
29Deuxième commentaire : les tours de parole dans le dialogue sont visuellement indiqués, d’une part par le jeu des majuscules chez Letourmy, qui indique moins le passage d’une phrase à une autre que la succession des répliques ; d’autre part par l’emploi de tirets cadratins, accompagnés ou non d’un retour à la ligne, dans les éditions savantes ou grand public de 1785 et 1800, à destination des adultes pour la première et des parents d’enfants pour la seconde.
30Troisième commentaire : dans le discours rapporté semi-direct du loup, dans les trois cas, on a une division visuelle du discours citant et du discours cité par les deux virgules qui encadrent l’incise « dit le Loup ».
31Dernière observation : l’orthographe lexicale n’est certes pas encore stabilisée comme le montre la variation graphique à laquelle donne lieu l’adverbe « longtemps » (qui présente une soudure des éléments composants et une lettre quiescente « p » dans l’édition de 1800, réunit ses éléments composants par un trait d’union et se passe encore de la lettre quiescente « p » dans l’édition de 1785 et dans l’édition Letourmy de la bibliothèque bleue). Pour autant, dans chacune des trois éditions, à un autre endroit, l’accent diacritique sur le « à » prépositionnel est systématique. Or, la différence entre la forme verbale sans accent et la forme prépositionnelle accentuée ne s’entend pas à l’oral. Il s’agit d’un dispositif visuel, encodant un mode de consommation du texte par les yeux. De ce point de vue, les trois éditions semblent avoir intégré le principe d’une appropriation silencieuse des Contes de Perrault. Les procédés de visualisation du conte sont certes plus avancés dans les deux éditions parisiennes, dédiées à un public lettré, que dans l’édition de la bibliothèque bleue. Pour autant, la différence – en l’occurrence, la présence vs absence d’un tiret cadratin à l’orée des tours de parole, tout comme la présence vs absence d’un signe de ponctuation fort pour démarquer récit et discours – est une différence non de nature, mais de degré.
32Inversement, les versions de la fin du xviie siècle et du début du xviiie siècle présentent des formes d’encodage beaucoup plus diversifiées.
3.2 Variations diamésique et diatrastique dans les mises en page et mises en texte au tournant des xviie et xviiie siècles
33Les trois versions sélectionnées orientent de facto la lecture matérielle du Petit chaperon rouge dans trois directions distinctes.
3.2.1 Le manuscrit d’apparat : une lecture empathique, alternative (localement silencieuse, localement vocalisée)
34 Dans le manuscrit d’apparat, le même extrait se présente comme suit :
Le Loup ne
fut pas longtemps a arri-
ver a la maifon de la mere
[saut de page]
grand. Il heurta a sa porte,
toc toc qui est là ? c’eſt votre
fille le petit chaperon rouge
dit le Loup en contrefaiſant
ſa voix qui vous apporte une
galette & un petit pot de beure
que ma Mere vous envoye.


Manuscrit d’apparat, Contes de ma Mere L’Oye, 1695, MA 1505 fol 28 verso – MA 1505 fol. 29
Source : The Morgan Library
35Il appert que la gestion du dialogue, ici, est sensiblement différente de celle du récit. Les répliques de la Mère-grand et du Loup sont dites d’une seule émission de voix : il n’y a pas de signes de ponctuation ni de majuscules séparant les tours de parole. De la même manière, l’incise de discours rapporté semi-direct n’est pas séparée du discours cité qu’elle régit par un signe, visuel, de ponctuation noire. C’est la ponctuation blanche, en l’occurrence, le passage à la ligne, impliquant une suspension physique de la voix, qui permet de distinguer les segments de discours cité du segment de discours citant. Nous formulerons l’hypothèse que l’invisibilisation des tours de parole et l’estompage des frontières du discours cité et du discours citant sont adéquats avec la pratique de lecture à voix haute, venue lisser les décrochages énonciatifs par l’unicité de la voix du conteur. Cette proposition semble au demeurant être validée par une note marginale, a priori de la même main que celle du copiste, qui apparaît à la toute fin de la version manuscrite du Conte. Constituant un commentaire de la dernière réplique du Loup – « c’est pour te manger » – dans le dialogue amébée final, elle invite le lecteur à « prononce[r] ces mots d’une voix forte pour faire peur à l’enfant comme si le loup l’alloit manger ». Exploité à l’envi par la critique folkloriste, voyant dans cette note la trace du rattachement des contes de Perrault non à une origine littéraire, mais bien à une tradition orale, ce commentaire, qui constitue un hapax dans le manuscrit d’apparat, et que les versions imprimées ultérieures ne reconduiront pas, a pu, à l’inverse, être compris comme un montage, un trompe-l’œil qui, à l’image du frontispice mettant en scène « ma Mere l’Oye », sous l’espèce du personnage de la nourrice conteuse, avait vocation à construire de toute pièce, de manière savante et concertée, une fiction d’oralité, rapportant l’opération de contage perraldienne à ce qu’elle était : un produit de l’art.
36Les tout récents développements de l’imagerie cérébrale nous inviteront peut-être à reprendre à nouveaux frais la documentation de cette note marginale. Deux études de neuroscience, respectivement de 2011 et de 2012, ont montré en effet que les TVA – the Temporal Voice Selective Areas –, autrement dit et beaucoup plus trivialement, les zones auditives de notre cerveau, s’activaient toujours en régime de lecture silencieuse, mais avec une intensité beaucoup plus soutenue « lorsque les participants lisent du discours direct12 ». Ce faisant, on pourrait formuler l’hypothèse que l’instruction, donnée dans la note marginale du manuscrit, de lire à « voix forte » la dernière réplique du Loup relaye par anticipation, avant même l’imagerie cérébrale, ce mécanisme d’activation de la zone vocalique du cerveau, en proposant d’en transformer la matière mentale en matière sensible, via un usage – en l’occurrence le plus énergique possible – de la voix projetée. À défaut, et quelque importance et interprétation qu’on confère à cette note, il apparaît, plus globalement, que dans le manuscrit d’apparat, la mise en texte des discours rapportés programme – tout du moins, va dans le sens de – leur appropriation vocale.
37La facture des segments proprement narratifs du conte est bien différente. Chaque proposition, chaque action, est séparée de la précédente et de la suivante par un signe de ponctuation noire, manifestant visuellement la succession des procès, et marquant pour l’œil les étapes de la progression textuelle. Dans l’extrait proposé ci-dessus, par exemple, l’arrivée du Loup et le heurt de la porte sont séparés par un point.
38Ce mode d’appropriation alternatif, visuel pour les passage narratifs, vocal pour les passages de discours rapporté, peut se comprendre comme une pratique de lecture empathique, pariant sur l’identification du lecteur avec les personnages et impliquant que celui-là (le lecteur) se mette à parler quand ceux-ci (les personnages) parlent.
39L’édition princeps procède d’une logique très différente, encodant un mode de lecture silencieux.
3.2.2 L’édition princeps : vers une lecture objectivée, silencieuse
40Dans les deux états de la version imprimée, l’instruction de lecture vocalisante accompagnant, dans le manuscrit, la réplique « c’est pour te manger », a été supprimée. Et dans le second état, pour l’extrait du « Toc, toc », que nous reconduisons ci-dessous, émerge une nouveauté.

Charles Perrault, Édition princeps. « Le Petit Chaperon rouge », Histoires ou contes du temps passé. Avec des moralitez. Paris, Claude Barbin, 1697, 2e état, p. 51. Source : NUBIS
41Avant d’en venir à cette dernière, qui concerne le discours rapporté, remarquons en préambule que le passage narratif obéit toujours à une logique visuelle plus ou moins marquée. Là encore, chaque proposition, chaque action, est séparée de la précédente et de la suivante par un signe de ponctuation noire, même si, en l’occurrence, le point du manuscrit séparant l’arrivée du Loup et le heurt de la porte a cédé le pas à une virgule, sans doute pour signaler visuellement la rapidité des actions, leur quasi-concomitance. Le changement de marque typographique concourt ici à l’accélération du rythme, tout en continuant de satisfaire une logique visuelle. La différence majeure tient à la mise en texte du dialogue, dont on ne commentera qu’un trait : l’apparition de parenthèses, venues segmenter pour l’œil l’insertion de l’incise du discours citant (« dit le Loup ») dans le discours cité. La logique visuelle du segment narratif s’est ainsi généralisée et étendue au segment de discours. Ce faisant, la pratique d’une lecture empathique, ponctuellement vocale, a cédé le pas à une pratique objectivée, où le lecteur ne prend plus physiquement part aux propos des personnages, selon un mécanisme choral, mais assiste, en spectateur, à leurs prises de parole et à leurs débats.
3.2.3 L’édition néerlandaise de 1708 : une lecture subjective, entièrement vocalisée
42L’édition parue à Amsterdam sous l’enseigne de Jacques Desbordes en 1708 est une édition fort peu soignée, pleine de coquilles, dont le système ortho-typographique, contrairement à celui du manuscrit et des deux états de l’édition princeps, est par excellence non standard : très nombreux sont les phénomènes d’agglutination, de sur-segmentation, les fautes d’accord, la confusion des homonymes. On ne saurait sans doute s’en émouvoir, tant la période est placée sous le signe des « incertitudes du mot graphique13 ». Pour autant, ce qui ne laisse pas d’étonner, c’est que, dans l’édition de 1708, ces formes non standard semblent avoir fait l’objet d’un tri sélectif – inconscient ou concerté, cela, on ne saurait statuer : dans le très vaste éventail des possibilités de sur-segmentation, de sous-segmentation, de variation ortho-typographique documentées entre autres pour toute la période par Jean-Pierre Seguin14 et Jean-Christophe Pellat15, ne sont retenues, à l’exclusion de toutes les autres, que celles qui ne s’entendent pas à l’oreille, et ne sont donc identifiables qu’à l’œil. Sur l’ensemble du recueil, on relèvera, parmi autres, les agglutinations « aboire » (Les Fées), « dequoi » (Cendrillon), « nesçauroit » (Riquet à la Houppe), « quai-je fait » (Le Petit Poucet) ; la sur-segmentation « ayant considéré qu’elle [quelle] douleur » (Le Petit Poucet) ; les homophones ou quasi homophones grammaticaux « les petits garçons s’étoit [s’étoient] cachés » (Le Petit Poucet), « lors qu’elle ne croyoit pas qui [qu’il] ſut encore onze heures » (Cendrillon), « portes [porte] luy une galette » (Le Petit Chaperon rouge) ; ou encore, les homophones lexicaux « la au [là-haut] » (La Barbe bleue), « mettre en ligne de conte [compte] » (Le Petit Poucet), toutes et tous inaudibles mais visibles. Cette pratique sélective des usages non standard, neutralisée à l’oral, laisse à penser que l’ouvrier imprimeur de l’édition néerlandaise s’était approprié les Contes de Perrault par l’oreille, et non par l’œil.
43 Mais revenons à notre Loup et à son « toc, toc ». L’édition de 1708 en propose la mise en texte et mise en page suivante :

[Charles Perrault], « Le Petit Chaperon rouge », Histoires ou Contes du tems passé. Avec des moralitez. Par le fils de Monsieur Perreault de l’Academie François, Amsterdam, Jacques Desbordes, 1708, p. 38. Source : bibliothèque de Mannheim, Mf f 820
44La lettre quiescente « p » pour l’adverbe « long-temps », lettre pour l’œil, figurant dans le manuscrit d’apparat et dans les deux états de l’édition princeps, a disparu (« long-tems ») ; et les parenthèses, qui constituaient une signalisation purement visuelle de l’incise au sein du discours rapporté, ont été remplacées par des virgules, signes de démarcation pour l’œil mais aussi pour l’oreille, au sens où elles peuvent instruire une reprise de souffle. Ce faisant, la logique de ces modifications va dans le sens d’une lecture impliquée, vocalisée, d’une lecture subjective somme toute, au sens où le sujet lecteur participe physiquement en oralisant le conte à l’opération de contage.
4. Pour conclure : matérialité de la lecture et interprétation
45Exception faite de la note marginale du manuscrit d’apparat à la fin du petit Chaperon rouge, qui ne porte que sur le mode d’appropriation des dialogues, les témoignages externes sur la manière dont on pouvait lire les Contes de Perrault sous l’ancien régime sont inexistants. Pour autant, se dessinent, en creux, à travers les dispositifs de mise en page et de mise en texte des différentes versions, des scènes de lecture variées, rejouées à chaque nouveau témoin, et dont l’identification est cruciale pour la compréhension du texte.
46Le projet EcoLe, dans la mouvance duquel s’inscrit cette contribution, formule à ce sujet l’hypothèse d’un lien entre l’adaptation des pratiques de lectures (par l’œil vs par l’oreille) aux formats textuels dédiés, et l’intelligence (littérale et interprétative) du texte par le lecteur, au moment où celui-ci découvre celui-là en le lisant. Compte tenu de leur mise en page et de leur mise en texte, certains documents écrits ou certaines versions du même document se comprendraient mieux en régime de lecture à voix haute, et d’autres en lecture silencieuse. Le programme de recherche EcoLe comprend au demeurant un volet expérimental, conduit à Lille par une équipe de psycholinguistes spécialistes de la lecture, dont l’objectif est de tester, sur des corpus anciens, modernisés pour les besoins de la cause, la corrélation entre formats textuels, modalités de lecture et degré de compréhension16. Cette question est de toute importance à l’heure où, en plein présentisme et accélération du temps, l’on redécouvre le rendement de la lecture à haute voix, ie de la lecture lente, dans différents milieux : le milieu scolaire tout d’abord, dont les instructions ministérielles recommandent, depuis 1992, d’« augmenter le temps dévolu à la lecture à voix haute », en raison, notamment, de son bénéfice pour la mémorisation ; le milieu paramédical (orthophonie), où différents travaux ont montré les « effets positifs » de la lecture à voix haute sur diverses pathologies, dont la dyslexie17 ; le milieu culturel enfin, où se multiplient les lectures à voix haute, au théâtre et dans les tiers-lieux18. Encore faudrait-il que les textes donnés à lire et à entendre présentent un format textuel qui s’y prête. À ce compte, le rôle que peuvent jouer – ou non – les différents types de mise en page et de mise en texte dans le succès vs insuccès du passage d’une pratique de lecture à une autre constitue aujourd’hui un enjeu sociétal. Et la question du mode d’appropriation des textes (par l’œil vs par l’oreille) est devenue une question suffisamment « actuelle » pour que les écrivaines et écrivains contemporains en fasse la matière de leurs propres scènes de lecture. Nous laisserons le dernier mot à Maylis de Kerangal, ou plutôt, à la narratrice de Canoës, racontant qu’elle a été invitée par un studio d’enregistrement, celui des sœurs Klang, à faire la lecture à haute voix d’un poème qu’elle ne connaît pas, et qu’elle découvre « en le lisant » :
J’ai appelé la veille de l’enregistrement pour demander à recevoir le texte, afin de le préparer un peu, de repérer les zones instables, les trous, les prises de vitesse possibles, l’une ou l’autre des Klang m’a remise à ma place : vous le découvrirez en le lisant, vous vous ferez surprendre, c’est la seule façon d’entrer en rapport avec ce matériau vivant qu’est la langue. Sur le coup, j’avais trouvé cela génial – une parole d’artiste, une vraie. Mais les premiers vers et le balayage visuel des feuilles sur la table du studio m’ont déstabilisée. Le Corbeau d’Edgar Poe. Jamais lu ce truc. Dix-huit Strophes. C’est Baudelaire qui a traduit.
[Puis…] Je me suis dit : elles veulent le texte d’un bloc, un plan-séquence vocal, pur, sans montage, c’est ta voix qu’elles ont choisie et elles ont tout leur temps.
[…] J’ai lu dans un souffle, somnambulique et parfaitement orientée, comme si je courais au-devant du poème, et bientôt, l’écholalie déréglant le langage, j’ai lu comme si j’avais peur, une peur archaïque, issue de cet âge des cavernes où s’était formée l’oreille humaine19.