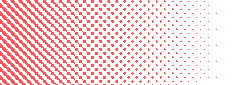Vers un déminage éditorial rétrospectif ?
1L’écrivain Kevin Lambert, récipiendaire du Prix Médicis 2023 pour son roman Que notre joie demeure, est souvent celui par lequel la polémique arrive au Québec, ou disons plus précisément le débat sur des questions divisant la société. La dernière en date de ces controverses passe par la France : deux jours après avoir été retenu dans la première liste du prix Goncourt, Kevin Lambert est vivement critiqué sur Instagram par l’écrivain Nicolas Mathieu (lauréat du Goncourt en 2018) pour avoir fait appel à une éditrice d’origine haïtienne dans le processus de relecture de son roman, « tout en disant que ceux qui s’opposent au recours à des lecteurs sensibles (sensitivity readers) étaient réactionnaires » (Maalouf, 2023).
2À vrai dire, la relation de travail entre Kevin Lambert et la poétesse et professeure de littérature Chloé Savoie-Bernard ressemble davantage à une consultation respectueuse et amicale, c’est-à-dire à une collaboration éditoriale, qu’à quelque processus confinant à la censure ou l’autocensure (Develey, 2023b)1. Il n’empêche que le débat sur les lecteurs sensibles, les sensivity readers, que nous appellerons démineurs éditoriaux, refaisait surface en contexte québécois quelques mois après que l’opinion publique eut été occupée par une série de nouvelles éditoriales en provenance du Royaume-Uni : les romans d’Agatha Christie, de Roald Dahl, de P. G. Wodehouse et, surtout, d’Ian Fleming (Atkinson, 2023)2, en voie de réédition, étaient allégés de certains termes pouvant être jugés blessants par des lecteurs contemporains (Develey, 2023a). À ces rares nouvelles sur le monde de la réédition entretenant la rumeur médiatique s’ajoutaient des dépêches relatives au retrait d’ouvrages jugés offensants dans diverses bibliothèques canadiennes, publiques et scolaires (Brockbank & King, 2023).
3Pour des raisons qui deviendront ci-dessous explicites, le public québécois est depuis l’automne 2020 particulièrement sensible aux questions relatives à la liberté d’expression et plus particulièrement à la liberté universitaire, sans qu’un consensus véritable, transcendant les lignes de démarcation politiques, n’émerge autour de certains dissensus : la liberté académique (menacée, voire morte selon certains, bien portante selon d’autres), la culture du bannissement (triomphante selon les uns, grandement exagérée selon les autres), le « déminage éditorial » enfin (procédant de la censure selon les uns, mais pour les autres du simple bon sens). Deux « affaires universitaires » ont en effet occupé un vaste espace médiatique ces dernières années au Québec, l’une venant de l’Université d’Ottawa (affaire dont je dois préciser d’emblée que je suis partie prenante), l’autre de l’Université McGill. Ces controverses ont le potentiel de bouleverser les études littéraires (entre autres domaines) d’une manière que je tenterai de préciser en me concentrant sur le xixe siècle dans la dernière partie de cet article.
L’Affaire Verushka Lieutenant-Duval
4De mémoire d’homme, jamais n’avait-il été autant question d’affaires universitaires dans le discours social québécois qu’au cours des années 2020 et 2021, et l’université qui a principalement alimenté cette rumeur se situe hors Québec : l’Université d’Ottawa, cette université bilingue où je fais carrière depuis 2005. Voici en quelques mots les tenants et aboutissants de ce qu’il convient désormais d’appeler l’« Affaire Verushka Lieutenant-Duval3 », du nom de cette professeure à temps partiel qui, en septembre 2020, a prononcé dans un cours d’histoire de l’art, dans le cadre d’une contextualisation historico-théorique de la théorie queer et de la resignification subversive, ce que nous serions désormais tenus d’appeler le « mot en N », à savoir le mot nègre (ou, dans le cas précis qui nous occupe, le mot nigger, car le cours était enseigné en anglais4). Il s’en est suivi la plainte d’une étudiante (une seule plainte), une déclaration immédiate du doyen de la Faculté des arts affirmant, sans doute sous l’effet de la panique, que le langage utilisé en cours était « inapproprié, offensant et tout à fait inacceptable dans les salles de classe de l’Université », la création d’une seconde section du cours dans lequel on transférait tous les membres de son groupe (les invitant à se signaler s’ils désiraient demeurer dans le groupe d’origine), l’humiliation publique et répétée de la professeure par le rectorat de l’Université d’Ottawa, cadrant résolument l’événement comme raciste et affirmant au passage dans un communiqué à la communauté universitaire qui sera repris dans tous les médias, en date du 19 octobre 2020 : « Les membres des groupes dominants n’ont tout simplement pas la légitimité pour décider ce qui constitue une micro-agression » (Fremont, 2020).
5Verushka Lieutenant-Duval serait demeurée une victime anonyme de la culture du bannissement, ou de l’annulation, n’eût été de la journaliste Isabelle Hachey, qui, alertée par un étudiant du groupe, a fait la lumière sur les événements dans une chronique écrite deux semaines après coup (Hachey, 2020). Le lendemain de cette chronique, 34 professeurs de l’Université d’Ottawa signaient une lettre d’appui à leur collègue qui avait aussi pour but de prévenir de nouveaux dérapages.
6Je suis donc l’un des 34 signataires de la lettre Libertés surveillées, dite « Lettre des 34 », envoyée aux médias le lendemain de la publication de la première chronique d’Isabelle Hachey (lettre publiée dans Le Journal de Montréal le 16 octobre et dans Le Droit, le quotidien francophone d’Ottawa-Gatineau, le 17 octobre 2020). Depuis lors, ma carrière et mon implication à l’Université d’Ottawa ont pris une orientation imprévue. J’ignorais effectivement qu’avec cette lettre inclusive, ne contenant aucune idée originale, s’ouvrant et se terminant par des appels à l’antiracisme, je signais mon entrée dans le rang des « suprémacistes blancs ».
7Dès la publication de la lettre, le caucus BIPOC (« Black, Indigenous, People of Color ») et le contingent le plus militant des associations étudiantes se mettent en branle, lancent des pétitions contre Verushka Lieutenant-Duval et contre nous tous (exigeant notre « rééducation » sinon notre renvoi). Ces pétitions ont été signées par des milliers de personnes (plus de 15 000...) et sont toujours en ligne au moment d’écrire ces lignes. Le coup le plus dur – et en fait le plus affolant – est porté par quatre collègues du Département d’études sociologiques et anthropologiques qui, prétendant parler au nom de l’Université d’Ottawa, lancent elles aussi une charge, affublée du logo officiel de l’université. Pour la première fois (je n’avais encore jamais entendu parler de Robin DiAngelo et de critical race theory à la mi-octobre 2020), nous nous voyons associés au « suprémacisme blanc » (pour un survol plus complet de l’affaire, voir Gilbert, Prévost & Tellier, 20225). Avec un peu de recul, tout cela paraît quasi amusant, tant le trait est forcé – Verushka Lieutenant-Duval, pour commencer, étant « aussi raciste que Camille Desmoulins était contre révolutionnaire », pour citer ma collègue et cosignataire Geneviève Boucher (Boucher & Prévost, 2022, p. 151). Mais comme des collègues prétendant représenter « the University of Ottawa » m’ont assigné le rôle du raciste, je crains désormais que mon enseignement soit interrompu par une (infime) minorité d’étudiants qui s’indigneront de ce que j’ose parler d’Alexandre Dumas, voire de ce que j’enseigne n’importe quel texte dans lequel apparaîtrait le mot nègre, le mot Indien, le mot sauvage – d’ailleurs certains s’enrageront du fait que j’aie osé écrire ces mots ici. Si la chasse aux sorcières, actuellement en période de latence, reprenait de plus belle, la haute administration de mon université refuserait très certainement de prendre ma défense. Comme l’a écrit notre recteur dans son communiqué du 19 octobre 2020 :
D’aucuns ont, dans ce contexte, expliqué que l’enseignante en question a offert de discuter de la question de l’utilisation du mot commençant par -n dans un cours subséquent. Cela fait partie de sa liberté académique et il lui sera loisible de le faire. Mais qu’on ne soit pas surpris que plusieurs de ses étudiants n’aient tout simplement pas envie, surtout dans la lancée du mouvement Black Lives Matter (BLM), d’avoir encore une fois à se justifier pour que leur droit à la dignité soit respecté. Lors de l’incident, l’enseignante avait tout à fait le choix, dans ses propos, d’utiliser ou non le mot commençant par -n ; elle a choisi de le faire avec les conséquences que l’on sait.
Du côté de l’Université McGill
8En parfaite synchronicité avec les événements résumés ci-dessus, l’Université McGill vivait une période de turbulence moins publique, mais dont les implications, majeures pour l’enseignement de la littérature, coïncidaient en tous points avec les craintes qui m’avaient mené à écrire l’ainsi nommée « Lettre des 34 ». Les données initiales sont semblables ; une professeure à temps partiel (on dit au Québec une « chargée de cours ») enseignant en distanciel un cours d’histoire de la littérature québécoise se fait arrêter en plein vol par une étudiante lors de l’analyse de la première œuvre au programme, le roman Forestiers et voyageurs publié par Joseph-Charles Taché en 1864 (nous reviendrons ci-dessous sur ce titre). Cette étudiante offusquée (elle portera plainte avec une camarade) remarque l’utilisation du mot honni à la page 99 du livre, dans cet extrait : « Le premier passage que nous fîmes ensemble dans les bois dura presque trois mois, pendant lesquels nous avions travaillé comme des nègres ». Forestiers et voyageurs est un récit de caractère ethnologique avant la lettre décrivant la vie des bûcherons, des chasseurs et des coureurs de bois canadiens du xixe siècle. Dans le contexte de cette œuvre et de cette époque, la phrase reproduite ci-dessus signifie ni plus ni moins « nous avions travaillé comme des esclaves ». Mais continuons. Dans un premier temps, la chargée de cours (qui tout au long de la couverture médiatique de l’événement et ses suites demeurera anonyme, pour éviter de devenir la nouvelle Verushka Lieutenant-Duval) ne comprend pas ce qui ameute l’étudiante, puis trouve le mot sur la dernière ligne de la page : elle lit alors la phrase à voix haute. Scandale ; toutes les caméras étudiantes s’éteignent une à une. Cours terminé. Une plainte est déposée contre elle (laquelle plainte portera aussi sur la présence dans les œuvres étudiées du « mot en S » : « sauvages », pour désigner les membres de ce que nous appelons aujourd’hui les Premières Nations et peuples autochtones).
9Dans les jours qui suivront, le vice-doyen en charge du dossier lui conseillera de multiplier les « traumavertissements » (les triggers warnings) pour prévenir les étudiants des chocs auxquels ils seront exposés, mais aussi « de leur offrir de sauter des pages, voire de ne pas lire des œuvres entières » : « Ne pas prononcer le mot, d’abord. Ne pas le faire lire. Prévenir les étudiants. Caviarder les PowerPoints. Les censurer. Enfin, recommander une non-lecture de l’œuvre sur laquelle ils devraient être évalués » (Hachey, 2021a)6. Précisons, pour la petite histoire, que les plaignantes se sont finalement désinscrites du cours, pour lequel elles ont été non seulement remboursées, mais encore créditées, bien qu’elles n’aient remis que le premier travail de la session (Hachey, 2021b)7.
10Les deux professeurs du Département des langues de littérature française, de traduction et de création de l’Université McGill qui ont porté l’affaire à l’attention des médias, la médiéviste Isabelle Arseneau et le dix-neuviémiste Arnaud Bernadet, ont, dans leurs propres interventions, mis l’accent sur l’essentielle distinction entre « mot en usage » et « mot en mention » : « Non, Verushka Lieutenant-Duval n’a jamais utilisé le mot “nègre”, elle en a fait mention pour décrire l’histoire de ses usages, ce qui est complètement différent. Ignorer ce qu’est une citation discursive entraîne de très graves conséquences, à la fois épistémologiques, éthiques et institutionnelles » (Arseneau & Bernadet, 2020). Je suis personnellement persuadé que si l’université cesse d’opérer une distinction entre mot en usage et mot en mention, elle ouvre grand la porte à la non-pensée et perd sa raison d’être. Or, rappeler cette distinction entre usage et mention, de même que quelque forme d’appel à l’historicité linguistique que ce soit, participerait désormais de la micro-agression. On voit comment ces inquiétudes sont intimement liées à l’enseignement de la littérature, notamment celle du xixe siècle.
11Notons au passage que ces affaires simultanées ont fait un tel bruit au Québec (mais pas au Canada anglais) que le gouvernement provincial s’est cru le devoir d’agir : « L’indignation face à l’Affaire Lieutenant-Duval a été si grande, la colère si unanime, que le gouvernement de la CAQ [Coalition Avenir Québec] a mis sur pied une commission sur la liberté académique, afin d’éviter qu’une telle dérive ne se produise au Québec » (Bédard, 2022-23, p. 1048). Cette commission, dite commission Cloutier du nom de son président, a donné lieu à un rapport9 qui mènera le gouvernement du Québec à adopter, en juin 2022, le projet de loi No 32 « en matière de protection de liberté académique universitaire et de lutte contre l’autocensure ». On notera toutefois que cette loi n’a été d’aucun secours au professeur Patrick Provost, ce professeur titulaire au Département de microbiologie-infectiologie et d’immunologie de l’Université Laval s’étant prononcé en défaveur de l’injection contre la Covid-19 chez les mineurs. Son cas est étonnant, puisque ses recherches portent sur les maladies infectieuses et immunitaires, les nanoparticules lipidiques et l’ARN messager, ce qui signifie que sa parole procède tout à fait de son champ de compétence professionnelle. Il subit pourtant des suspensions répétées et se voit privé de plus de six mois de salaire, avant d’être finalement congédié par l’Université Laval au printemps 2024 (Prévost, 2024). Quelques voix ont exprimé leur indignation face à cette affaire, mais, ayant été partie prenante de l’affaire Verushka Lieutenant-Duval, je n’ai pu qu’être frappé par le peu de résonance du cas Provost dans notre société : les médias et le public s’y sont peu intéressés (outre le réseau indépendant Libre Média ; voir Blanchet-Gravel, 2023). Est-ce que les appels à la liberté universitaire seraient à géométrie variable ?
12Mais revenons à la littérature. Plusieurs livres, sinon la majorité des livres (voire, au fil des ajouts à la liste noire sémantique, la totalité d’entre eux) constituent aux yeux de certains un scandale par leur seule existence, ou même par leur seul titre. C’est le cas de deux monuments de la littérature québécoise qu’évoquait la « Lettre des 34 », désormais condamnés à tomber dans les oubliettes de l’enseignement :
Prenons l’exemple de Pierre Vallières, peut-être le plus inclusif des intellectuels indépendantistes avec Gérald Godin. Si ce grand essayiste écrivait aujourd’hui, après le questionnement collectif lié à l’appropriation culturelle, il choisirait sans doute un autre titre que Nègres blancs d’Amérique. En 1965, la question se posait différemment, et l’auteur choisit ce titre en hommage à Léopold Sédar Senghor, à Aimé Césaire, à Frantz Fanon et par solidarité avec les membres des Black Panthers qu’il côtoyait dans son emprisonnement américain. De même, Dany Laferrière conteste les stéréotypes dans son premier roman, dont le titre même, Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, est provocateur. N’est-ce pas le rôle de l’université de mettre ces réalités en perspective ? D’enseigner ces œuvres et tant d’autres qui permettent de penser le monde ? Cette mission fondamentale deviendrait pour le moins difficile dans un contexte de libertés universitaires surveillées, où une professeure se ferait (comme Catherine Russell de l’Université Concordia) retirer son cours pour avoir mentionné le seul titre de l’essai de Vallières (pour ne pas souligner le sort de la journaliste Wendy Mesley, suspendue par la CBC après avoir cité la traduction anglaise du même titre). (Gilbert, Prévost & Tellier, 2022, p. 31-33)
13Avec un peu recul sur la crise qui avait secoué l’Université d’Ottawa, j’écrivais en 2021 :
J’ai souvent dit à mes classes, au début de la session, que le passé était fascinant par sa radicale altérité, qu’il fallait éviter de le juger à la lumière du présent, parce que l’état actuel des choses ne correspond pas à un telos divin et immuable, c’est-à-dire parce que nous sommes le passé de l’avenir. Mais avec la théorie critique, et à plus forte raison avec la théorie critique appliquée, on fait face à un rejet catégorique de l’histoire. Les rapports de domination sont les mêmes de tout temps, ils définissent l’ensemble de l’humaine condition, ils sont à condamner toujours et partout avec la même intensité. Les mots ont le même sens et la même valeur partout, toujours et en toute situation. Il faut donc caviarder les exemplaires de Voltaire, de Jules Verne, d’Anne Hébert que nous ferons lire. En toute logique, les éditeurs subiront bientôt la pression de rééditer les textes du passé en écriture inclusive et en faisant disparaître les termes tabous. Nous en serons alors à une étape avancée de l’établissement d’une novlangue, laquelle rendra « immorale » la pensée non conforme et son expression, que celle-ci date de 1622 ou de 2022. Les problèmes que nous sommes susceptibles de rencontrer, les micro-agressions dont on risque de nous accuser, sont de toutes sortes et de tout ordre. Il est essentiel de comprendre que le « mot en N » n’est que la pointe d’un gigantesque iceberg – voire d’un continent de glace. Les grands textes littéraires sont de hauts lieux de dissensus. (Boucher & Prévost, 2022, p. 173)
14On me dira que je dramatise, qu’il suffit de certaines mises en garde, de certains ménagements. Qu’il s’agit, en somme, de déminer le passé. J’y vois au contraire une dangereuse mise à niveau à laquelle il importe de résister. Il ne s’agit pas ici d’une condamnation ontologique, mais bien historique du déminage éditorial. Les écrivains d’aujourd’hui et de demain sont et seront tout à fait libres de consulter tous les experts du marché des sensibilités qu’ils voudront ; de même, les ayant droit d’Ian Fleming ou de Roald Dahl peuvent souhaiter protéger leurs intérêts commerciaux contre d’éventuelles mises en accusation et appels au bannissement (car c’est au fond de cela qu’il retourne, voir Chilton, 2023), même si les résultats seront parfois involontairement ridicules (car, en vérité, est-il moins blessant de lire dans Charlie and the Chocolate Factory qu’Augustus Gloop est enormous plutôt que fat ? ; voir Zakir-Hussain, 2023). Il est vrai aussi que la littérature pour la jeunesse, censée former une vision du monde acceptable pour un état donné de société, présente certaines difficultés particulières ; comment rééditer tel quel The Story of Doctor Dolittle, par exemple, avec son prince africain qui rêve de devenir blanc ? (Lofting, 1967, p. 83 et suiv.)
15Il importe néanmoins et surtout, à mon sens, de bien comprendre la logique dans laquelle ce processus pourrait nous entraîner, et, the readiness being all, d’être prêts lorsque, comme cela arrivera inévitablement, certains exigeront que l’on adapte l’ensemble des textes du passé aux sensibilités contemporaines. Car le soupçon pèse désormais sur nos objets d’étude et de recherche mêmes : plusieurs objets ou même champs d’étude, qui ont tous en commun l’historicité, risquent de se voir décrédibilisés institutionnellement. S’adapter à l’enseignement de la littérature à l’ère de la micro-agression est une chose, tout comme s’abstenir de dire certains mots ou de lire des extraits que l’on pressent explosifs. Mais, comme l’écrit Geneviève Boucher : « Le problème, à mon sens, n’est pas le concept de micro-agression en lui-même, mais ce qu’on en fait et la justice qu’on se sent en droit de réclamer en son nom. Cela est encore plus problématique dans une situation d’enseignement, où ce ne sont pas nos propos directs qui sont considérés comme des micro-agressions, mais la matière que nous enseignons » (Boucher & Prévost, 2022, p. 165). On voit où je veux en venir : je crains que l’institution universitaire en vienne à faire des demandes éditoriales pour déminer les textes du passé, ce qui affecterait bien plus que la seule salle de classe. On me jugera peut-être coupable d’utiliser la rhétorique de la pente glissante, mais j’ai déjà dévalé la pente glissante, et pu constater que la chute est rapide, impossible à stopper une fois commencée. Comme l’écrit l’historien Harold Bérubé : « Si l’idée de décoloniser l’histoire en élargissant le regard que l’on porte sur notre passé me sourit, celle d’interdire la mention de certains mots en classe, quel que soit le contexte, ou encore d’exclure des plans de cours tout document qui les contiendrait sous une forme ou une autre me semble pour le moins problématique, sinon entièrement incompatible avec la pratique de l’histoire » (Bérubé, 2022-23, p. 117-11810). Cela s’applique à plus forte raison à l’histoire littéraire.
16Les historiens et les juristes (voir Otis et al., 2020) semblent percevoir plus clairement la menace, de même qu’un contingent, disons, conservateur, des sciences sociales. Comme je l’écrivais en 2021 : « Nos collègues des sciences sociales étaient beaucoup mieux préparés que nous à la crise et sont tombés de moins haut : ils vivaient depuis plusieurs années dans l’épicentre de la gauche identitaire. Mais je crois que les études littéraires sont celles qui sont le plus directement – et le plus totalement – menacées par la non-pensée qui se déploie actuellement » (Boucher & Prévost, 2022, p. 168-169).
Notre xixe siècle
17En effet, comment enseigner des textes dont non seulement les idées mais encore les mots mêmes qui les constituent sont mis hors la loi ? Au cœur de la crise de l’Université d’Ottawa, Geneviève Boucher s’était trouvée paralysée face à l’enseignement de la Carmen de Prosper Mérimée, tant elle avait l’impression que le degré de bienveillance (ou du moins de neutralité) espéré de la part de son auditoire était fragilisé :
Je me trouvais dans une sorte d’état second, avec la brûlure constante de l’adrénaline : c’était un peu comme ce qu’on éprouve après avoir évité un accident de justesse, mais à longueur de journée, pendant plusieurs jours. J’ai dû enregistrer un cours dans cet état. C’était une séance sur Carmen (la nouvelle et l’opéra). J’ai supprimé le matériel qui me semblait possiblement « problématique » : la partie sur les Gitans, l’analyse de la figure de l’étranger, les développements sur la femme fatale. Il ne restait plus grand-chose. J’ai fait face à la caméra en tremblant (on l’entend dans ma voix) ; quand l’enregistrement a été terminé, j’ai rabattu l’écran de mon ordinateur et je me suis effondrée en larmes. Est-ce que ce serait comme ça désormais, prendre la parole avec l’étiquette « raciste » accolée au front ? (Boucher & Prévost, 2022, p. 152)
18Avec quelques mois de recul, elle parvenait à cette observation, moins catastrophiste, mais dont les répercussions sont majeures : « Dans l’état actuel des esprits, il me semble difficile de présenter le personnage de Carmen autrement que comme une victime de féminicide. Elle l’est, évidemment, mais elle n’est pas uniquement cela » (Boucher & Prévost, 2022, p. 169).
19Au plus fort de la crise, je me disais pour ma part que je n’enseignerais plus jamais Alexandre Dumas, qui occupe pourtant un rôle central dans mes recherches. Puis, la poussière retombant, je me suis dit que je continuerais de l’enseigner, mais sans jamais mentionner quoi que ce soit qui ait trait à son expérience d’écrivain métissé, aux insultes raciales que lui adressaient Balzac, mademoiselle Mars ou Eugène de Mirecourt, parmi tant d’autres (voir Prévost, 2021). J’ai décidé que je n’expliquerais plus son choix révolutionnaire d’adopter le nom de sa grand-mère esclave (Césette Dumas / « du mas », c’est-à-dire « appartenant au maître ») plutôt que le nom sonore Davy de la Pailleterie qu’il était en droit de revendiquer dans la société de la Restauration. J’ai décidé que lorsque je parlerais de ses collaborateurs, et particulièrement d’Auguste Maquet avec qui il a coécrit ses plus grands romans, j’omettrais de préciser qu’un collaborateur s’appelait dans la langue de l’époque un « nègre ». J’ai décidé que je cesserais de parler de la fascination qu’exerçait sur l’écrivain la mémoire de son père, le général Dumas, d’abord encensé par Bonaparte (qui voyait sans doute d’un bon œil, sur le plan symbolique, qu’un Noir devienne général, objectivisation du caractère méritocratique de la nouvelle armée), mais rapidement tombé en disgrâce : après avoir rétabli l’esclavage dans les colonies, le Premier Consul trouva piquant d’ordonner à son « général noir » d’aller guerroyer contre Toussaint-Louverture à Saint-Domingue. La lettre de refus du général Dumas fut bien entendu cinglante, mais j’ai décidé que je ne la citerais plus : « Citoyen consul, vous oubliez que ma mère était une négresse. Comment pourrai-je vous obéir ? Je suis d’origine nègre. Je n’irai pas apporter la chaîne et le déshonneur à ma terre natale, et à des hommes de ma race ». J’ai décidé que je n’expliquerais pas qu’à partir de ce moment Bonaparte n’appellerait plus son général disgracié que « le nègre Dumas » (Zimmerman, 2022, p. 33).
20J’ai honte de le dire, parce que cette constatation va à l’encontre des résolutions prises lors de l’écriture du « Dialogue de l’Éveil » des Libertés malmenées (Boucher & Prévost, 2022, p. 177-178), mais force est de constater que je m’autocensure désormais, en salle de classe du moins. Pourtant, j’avais toujours senti que les éléments rapidement évoqués ci-dessus fascinaient les étudiants « racisés » de cette salle de classe, particulièrement ceux d’origine haïtienne, étonnés de découvrir le rôle de la nation de leurs parents ou grands-parents dans la destinée des Dumas. Citoyen consul, n’oubliez pas que ma mère était un mot en N ? Non, je ne crois pas. Cet absurde et infantilisant vocable » mot en N », chaque fois qu’il sera utilisé en salle de classe, objectivera que nous tenons notre population étudiante pour trop immature et simplette pour réfléchir historiquement.
21Revenons au livre Forestiers et voyageurs de Joseph-Charles Taché, cette œuvre du xixe siècle canadien, de teneur ethnologique, qui décrit par une série de récits, de légendes et de chansons la vie des bûcherons et surtout de ces coureurs des bois absolument centraux dans l’imaginaire québécois. Les coureurs des bois étaient des chasseurs et des négociants ayant adopté le mode d’occupation du territoire des Premières Nations, développant un mode de vie proprement américain, abandonnant les us et coutumes européennes, se faisant en retour adopter par les autochtones du continent. Leur grande figuration littéraire est le Hawk-eye de James Fenimore Cooper, protagoniste des cinq Leatherstocking Tales qui ont partiellement défini le regard tant américain qu’européen sur l’Amérique. À la suite de Cooper, le polygraphe Washington Irving, le plus canadien des auteurs américains, qui a fréquemment séjourné à Montréal et ailleurs au pays, ira dans son Astoria à la rencontre de ces personnages exerçant une telle emprise sur l’imaginaire atlantique (Irving, 1836 et 184311). Irving s’intéresse particulièrement aux voyageurs, aux « coureurs des bois, or rangers of the forest » (Irving, 1836, p. 4), dont il décrit avec minutie l’habillement, les us et coutumes, l’historique : tant le Jules Verne signant ses « romans canadiens » (Verne, 2020 [1873], 2024a [1889], 2024b [1906]) que les autres romanciers français s’intéressant au Canada (Gabriel Ferry, Henri-Émile Chevalier, Gustave Aimard) trouvent là un texte dont les réminiscences se conjuguent à celles des romans de Cooper, et sert de point de départ à Joseph-Charles Taché, dont l’œuvre cherche à documenter la réalité derrière cette mythologie américaine, à l’intention de lecteurs canadiens et sans doute français.
22On se rappelle que, dans la plainte étudiante à l’Université McGill concernant l’enseignement de ce livre, la présence du mot sauvages constituait un irritant, voire une source d’indignation majeure. Il me semble significatif que personne n’ait cherché à rappeler que dans la langue canadienne du xixe siècle, ce mot avait la même valeur qu’aux xvie et xviie siècles, à savoir celui d’« habitant des forêts », alors même que l’oubli de cette réalité philologique menace jusqu’à l’enseignement des écrits du père de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain (Des sauvages, 1603). Dans le contexte précis du roman de Joseph-Charles Taché, l’anathème jeté sur le mot sauvages dénote une incompréhension, voire une complète indifférence au contexte d’ensemble, puisque le chroniqueur cherche à rappeler le sens de l’expression se faire sauvage, laquelle désigne la réalité, décrite de manière positive, voire élogieuse, des coureurs des bois qui savent fraterniser avec les premiers habitants du continent. Ainsi, l’incipit du chapitre « Le Passeur de Mitis » se lit : « J’étais si bon ami avec les sauvages qu’il ne s’en est guère manqué que je me sois mis sauvage comme mes amis Fitzbac et Lagorjendière, que vous avez tous connus. Vous me croirez si vous voulez, mais je vous dis qu’il n’y a pas d’homme plus heureux qu’un bon sauvage » (Taché, [1864] 2002, p. 86). À cette déclaration du narrateur (le père Michel, un coureur des bois devenu simple chasseur et raconteur en son vieil âge), Taché ajoute une note de bas de page explicative : « Se mettre sauvage est une expression consacrée, à l’occasion du petit nombre de Canadiens et d’Européens qui ont adopté la vie des bois et des côtes, en s’associant aux tribus aborigènes auxquelles leurs familles sont devenues incorporées » (ibid.). On chercherait en vain le « suprémacisme blanc » ici ; on pourrait à la limite faire planer le spectre de l’appropriation culturelle, mais d’une appropriation inversée laquelle, comme dans les romans de Cooper (et de Verne), mène à un questionnement sur le mode d’habitation et d’exploitation du continent américain.
« Désinfecter » la vieille littérature
23À travers les âges, les limites à la liberté d’expression sont tantôt hard (exécution, autodafés, index, censure royale ou d’État), tantôt soft (autocensure, obéissance à ce que John Stuart Mill appelle « la tyrannie de la majorité », crainte de participer à la « désinformation » ou la « mésinformation », etc.), mais toujours présentes, à toutes les époques, sous une forme ou une autre. La menace qui me préoccupe aujourd’hui est la limite aux libertés d’expression du passé, ce qui sauf erreur, constitue un cas de figure relativement nouveau. Geneviève Boucher : « La conjonction du présentisme et du moralisme, qui fait un procès permanent à l’histoire, transforme en un champ de mines l’exploration des productions culturelles du passé » (Boucher & Prévost, 2022, p. 163).
24H. G. Wells, dans un roman futuriste qui se voulait davantage prophétique que dystopique (The Shape of Things to Come. The Ultimate Revolution), annonçait en 1933 que l’éducation serait la clé de voûte de tout changement social, la clé ouvrant un monde nouveau, affranchi des anciennes identités nationales. Nulle part ailleurs que dans l’éducation, analysait son narrateur du xxiie siècle, aura été mise en œuvre une forme aussi parfaite de démolition contrôlée précédant l’inévitable et souhaitable reconstruction. Pour ce faire, il aura fallu un changement de paradigme faisant passer l’éducation de la transmission des savoirs passés à l’imposition de nouvelles formes de pensée. L’éducation, de conservatrice, est devenue militante, alors qu’avant le xxie siècle, écrit Wells, elle avait été conservatrice et traditionnaliste, et devait donc être bouleversée de fond en comble avant l’institution d’un nouvel ordre mondial (Wells, [1933] 2005, p. 14212). Les « nouveaux puritains », ajoute-t-il, sont ainsi parvenus à « désinfecter » la vieille littérature, laquelle a cessé d’être une source de mauvais exemples sociaux et existentiels doublée d’une source de démoralisation collective (p. 37613).
25S’il me semble raisonnable de postuler, à l’encontre du diagnostic de Wells, que les guerres culturelles divisant actuellement divers campus à l’internationale participent d’un moment précis de l’histoire qui passera, tombant progressivement dans l’indifférence sous le poids de ses propres outrances, le moment pourra néanmoins sembler dangereux pour la tentation du déminage éditorial rétrospectif qu’il cherchera vraisemblablement à instituer ; car celui-ci, de manière insidieuse et dans la durée, pourrait se donner le mandat de transformer la lettre du passé. Les ferveurs s’envolent, les écrits du passé restent – du moins jusqu’à ce jour.