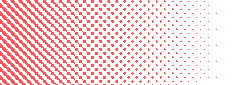Comment annoter la scène du marché aux esclaves dans le Voyage en Orient de Nerval
1Dans un article à la fois très documenté et très critique à l’égard du regard européen sur l’esclavage, publié en 2016 dans le Journal des africanistes et intitulé « Des Européens au marché aux esclaves : stade suprême de l’exotisme ? Égypte, première moitié du xixe siècle », l’anthropologue Roger Botte, qui considère que Nerval est « le précurseur en France du racisme littéraire », écrit à la note 56 de cet article : « Moussa [...] fait justement le rapprochement entre Nerval et les thèses polygénistes, mais il l’exonère finalement de tout discours racialiste. » (Botte, 2016). L’auteur renvoie ici à une étude (disponible sur HAL depuis 2013) que j’avais publiée en 2009 dans un volume collectif paru en Pologne, La Perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones. Cet article, intitulé « La couleur des esclaves dans le Voyage en Orient de Nerval » (Moussa, 2009), disait pourtant le contraire de ce que prétend Roger Botte. S’il est difficile de savoir comment on peut en arriver à un tel contresens, il n’en reste pas moins que nous sommes entrés dans une période nouvelle où les études postcoloniales ne peuvent plus être ignorées, et où elles font donc l’objet de débats. Elles donnent lieu à des discussions méthodologiques, en France, non seulement chez les spécialistes d’études anglaises et américaines, pour qui leur prise en compte est beaucoup plus naturelle pour des raisons linguistiques, mais aussi, désormais et de plus en plus, chez les historiens, les anthropologues, les politologues, ainsi que chez les littéraires, et, plus encore, chez les comparatistes. C’est donc dans ce contexte que je souhaite réexaminer la façon dont la scène du marché aux esclaves, dans le Voyage en Orient de Nerval, a été commentée (ou non) par ses différents éditeurs, tout en l’ouvrant sur une réflexion concernant l’héritage français d’Orientalism (1978) d’Edward Said. Mais avant d’en arriver là, il est nécessaire de revenir à mon commentaire de cet épisode nervalien, dont on verra qu’il va très largement dans le sens de celui de Roger Botte, s’agissant des esclaves noires décrites dans Les Femmes du Caire. Mon article visait justement à ne pas exonérer Nerval d’un discours négrophobe qui traverse à l’évidence l’épisode du marché aux esclaves, l’un des éléments de ma démonstration consistant à faire la contre-épreuve en examinant comment les esclaves blanches sont représentées (elles échappent non par hasard au regard raciste), sans parler de Zeynab elle-même, esclave « jaune » incarnant une race intermédiaire dans le nuancier des couleurs de peau et des discours raciologiques qui leur sont associés1.
2Voici ce que j’écrivais à la fin de la première partie, intitulée « Rejet de la noirceur », de mon article cité ci-dessus :
La fin de la première « rencontre » avec les esclaves noires, dans le Voyage en Orient, confirme en tout cas ce rejet, qui se manifeste jusque dans la pseudo-compassion du narrateur : « À voir ces formes malheureuses, qu’il faut bien s’avouer humaines, on se reproche philanthropiquement d’avoir pu quelquefois manquer d’égards pour le singe, ce parent méconnu que notre orgueil de race s’obstine à repousser2. » Accentuée par l’idée de dégradation morale traditionnellement associée à l’esclavage, la représentation nervalienne de ces Noires est aux antipodes de l’image esthétisante (à laquelle elle répond peut-être) qu’un Lamartine avait donnée, dans son propre Voyage en Orient (1835), d’un groupe d’Abyssiniennes exposées dans le marché aux esclaves de Constantinople3. (Moussa, 2009, p. 216)
3La deuxième partie de mon article était intitulée « Pitié pour la blancheur », et la troisième « L’imaginaire de la “race jaune” ». Je concluais que, malgré la « médiation artistique » (Moussa, 2009, p. 220) de la Javanaise, « on ne peut pas déconnecter Nerval du discours polygéniste triomphant et théorisé, à peu près au même moment, par l’Essai sur l’inégalité des races humaines de Gobineau » (Moussa, 2009, p. 221).
L’annotation de cet épisode dans quelques éditions du Voyage en Orient
4Je me suis permis de revenir sur mon article « La couleur des esclaves… » pour répondre à la note surprenante de Roger Botte. Dans cet article, je réagissais moi-même à une note de Claude Pichois, qui parlait, en 1984, de la « juste réaction de Nerval devant la femme-objet » (Nerval, éd. Jean Guillaume et Claude Pichois, 1984, p. 1487, note 1 de la page 339) – note qu’on peut considérer comme problématique par son caractère abusivement généralisant. En effet, le savant éditeur du Voyage en Orient dans la seconde « Pléiade » commentait ainsi le passage suivant, dont on s’aperçoit très vite qu’il concerne une esclave blanche – « presque blanche4 », pour être exact, donc sans doute d’origine caucasienne, puisque l’Empire ottoman refusait de réduire ses propres populations chrétiennes en esclavage (il fallait aller chercher assez loin les très convoitées esclaves blanches, notamment les Circassiennes) :
Il y avait autour de la cour plusieurs salles basses, habitées par des négresses, comme j’en avais vu déjà, insoucieuses et folles la plupart, riant à tout propos ; une autre femme cependant, drapée dans une couverture jaune, pleurait en cachant son visage contre une colonne du vestibule. La morne sérénité du ciel et les lumineuses broderies que traçaient les rayons du soleil jetant de longs angles dans la cour protestaient en vain contre cet éloquent désespoir ; je m’en sentais le cœur navré. (Nerval, éd. Jean Guillaume et Claude Pichois, 1984, p. 339)
5On doit postuler que c’est bien la blancheur de la peau qui rend le narrateur sensible au sort de cette esclave : il reconnaît en elle une semblable. À l’inverse, les esclaves noires ne suscitent aucune empathie, tout au contraire : même quand elles ne sont pas comparées à des singes, elles apparaissent comme « folles et insoucieuses », autrement dit insensibles à leur propre sort, ce qui, du coup, est censé relativiser leur condition. Certes, Zeynab, l’esclave musulmane asiatique que le narrateur achètera finalement, dénote aussi un certain degré d’altérité, puisqu’elle appartient à la « race jaune » (Nerval, éd. Jean Guillaume et Claude Pichois, 1984, p. 341), mais la distance est en partie comblée par une comparaison esthétisante qui la ramène à des modèles picturaux européens : « Je venais de reconnaître l’œil en amande, la paupière oblique des Javanaises, dont j’ai vu des peintures en Hollande. » (Nerval, éd. Jean Guillaume et Claude Pichois, 1984, p. 341). La supposée indignation nervalienne face au statut de « femme-objet » dont parle Claude Pichois est donc pour le moins sélective : même si elle était avérée (ce qui me paraît en réalité quelque peu anachronique et difficile à prouver chez Nerval), force est de constater qu’elle est orientée : c’est bien une esclave blanche qui suscite la pitié du narrateur, les esclaves noires, quant à elles, étant au mieux considérées avec une condescendance moqueuse, au pire expulsées de l’humanité pensante et sensible. Cela dit, cette note est intéressante, d’une part parce qu’elle montre l’aveuglement dont peut être victime un grand dix-neuviémiste face à un auteur qu’il veut faire apparaître sous un jour clairvoyant, si ce n’est « prophétique », d’autre part parce Claude Pichois se montre lui-même, dans les années 80, sensible à des questions de son temps, comme celle du féminisme.
6Mais voyons ce que dit un autre savant éditeur du Voyage en Orient, celui de la première « Pléiade ». En 1961, au tome deux des Œuvres de Nerval, Jean Richer ne consacre tout simplement pas une seule note à la question de l’esclavage, ni à sa représentation littéraire, ni aux discours raciologiques contemporains dans lesquels pourrait s’inscrire cette scène. Ce n’est pas que Jean Richer n’attache aucune importance à l’annotation, mais celle-ci est d’ordre purement philologique. Il donne les variantes du texte, puisque les différents chapitres sont souvent parus initialement dans des revues5 ; il signale une possible allusion au Voyage en Orient (1835) de Lamartine, ce qui est parfaitement juste par ailleurs ; il identifie les emprunts aux Modern Egyptians (1836) d’Edward W. Lane, illustrant ainsi l’importance de l’intertextualité s’agissant de ce corpus nervalien6. Ce qui intéressait Jean Richer, on le sait, c’étaient surtout les doctrines ésotériques dans l’œuvre nervalienne, d’où une vision très « spiritualiste » du Voyage en Orient – c’est cela même que contestait de son côté Claude Pichois, attaché, lui, à ramener Nerval à une vision plus « matérialiste », non spéculative, fondée sur l’étude de sources avérées. Mais ni l’un ni l’autre, on le voit, n’attache la moindre importance à des questions pourtant cruciales pour nous aujourd’hui, celles du racisme, des discours raciologiques, de l’esclavage et de sa représentation.
7Il en va un peu autrement si l’on regarde en aval, ce qui ne surprend pas. Jacques Huré, qui fut lui aussi un grand nervalien, procura une édition annotée du Voyage en Orient, parue à l’Imprimerie Nationale en 1997. Chaque nouvel éditeur de Nerval se sentant obligé de se positionner par rapport à ses prédécesseurs, Jacques Huré conçoit clairement sa propre édition en opposition à celle de Claude Pichois, à qui il reprochait de ne pas connaître suffisamment l’Orient réel, ni les langues orientales (Jacques Huré, qui était comparatiste et qui vécut de longues années au Maghreb et en Turquie, avait au minimum une grande familiarité avec le turc et l’arabe). Du coup, son annotation est un peu différente. Ainsi, à propos du chapitre « L’okel des jellab », il écrit en note : « Djallab, “commerçant”. L’esclavage (aboli en France en 1794) est toujours, en 1843, une réalité de la société musulmane, et sa disparition, imposée par l’Europe, sera très lente. » (Nerval, éd. Jacques Huré, 1997, t. I, p. 456, note 96 des Femmes du Caire). Signalons au passage que Jacques Huré se réfère ici à l’orientaliste anglais Bernard Lewis, dont l’ouvrage traduit en français en 1997 sous le titre Race et esclavage au Proche-Orient a été jugé très anti-musulman par Edward Said, avec qui il eut une violente polémique7, dont Huré ne fait pas état. Mais il est de fait que la traite, officiellement interdite dans l’Empire ottoman par un firman de 1857, n’empêchera pas de continuer à posséder des esclaves. S’agissant de l’Égypte, c’est à l’époque de l’occupation anglaise que l’abolition sera effective8. Pour revenir à Jacques Huré, il faut signaler qu’il consacre un commentaire, si bref soit-il, à la scène où il est question des « négresses du Senaar » que, en raison des traits de leur visage, le narrateur nervalien compare à des créatures appartenant à « une catégorie presque bestiale » : « On s’étonne de ne lire aucune protestation devant une telle scène », écrit-il en note (Nerval, éd. J. Huré, t. I, p. 457, n. 98 de la p. 233). On sent ici la déception du commentateur, qui regrette, comme beaucoup d’entre nous sans doute, que Nerval, incontestablement l’un des chantres de l’ouverture à l’autre dans la tradition viatique des Voyages en Orient au xixe siècle, n’ait pas au minimum mis en tension le discours de son personnage-narrateur, qu’il faut bien qualifier de négrophobe.
8Cela dit, un commentateur plus récent, Philippe Destruel, cherche à distinguer entre l’auteur du Voyage en Orient et son narrateur, tout en incriminant curieusement surtout le premier. Dans l’édition des Scènes de la vie orientale qu’il a procurée en 2014, autrement dit dans la première version publiée en librairie, en 1848, des « Femmes du Caire », avant le texte définitif que nous connaissons, publié en 1851, il écrit en note, à propos du portrait des Noires du Sennaar : « “Bestiale”. Nerval n’échappe pas à son siècle, sur ce plan en tout cas. Pour ce qui est de la position du narrateur nervalien, c’est moins simple... » (Nerval, éd. Philippe Destruel, 2014, p. 162, n. 3). Il faut se reporter à la « Présentation » du volume pour voir ce que son éditeur en dit plus précisément. Je cite le paragraphe en question :
Ayant décidé d’acheter une esclave, le voyageur a parcouru les marchés : l’okel des jellab, où il a vu des Nubiennes, un comptoir où il a observé des Éthiopiennes. L’esclavage – qui provoque l’apitoiement d’un Européen – devrait être considéré du point de vue de la réalité orientale : une esclave pleure parce qu’elle... regrette son maître ! qui en lui rendant sa liberté la vouerait à une vie de perdition... Nerval est homme de son siècle ; il est intéressant que son effort de jugement le conduise à l’expression d’un relativisme, en l’occurrence : la liberté à laquelle tiennent tant de Français ne serait pas forcément une source de bonheur pour les esclaves, ou pour les enfants... Bien entendu, ce relativisme peut avaliser les inégalités comme autant de différences. Ce sont en tout cas les évidences occidentales qui sont alors bousculées. (Nerval, éd. Philippe Destruel, 2014, p. 37)
9Philippe Destruel fait allusion à la situation paradoxale dans laquelle se trouve cette esclave – situation qui était déjà celle de l’esclave abyssinienne dans le Voyage en Orient de Lamartine, raison pour laquelle le clin d’œil est évident –, à savoir que le maître, voulant punir celle-ci d’on ne sait quelle faute, aurait fait semblant de la mettre en vente pour l’humilier et lui faire regretter sa situation première. Si l’on en vient à l’argumentation de Philippe Destruel concernant ce passage, elle me semble peu claire : au fond, il s’agirait expliquer à la fois le différentialisme nervalien et son potentiel de subversion vis-à-vis des discours sociaux – et cette ambiguïté traduit sans doute une gêne intellectuelle, une oscillation entre la déception dont témoignait Jacques Huré, qui aurait espéré une condamnation claire de l’esclavage par Nerval, et, d’autre part, le désir de défendre malgré tout un grand auteur en le situant du côté de la modernité comme mise à distance des préjugés européens .
10Voyons maintenant brièvement ce qu’il en est dans la plus récente édition du Voyage en Orient proprement dit (donc le texte de l’édition définitive, celle parue en 1851), que Philippe Destruel a procurée, toujours pour Classiques Garnier, en 2022. Concernant le chapitre « L’okel des jellab », on trouve une seule et unique note, qui commente l’expression de « masque étrange » qu’on trouve dans le texte nervalien pour résumer le portrait animalisé des « négresses du Sennaar » : « L’animalité, écrit le commentateur, se concentre sur le visage, seul lisible, seul interprétable ! Barthèlemy n’a peut-être pas tort quand il parle de l’altérité excessive des “Négresses” aux yeux du narrateur... (Cf. Thèse). » (Nerval, éd. Philippe Destruel, 2022, p. 291) La position de Philippe Destruel est ici plus claire, mais très prudente : citant la thèse non publiée de Guy Barthèlemy (Barthèlemy, 1993), il se contente d’euphémismes (« n’a peut-être pas tort », altérité « excessive ») pour désigner ce qu’il ne faudrait pas hésiter à appeler, aujourd’hui, des énoncés racistes, et dont il n’est pas certain qu’il faille les prendre au second degré, ni que Nerval prenne distance, sur ce point, de son personnage-narrateur. Pourquoi une telle hésitation à nommer les choses par leur nom, et à parler, au moins en ce qui concerne ce passage, d’un discours négrophobe, tel qu’on le trouve par ailleurs chez nombre d’autres voyageurs contemporains ? ou, si l’on préfère situer l’analyse sur un autre plan, pourquoi ne pas suggérer qu’il s’agit d’un discours provocateur et anti-humaniste refusant la condamnation claire et nette de l’esclavage comme système, telle qu’on pouvait la lire par exemple dans L’Égypte en 1845 de Schœlcher, un ouvrage paru en 1846, oscillant entre le récit de voyage et l’essai9 ? Les raisons de cette étonnante discrétion, pour ne pas parler de « silence10 », sont sans doute multiples, mais la question devait être posée. Quoi qu’il en soit, il faut attendre la fin du chapitre XII (« Abd El-Kérim ») pour qu’une note trahisse finalement une prise de position personnelle du commentateur sur la façon dont Nerval parle de l’esclavage oriental dans son Voyage en Orient :
Tout relativisme historique a heureusement ses limites. Le baron Ferdinand de Géramb, trappiste, passe plusieurs mois en Égypte, entre 1832 et le printemps 1833, avant de se rendre à Jérusalem. Il dénonce vigoureusement l’esclavage. [...]. Valérie de Gasparin est révoltée, en 1847, à Assiout, par une caravane d’esclaves [...]. (Nerval, éd. Ph. Destruel, 2022, p. 306, n. 19 ; je souligne)
11Quant à la note de Claude Pichois sur la « femme-objet » dans le chapitre sur « L’okel des jellab », Philippe Destruel ne la mentionne pas, ni ne la remplace par une autre note, dans aucune des deux éditions publiées chez Classiques Garnier : il ne commente tout simplement pas le paragraphe se terminant par la vision d’une esclave blanche pleurant et dont le narrateur disait : « Je m’en sentais le cœur navré. » La question idéologique est ici presqu’évacuée, alors même que mon article sur « La couleur des esclaves » est cité en Bibliographie de son édition du Voyage en Orient (Nerval, éd. Ph. Destruel, 2022, t. II, p. 1643), mais sans qu’aucune conséquence n’en soit tirée sur les différences d’appréciation des esclaves selon leur « race », pour reprendre la terminologie de l’époque. Ce qui montre, soit dit en passant, qu’il faut se garder d’une vision trop téléologique dans notre propre examen critique des éditions du Voyage en Orient : Jacques Huré, qui vient pourtant avant Philippe Destruel, et bien que son annotation soit discrète, me paraît plus critique que Philippe Destruel, dont les travaux se situent bien après la loi dite « Taubira » de 2001 sur la reconnaissance de l’esclavage comme crime contre l’humanité, et même après l’instauration, par Jacques Chirac, en 2006, d’une Journée nationale des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions (commémorée le 10 mai).
12Pour terminer avec le commentaire de l’édition de Philippe Destruel du Voyage en Orient, on peut signaler que la « Présentation » de ce texte consacre plusieurs pages à la figure de l’esclave Zeynab, mais sans que la question de l’esclavage ne soit jamais vraiment traitée, si ce n’est par une note qui tend à disculper Nerval, sur la base d’une lettre qui ne se laisse en réalité pas du tout réduire à une prise de position abolitionniste. Philippe Destruel écrit donc ceci : « En tant qu’Européen, Français – dont le pays abolira dans peu [sic : manque visiblement « de temps »] l’esclavage – le narrateur sait parfaitement ce que peut représenter l’achat d’une esclave ! » Et il ajoute en note : La correspondance est d’ailleurs claire sur ce point : cet acte est indigne. Cf. la lettre à Gautier du [Caire] 2 mai 1843. » (Nerval, éd. Ph. Destruel, 2022, p. 78 et n° 178) Or cette lettre dit tout autre chose. Citons le passage concernant l’esclave achetée par le compagnon de voyage de Nerval :
Le Fonfride a été assez convenable. Il a acheté une esclave indienne et comme il voulait me la faire baiser je n’ai pas voulu, alors il ne l’a pas baisée non plus, nous en sommes là. Cette femme coûte très cher et nous ne savons plus qu’en faire. On a d’autres femmes tant qu’on veut. On se marie à la cophte, à la grecque, et c’est beaucoup moins cher que d’acheter des femmes, comme mon compagnon a eu la muflerie de le faire. Elles sont élevées dans des habitudes de harem et il faut les servir, c’est fatigant. (Nerval, éd. Jean Guillaume et Claude Pichois, 1989, p. 1396).
13On conviendra qu’il est difficile de s’appuyer sur un tel passage pour faire de Nerval un fervent abolitionniste. Certes, il dit n’avoir pas voulu « baiser » l’esclave, mais est-ce parce qu’il condamne l’esclavage ?
L’héritage de Said
14Revenons maintenant sur un ouvrage mentionné en introduction, Orientalism d’Edward Said, traduit en français dès 1980 sous le titre L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, réédité à de nombreuses reprises. Dans la deuxième partie de L’Orientalisme, Said consacre un chapitre aux voyageurs anglais et français en Orient au xixe siècle. Parmi ceux-ci, Nerval, dont il propose une analyse critique du Voyage en Orient (Said, 1980, p. 209 et suivantes). Pour le dire brièvement, Said reproche à Nerval de donner à voir un Orient vidé de sa présence réelle, car il privilégierait le passé, la fiction, l’intertextualité – un certain nombre de considérations sur l’Égypte sont en effet empruntées à l’orientaliste anglais Edward W. Lane dont il a traduit par ailleurs certains chapitres des Modern Egyptians (1836). Said reproche aussi à Nerval son obsession du voile et du dévoilement, une thématique qui apparaît dès les premières pages des « Femmes du Caire », à propos de la capitale égyptienne, désignée comme « la ville du Levant où les femmes sont encore le plus hermétiquement voilées », et qui, comparée ensuite à ses habitantes, « ne dévoile que peu à peu ses retraites les plus ombragées, ses intérieurs les plus charmants » (Nerval, éd. J. Guillaume et C. Pichois, 1989, p. 260 et 262).
15Toutes ces remarques sont justes en elles-mêmes, mais elles sont évidemment très incomplètes, et là est le problème. Said en tire la conclusion univoque que « Nerval a la vision négative d’un Orient vidé » (Said, 1980, p. 212). Certes, l’Orient nervalien est traversé par une tension entre illusion et désillusion, ainsi que par la thématique des « déesses absentes », pour reprendre un titre de Michel Brix (Brix, 1997), enfin par une « mélancolie » dont Ross Chambers a pu d’ailleurs montrer qu’elle pouvait s’inscrire dans une dimension oppositionnelle, liée à la contestation d’une certaine forme de modernité (Chambers, 1987). Mais le Voyage en Orient n’est pas que cela : il est aussi volonté d’immersion dans la population11, et la partie égyptienne de ce récit de voyage, qui correspond à la période la plus longue du voyage réel (Nerval est resté près de quatre mois au Caire12), est à l’évidence une spécificité qui le distingue des Voyages en Orient de ses prédécesseurs, en tout cas de l’Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811) de Chateaubriand. À peine arrivé en Égypte, le narrateur nervalien revêt un costume oriental ; il va chez le barbier pour se faire couper les cheveux ; il loue une maison dans le quartier franc pour éviter de loger à l’hôtel, comme le ferait un « touriste » (le mot existe déjà et commence à prendre les connotations négatives qu’il conservera ensuite largement chez les écrivains dits voyageurs13) ; enfin – et je reviens maintenant à notre objet principal –, le narrateur se rend au marché aux esclaves, où il achète finalement Zeynab, croyant ainsi se conformer au code culturel en vigueur. Le fait que cet épisode, qui met en scène de nombreux malentendus culturels, soit finalement un échec qui comporte une dimension humoristique et même auto-ironique, n’enlève rien au fait que le lecteur, par le biais des « Femmes du Caire », suit imaginairement le narrateur dans les ruelles de la capitale et même dans ses marges (bazar, cafés, jardins...). L’Orient nervalien, en réalité, n’est pas « vide », comme le disait Said, il déborde au contraire d’êtres et de choses qui font signe – mais il est vrai que cette apparente « plénitude » est souvent trompeuse.
16Le caractère incomplet, et donc problématique, de l’analyse saïdienne du Voyage en Orient, doit-il nous conduire à rejeter l’ensemble de son essai fondateur, L’Orientalisme, comme le font par exemple François Pouillon et Jean-Claude Vatin dans leur ouvrage collectif au titre programmatique, Après l’orientalisme. L’Orient créé par l’Orient14 ? Je ne le pense pas. Said nous a obligés à penser ce qui avait été justement un grand impensé des études littéraires, et qui l’est resté assez longtemps en France, à savoir leur lien avec l’impérialisme occidental, donc avec les rapports de domination. La question, aujourd’hui, n’est pas de savoir si Nerval contribue ou non à légitimer la domination coloniale de l’Occident sur l’Orient – question à laquelle il faut se garder, à mon sens, de répondre par oui ou par non. Nerval est profondément ouvert à l’altérité, et même aux formes multiples d’altérité, ainsi en ce qui concerne les religions. Il n’empêche que son récit de voyage est traversé par des discours raciologiques contemporains, et notamment par des représentations négrophobes, telles qu’elles apparaissent dans la scène du marché aux esclaves. Ne pas le reconnaître, c’est du même coup, me semble-t-il, risquer de faire l’impasse sur nos propres « taches aveugles », comme s’il n’était pas si grave, finalement, de comparer un Noir à un singe, au motif que bien des écrivains et des scientifiques le faisaient au xixe siècle. Il ne s’agit pas de s’ériger en tribunal, mais de comprendre – et, pour cela, il faut dans un premier temps reconnaître ce qui, pour nous, aujourd’hui, pose problème. Au lieu d’essayer de « sauver » Nerval en en faisant un féministe avant la lettre (Claude Pichois), ou de le condamner en pratiquant une surenchère saïdienne (Roger Botte), mieux vaut se demander pourquoi l’empathie du narrateur du Voyage en Orient ne porte que sur une esclave blanche et non sur les noires – lesquelles sont rejetées dans l’animalité, voire dans la « choséité15 », ce qui justifie du même coup le traitement qu’on leur impose, même si le narrateur nervalien cherche à le banaliser en assurant (c’est un topos qu’on retrouve chez nombre de voyageurs) que l’esclavage oriental serait plus doux que l’esclavage américain, comme on le voit à la fin du chapitre intitulé « Abd El-Kérim »16.
17En somme, ce que je voudrais montrer, c’est que même les réticences dans la reconnaissance de l’existence de discours raciologiques que j’ai pu mettre en évidence, chez les différents commentateurs des éditions successives du Voyage en Orient de Nerval, sont sans doute révélatrices d’une mauvaise conscience qui naît peu à peu, de manière lente mais irréversible, en France, concernant notre propre passé, en particulier s’agissant de la traite négrière. Du silence complet, chez Jean Richer, au traitement prudent, chez Philippe Destruel, de cette question, il y a bel et bien un chemin parcouru, même s’il ne l’est pas de manière linéaire. Mon hypothèse est que l’ouvrage L’Orientalisme, même s’il n’est pas explicitement cité, a quelque chose à voir avec cette progressive réévaluation du traitement idéologique d’une scène comme celle du marché aux esclaves. Si Said n’a pas analysé lui-même cette scène, et si son commentaire sur l’ensemble du Voyage en Orient de Nerval peut nous apparaître à la fois insuffisant et partial, il serait dommage de nier son rôle d’incubateur dans les débats qui nous occupent actuellement. J’ai moi-même passé suffisamment de temps à le nuancer, pour pouvoir reconnaître ma dette à l’égard de ce grand critique américain d’origine palestinienne, ne serait-ce que dans le choix que j’ai fait, dès 2009, d’organiser à Lyon un premier colloque sur « Littérature et esclavage17 », un sujet qui était alors encore relativement neuf en France, du moins en littérature française.
*
18Je pense qu’il est très nécessaire, aujourd’hui, d’aborder une thématique comme celle-ci, dans la recherche comme dans l’enseignement, d’ailleurs. Certes, il est toujours important de contextualiser notre objet. En ce sens, il faut rappeler que la négrophobie nervalienne n’est pas un cas unique : on trouverait des exemples similaires, à la même époque, dans le récit de voyage en Algérie de Gautier, ou dans les notes et la correspondance du voyage en Orient de Flaubert et de Du Camp. De même, il ne serait pas difficile de trouver dans ce même corpus des pages antisémites, une forme de racisme qui ne fera d’ailleurs que s’aggraver à la suite du triomphe du polygénisme et du racisme biologique sous le Second Empire, avec l’Essai sur l’inégalité des races humaines de Gobineau, d’une part, et avec l’émergence de l’anthropologie physique comme discipline, dont Paul Broca sera un grand propagateur (Blanckaert, 2009). Le fait de reconnaître que des considérations racistes sont très répandues au xixe siècle, y compris chez de grands auteurs, ne doit pas nous conduire à les banaliser, encore moins à les ignorer.
19Posons enfin la question de la manière suivante : que doit penser un lecteur noir, aujourd’hui, lorsqu’il lit ce passage déjà cité, et que je reprends de manière plus complète, à propos des « négresses » esclaves dans le Voyage en Orient ?
À voir ces formes malheureuses, qu’il faut bien s’avouer humaines, on se reproche philanthropiquement d’avoir pu quelquefois manquer d’égards pour le singe, ce parent méconnu que notre orgueil de race s’obstine à repousser. Les gestes et les attitudes ajoutaient encore à ce rapprochement, et je remarquai même que leur pied, allongé et développé sans doute par l’habitude de monter aux arbres, se rattachait sensiblement à la famille des quadrumanes. (Nerval, éd. J. Guillaume et C. Pichois, 1989, p. 325).
20Croit-on vraiment que l’argument de la proximité entre l’homme et les grands singes, qui faisait en effet l’objet de débats à cette époque18, atténuera la blessure causée par cette comparaison en réalité volontairement dégradante pour les Noirs, comme le montre l’ensemble de cet épisode ? Ne pas proposer la moindre note, ni la moindre discussion sur cette question, dans le paratexte, comme c’est le cas chez les éditeurs des deux éditions dans la « Pléiade » du Voyage en Orient, ne peut-il pas être le signe, pour un lecteur de la jeune génération, d’une acceptation tacite de ce discours négrophobe ? Bien sûr, ni Jean Richer ni Claude Pichois ne sont là pour répondre, et il est difficile de leur attribuer des intentions à partir de ce que j’interprète comme une absence, un silence19. Mais en termes d’effets de sens, je pense que le fait de ne pas entrer dans ce débat, ou de le faire de manière timide (Jacques Huré), ou encore de le faire de manière ambiguë (Philippe Destruel), avec la volonté d’atténuer la critique du grand auteur dont on veut embellir la mémoire (ce dont il n’a nul besoin : Nerval est aujourd’hui « canonisé ») – toutes ces stratégies éditoriales ne contribuent pas à la compréhension d’un monde qui doit se penser désormais de manière globale. D’ailleurs, reconnaître la banalité du racisme négrophobe au xixe siècle ne doit pas non plus faire oublier qu’il y a de grandes exceptions à cela, et même de manière précoce, ainsi l’admirable nouvelle de Claire de Duras, Ourika (1823), qui en est clairement une dénonciation, même s’il ne s’agit pas d’en faire un texte abolitionniste20. Il est donc nécessaire de prendre en compte la pluralité des voix, donc la complexité d’un siècle qu’il ne faut certainement pas rejeter, mais expliquer – un siècle dont nous sommes sans doute encore les héritiers, parfois pour le meilleur (une réflexivité critique), parfois pour le pire (des préjugés racistes).