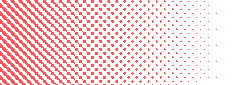« Ah ! Je t’arracherai cette langue importune. » Parole et violence dans La Place Royale, Le Menteur et La Suite du Menteur
1Parmi les quelques différences qui distinguent La Suite du Menteur de la comédie de Lope de Vega dont elle est adaptée, Amar sin saber a quién, la plus importante est peut-être la toute première. La pièce espagnole s’ouvre sur le duel au cours duquel Don Fernando abat Don Pedro sous le regard inquiet de Don Juan – le Dorante de la Suite du Menteur. Dans la version française, Corneille ne conserve pas la scène de duel. Quand la pièce commence, le combat a déjà eu lieu, il ne sera jamais représenté sur la scène, et le meurtre du jeune Florange n’apparaîtra nulle part ailleurs que dans un discours rapporté.
2Dans l’« Avis au lecteur » du Menteur, Corneille reconnaît vouloir « habiller » les pièces espagnoles dont il s’inspire « à la française » (Corneille [1644], 2010, p. 285) pour les « accommoder à notre usage » (p. 287). Or, ces adaptations sont aussi l’expression d’une autre vision du théâtre qui fait primer les paroles sur les actes. Dans les comédies de Corneille, les personnages sont des orateurs dont la puissance d’agir est d’abord incarnée par les mots. Pas besoin de coups d’épée : tout s’ordonne selon les règles du débat et l’art de bien parler. C’est l’éloquence qui est chargée de régler les conflits.
3Il semble en cela que le théâtre de Corneille et la société qu’il dépeint illustrent avec pertinence la théorie que le sociologue allemand Norbert Elias appelle la civilisation des mœurs ou le processus de civilisation1. D’après ses observations, les différences économiques et culturelles entre la noblesse et les classes laborieuses bourgeoises en France ont commencé à se lisser dès la fin du XIVe siècle. Cet infléchissement du champ socio-économique a entraîné d’importantes modifications de l’habitus de cour et des comportements. D’abord, une horizontalisation des rapports sociaux qui induit une plus grande mobilité économique et culturelle, notamment en milieu urbain. La volatilité des destins économiques individuels et familiaux brise la hiérarchie figée qui permettait à la noblesse d’exercer un pouvoir incontestable sur le reste des masses. Dès lors, les rapports sociaux se traduisent par une plus grande fluidité. Il n’est pas rare que, de génération en génération, des familles de notables bourgeois s’élèvent socialement et revendiquent pour elles-mêmes la déférence qu’elles concédaient à leurs seigneurs. Ainsi, au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècles,
[l]a bourgeoisie de cour et l’aristocratie de cour parlaient toutes deux le même langage, lisaient les mêmes livres, pratiquaient, selon une certaine hiérarchie, les mêmes règles de convenance […] : les conventions de style, les formes de la civilité, l’éducation de la sensibilité, l’importance attribuée à la courtoisie, au beau langage et à l’art de la conversation, les soins apportés à l’élocution, tout cela s’est élaboré en France d’abord à l’intérieur de la société de cour, avant de s’intégrer au caractère national. (Elias [1939], 2002, p. 78-79)
4Cette progression du raffinement et de la civilité de cour dans les milieux bourgeois a eu pour principal effet de limiter la violence et les pulsions dans les rapports sociaux. Au début de la Renaissance, les seigneurs et les classes guerrières sont graduellement dépossédés de la violence, qui était un de leurs principaux attributs, en vue de sa « monopolisation » (Elias [1939], 2009, p. 181-202) : c’est-à-dire pour favoriser la constitution d’une force étatique mandataire d’une violence dite « légitime » (pour reprendre le mot d’Émile Durkheim), désincarnée donc irrévocable et incorruptible.
5On passe d’une féodalité médiévale dans laquelle la violence participait de l’organisation de la société, dans laquelle il était normal – et même joyeux, dans certaines situations2 ! – de soumettre, de tuer, de torturer, à une sociabilité dans laquelle il est nécessaire que le citoyen observe une forme d’autocontrainte, c’est-à-dire qu’il refoule ses instincts et s’astreigne à la neutralité affective pour le maintien des bonnes relations d’interdépendance, réciproques et nécessaires :
[La maîtrise de l’affectivité] a été conditionnée comme toutes les autres manifestations pulsionnelles par l’état avancé du partage des fonctions, par la dépendance plus marquée de l’individu envers ses semblables et envers l’appareil technique ; elle a été émoussée et limitée par une infinité de règles et d’interdictions qui se sont ainsi transformées en autant d’autocontraintes. (Elias [1939], 2002, p. 421)
6Dans les comédies de Corneille, la parole est le vecteur de cette intelligence sociale qui permet de reconnaître ses pairs et d’être reconnu d’eux, de se positionner dans la hiérarchie des valeurs, de résoudre les conflits et de dissiper les ambiguïtés. L’idéal chevaleresque qui ordonnait la société médiévale est toujours là ; il s’est simplement déplacé dans la parole. Au sein des cercles de jeunes urbains qui gravitent près de la Place Royale ou de la Place Bellecour, ce sont donc bien les mots – et non plus les épées – qui donnent le moyen d’assurer son maintien individuel et, partant, la cohésion du groupe social. C’est la parole, devenue mandatrice de la violence, qui hiérarchise les rapports sociaux : qui a le droit de parler, qui est favorisé par son usage de la langue, qui a le droit de faire taire les autres.
7D’un point de vue stylistique, il est donc intéressant de s’attacher à comprendre quelle distribution des rôles sociaux les mots instituent, quelles formes de dominations ils perpétuent, renouvellent ou inaugurent, quelles souffrances ils peuvent potentiellement infliger. Mais surtout, il est capital – au vu des enjeux qu’elle soulève – de s’interroger sur ce qu’il se passe lorsque la parole déraille, ou échoue à remplir son rôle socialisant et pacificateur. C’est à ce moment-là que le spectateur voit surgir une violence que la société du XVIIe siècle pouvait croire expurgée.
8Nous commencerons par analyser les marques visibles de la violence dans le langage : choix des mots, dispositio et elocutio, intentions pragmatiques des personnages. Nous verrons ensuite que la parole peine parfois à se substituer à la violence et que les excès de l’affectivité font parfois dérailler la parole. Enfin, nous terminerons en envisageant la question dans l’autre sens : que se passe-t-il lorsque la parole est insuffisante et que la brutalité l’emporte sur les discours ? Et comment la parole renégocie-t-elle la domination violente après-coup ?
I. Les mots qui blessent
9Pour aller au plus évident, il est clair que, dans La Place Royale, Le Menteur et La Suite du Menteur3, la violence est d’abord l’apanage des hommes. Sans surprise, elle met en scène la volonté d’imposer, à soi-même et aux autres, une forme de virilité chevaleresque et autoritaire.
10Dans Le Menteur et La Place Royale, Dorante et Alidor ne cessent de fantasmer une violence qu’ils ne mettent jamais à exécution. Par ses mensonges, Dorante jouit de s’imaginer en homme violent et dominateur : le récit de ses exploits guerriers en Allemagne (M, I, 3, p. 46-48), sa rocambolesque histoire de sérénade ratée (M, II, 5, p. 78-80) et la rumeur très vite contrariée de sa victoire en duel contre Alcippe (M, IV, 1, p. 109-110). Ses mensonges dévoilent une sensibilité exacerbée et incivile, quelque part entre un imaginaire aristocratique qui valorise la brutalité chevaleresque, l’honneur viril et l’immaturité de l’adolescent qui se rêve en un genre d’hidalgo, embarqué dans des intrigues picaresques.
11Dans La Place Royale, Alidor ment lui aussi. Il parodie le discours pastoral cher à l’imaginaire d’Angélique et feint le suicide d’honneur quand il apprend qu’elle a accepté Doraste :
ALIDOR. – Aussi ne viens-je pas pour regagner votre âme,
Préférez-moi Doraste, et devenez sa femme.
Je vous viens, par ma mort, en donner le pouvoir.
Moi vivant votre foi ne le peut recevoir,
Elle m’est engagée, et quoi que l’on vous die,
Sans crime elle ne peut durer moins que ma vie.
Mais voici qui vous rend l’une et l’autre à la fois. (PR, III, 6, p. 132-133)
12Le bluff d’Alidor crée une dynamique tout à fait intéressante. Il tire son épée : seule sa mort peut signer l’union d’Angélique avec Doraste. La tension de la scène tient dans l’ambiguïté de ses sentiments : à ce stade, les spectateurs ne savent pas précisément à quel point il tient à la jeune femme et peuvent se demander si son geste est sérieux. Quoiqu’il en soit, en faisant spectacle de cette violence a priori factice (mais qui ne l’est peut-être pas), il dissimule la violence qu’il exerce réellement : celle de sa domination sur les sentiments d’Angélique.
13Un peu plus tôt dans l’acte III, Cléandre a lui aussi appris la nouvelle : Doraste a obtenu la main d’Angélique qui devait lui revenir. Dans les deux scènes qui suivent, Cléandre blâme son manque de virilité. Il n’a pas su affronter Doraste et doit se contenter de mots pour remplacer les actes qu’il n’a pas commis : « Que faisiez-vous mes bras ? Que faisiez-vous ma lame ? » (PR, III, 3, p. 123) ; « Si Doraste a du cœur il faut qu’il la défende, / Et que l’épée au poing il la gagne, ou la rende » (PR, III, 4, p. 127). Cléandre a fauté par impuissance et se sent, de fait, dévirilisé : il s’est d’abord montré incapable de s’imposer par la parole pour obtenir Angélique, puis incapable de s’imposer par la violence contre Doraste. Les tournures interrogatives rendent cette tension évidente : Cléandre ne parvient même pas à être l’acteur de sa vengeance, il est en position de spectateur qui interroge son « bras » et sa « lame » et attend qu’ils le vengent à sa place, comme s’il s’agissait d’acteurs dissociés de lui-même.
14Contrairement à ces trois garçons immatures, Alcippe et Géronte, dans Le Menteur, incarnent une violence plus authentiquement virile. Chez eux, la parole n’est pas un substitut de la violence physique, elle l’annonce. Ainsi disent Alcippe à Clarice et Géronte à Dorante :
ALCIPPE. – Je cours à la vengeance, et porte à ton amant
Le vif et prompt effet de mon ressentiment.
S’il est homme de cœur, ce jour même nos armes
Régleront par leur sort tes plaisirs ou tes larmes,
Et plutôt que le voir possesseur de mon bien,
Puissé-je dans son sang voir couler tout le mien […]. (M, II, 4, p. 73)
GÉRONTE. – Je jure les rayons du jour qui nous éclaire
Que tu ne mourras point que de la main d’un père,
Et que ton sang indigne à mes pieds répandu
Rendra prompte justice à mon honneur perdu. (M, V, 3, p. 141)
15Ce sont des menaces qui visent à impressionner et à effrayer ; mais elles ont aussi un effet comique car elles sont à chaque fois désamorcées. Alcippe profère à Clarice la menace de la séparer pour toujours de son amant… mais elle vient de quitter son balcon et Alcippe parle dans le vide. Il confronte ensuite Dorante physiquement au début de l’acte suivant (M, III, 1, p. 85-86)… mais il renonce à la querelle après quelques mots creux de son ami. Géronte profère ses menaces comme un roi de tragédie… mais Dorante confie dans la foulée à Cliton qu’il « crain[t] peu les effets d’une telle menace » (M, V, 4, p. 142).
16Dans La Suite du Menteur, le puéril Dorante a mûri : il utilise désormais ses talents de menteur, non pour fantasmer et raconter une violence imaginaire, mais pour couvrir la violence bien réelle du meurtre de Florange par Cléandre (SM, I, 4, p. 182). En dissimulant ce crime d’honneur derrière son mensonge, il approche d’une forme de virilité. Du moins, il crée avec Cléandre une forme de connivence virile qui relève de l’intelligence sociale. Reconnaître en lui un « homme de courage » (SM, I, 4, p. 183), c’est s’attribuer le partage de cette même valeur.
17La violence de la parole des femmes est de nature différente : elle est plutôt la marque visible des outrages qu’elles subissent et de leur impuissance à y répondre. Là où la violence verbale masculine se caractérise comme la projection fantasmée d’une confrontation ou d’une domination physique, la violence verbale féminine cherche au contraire à signaler une impuissance, à alerter les interlocuteurs (et surtout : les spectateurs !) sur le sort qui leur est fait. L’éloquence féminine est donc marquée par une expressivité pathétique qui les fait ressembler à des héroïnes de tragédie ou par une parole plus directement injurieuse :
CLARICE. – Je ne puis plus souffrir une telle impudence,
Après ce que j’ai vu moi-même en ma présence,
Vous couchez d’imposture, et vous osez jurer,
Comme si je pouvais vous croire, ou l’endurer !
Adieu : retirez-vous […] (M, III, 6, p. 103)
MÉLISSE. – C’est à Philiste donc que vous m’abandonnez ?
Ou plutôt c’est Philiste à qui vous me donnez ?
Votre amitié trop ferme, ou votre amour trop lâche,
M’ôtant ce qui me plaît, me rend ce qui me fâche ? (SM, V, 3, p. 272)
LYSE. – Eh quoi ! pauvre ignorant, ne sais-tu pas encore
Qu’il faut suivre l’humeur de celle qu’on adore,
Se rendre complaisant, vouloir ce qu’elle veut ? (SM, V, 2, p. 266)
18Dans un sens, les répliques des femmes sont plus démonstratives et véhémentes. Elles n’annoncent pas de projet de duel ou de confrontation ; elles clament leur indignation, elles interpellent directement leurs adversaires, elles interrogent la cruauté de leurs amants, leur égoïsme et la déloyauté de leurs comportements. Cette combattivité verbale est la démonstration de l’état d’impuissance qui caractérise leur position sociale. Incapables de se faire justice par la violence (ou même de menacer de le faire) elles utilisent la parole pour faire plier les hommes et peut-être retrouver une forme d’agentivité, de contrôle sur leurs vies. Les femmes de comédie sont en cela bien différentes des femmes de tragédie comme Médée ou la Cléopâtre de Rodogune, ou de certaines tragicomédies, comme la sournoise Dorise de Clitandre.
19Au niveau lexical, la parole est marquée par les intentions guerrières qu’elle assume. Au XVIIe siècle, le lexique usuel de l’éloquence est parsemé de métaphores militaires qui signalent sa qualité pragmatique. Pour revenir aux travaux de Norbert Elias, ces termes s’inscrivent dans le processus de civilisation des cercles mondains que Corneille représente dans ses comédies. La vie mondaine est faite de joutes et d’accrochages, de rivalités, de compétitions et de rapports de forces. Les débordements affectifs qui menaient aux rixes et aux meurtres ont été abolis par la civilisation renaissante ; c’est désormais sur le terrain du débat et des mots qu’il convient de s’affronter.
20On ne sera donc pas surpris de trouver, chez les personnages de Corneille, le lexique commun à l’éloquence et aux arts militaires. On y trouve des termes d’archerie et d’escrime comme « trait » et « pointe ». « Trait », chez Furetière, « se dit […] de ce qu’on pousse, de ce qu’on chasse au loin par quelque arme ou machine », mais aussi « particulierement de la flesche qui se tire avec l’arc ordinaire. » (Furetière, 1690) La « pointe » est géométriquement l’« [e]xtrémité d’un corps ou d’une figure où aboutissent toutes ses lignes ou ses surfaces » ; de ce fait, « les espées, poignards, piques, hallebardes, canifs, poinçons aboutissent en pointes aiguës ». D’ailleurs, Furetière précise qu’« [i]l est plus dangereux d’estre frappé de la pointe que du taillant » (ibid.). Ce vocabulaire, propre à la sociabilité aristocratique et bourgeoise du XVIIe siècle, est donc omniprésent chez les jouteurs que sont les personnages de nos trois comédies. Quelques exemples (nous soulignons) :
CLÉANDRE. – On me joue, on me brave, on me tue, on s’en rit,
L’un me vante son heur, l’autre son trait d’esprit,
L’un et l’autre à la fois me perd, me désespère,
Et je puis épargner ou la sœur ou le frère. (PR, III, 3, p. 123)
DORANTE. – Pas deux mots ;
Et tu ne viens d’ouïr qu’un trait de gentillesse
Pour conserver mon âme et mon cœur à Lucrèce. (M, II, 6, p. 81)
DORANTE. – Je me suis bien défait de ces traits d’écolier4
Dont l’usage autrefois m’était si familier ;
Et maintenant, Cliton, je vis en honnête homme. (SM, I, 1, p. 167)
CLÉANDRE. – C’est le plus généreux qui jamais ait vécu ;
C’est le cœur le plus noble, et l’âme la plus haute...
MÉLISSE. – Quoi ? Vous voulez, mon frère, ajouter à sa faute,
Percer avec ces traits un cœur qu’il a blessé,
Et vous-même achever ce qu’elle a commencé ? (SM, II, 2, p. 195)
ALIDOR. – Vous êtes en colère, et vous dites des pointes. (PR, II, 2, p. 105)
ALIDOR. – Que Clarine vous die à la première vue,
Si jamais de mon change elle s’est aperçue ;
Aussi mon compliment flattait mal ses appas,
Il vous offensait bien, mais ne l’obligeait pas,
Et ses termes piquants, mal conçus pour lui plaire,
Au lieu de son amour, cherchaient votre colère. (PR, III, 6, p. 132)
21Le lexique de l’éloquence au XVIIe siècle se compose aussi de termes de lutte et de pugilat. « Touche », par exemple, qui « signifie […] l’action de frapper, de faire impression violente sur quelque chose », ce qui justifie que « [l]es gens craintifs craignent la touche » (Furetière, 1690). Évidemment, le mot « coup », désigne le « [m]ouvement violent d’un corps grave & solide, qui tombe sur un autre, & qui le frappe », mais signifie aussi « quelquefois, Tour subtil, adresse, promptitude à faire quelque chose ». Quelques exemples (là encore, nous soulignons) :
GÉRONTE. – Quoi ? Des contes en l’air et sur l’heure inventés ?
DORANTE. – Non, la vérité pure.
GÉRONTE. – En est-il dans ta bouche ?
CLITON, à Dorante. – Voici pour votre adresse une assez rude touche. (M, V, 3, p. 139-140)
CLITON. – Obligez, Monsieur, votre valet :
Quand vous voudrez jouer de ces grands coups de maître5,
Donnez-lui quelque signe à les pouvoir connaître ;
Quoique bien averti, j’étais dans le panneau. (M, II, 6, p. 82)
CLITON. – Cette métamorphose est de vos coups de maître (SM, III, 5, p. 234)
MÉLISSE. – Hélas ! Tout ce discours ne sert qu’à me confondre.
Je n’y puis consentir, et ne sais qu’y répondre.
Mais je découvre enfin l’adresse de vos coups :
Vous parlez pour Philiste, et vous faites pour vous. (SM, V, 3, p. 273)
22Tous ces termes sont polysémiques et possèdent un sens figuré attesté à l’époque qui les relie très clairement à l’art oratoire. Ainsi, « trait » et « pointe » se disent « figurément en choses spirituelles & morales », « touche » aussi « se dit figurément en choses morales » : « [i]l y avoit de beaux traits d’eloquence dans ce sermon », « [l]es pointes6 sont des equivoques, & des jeux d’esprit », ou bien « il a esté malade à l’extrémité, il a perdu un grand procès, ce sont de rudes touches qu’il a souffertes ». « Coup », enfin, « se dit encore figurément des attaques qui se font par le discours » (Furetière, 1690).
23Il est donc très clair que, dans les cercles mondains que dépeint Corneille, la parole est une arme. Malgré de réelles divergences sur la forme, la valeur des mots, dans ses comédies, rejoint sur le fond les théories des Espagnols qu’il adapte et dont les pièces, de l’autre côté des Pyrénées, servent de base au déploiement de la philosophie politique de Baltasar Gracián. Pour Gracián, les mots sont des outils pragmatiques qui ont le pouvoir de modifier le réel politique mieux que les actes : « Un entendement sans pointe ni piquant est un soleil sans lumière, sans rayons ; et pour briller au ciel, ceux des astres en sont que matériels auprès de ceux de l’esprit. » (Gracián [1648], 2005, p. 440) Une bonne « pointe » peut vaincre un adversaire mieux qu’une épée, un « trait » peut dissuader un rival mieux qu’une flèche dans la cuisse. Une « touche » bien placée ou un « coup de maistre » peut laver un déshonneur ou conquérir des cœurs mieux qu’un acte héroïque. L’éloquence pointue est d’ailleurs l’apanage du héros, c’est le signe manifeste d’une vertu qui se signale d’abord et surtout par les mots :
Tout comme il y a des sentences qui expriment la profondeur de l’esprit, une intelligence substantielle, il y a des dits héroïques qui manifestent avec excellence la grandeur de la valeur, la vaillance du cœur et la généreuse majesté d’une grande âme. La grande capacité se manifeste dans celles-là, le courage dans ceux-ci, dignes mots des héros. […] L’éminence de ces apophtegmes consiste à faire apprécier quelques majestueuses vertus et plus cette dernière est excellente, plus digne le mot d’une immortelle estimation. […] Bien que l’éminence de ces sentences se trouvent davantage dans la manifestation de la grandeur d’âme et de l’élévation du cœur, elles sont malgré tout relevées par l’acuité du concept qui redouble ainsi leur perfection. (Gracián [1648], 2005, p. 585-586).
24Si la parole permet d’attaquer et de se défendre efficacement, c’est évidemment qu’elle peut faire souffrir. Prenons l’exemple de Mélisse dans le dernier rebondissement de La Suite du Menteur :
DORANTE. – Puis-je voir tant d’amour avec tant de mérite,
Et dire sans mourir qu’il faut que je vous quitte ?
MÉLISSE. – Vous me quittez ! Ô ciel ! Mais, Lyse, soutenez :
Je sens manquer la force à mes sens étonnés. (SM, V, 3, p. 270)
25Non seulement la phrase de Dorante est performative (Austin [1955], 1991, p. 41-42) – elle produit l’action qu’elle désigne : dire qu’il quitte Mélisse revient à la quitter – mais elle provoque en plus un effet réel : l’« étonnement » de Mélisse. Cette même faculté d’affecter qu’ont les mots permet aussi à Dorante d’échafauder son premier mensonge à Clarisse : « Nommer quelques châteaux, de qui les noms barbares / Plus ils blessent l’oreille, et plus leur semblent rares. » (M, I, 6, p. 59) Pour le jeune menteur, les mots sont dotés d’une qualité sensible qui participe de son art poétique du mensonge car ils agissent dans le discours. Leurs vibrations causent des effets physiques : ici, celui d’égratigner, de créer une friction qui suscite le rejet, puis aiguillonne la curiosité.
II. Les excès du pathos : une poétique de l’emportement
26Les mots produisent donc des effets réels, ce qui les autorise à se substituer à la violence physique. Mais ceci n’est vraiment opérant que dans la mesure où les personnages sont aptes à s’exprimer clairement et civilement. Or, les trois comédies que nous étudions montrent que, parfois, la parole déraille et échoue.
27Le début de l’acte II de La Place Royale constitue un moment-pivot de l’intrigue : Angélique vient de découvrir le faux billet écrit par Alidor à Clarine. C’est la première étape du plan qui doit ensuite la pousser dans les bras de Cléandre. La réaction d’Angélique est spectaculaire : furieuse, elle tonne contre Polymas, simple pion dans le stratagème de son maître, et s’emporte contre son amant. Sa colère est telle qu’elle affecte la syntaxe et la prosodie dans son discours. Par exemple, dans la dernière réplique de la scène 1, alors que Polymas la laisse seule sur scène, Angélique laisse libre cours à une parole passionnée et tourbillonnante, dans laquelle elle dénonce la trahison des fables dont elle est la victime :
ANGÉLIQUE. – Mes feux, il est donc vrai que l’on vous a trahis,
Et ceux dont Alidor paraissait l’âme atteinte
Ne sont plus que fumée, ou n’étaient qu’une feinte !
Que la foi des Amants est un gage pipeur !
Que leurs serments sont vains, et notre espoir trompeur !
Qu’on est peu dans leur cœur pour être dans leur bouche !
Et que malaisément on sait ce qui les touche,
Mais voici l’infidèle, ah ! qu’il se contraint bien [!] (PR, II, 1, p. 101)
28Le retour du mot « que » est intéressant : la première conjonction de subordination se confond ensuite avec les adverbes de négation restrictive et les adverbes exclamatifs. Les propositions de différentes natures s’ajoutent les unes aux autres sur un rythme de plus en plus resserré. La phrase semble enfler jusqu’à la saturation – ou du moins jusqu’à l’entrée d’Alidor qui rompt l’emballement du monologue. Cette même rhétorique se prolonge dans la confrontation de la scène suivante. Elle prend un aspect pathétique avec le vocatif « Ciel », suivi de la gradation « il + verbe » qui étouffe le « je » d’Angélique :
ANGÉLIQUE. – Ciel, tu ne punis point des hommes si méchants !
Ce traître vit encore, il me voit, il respire,
Il m’affronte, il l’avoue, il rit quand je soupire. (PR, II, 2, p. 104)
29Du point de vue de la prosodie, on entend le piège d’Alidor qui se referme sur elle : là aussi, le rythme gonfle et enfle jusqu’à la recouvrir. La violence de tant de colère peine à être contenue, Angélique est si furieuse qu’il semble que les phrases et les propositions se bousculent et que, finalement, les mots lui manquent pour dire toute sa rage et toute la scélératesse de son amant :
ANGÉLIQUE. – Eh bien, ta trahison est-elle en évidence ?
ALIDOR. – Est-ce là tant de quoi ?
ANGÉLIQUE. – Tant de quoi ! L’impudence !
Après mille serments il me manque de foi,
Et me demande encore si c’est là tant de quoi ! (PR, II, 2, p. 103-104)
30Angélique se laisse emporter : elle interrompt la réplique d’Alidor et coupe le vers en deux en reprenant ses mots. Sa réplique prend alors la forme d’une épanadiplose qui fait revenir le premier élément à la fin. Sa misère est sans issue face à l’insensibilité d’Alidor, son discours se mord la queue.
31Ces dérèglements de la parole ne sont pas que le fait d’Angélique. On constate parfois que les personnages sont emportés par la violence des mots et des discours et qu’ils semblent perdre la faculté à s’exprimer avec la modération que la bonne civilité exige. Cela commence, dans La Place Royale, par des scènes dans lesquelles l’hétérométrie déséquilibre le rythme mesuré et régulier des alexandrins7. On remarque des stances hétérométriques dans deux monologues : le premier monologue de Cléandre (PR, I, 3, p. 91-92) – qui nous fait découvrir un jeune homme perdu dans la tempête de ses émotions, perdu entre sa loyauté envers Alidor et sa passion pour Angélique – et le second monologue d’Angélique à l’acte III (PR, III, 5, p. 129), toujours ébranlée par la résolution d’Alidor. Comme pour les billets, le passage à l’hétérométrie signale une rupture énonciative. La parole n’est pas celle – construite et raisonnée – de la conversation civile, elle est celle – intérieure et débridée – des pensées, de l’introspection. C’est aussi là qu’on voit la place que prennent les sentiments dans la psychologie des personnages et la violence qu’ils exercent sur eux : le cadre purement subjectif du monologue n’est pas celui, rationaliste, de la conversation civile, il est modelé par l’intensité des émotions.
32Le dérèglement de la parole transparaît aussi dans le second monologue de Cléandre, que nous avons déjà mentionné. Le jeune homme vient de découvrir que Doraste l’a devancé auprès d’Angélique. Hébété, il entend d’abord diriger sa colère contre Doraste, mais la violence de ses sentiments se retourne contre lui-même. Il exprime son désespoir sur un mode pathétique. Le monologue est jonché de tours rhétoriques de répétition, mais la pallilogie des vers 696-697 est d’une autre nature : « C’était, c’était tantôt qu’il fallait t’exciter, / C’était, c’était tantôt qu’il fallait m’emporter. » (PR, III, 4, p. 125) Comme Angélique plus tôt, Cléandre perd la raison en même temps qu’il perd ses mots. Cette colère – qui reste inexprimée, qui ne parvient pas à se convertir en violence physique – change le discours articulé en bégaiement.
33Plus encore, il arrive aussi que la conversation se dissolve dans le cri et que les phrases exclamatives construites cèdent la place à des suites d’interjections ou à des phrases incomplètes qui traduisent une violence brute qui échoue à se convertir en discours. C’est notamment le cas dans Le Menteur, lorsqu’Alcippe – qui se croit trahi par Clarice à cause des mensonges de Dorante – se met à crier sous le coup de l’indignation :
ALCIPPE. – Ah, Clarice ! ah, Clarice ! inconstante, volage !
CLARICE. – Aurait-il deviné déjà ce mariage ?
Alcippe, qu’avez-vous ? qui vous fait soupirer ?
ALCIPPE. – Ce que j’ai, déloyale ! et peux-tu l’ignorer ?
Parle à ta conscience, elle devrait t’apprendre...
CLARICE. – Parlez un peu plus bas, mon père va descendre. (M, II, 3, p. 67-68)
34Sa colère est trop forte, elle doit éclater, mais il ne parvient pas à la convertir en discours : c’est plutôt un appel sans réponse face à la froideur de Clarice, l’imploration d’être entendu et considéré (qui ressemble en cela beaucoup au discours féminin d’impuissance). Il faut d’ailleurs noter la réaction de Clarice qui tente de ramener Alcippe dans le cadre de la civilité. Elle veut non seulement l’empêcher de réveiller son père, mais aussi et surtout éviter qu’il ne cède à l’épanchement de son affectivité. Alcippe ne sachant s’autocontraindre, c’est Clarice qui doit le contraindre à se montrer courtois et discret, à continuer, malgré l’affront, de se conduire en galant civilisé et – peut-être de façon plus prosaïque – à ne pas réveiller les voisins pour éviter de perturber la paix sociale.
III. La menace et le silence
35Mais la demande de Clarice à Alcippe pour qu’il baisse d’un ton n’est pas non plus une injonction à se taire. Or, le commandement du silence apparaît plusieurs fois dans les trois comédies et n’est jamais un acte gratuit. On peut même dire que – dans le cadre du théâtre cornélien de la conversation, fait d’intrigues qui ne sont nouées et dénouées que par le dialogue – l’imposition du silence est peut-être la plus haute forme de la domination. Faire taire son interlocuteur est bien entendu une marque d’autorité, une façon de cimenter, par le discours pragmatique, un ordre familial ou social. C’est, par exemple, la façon dont Angélique parvient à se faire immédiatement obéir lorsqu’elle exige sèchement de Polymas qu’il se taise et disparaisse de sa vue après qu’il lui a remis le faux billet :
POLYMAS. – C’est d’elle désormais que je tiendrai la vie.
ANGÉLIQUE. – As-tu de la garder encore quelque envie ?
Ne me réplique plus, et va-t’en.
POLYMAS. – J’obéis. (PR, II, 1, p. 101)
36Angélique vient de faire l’expérience d’une terrible défaite et d’une insupportable déception : elle est vaincue et pourtant elle conserve toute autorité sur Polymas. On le voit, la parole est une extension du pouvoir qu’elle tire de sa position sociale. Au fond, la violence du discours est à rapprocher ici de ce que la sociologie bourdieusienne nomme violence symbolique (Bourdieu, 1997, p. 235-275). La violence d’Angélique n’est pas celle d’une menace physique, elle est incarnée dans sa position sociale, sa situation dans le système hiérarchique qui la relie à Polymas et la distingue de lui. Cette forme moderne de violence – une violence qui s’exerce sans jamais avoir à se réaliser (et qui est encore récente au XVIIe siècle) – se traduit immédiatement par l’obéissance, sans aucune contestation de la part de Polymas. Pour Pierre Bourdieu, la violence symbolique fonctionne (peut-être mieux encore que la violence réelle ou la coercition armée) parce qu’elle présuppose l’intériorisation, par les dominés, de leur soumission, qui est une participation active au système de domination : « [l]e pouvoir symbolique ne s’exerce qu’avec la collaboration de ceux qui le subissent parce qu’ils contribuent à le construire comme tel. » (p. 246)
37C’est ce même type de violence qui fait que Géronte est le seul personnage du Menteur capable de faire taire efficacement Dorante à la langue pourtant bien pendue :
GÉRONTE. – Tu n’es plus gentilhomme, étant sorti de moi.
DORANTE. – Moi ?
GÉRONTE. – Laisse-moi parler, toi de qui l’imposture
Souille honteusement ce don de la nature :
Qui se dit gentilhomme, et ment comme tu fais,
Il ment quand il le dit, et ne le fut jamais. (M, V, 3, p. 137-138)
38Dorante se vante peut-être devant Cliton du peu de pouvoir réel que son père exerce sur lui, mais il est bien contraint de ravaler sa fierté quand il se trouve exposé à sa colère. Il est d’ailleurs intéressant de noter qu’avant l’interruption de Dorante, Géronte était en train d’argumenter pour vaincre sa résistance. Mais, devant l’insolence de son fils, l’ethos prend le relais du logos : Géronte interrompt sa démonstration sur l’hérédité de la vertu et ne se repose plus que sur son autorité naturelle de père.
39Il est d’ailleurs amusant de noter l’effet-miroir comique entre Géronte et Dorante : si Géronte impose naturellement son autorité pour faire taire son fils, Dorante, lui, est démuni face à son valet. Cliton est volontiers impertinent et résiste aux injonctions de son maître.
CLITON, le tirant par la basque. – Savez-vous bien, Monsieur, que vous extravaguez ?
DORANTE. – Tais-toi.
CLITON. – Vous rêvez, dis-je, ou...
DORANTE. – Tais-toi, misérable.
CLITON. – Vous venez de Poitiers, ou je me donne au diable ;
Vous en revîntes hier.
DORANTE, à Cliton. – Te tairas-tu, maraud ? (M, I, 3, p. 47)
40Les interruptions de Cliton rompent le rythme des vers et déséquilibrent les propos de Dorante : la césure du vers 179 est décalée entre « dis-je » et « ou », et le vers s’étend sur trois répliques selon un rythme brisé (2/5/5). Les marques de frustration de Dorante sont d’ailleurs un ressort comique qui reparaît plusieurs fois dans Le Menteur et mettent l’accent sur son immaturité :
CLITON. – De grâce, dites-moi si vous allez mentir.
DORANTE, à Cliton. – Ah ! Je t’arracherai cette langue importune. (M, III, 5, p. 99)
41Dorante fait peser sur son valet la menace d’une violence féodale qui n’a plus cours au XVIIe siècle (battre et torturer un serf est un comportement tout à fait acceptable pour un seigneur du Moyen Âge8) et qui semble tout à la fois puérile, grossière et ridicule. Son incapacité à faire taire Cliton n’est pas tant la marque de l’entêtement et de la défiance de son valet que le signe d’une forme d’équivalence entre eux. Dorante manque d’autorité parce qu’il manque de vertu et se conduit comme un enfant en cédant à son affectivité : en cela, il ressemble trop à un homme de basse extraction – un homme incivil – pour pouvoir se faire obéir de Cliton.
42Au contraire, il arrive aussi que se taire, refuser de répondre, soit une marque de domination. Lors de la première altercation entre Angélique et Alidor, rien n’est plus efficace et plus cruel de la part du jeune homme que de cesser de répondre :
ANGÉLIQUE. – Quoi ? Tu ne me dis mot ! Crois-tu que ton silence
Puisse de tes discours réparer l’insolence ?
Des pleurs effacent-ils un mépris si cuisant
Et ne t’en dédis-tu, traître, qu’en te taisant ?
Pour triompher de moi veux-tu, pour toutes armes,
Employer des soupirs et de muettes larmes ?
Sur notre amour passé c’est trop te confier ;
Du moins dis quelque chose à te justifier ;
Demande le pardon que tes regards m’arrachent ;
Explique leurs discours, dis-moi ce qu’ils me cachent. (PR, II, 6, p. 131)
43Refuser de parler est une manière de rompre le contrat de civilité qui et pourtant censé l’unir – tant sur le plan des sentiments que sur celui de la condition sociale – à Angélique. Il ne faut pas comprendre le silence d’Alidor comme un signe de gêne mais bien comme une confiscation. C’est tout le pouvoir d’Alidor sur Angélique : elle attend quelque chose de lui qui ne peut advenir que par une parole pragmatique performative (Austin [1955], 1991, voir supra) : une promesse, un rachat ou au moins des excuses. Lui n’attend rien d’elle sinon la fin de la conversation.
44C’est pourquoi, lorsque c’est Angélique qui refuse de poursuivre la discussion, un peu plus tôt dans la pièce, son silence n’a pas la même valeur. Il est le signe d’une colère sourde qui manifeste là encore l’inutilité d’une réponse et son impuissance à user d’armes plus coercitives que celles des mots : « Angélique déchire la Lettre et en jette les morceaux. » (PR, II, 2, p. 104) Ce rapport contraint à la parole est commun à tous les personnages féminins, c’est d’ailleurs le même qui force Mélisse au silence à la fin de La Suite du Menteur : « Hélas ! Tout ce discours ne sert qu’à me confondre. / Je n’y puis consentir, et ne sais qu’y répondre. » (SM, V, 3, p. 273)
45Pour finir, même si nous n’avons cessé de remarquer que Corneille évacue systématiquement les actes violents au profit de discours qui s’y substituent, il faut relever une exception majeure qui englobe tous les rapports interpersonnels et systémiques que nous avons évoqués concernant la représentation de la violence. Il s’agit de la scène de l’enlèvement dans La Place Royale. Au-delà de l’immoralité de l’acte de Cléandre, c’est d’abord la question de la parole qui est posée ici. Dans la tête d’Alidor et Cléandre, l’enlèvement d’Angélique (qui s’avère par erreur être Phylis) passe nécessairement par le silence de leur victime : empêcher sa parole est une des clés principales de la réussite de leur entreprise. Alidor et Cléandre insistent tous deux sur ce point alors qu’ils fomentent leur crime :
ALIDOR. – […] Regarde après ses cris si tu serais le maître.
CLÉANDRE. – Ma main dessus sa bouche y saura trop pourvoir. (PR, IV, 2, p. 146)
46On remarquera que Cléandre choisit encore une fois la voie de la facilité qui consiste à éviter la confrontation par le discours en veillant à ce que sa victime n’ait aucun moyen de s’exprimer. Et il est tout à fait intéressant que Corneille reprenne exactement la formule de Cléandre dans la didascalie qui décrit leur forfait, en insistant sur l’enchaînement nécessaire des gestes avec l’adverbe « d’abord » :
Alidor paraît avec Cléandre accompagné d’une troupe, et après lui avoir montré Phylis, qu’il croit être Angélique, il se retire en un coin du théâtre, et Cléandre enlève Phylis, et lui met d’abord la main sur la bouche. (PR, IV, 5, p. 149)
47Pourquoi cette insistance des personnages et du dramaturge ? Après tout, l’enlèvement a lieu de nuit, dans un coin retiré. Phylis est seule et ses agresseurs sont « une troupe ». On peut penser qu’il s’agit d’un effet de réel, une manière de rendre la scène plus crédible : un cri de Phylis pourrait avertir un témoin, même s’il ne semble pas qu’il y en ait à proximité. C’est peut-être aussi un effet de dramaturgie : si Phylis avait eu le temps de crier, Cléandre et Alidor auraient pu s’apercevoir de leur méprise. Ils auraient été forcés d’abandonner leur plan et Corneille le dénouement de la pièce par le mariage.
48Mais il faut aussi se demander si la raison n’est pas pragmatique. Après tout ce que nous avons dit sur la valeur de la parole et son rôle dans la distribution sociale de la violence, il semble que laisser à la femme qu’ils enlèvent la possibilité de s’exprimer, ce serait déjà lui permettre de répliquer, de se défendre, de retourner l’arme des mots contre les bras qui la saisissent. Dans le cadre pragmatique de la parole cornélienne, qui dit qu’une bonne « pointe » ou un « trait » habile n’aurait pas permis de fléchir les ravisseurs et d’empêcher que le crime soit commis ? Si l’on en revient à la théorie de Norbert Elias, le débordement pulsionnel qui explose dans l’enlèvement, par deux hommes, de la femme qu’ils désirent ensemble (celle qu’ils croient être Angélique) ne peut advenir que dans la zone d’ombre qui exclut la civilisation, ce mode d’organisation de la société qui fait de la parole le substitut et le remède à la violence. D’ailleurs, le silence imposé à Phylis se perpétue par la suite : elle doit certes épouser Cléandre (on est bien dans une comédie), mais surtout elle doit continuer à se taire pour éviter le déshonneur :
CLÉANDRE. – […] La moitié d’une nuit passée en ma puissance
À d’étranges soupçons portent la médisance.
Cela su, présumez comme on pourra causer.
PHYLIS. – Pour étouffer ce bruit il vous faut épouser,
Non pas ? […] (PR, V, 1, p. 163)
49Le silence contraint de Phylis étend la zone d’ombre dans laquelle la violence a pu se manifester. Dans une certaine mesure, l’acte de Cléandre reste impuni, mais c’est à ce seul prix que Phylis pourrait racheter son honneur. Toutefois, en contrepartie de son silence, Cléandre, lui, va devoir enfin « tout dire » (PR, V, 1, p. 163) aux parents de la jeune femme. Il doit, pour la première fois, faire la démonstration qu’il est un homme d’honneur par sa parole. Il n’a plus le choix : il ne peut plus se taire et attendre qu’Alidor ou un autre élément extérieur (ses « bras », sa « lame ») lui sauve la mise. En cela, Phylis lui offre une voie de sortie, elle le force à tourner le dos à sa sauvagerie adolescente, à remettre la civilité à sa place. Mais c’est à lui de saisir la perche qu’elle lui tend : il devra se montrer responsable devant elle et sa famille en remettant des mots sur ses gestes puérils et barbares, mais aussi en domestiquant son désir par le mariage.
50En somme, le drame, chez Corneille, est structuré et organisé autour d’un rapport proportionnel entre la violence et la parole. La violence surgit dans des proportions parfois extrêmes quand la parole n’est pas possible ou qu’elle est empêchée et, au contraire, quand la parole intervient, elle a le pouvoir d’amender ou de réparer les actes violents. Ce paradigme d’une parole guerrière, rectrice de l’ordre social, est un des multiples signes de la civilisation des mœurs qui traverse la société aristocratique et bourgeoise du XVIIe siècle. L’honneur se solde par la capacité à parler (discourir, persuader, menacer...) et le talent d’orateur remplace celui de bretteur :
S’il est vrai que la violence physique a été bannie des relations humaines, que même le duel a été interdit par la loi9, l’homme n’en exerce pas moins sur ses semblables toutes sortes de contraintes et de violences. La vie dans cette sphère n’est pas une vie paisible. Des liens de dépendance existent entre beaucoup d’hommes. Les « affaires », les querelles et les intrigues se succèdent. Si l’épée ne force plus la décision, les cabales, les luttes, les disputes pour l’avancement et le succès social la remplacent. Pour s’imposer, il faut cultiver d’autres qualités que celles qui assurent la victoire dans les passes d’armes : la réflexion, la prévision à long terme, la maîtrise de soi, la régulation rigoureuse de son émotivité, la connaissance du cœur humain et du champ social. (Elias [1939], 2009, p. 236)
51L’art militaire de la noblesse est avant tout celui des mots, violence intangible qui inflige déceptions et humiliations, qui manie l’aiguillon brûlant des traits d’esprit et des pointes et ne peut être combattu qu’à l’aide des mêmes armes. Nous avons vu au passage que ce déplacement est aussi une ouverture : ouverture à une aristocratie féminine qui n’est pas moins combattive que sa contrepartie masculine et brûle d’ailleurs de ne plus se satisfaire du silence et de se faire entendre.