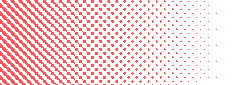Vel meliores vel deteriores imitari. La caractérisation morale du personnage dans La Place Royale
1Soit l’énoncé d’Aristote au chapitre ii de sa Poétique :
Ceux qui imitent, imitent des gens en action, [et] ces gens sont nécessairement nobles ou bas […], et en vérité soit meilleurs, soit pires, soit pareils que nous1 (Aristote, 1990, 48a, p. 86-87).
2À première vue, le passage ne fait pas difficulté : en distinguant des caractères « meilleurs », « pires » ou « pareils », le Philosophe propose un critère pour définir les deux genres de poème dramatiques. Puisqu’il appartient à la tragédie de représenter les caractères « meilleurs », il revient au poète comique de mettre en scène les mœurs « pires » ou « pareilles. »
1. Bassesse morale et bassesse sociale chez les commentateurs
3Encore faut-il s’entendre sur le sens précis à accorder à ces adjectifs. Par « noble ou bas [ἢ σπουδαίους ἢ φαύλους] », par « soit meilleurs soit pires [ἤ τοι βελτίονας, ἢ χείρονας] », Aristote propose de distinguer les caractères d’un point de vue non pas social, mais moral, ce dernier terme étant à prendre au sens strict de jugement de valeur2 : « c’est le vice ou la vertu qui fait la différence entre les caractères » (Aristote, 1990, p. 87). Il y revient au chapitre III, au moment d’énoncer son célèbre postulat sur la mimèsis comme principe de plaisir (1990, 48b, p. 89), puis une dernière fois au chapitre v en manière de rappel : « La comédie est, comme nous l’avons dit, une imitation d’hommes sans grande vertu » (1990, 49a, p. 91). Corneille traduira : « une imitation de personnes basses et fourbes » (Corneille, [1660], 1999, p. 71). En un mot, la tâche du poète tragique est de représenter les vertus, celle du poète comique est de représenter les vices. Le texte paraît univoque. Sur ce point, Aristote a eu le souci de se faire comprendre.
4Seulement, à l’époque moderne, on lit rarement Aristote pour lui-même. Celui-ci ne se présente jamais à la lecture qu’accompagné de son cortège d’exégètes. Depuis la remise en circulation de la Poétique à la fin du xve siècle, les éditeurs, traducteurs et commentateurs se sont succédés, glosant le texte presque phrase par phrase avec le dessein d’en élucider les obscurités. Très concrètement, cela signifie qu’un lecteur instruit tel que Corneille n’a presque jamais la seule Poétique entre les mains : dans les ouvrages dont il dispose, le texte s’offre à lui flanqué d’une ou plusieurs traductions, et le plus souvent, il est disloqué en « parcelles » (particulae ou particelle) que l’auteur a réparties tout au long d’un ample commentaire pour les gloser l’une après l’autre. Au cours de ses développements, un commentateur de la Poétique mentionne les traductions proposées par ses prédécesseurs, reformule les différentes interprétations existantes avant de les approuver ou les discuter. C’est notamment le cas des ouvrages que l’on appelle aujourd’hui les « grands commentaires », tels celui de Francesco Robortello (1548), de Vincenzo Maggi (1550), de Pietro Vettori (1560), dans lesquels les compréhensions successives, discutées une à une, s’accumulent.
5La conséquence de ce phénomène est que la Poétique n’est jamais lue, méditée et comprise qu’à travers une tradition exégétique. Son sens s’altère au gré des interprétations et au contact des textes cités par les commentaires ; Horace le plus souvent, mais aussi, pour la comédie, Donat3. Ainsi le traité d’Aristote, et la science poétologique qu’il contient, n’existent que par cette tradition. Et jusque dans les conditions matérielles de sa lecture, il en est inséparable.
6La fortune critique de l’énoncé cité plus haut illustre bien cette tendance à l’altération, et si l’on peut dire, à la sédimentation des interprétations. Les commentateurs de la Renaissance voient comme nous : ils ont bien lu qu’Aristote propose de distinguer le personnage comique du tragique sur une base exclusivement morale, c’est-à-dire, selon le vice et la vertu. Mais cela ne les satisfait pas.
7Prenons pour exemple le traitement que donne de ce passage le premier « grand commentaire » de la Renaissance. Dans ses Explicationes en 1548, Francesco Robortello (auteur connu de Corneille, qui le francise en « Robortel ») commence par approuver l’interprétation morale du passage, qu’il complète en le rapprochant de la définition du vice et de la vertu fournie par le même Aristote dans l’Éthique à Nicomaque (Robortello, 1548, p. 19-20). Loin de s’arrêter à ce premier niveau, il décline alors les autres manières de comprendre l’expression. Il soutient que les comparatifs suggèrent un éloignement dans le temps qui implique une idée de notoriété : les personnages de la tragédie ne sont pas meliores, ils sont praestantiores, c’est-à-dire plus illustres que les hommes de notre temps : c’est pourquoi ils appartiennent presque toujours à un passé héroïque. De l’idée de notoriété, on ne se trouve plus qu’à un pas de celle de condition. Car l’autre mot de deteriores, développe-t-il, peut certes désigner des mœurs pires que celles que l’on rencontre au quotidien (à l’instar d’un peintre qui représente un visage grimaçant), mais il revêt lui aussi une idée de notoriété et de de condition sociale : « Par “pires” on peut aussi entendre vils et communs (ignobiles) [Per deteriora possunt etiam viles et ignobiles intellegi] » (p. 20. Nous traduisons).
8Ce chapitre des Explicationes offre un cas de superposition ou de compilation des sens : on maintient le sens le plus évident, mais on y ajoute ce qu’Aristote semble n’avoir pas bien explicité. Un second et dernier exemple montrera qu’on ne se contente pas toujours de le compléter.
9Le grand commentaire italien que Castelvetro dédie à la Poetica d’Aristotele (1670) se signale par la grande liberté de son auteur envers l’autorité du Philosophe. Pour notre passage, il a bien compris qu’il était question des vices et des vertus. Alléguant que le texte grec n’est qu’une prise de note, et jouant les contradictions d’Aristote contre Aristote, l’auteur italien nie que la caractérisation morale puisse fournir un critère entre les genres dramatiques. (Castelvetro, 1570, p. 19-20). Selon lui, celle-ci doit être prise en compte, non pas au moment de définir la matière du poème, mais uniquement lorsqu’il s’agit de déterminer les passions qu’on cherche à susciter auprès du public (ce que fait Aristote lui-même lorsqu’il décrit le héros médian). Aussi refuse-t-il d’admettre que l’invention des personnages se résume à la représentation des vices et des vertus. Elle en est selon lui un aspect parmi d’autres, et les qualités morales se répartissent effectivement entre comédie et tragédie comme Aristote le dit. Mais leur importance n’est pas telle qu’elles puissent fournir à une définition du genre. C’est la « condizione », royauté ou vie privée, noblesse ou « viltà, » qui différencie la matière tragique de la matière comique. Chez Robortello comme pour la plupart de ses successeurs, l’interprétation sociale de « meilleurs » et « pires » s’ajoutait au sens d’origine ; chez Castelvetro, elle le supplante.
2. La bassesse et la fourbe chez Corneille théoricien (1660)
10De cette furtive incursion dans le massif des poéticiens humanistes il importe de retenir une chose : depuis au moins le milieu du xvie siècle, les interprètes (et leurs lecteurs avec eux) ont constamment devant les yeux les deux niveaux de compréhension. Les caractères meilleurs et pires, « meliores » et « deteriores, » départagent le personnel comique du héros tragique non seulement dans l’ordre des valeurs, conformément à Aristote, mais aussi dans l’ordre social, conformément à la pratique du genre.
11Au xviie siècle, la remarque d’Aristote semble avoir attiré très peu d’attention de la part des penseurs avant-courriers du classicisme. Heinsius et La Mesnardière, qui donnent chacun à leur époque une Poétique, se contentent d’une définition des matières comique et tragique comme d’actions respectivement légère et grave, sans revenir sur la partie des « mœurs »4.
12Qu’en est-il de Corneille poéticien, lorsqu’en 1660 après trente ans de métier il se fait à son tour le lointain continuateur des académiciens italiens ? Dans le premier de ses trois Discours, il se rappelle le critère de définition choisi par Aristote : « la différence de ces deux espèces de poèmes ne consiste qu’en la dignité des personnages, et des actions qu’ils imitent ». (Corneille, [1660], 1999, p. 71).
13Pour ce qui concerne l’action, ce serait à voir, car Aristote n’a rien dit de tel5. Au sujet de la « dignité des personnages », en tout cas, le dramaturge français semble l’entendre dans les deux sens existants – celui d’Aristote et celui des commentateurs – lorsqu’ au même endroit, il traduit approximativement : « une imitation de personnes basses et fourbes » (1999, Ibid). Nous comprenons : basses dans leur condition, fourbes par leurs dispositions. Et d’ajouter aussitôt : « Je ne puis m’empêcher de dire que cette définition ne me satisfait pas ». Mais le désaccord ici exprimé porte sur le sens des commentateurs plutôt que celui d’Aristote ; la bassesse plutôt que la fourbe. La suite du passage fait nettement référence à la comédie héroïque, qui n’a rien gardé de la « médiocre condition » des marchands, des esclaves et des courtisanes de Plaute et Térence.
14Que Corneille ne fût pas partisan de la comédie comme « imitation des personnes basses », on pouvait s’en douter bien avant qu’il n’eût écrit une seule ligne de théorie : ses premières pièces l’attestent puisqu’il s’y est fait l’inventeur (ou le réinventeur) de ce que Liliane Picciola a judicieusement baptisé la « comédie aristocratique » (2002, p. 43-50). Qu’en revanche il n’y eût pas de place pour « les personnes […] fourbes », cela a moins d’évidence.
15Dans le monde galant des comédies cornéliennes, tout n’est que change, mécompte et bons tours : les dames feignent des froideurs pour éprouver leurs amants, les amants feignent l’inconstance pour reconquérir leur objet, les amis s'épaulent pour devancer un rival. Mais à la rigueur, ces petites menteries ne font pas de leurs auteurs des personnes fourbes. En revanche, l’intrigue principale se noue toujours autour d’une machination plus grave où un personnage cherche à tromper tous les autres. Dans le Discours déjà cité, le dramaturge y revient lui-même. Relisons ces lignes :
Ainsi dans les comédies de ce premier volume, j'ai presque toujours établi deux amants en bonne intelligence, je les ai brouillés ensemble par quelque fourbe, et les ai réunis par l'éclaircissement de cette même fourbe qui les séparait. (1999, p. 71.)
16Ici, Corneille s’accorde tacitement avec un autre versant de la définition commune, selon laquelle la comédie représente d’une part des personnes basses et viles, que sa matière consiste d’autre part en des ruses, mensonges, tromperies. Il est remarquable qu’après avoir balayé du revers de la main le premier axiome légué par Donat à la tradition comique, il fasse sien ce deuxième sans discussion6. Comme praticien, Corneille a éprouvé qu’il y avait là un ingrédient indispensable pour inventer une intrigue. Mais il ne s’agit plus pour lui que d’un élément d’action, qu’il énonce comme tel indépendamment de ce qu’il dit des personnages.
17Se pose alors un problème théorique. Comme poéticien, Corneille ne retient que la moitié de la définition traditionnelle du genre comique. Ce fait offre un angle de vue éclairant sur ses comédies. On gagnerait à chercher jusqu’à quel point, dans la pratique, ce qu’il conserve de cette définition peut se passer de ce qu’il en laisse : l’élément d’action qu’est « la fourbe » implique-t-il la caractérisation d’un personnage comme moralement bas ? Autrement dit : la fourbe implique-t-elle un fourbe ? Ou la comédie aristocratique peut-elle se passer de personnage « pire » sous tous les rapports ?
3. La bassesse morale dans les comédies (1629 – 1637)
18Le propos de la présente étude est double : d’une part, nous supposons que la base théorique clairement posée par les auteurs italiens connus de Corneille a déterminé en profondeur l’imaginaire comique de celui-ci à partir de La Veuve (1631-1632). D’autre part, il semblerait que La Place Royale (1633-1634) constitue un moment précis d’infléchissement, ou de dépassement, dans lequel le fonctionnement en place depuis La Veuve n’a plus cours. Pour appréhender cette particularité de La Place Royale, il convient de survoler les comédies qui la précèdent.
19De quoi La Veuve était-elle donc le commencement ? En composant Mélite (1629-1630), sa première pièce, Corneille a eu nettement conscience de réinventer le personnage comique. Mais cela, uniquement sur le plan de la caractérisation sociale. Il nous semble qu’à cette même période en revanche, il ne se soit pas encore posé la question de la caractérisation morale. Du moins, il ne se l’est pas posée d’une manière qui influençât l’écriture de sa pièce.
20En effet, on voit bien dans Mélite le soin qu’a eu Corneille de caractériser socialement ses personnages, qui sont tous nobles. En comparaison, le jeune dramaturge s’est montré moins attentif à les caractériser moralement. À leur apparition sur scène, aucun indice dans leur caractère ne permet de prévoir lequel des prétendants se fera l’auteur de l’acte répréhensible annoncé par le titre. Encore moins de savoir d’avance auquel des trois le dénouement donnera tort, en le condamnant à un sort malheureux et mérité. Tircis est-il mauvais parce que d’une frivolité mâtinée de cynisme ? Mais il devient l’amant couronné pour ses mérites amoureux. Eraste est-il fourbe parce que faussaire ? Mais il est digne de pitié et finit par être pardonné. Au rebours, rien dans son caractère ne prédisposait Philandre plutôt qu’un autre à commettre le crime jugé irrémissible : l’infidélité, enfreinte suprême à l’éthique amoureuse.
21Sa perception du personnel comique change à partir de La Veuve. Corneille se met alors à prendre en compte le fait que la fourbe n’est pas seulement un élément indispensable de l’intrigue comique, mais qu’elle est aussi une propriété du personnage comique. Autrement dit, que le genre bas ne peut faire l’économie de caractères moralement bas.
22Pourquoi ce moment particulier ? Parce que Mélite est la seule pièce que Corneille ait écrite avant son premier contact, fût-il indirect, avec la Poétique, c’est-à-dire avant de se rendre à Paris avec la troupe de Mondory. Il nous apprend avec mauvaise humeur dans la préface de Clitandre, sa seconde pièce, qu’il n’était alors pas au fait de ces théories à la mode. Pour Mélite, il s’était donc positionné par rapport au corpus comique existant : la palliata des Anciens et la comedia erudita de ses contemporains essentiellement. Il en avait déduit les codes sans passer par un discours théorique autorisé. Constatant alors que la comédie était affaire de marchands et d’hommes du peuple, il s’était naturellement empressé d’abolir cette loi implicite du genre. Plus tard, il a lu dans Aristote et ses commentateurs que le personnage comique devait être deterior.
23De cette lecture, il a pu tirer deux conséquences. D’une part, que s’il fallait chercher dans Aristote des règles propres à la comédie, la caractérisation morale du personnage était peut-être la seule. D’autre part, que le statut social du personnage était une règle écrite, quoiqu’elle fût une déformation des commentateurs.
24En tout cas, ces deux leçons de poétique correspondent à deux nouveautés dans la composition de La Veuve, qui deviennent autant d’invariants jusqu’à La Galerie du Palais. D’une part, des personnages résolument « bas et fourbes » font leur apparition dans la comédie cornélienne : soit qu’ils fussent indispensables à ses intrigues, soit qu’il ait éprouvé le besoin de conformer sa dramaturgie à l’avis d’Aristote, l’auteur s’est interrogé à ce moment précis sur l’opportunité de tels rôles. D’autre part, il attribue systématiquement ces mauvais rôles aux personnages les moins fortunés : la répartition entre malfaiteurs et jeunes premiers recoupe ainsi la répartition des conditions sociales dans la pièce.
25Dans La Veuve, le lecteur ou spectateur n’a aucun doute quant à l’identité du « traître » annoncé par le sous-titre. Entouré d’amis fidèles, Alcidon, prétendant calculateur et intéressé, s’y distingue nettement par sa constance à mentir et manipuler pour parvenir à ses fins. Or en inventant ce rôle, Corneille a soigneusement veillé à le pourvoir d’un discours moratus, c’est-à-dire d’un « discours de caractère » (Heinsius [1611], 2001), par lequel transparaît la qualité morale du personnage qui le prononce : de bout en bout, les propos d’Alcidon révèlent une personnalité sournoise, dissimulatrice et lâche. Le faussaire Éraste dans Mélite ne saurait constituer un équivalent d’Alcidon dans La Veuve. Car Éraste n’est pas essentiellement faussaire. Il n’est pas pourvu d’une cohérence caractérologique – transparaissant dans des « discours de caractère » – qui devait l’amener à le devenir. Voilà notre premier point. Il se trouve en outre que les traits d’Alcidon ne paraissent jamais avec autant d’évidence que dans ses deux entretiens avec le personnage de la Nourrice. Or c’est là le second point : le personnage foncièrement mauvais, s’il est de même condition que les autres amants, agit en concertation avec le seul acteur non noble (ignobilis) de la pièce. Ainsi le personnage moralement bas apparaît en même temps que la confusion de celui-ci avec une condition socialement basse. Dans La Veuve, le deterior n’est donc pas lui-même ignobilis, mais il s’associe à l’ignobilis, il agit comme lui, appliquant à la lettre le plan de ses « ruses. » La tendance se confirmera les années suivantes.
26Ces traits s’accusent en effet dans la pièce suivante, La Galerie du Palais (1632-1633). Cette fois-ci, c’est par les mauvais offices d’un « écuyer » et d’une suivante que la fourbe s’introduit dès la scène d’exposition. Ce sont là les ignobiles de la comédie aristocratique : Corneille attribue ces rangs subalternes pour maintenir la hiérarchie fonctionnelle de la comédie sans ravaler son personnel à la plus basse domesticité qu’était celle du servus ou du gracioso. Dans les discours de cet écuyer, mais surtout dans ceux de Florice la suivante, on est tenté de déceler le vocabulaire d’un machiavélisme amoureux dont le « secret », « l’occasion » et la « ruse » sont les maîtresses vertus (v. 16, 19, 316 et 493). Plus nettement encore que la Nourrice de La Veuve, Florice est la version galante du conseiller machiavélique qui débauche le prince. Elle est à proprement parler le Segretario, le secrétaire qui « parle à l’oreille » (p. 322) et pilote jusqu’aux allées et venues sur scène de sa maîtresse (v. 480-486).
27Le modèle semble encore opératoire dans La Suivante (1633-1634), pièce peut-être contemporaine de La Place Royale7. La situation est déjà plus complexe : il y règne une ambiance de traîtrise généralisée, produite par les manœuvres des deux galands qui tournent autour d’Amarante, la suivante éponyme, uniquement pour accéder à sa maîtresse. Mais c’est encore ce personnage subalterne que Corneille a choisi de mettre en avant pour mener la ronde des trahisons. Dans cette pièce « aigre-douce, plus aigre que douce » (Georges Couton, 1980, p. 1315), Amarante n’est au fond pas plus traîtresse que les autres, mais elle les surpasse tous par sa maestria en menterie, qui culmine au milieu de la pièce (III, 6 et III, 10). À la fin du dernier acte, un monologue lui donne le loisir de déplorer son « inégalité » de condition, qui seule la fait dédaigner de ses amants (v. 1669-1672). Amarante illustre merveilleusement la coïncidence dans nos comédies des caractérisations morale et sociale : c’est parce que la suivante est inférieure socialement qu’on la délaisse ; et c’est parce qu’on la délaisse qu’elle déploie des trésors d’ingéniosité. Dernière venue dans l’ordre protocolaire de la liste des acteurs, Amarante tient le premier rang parmi les deteriores et ignobiles de la pièce : elle est à la fois le personnage le plus humble et le plus activement trompeur. Elle n’est pas pour autant la seule. Si l’on étend l’angle de vue aux autres personnages, on constate que la part prise aux fourberies est comme proportionnelle à la place occupée dans la hiérarchie de la pièce. Nouvel avatar d’Alcidon, Théante, pleutre et sournois, pousse les autres au duel tout en s’en tenant soigneusement à l’écart. Or il est lui aussi au bas de l’échelle sociale, certes pas par le sang, mais par les biens : c’est Amarante qui se charge de lui rappeler cette même « inégalité » qui fait son propre dépit (v. 597). Même chez Florame, le jeune premier qui a participé à la persécution d’Amarante, l’imperfection morale est doublée d’un défaut de fortune, comme si « l’ignominie » comique devait toujours avoir deux versants (v. 74-76).
28La fresque, peut-être hâtive, que nous venons de proposer vise à saisir le mouvement d’ensemble que suit la caractérologie comique de Corneille. Au passage, on aura remarqué avec quelle liberté celui-ci adapte à son univers galant l’unique précepte d’Aristote touchant spécifiquement la comédie. Premièrement, s’il introduit des personnages ignobiles et deteriores à partir de La Veuve, ce n’est pas pour remplacer les « honnêtes gens » auxquels il avait donné l’accès à la scène comique dans Mélite. Corneille ajoute, il ne retranche pas. Désormais, les meilleurs et les pires se côtoient. Deuxièmement, les ignobiles ne se trouvent pas si bas socialement qu’ils ne l’étaient traditionnellement, hormis peut-être la Nourrice de La Veuve. La comédie aristocratique fait ainsi bénéficier d’une ascension sociale tout son personnel.
4. Praestantiores et deteriores dans La Place Royale
29Ce tour d’horizon nous aura certainement fait passer par d’inévitables simplifications8. La conclusion que nous souhaitons en tirer ne nous semble pas moins certaine : dans La Place Royale, on n’identifie plus un malfaiteur ignobilis dont les machinations visent à désunir le couple principal. Le type cornélien, si c’en est un, que revêtaient la Nourrice, Alcidon, Florice, Théante et Amarante n’y rencontre pas d’équivalent.
30Est-ce à dire que l’on en est revenu à Mélite ? Pas exactement, car depuis sa première pièce, Corneille, qui désormais a du métier, a notamment approfondi sa science des caractères. Et de fait, il n’y a pas de comédie où il soit aussi souvent question de l’« humeur » et du « tempérament » des personnages que dans la Place Royale9. L’innovation de Corneille dans celle-ci porte en grande partie sur cet aspect.
31Aux deux invariants que nous avons cru devoir déceler dans les pièces précédentes répondent deux nouveaux paramètres qui contribuent à faire la singularité de La Place Royale. D’un côté, il n’y a plus de personnage « bas et fourbe » dont la condition sociale traduise le mauvais rôle que l’intrigue lui réserve. Les domestiques ont presque disparu du tableau de présence scénique, et l’inégalité des fortunes a cessé de préoccuper les autres personnages dans leurs entretiens. De l’autre, l’acte fourbe indispensable à l’action n’oppose plus le couple des « premiers acteurs » à un ignoble malfaiteur. Comme par un retournement contre lui-même du schéma comique cornélien, l’auteur du mauvais coup se trouve être le « premier amant » dont l’intention est de désunir son propre couple.
32Portons donc notre attention sur ces deux amants. Auteurs de fourbe tout en appartenant à l’ordre social des « meilleurs », c’est-à-dire des « honnêtes gens », Alidor et Angélique sont praestantiores et deteriores : à la fois meilleurs et pires. Ce qui ne consiste pas seulement à dire qu’ils sont des aristocrates qui agissent mal. Fonctionnellement, Alidor assume deux rôles apparemment incompatibles, comme jeune premier et comme malfaiteur. Il faut donc que son caractère tienne un peu du meilleur, et un peu du pire.
33Il n’y a qu’une seule raison à cette nouvelle situation : les « personnes basses et fourbes » se sont retirées du circuit comique. On le voit, en modifiant ce paramètre fondamental, Corneille s’est posé un délicat problème de composition. Car sans le personnage « pire », l’action comique se trouvait privée de son moteur. À moins d’attribuer certaines propriétés du « pire » à des personnages qui, par ailleurs, présentent des qualités de « meilleurs ». Ce que fit Corneille quand il inventa Alidor. Car il nous semble que la genèse d’Alidor tient à cela. Ce personnage est conçu de telle sorte qu’il puisse remplacer le malfaiteur dans ses fonctions dramatiques sans entrer tout à fait dans le type du malfaiteur. La composition de son caractère répond au besoin de trouver une cause à la fourbe comique sans la faire assumer à un fourbe.
34Dans la mécanique cornélienne, le caractère d’Alidor sert donc de pièce de remplacement pour assurer à l’action comique son bon fonctionnement. Et ce caractère, l’auteur l’a lui-même nommé : l’extravagance. Qu’un amant sorti de bon lieu pût être l’initiateur de la trahison ne semblait pas une équation si aisée à résoudre pour Corneille qu’il ne fît intervenir cet élément jusqu’alors inédit dans sa poétique10. L’extravagance nous semble donc la solution trouvée par le dramaturge pour attribuer à un même personnage les rôles du pire et du meilleur. C’est elle qui permet à Alidor de prendre les attributs du malfaiteur sans en revêtir l’identité, et à Corneille de nouer l’intrigue comique en en congédiant les « personnes basses et fourbes ».
35En effet, seule l’extravagance pouvait justifier que se comportât en traître celui qui, par ailleurs, présentait tous les traits du parfait amant. En fait, l’extravagance et la trahison qu’elle entraîne naissent de cette perfection même d’amant.
36Car ce qu’Alidor observe en lui-même avec appréhension, ce sont précisément les valeurs de l’éthique pastorale. Les deux jeunes gens les ont jusqu’alors merveilleusement illustrées si l’on en croit ce qu’il relate à son ami lors de l’acte d’exposition. Dès sa première tirade, en effet, l’amant déplore l’honnête amitié qui fait d’eux de « fidèles amants. » Honnête amitié à laquelle on attendrait en vain que l’un ou l’autre fasse jamais défaut :
Mais las ! elle est parfaite, et sa perfection
N’est pourtant rien auprès de son affection (v. 191-192).
37Mais par-dessus tout, Alidor a en horreur sa propre constance. Voudrait-il se laisser divertir par un autre objet, « [ses] pensers n’oseraient [l]’entretenir que d’elle » (v. 214). Se projetant alors dans un temps où la vieillesse aura flétri la beauté de sa dame, chercherait-il à douter de sa capacité à l’aimer durablement ? Même de cela, ses propres raisons ne parviennent à le persuader :
Cependant Angélique à force de me plaire
Me flatte doucement de l’espoir du contraire (v. 237-238).
38On remarque dès cette entrée en scène que la persuasion libertine d’Alidor est indissociable de tout ce qui fait de lui un amant idéal : si une once de tentation se faisait ressentir, il n’aurait à avancer pour lui-même pas un seul des raisonnements forcés qui justifient sa bizarre conduite. Au contraire, c’est parce que son amour pour Angélique ne présente aucun défaut, ne laisse même espérer aucune lassitude, qu’il prétend s’arracher à elle.
39L’amour sans faille et la réaction inapproprié qu’il suscite sont les deux composantes indissociables de l’extravagance. Elle est l’alliage (peut-être le seul possible) des qualités rigoureusement contraires de l’amant pastoral et du perfide. Jusque dans son langage, Alidor est à la fois l’un et l’autre. Notre extravagant parle couramment ce qui était déjà la langue du cœur depuis Pétrarque : les métaphores de la captivité et du supplice, de la maladie et de la guérison, la personnification d’Amour en un petit dieu qui tourmente malignement les cœurs, l’évocation émue du pouvoir qu’exercent les yeux de l’être aimé ne sont pas de son invention. Mais sa singularité est d’en avoir pris les images rebattues au pied de la lettre. Alidor ne pratique la langue poétique des soupirants que pour s’extraire de leur nombre : il évoque les fers pour les rompre, la maladie pour s’amputer, la tyrannie pour la renverser. C’est par l’usage inapproprié qu’il en fait que le fidèle amant se transforme en amoureux extravagant.
40En un mot, Alidor ne saurait être extravagant qu’à mesure qu’il est fidèle amant. Son délire a pour condition cette qualité première. À plusieurs reprises le dramaturge laisse entendre que, chez son personnage, la rêverie libertine n’est que de surface. Le mauvais entêtement n’a pas entièrement raison de sa disposition profonde, qui est d’aimer Angélique. Le personnage confesse lui-même à son ami qu’il ne peut que « [s]e fein[dre] léger » (v. 727). L’apprenti libertin a tout juste les moyens de ses ambitions philosophique : contrefaire le volage devant Angélique demande de sa part un effort qu’il peine à fournir. À demi repenti après la déconvenue de Cléandre, il finit même par persuader son amante (et le spectateur avec elle) que la provocation de l’acte ii était une preuve d’autant plus éclatante de sa passion qu’elle était insolente : plus je me montre léger, plus je laisse comprendre que je suis un amant passionné, car il n’échappe à personne que « mes mépris sont feints11 » (v. 816). Les délibérations monologuées, particulièrement fréquentes dans cette pièce, donnent tout le loisir au spectateur de suivre le conflit sourd que se livrent les mouvements de son cœur. À deux reprises (IV, 1 et 1V, 5), Alidor resté seul sur scène laisse échapper à sa conscience amoureuse un sursaut qu’il étouffe aussitôt sous les raisonnements. Le soupçon, le repentir, le « reproche secret » se maintiennent à peine le temps d’une vingtaine de vers avant que ne reviennent à la charge les maximes de l’esprit fort (v. 955-974, et 1051-1067).
41À cette « étrange humeur d’Amant » est adossé l’autre versant de cette personnalité fictive : son dévouement exemplaire pour Cléandre. L’apparente incongruité de cette excellence en amitié n’a pas échappé au lecteur le plus intransigeant de cette pièce. Près de trente ans plus tard dans son Examen, Corneille censeur de lui-même se demandait encore s’il était possible d’être à la fois un si bon ami et si piètre amant (Corneille, 2001, p. 74). Mais sur sa trame comique, le poète avait tressé si étroitement ces deux qualités qu’Alidor ne pouvait être l’un qu’en étant l’autre : on a parfois vu chez lui comme une forme primitive du dilemme cornélien, cette conscience qu’il a de ne pouvoir s’affirmer du côté de l’amitié qu’en persévérant dans la trahison amoureuse. Parvenus à l’acte iii, on en est même rendu à un point où celle-ci prendrait fin si elle n’était soutenue par celle-là12. L’œuvre d’amitié pour Cléandre qui motive l’action pour le reste de la pièce constitue le moment crucial où se manifestent les dispositions contradictoires de ce personnage : agir généreusement tout en continuant de professer son dogmatisme libertin (v. 657-764).
5. Duplicité d’action, inégalité de mœurs et extravagance
42C’est ici que Corneille a identifié les plus importants défauts de sa pièce. Pour avoir rendu Alidor capable de présenter à Cléandre et Angélique deux visages si différents, il s’est rendu coupable d’« inégalité de mœurs ». Pour avoir relancé l’action à l’acte III en engageant Alidor au service de Cléandre, il a péché par « duplicité d’action ». Or il nous semble que ces deux objets de grief sont autant d’effets indésirables du travail caractérologique de Corneille dans cette pièce tel que nous l’avons décrit. L’inégalité de mœurs d’Alidor est un moyen, non seulement de contrebalancer, mais de fusionner les qualités du fidèle ami et du perfide amant (perfidie en elle-même complexe, procédant elle aussi de la synthèse entre la qualité d’amant et le vice d’extravagance). La duplicité d’action née de l’acte iii prend pour point d’articulation l’instant où se réalise pleinement et tout d’une pièce sa double caractérisation positive et négative.
43On ne peut que donner raison à Marc Escola lorsqu’il écrit qu’interpréter La Place Royale revient souvent à tenter d’expliquer ses deux défauts de fabrication (Corneille, 2001, p. 39). Les pages qui précèdent n’ont pas échappé à cette fatalité. En somme, nous croyons pouvoir avancer que ces irrégularités présumées sont dues à la nécessité éprouvée par Corneille de pourvoir Alidor d’une double caractérisation, négative et positive. Que cette nécessité est elle-même le résultat de l’assignation à un même personnage de deux fonctions dramatiques a priori inconciliables dans les habitudes cornéliennes, celles de traître et de premier amant. Qu’en dernière analyse c’est de la suppression du type de l’ignobilis, apparu dans La Veuve, qu’a résulté le besoin d’inventer un personnage à la fois meilleur et pire.
44Ainsi, l’extravagance constitue selon nous la solution caractérologique trouvée par Corneille pour répondre à ce besoin. La duplicité d’action et l’inégalité de mœurs en sont les dégâts collatéraux. En poursuivant sa trahison par pur devoir d’amitié, Alidor prend à l’acte iii une décision qui fait à la fois de lui un héros et un fourbe. Sa passion irrésistible et son dévouement d’ami sont autant de gages d’appartenance à l’ordre des praestantiores13. Et simultanément, ce sont ces deux mêmes aspects qui le caractérisent négativement : Alidor a des vertus d’ami et d’amant, mais il les pratique excentriquement. En amour, il est à la fois constant et inconstant. Et s’il se montre dévoué en amitié, c’est toujours pour poursuivre du même coup ses bizarres desseins14. Sur tous les plans, il est le prototype d’un personnage dont les qualités de meilleur et de pire se conjuguent dans l’extravagance.
45Remarquons pour conclure que l’analyse peut s’étendre à l’autre personnage principal. Angélique, elle aussi, apparaît d’abord comme une amante accomplie ; elle aussi est coupable de perfidie envers Doraste ; enfin, elle aussi tombe dans la catégorie de l’extravagance lorsque Phylis devenue le raisonneur de cette pièce condamne la décision excessive où la pousse son dépit15. Les deux amants ont pour point commun de se glorifier par la trahison amoureuse. À l’instar de son perfide amant, Angélique tient pour un « dessein généreux » de rompre la foi jurée à Doraste (v. 889 et 1177). Dans l’instant décisif, ce pourrait être indifféremment Alidor ou Angélique que l’on entend déclarer : « Ce coup n’est qu’un effet de générosité » (v. 991). Et peut-être l’est-il en effet, puisqu’il signale son amour inconditionnel, en parfaite cohérence avec le caractère absolu qu’on lui connaît depuis le début de la pièce. Angélique est ainsi admirable par son intransigeance amoureuse, et rendue ridicule par cette même intransigeance, qui tend à Alidor un miroir inversé de son opiniâtreté. Finalement, les amants désunis se retrouvent dans l’extravagance, qui dans les deux cas résulte d’une disposition vertueuse dont ils ont usé avec excès et maladresse. L’hybridité commune à ces deux caractères est le reflet (et peut-être, au point de vue « génétique », la conséquence) de la fonction qu’ils occupent dans l’intrigue : alors qu’ils forment le couple des jeunes premiers, ils finissent par être punis comme l’étaient depuis La Veuve les ignobles malfaiteurs. Car pour la première fois chez Corneille, le dénouement de La Place Royale donne tort aux premiers amants : par les sentences, puisqu’on y entend les autres personnages désapprouver leur conduite, et par l’action elle-même qui les punit en les faisant passer du bonheur au malheur. Mais ils ne laissent pas d’être les premiers amants.
6. La Place Royale dans l’art cornélien
46En introduisant les « honnêtes gens » sur la scène comique, Corneille savait qu’il bousculait les habitudes. Mais à l’époque de Mélite, il n’en avait conscience que par son expérience de lecteur et de spectateur, et il n’a pas pu saisir toute la portée du renversement théorique que cette nouveauté impliquait. En réinventant pour le théâtre français la « comédie aristocratique » Corneille faisait passer le personnage comique du « pire » au « pareil » (socialement), et même au « meilleur », puisque ses protagonistes sont nobles. Il sentait que l’entreprise était hardie, mais pas au point de penser qu’il pût s’agir, en théorie poétique, d’une contradiction dans les termes. Car du temps de Mélite, affirme-t-il lui-même, Corneille ignorait qu’il y eût des règles (1980, p. 5). Peut-être même ignorait-il qu’il y eût une Poétique d’Aristote, en tout cas qu’elle comptât pour ses contemporains et qu’il fallût l’étudier. Il n’a donc pas pu avoir connaissance de cette définition de la poésie comique. Du moins, il n’a sans doute pas porté à cet aspect toute l’attention qu’il lui eût accordée s’il avait eu la Poétique en main.
47À partir de Clitandre et surtout de La Veuve, Corneille nous fait savoir qu’il soumet son théâtre comique aux règles que la vie parisienne et la rencontre des doctes ne lui ont pas laissé ignorer. Les rôles d’ignobiles inventés pour La Veuve, La Galerie et La Suivante peuvent s’interpréter dans ce même mouvement de régularisation par lequel le théâtre cornélien se range, comme de mauvaise grâce, dans les unités. Le saut qui fait passer de Mélite à La Veuve peut en effet s’expliquer par une prise de conscience théorique, peut-être liée à ce premier contact avec la Poétique : à un moment entre ces deux pièces, le dramaturge a considéré que l’intrigue comique impliquait des caractères bas. Ne renonçant pas pour autant à aristocratiser le personnel comique, il a trouvé une manière de faire cohabiter les meilleurs et les pires.
48Lorsqu’il compose La Place Royale, Corneille est désormais familier des théories en vogue, et fort de l’autorité que lui confèrent ses succès répétés dans le genre comique. Peut-être comprend-t-il déjà que les poéticiens de sa propre époque se préoccupent très peu de définir la comédie, tout tournés qu’ils sont vers la restauration du grand genre. Il peut donc se sentir les coudées franches pour expérimenter plus avant son domaine de prédilection, sachant qu’on ne le querellera pas sur l’unique règle spécifique à la matière comique. Il se débarrasse alors de la concession qu’il lui avait faite : il invente une intrigue à laquelle n’a de part aucun personnage dont la caractérisation sociale soit basse. Ce retrait a pour conséquence dans l’ordre des valeurs morales qu’on n’y trouvera pas non plus de personnage foncièrement mauvais. Les « pires » sont remplacés par les extravagants, socialement « meilleurs » et moralement ambigus16.
49À partir de là et dans les années à venir, c’est tout le système théâtral de Corneille qui va suivre, par un même mouvement, un décalage vers le haut. On se souvient en effet que Le Cid, Horace et Cinna constitueront les étapes par lesquelles le dramaturge découvre progressivement l’intérêt de mettre sur la scène tragique un héros sans faiblesse et de lui préparer un sort heureux17. La Place Royale, dernière comédie de Corneille avant qu’il ne s’essaie à la tragédie l’année suivante avec Médée, représente un champ d’expérimentation qui a bien pu être déterminant pour la suite de sa carrière.
50Parvenu au terme provisoire de son œuvre comique, on voit quel premier à-coup donne Corneille pour quitter le monde aristotélicien. Désormais, le personnage comique, déjà recatégorisé auparavant parmi les nobles, s’apparente moralement au héros tragique. L’extravagance fait office, si l’on peut dire, de faute comique : elle déchoit le jeune premier du statut de parfait amant. Cette altération morale a pour effet simultané l’inversion de la trajectoire traditionnelle devant conduire les amants du malheur au bonheur : « [Nos Comédies] n’ont que très rarement une autre fin que des mariages » (1980, p. 133). Comme s’il avait fallu, avant de voir le héros médian de la tragédie céder la place aux héros parfaits, que les personnages de la comédie devinssent eux-mêmes des héros médians. Comme si Corneille, avant de faire triompher le héros sans tache par un tragédie à fin heureuse, avait d’abord dû doter la comédie d’un dénouement tragique.