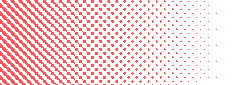Le XIXe siècle, hélas !
« [C]hacun est libre de regarder l’histoire à sa façon, puisque l’histoire n’est que la réflexion du présent sur le passé, et voilà pourquoi elle est toujours à refaire […]. » (Gustave Flaubert [1864], p. 414-415)
1La journée d’études qui s’est tenue le 30 novembre 2023 à l’Université de Strasbourg1 avait pour point de départ une interrogation quant aux difficultés que pose ou que poserait l’enseignement de la littérature du xixe siècle aujourd’hui : ce siècle qu’on associait, il y a peu encore, à la modernité des révolutions (politique, sociale, esthétique), et donc à un socle de valeurs dont notre société serait l’héritière, s’éloignerait désormais de nous ; et il s’éloignerait non véritablement en raison du temps qui passe, mais du fait de son association à des contenus, pratiques ou discours subitement devenus inacceptables pour les mentalités contemporaines. Le développement – nécessaire – d’un appareil critique (pensée postcoloniale, puis décoloniale, émergence du mouvement #metoo en particulier) aurait donc encouragé le discrédit des corpus dix-neuviémistes, en rendant parfois l’étude intempestive, voire contreproductive : l’antisémitisme, le racisme ou la misogynie qui façonnent les représentations du xixe siècle constitueraient désormais d’insurmontables pierres d’achoppement pour l’étude de productions littéraires, et rendraient leur enseignement mission impossible.
2La difficulté, soulignée par Tiphaine Samoyault, lors d’une émission de radio consacrée à la l’adaptation des traductions de textes classiques à l’époque de leurs lecteurs2, n’est donc pas, dans ce cas précis, d’ordre linguistique ou culturel, même si un éloignement temporel grandissant pose en soi d’inévitables problèmes de transposition auxquels il est impossible, à terme, d’échapper. Le problème soulevé, et qui touche la possibilité même d’un enseignement, est ici d’ordre axiologique, et fait du xixe siècle un laboratoire particulièrement intéressant pour analyser une mutation d’ordre moral. Ce problème, en effet, est – pour l’heure – propre au xixe siècle, victime d’une défamiliarisation spécifique et sélective, sans doute favorisée par une paradoxale proximité. Ce siècle qui ouvre l’ère médiatique, initie une accélération inédite du progrès technique et de la vie en général (une vie de plus en plus urbaine, qui plus est), ce siècle qui place au centre de ses valeurs l’individu, ses droits et ses revendications, le siècle de Hugo et de Pasteur, de l’affaire Dreyfus et de la naissance de l’intellectuel, de la littérature industrielle et d’un imaginaire sériel, ce siècle ne serait plus le nôtre – ou du moins plus le leur, puisque cette « difficulté » de l’enseignement relève en grande partie d’un écart générationnel, devenu axiologique.
3Ce rejet semble d’autant plus paradoxal que nous sommes les héritiers directs de cette époque sur le plan politico-culturel, mais aussi littéraire : le discours romanesque problématique de Balzac ou des frères Goncourt serait d’autant plus insupportable aujourd’hui qu’il prend place dans des œuvres qui nous demeurent, en réalité, familières, du fait de l’univers représenté, des ressorts éthiques mobilisés, et, sans doute, des modalités esthétiques employées (un siècle dominé par le « réalisme » ?). Sa modernité finit en définitive par faire problème : si les spécialistes des siècles anciens peuvent (peut-être trop facilement) dédouaner leurs œuvres des accusations de représenter le viol ou l’oppression des femmes au motif que le Code Civil ne donne pas encore de réalité indiscutable à l’offense et que plus généralement, si l’on suit la périodisation de Geneviève Fraisse3, le féminisme ne commence qu’avec la Révolution, le xixe siècle n’aurait plus d’excuses. Comment expliquer qu’il puisse être moderne, mais pas pour tout le monde ? Aussi est-ce peut-être avant tout de cette proximité que, fondamentalement, découle cette « difficulté », qui trahit elle-même le sentiment diffus que ce siècle est encore le nôtre.
4Car ce qui se trouve dans la ligne de mire, c’est clairement la centralité historique du xixe siècle : c’est à cette époque que se construisent la plupart des mythologies et des pratiques littéraires dont nous avons aujourd’hui hérité et qu’il s’agit donc de déconstruire en remontant – on notera le caractère très zolien de cet imaginaire – vers l’ancêtre vicié pour le dénoncer. C’est du xixe siècle que date « l’exception culturelle » que constitue la figure du mage romantique, présidant à la configuration contemporaine des usages politiques du littéraire ; au xixe siècle que s’affirment la production et l’exportation de la littérature à grande échelle, potentiellement dans un climat de rivalités entre les nations, en tout cas avec l’appui économique des colonies pour développer le marché du livre ; au xixe siècle que le romantisme émet l’idée d’une croissance organique des nations, engendrant de nombreux discours conservateurs et alimentant dans certains cas un messianisme polarisant. Plus gravement, la littérature est présente à tous les étages dans ces processus : le siècle est l’époque du culte national de la culture qui fait de la littérature un des hauts lieux du politique et un des terrains où l’on décèle un potentiel caractère national ; il devient le siècle par excellence de la patrimonialisation, prêtant le flanc à des lectures téléologiques de l’histoire littéraire qui ferait de lui le moment où tout bascule vers une lecture verrouillée et contrôlée, valorisant les dead white males au détriment des femmes et autres subalternes. Le xixe siècle apparaît dans ces nouvelles historiographies comme un point de rupture, accusé pour son contenu, mais aussi pour les usages qu’il fait de la littérature. Doit-on alors en conclure qu’il faut être un peu du xixe siècle pour vouloir l’enseigner, ou pouvoir, un tant soit peu, encore s’y reconnaître ?
5La conscience d’un écart axiologique n’est pourtant pas en soi une réelle nouveauté, et elle n’a pas forcément empêché la reconnaissance d’une dette ou d’une parenté partielles, sans que cela ne suppose l’occultation ou la simplification d’un héritage complexe. Le rejet actuel d’une production littéraire datée, mais toujours proche dans ses formes et ses enjeux (l’avènement du roman et du « réalisme », avec pour finalité la description d’un monde que nous reconnaissons comme proche du nôtre) pourrait même apparaître comme un nouveau lien avec ce siècle qui a fait des mœurs et de la littérature de purs produits de l’histoire. Le romantisme et tous les -ismes qui le suivront font en effet de la rupture une nouvelle manière de penser la continuité, puisque c’est à travers la recherche d’une opposition que se donne à lire, depuis le romantisme, une constante : celle qui suppose que chaque génération a sa littérature et que, pour paraphraser Stendhal, il y a un art susceptible de plaire aux peuples « dans l’état actuel de leurs habitudes et de leurs croyances », comme il y avait un art qui « donnait le plus grand plaisir possible à leurs arrière-grands-pères » (Stendhal [1825], 1928, p. 43). Stendhal parlait cependant avant tout de manières de faire (ou d’écrire), lorsqu’il opposait le classicisme au « romanticisme », et sa cible première était l’idée d’un canon éternel empêchant l’actualisation de la littérature, non les œuvres du passé en tant que telles – dont l’étude n’était ni à remettre en question, ni à proscrire.
6La « difficulté » à laquelle serait actuellement confronté l’enseignement de la littérature du xixe siècle est d’une tout autre nature. La forme actuelle que prend cette conscience d’un écart axiologique n’entre plus forcément dans une dynamique d’opposition constructive, comme dans le cas d’écrivains prenant position pour faire œuvre à leur tour – ainsi lorsqu’il s’est agi de défendre, comme pour Sartre, une certaine éthique de la littérature fondée sur l’engagement, par opposition à un purisme esthétique ou à une forme d’absolu littéraire incarnés par le xixe siècle. La perception d’une discrépance de nature morale, aujourd’hui, menace la possibilité d’un dialogue, en favorisant un jugement tranché et définitif sur une littérature considérée comme trop éloignée de nos valeurs pour qu’elle puisse toujours faire l’objet d’un quelconque enseignement, pratique ou théorique. L’originalité de l’opposition nouvelle qui se dessine, à travers la difficulté, tout aussi nouvelle, d’enseigner la littérature du xixe siècle – et non d’y intéresser les élèves, ce qui est un problème différent – tient en définitive au fait qu’elle n’est plus réellement motivée par le concept d’avant-garde, même si elle continue de correspondre à une défense de la « modernité » (celle de nos valeurs, et des valeurs défendues à l’école, ou par l’école). Le critère de partage se fait avant tout au nom de l’intégrité supposée de l’œuvre ou de son auteur, dont on évalue les prises de position morales, fictives ou réelles ; mais aussi, et sans doute surtout, du lecteur, soumis à une œuvre dont le contenu pourrait l’altérer, alors que l’école se devrait, selon la formule consacrée, d’être un « sanctuaire », et donc un espace protégé et sécurisé, où chaque élève pourrait être préservé des violences du monde, et non menacé par des discours difficilement supportables – du moins pour les plus sensibles d’entre eux. D’un côté la défense des principes, de l’autre celle du bien-être et de la sensibilité de chacun : telles semblent être les raisons qui expliquent cette difficulté de l’enseignement, et la nécessité défendue par certains d’une adaptation des œuvres du xixe siècle aux valeurs contemporaines.
7Comment, dans ces conditions, penser une approche rénovée qui ne soit pas une nouvelle censure ? Comment préserver les savoirs historiques et l’enseignement qu’ils nous apportent ? Actualiser veut-il forcément dire adapter (à la sensibilité du public, et plus précisément d’un public scolaire), ou peut-on encore envisager d’autres voies possibles ? L’écart axiologique est-il réellement tel qu’il bloque désormais le processus de l’immersion fictionnelle, et empêche de suspendre momentanément le jugement éthique ? S’immerger est-il pour autant forcément adhérer, et comment préserver d’autres modalités d’évaluation, qui peuvent être, elles aussi, riches en enseignement ? Le danger n’est-il pas, finalement et inversement, que l’immersion fictionnelle fonctionne désormais trop bien en raison d’une sensibilité accrue aux problèmes éthiques, et qu’elle impose la sensibilité, personnelle, comme grille de lecture unique, voire comme critère ultime de décisions collectives concernant ce que l’on peut ou que l’on doit enseigner ? Comment concevoir une approche de la littérature du xixe siècle qui prenne en compte ces exigences nouvelles sans renoncer à une partie des enjeux propres à l’enseignement (préserver l’esprit critique et l’esprit de dialogue, qui supposent de pouvoir continuer à affronter des discours ou des représentations qui ne plaisent pas, moralement ou émotionnellement – mais dont l’analyse demeure utile dans une formation intellectuelle) ? Le problème moral que pose l’enseignement actuel de la littérature du xixe siècle permet non seulement de réfléchir à la finalité de l’enseignement académique, mais aussi à la place respective du jugement et de la sensibilité dans ce qui, aujourd’hui, fait obstacle, et détermine la conception de l’admissible : il est également porteur d’un enjeu démocratique fondamental.
8Les contributions réunies dans ce volume tentent d’apporter des éléments de réponse aux questions d’ordre pratique ou théorique que soulève l’admissibilité sous conditions d’un enseignement ou d’une étude critique de la littérature du xixe siècle. Elles constituent moins un droit de réponse qui consisterait à défendre coûte que coûte le xixe siècle qu’une tentative de réfléchir aux manières d’« enseigner à partir des refus », pour reprendre le titre d’un des chapitres d’Au NON des femmes de Jennifer Tamas (2023) : l’enjeu de ce volume est de souligner que les questions posées au canon sont autant d’opportunités permettant de (re)penser les pratiques pédagogiques et celles de la critique littéraire, en en clarifiant certains présupposés (à quoi sert exactement le « retour au contexte » ? Est-il une solution trop facile pour relativiser le malaise provoqué par le texte ?) ou en affrontant certaines tentations (doit-on choisir uniquement des objets d’étude conformes à ses valeurs ?). Il n’est donc pas question ici de nier toute pertinence heuristique au fait de lire à partir du contemporain, mais de prendre acte des nouveaux défis que le contexte contemporain présente à l’étude et la compréhension des textes. Par ailleurs, ce volume fait le choix d’introduire une dimension comparative, à travers ce que le xixe siècle voit (en orient, notamment), le xixe siècle vu d’ailleurs (d’Amérique du Nord en l’occurrence) ou encore un autre canon dix-neuviémiste (le canon russophone). Cette perspective permet de mieux cerner ce qui « accroche » avec le xixe siècle sous la forme d’invariants ou de patterns de condamnation, mais aussi de voir comment s’est configuré le champ des savoirs autour de cet objet controversé, ici et ailleurs. Cela permet in fine de lutter contre le « nationalisme méthodologique » que l’on accuse souvent le xixe siècle d’avoir créé.
9Dans ce carrousel d’approches et de réponses, une première, d’ordre historiographique, consiste à tenter de désamorcer l’emprise potentiellement toxique de l’émotion, voire de l’identification, en rappelant que l’enseignement de la littérature n’a pas forcément pour fonction de prendre parti, mais de comprendre : comprendre que la littérature est le produit d’une société historiquement donnée, et que la spécificité de son étude réside dans le décryptage des codes employés. C’est ce qui différencie, selon Alain Vaillant, l’enseignement de la littérature du « club de lecture », où l’engagement personnel et la place du jugement moral sont tout autres : l’évaluation de l’idéologie mise en texte, pour qui pratique et enseigne l’analyse littéraire en historien, n’est pas un prérequis, mais une conséquence de ce qui peut s’apparenter à un apprentissage de l’esprit critique. S’il se retrouve au centre de l’enseignement, le jugement moral, rappelle Paolo Tortonese, menace en effet d’entretenir la confusion entre le fait et la fiction. Or, enseigner la littérature, de quelque siècle qu’elle soit, c’est aussi permettre l’apprentissage de l’illusion référentielle, et faire l’expérience d’une juste distance avec les émotions ressenties, qu’il convient d’apprivoiser pour les convertir en connaissance. Revenir aux théories de la fiction constitue donc une autre voie possible pour dépasser le point de blocage que peut constituer une axiologie restreinte au seul jugement moral, voire une réponse au risque que représente une telle réduction.
10Comment, néanmoins, faire face concrètement aux agressions que peut véhiculer un texte, sans minimiser ou marginaliser la sensibilité qui est également au cœur de la lecture ? En envisageant cette dernière comme un sport de combat, ou plus exactement comme un art du self-défense utilisant la force de l’adversaire, pour Sophie Rabau : prenant l’exemple de Carmen, elle propose d’inventer, à partir du texte même, d’autres fins possibles que celle d’un féminicide, et invite ainsi à retourner le pouvoir de la fiction contre elle-même. Anne-Claire Marpeau rappelle en outre que la relecture féministe des textes du canon a eu dès l’origine une fonction herméneutique, et qu’elle a permis l’émergence de nouvelles interprétations des textes, tout en attirant l’attention sur leur réception. Les lectures féministes peuvent à ce titre constituer un précieux outil didactique, favorisant l’esprit critique sans enfermer l’étude littéraire dans la prescription morale. La pratique d’une lecture active, capable de contrer toute sidération face au texte, peut également être aidée par un travail précis d’édition critique, montre Sarga Moussa à partir d’un chapitre du Voyage en Orient de Nerval : l’appareil critique a une fonction d’explicitation, mais aussi de « cadrage » éthique qui peut faciliter la lecture, en ne laissant pas celui qui la pratique seul face à un texte dont l’idéologie est problématique. Le « combat de notes » dont témoignent les différentes éditions de ce texte est aussi un combat contre les non-dits ou la sacralisation du texte littéraire, qui font indéniablement obstacle à sa bonne réception aujourd’hui – et par conséquent à sa pérennité.
11Le danger serait en effet que la sacralisation se retourne en proscription, et que les mots d’un autre siècle ne puissent même plus être prononcés. Le « déminage » éditorial a de fait déjà lieu, rappelle Maxime Prévost, et « l’affaire Verushka Lieutenant-Duval », du nom de cette enseignante licenciée de son université (Ottawa) suite aux plaintes d’étudiants s’étant sentis agressés par l’emploi en mention de mots considérés comme offensants, laisse entrevoir l’émergence d’une nouvelle forme de censure au cœur de l’enseignement lui-même. Cet usage politique de la littérature peut sembler nouveau en contexte démocratique. Victoire Feuillebois montre, à partir de l’exemple du « monument national » qu’est Pouchkine et des passions qu’il a suscitées dans le cadre de la guerre à grande échelle en Ukraine, que les mécanismes présidant à la constitution d’un canon s’inscrivent aussi dans des dynamiques idéologiques : à ce titre tout travail de sélection, voire d’épuration du canon, bien qu’il puisse apparaître tout d’abord comme une simple manière de résoudre les difficultés à aborder les œuvres du passé, est aussi un geste d’historiographie littéraire qui dévoilent les valeurs du passé comme celles du présent. L’enseignement est aussi le reflet de la vision de la démocratie que l’on souhaite défendre, avance Bertrand Marquer en guise de conclusion : le succès remporté par Le Bal des folles de Victoria Mas (prix Renaudot des Lycéens en 2019) montre quoi qu’il en soit que c’est moins le xixe siècle qui rebute, que ce qu’il dit des origines de notre société contemporaine. Établir des fractures artificielles ou rétablir une forme de censure morale risquerait de conduire à l’oubli de ce qui la fonde : pour le pire, comme pour le meilleur.