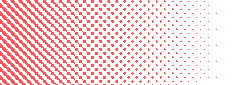Du vaisseau Le Vengeur à la frégate La Sérieuse
1« La Frégate La Sérieuse » paraît dans les Poèmes de 1829, c’est-à-dire dans le recueil qui réunit celui de 1822 et celui de 1826, constituant une première version de ce qui est aujourd’hui connu sous le titre Poèmes antiques et modernes. Il ne manque alors que les deux « Élévations » finales, pas encore écrite, et « Le Malheur », publié en 1822 mais repris seulement à partir de 1841. « Le Malheur » servait de conclusion au premier recueil, avec une dernière strophe commençant par cette question : « Malheur ! oh ! quel jour favorable / De ta rage sera vainqueur ? (v. 71-72, GF, p. 130) ». Le recueil de 1826 s’achevait par le « Le Cor » : « Dieu ! que le son du Cor est triste au fond des bois ! » (v. 86, GF, p. 151). En 1829, c’est « La Frégate La Sérieuse » qui occupe cette position stratégique. Son importance était aussi rendue visible par la gravure de la page de titre. Sur cette image exceptionnelle — les autres recueils n’en comportent pas —, on voit le capitaine de La Sérieuse accroché à un pavillon tricolore en lambeaux au moment où sa frégate fait naufrage1. Le 9 mai 1829, quelques jours avant la mise en vente du volume, le journal Le Globe met aussi ce poème en avant en l’imprimant intégralement.
2Le poème raconte le dernier voyage de la frégate La Sérieuse et sa destruction par les navires anglais lors de la bataille navale d’Aboukir, le 1er août 1798. La flotte de la jeune République française subit de lourdes pertes, si bien que la campagne d’Égypte, voulue par le Directoire et conduite par le général Bonaparte, commence par un désastre militaire. Si rien n’est dit dans le texte de Vigny de celui qui a depuis été empereur, le mouvement général reprend les étapes de l’événement historique, de l’élan de « la traversée » au « repos » trompeur et au « combat » fatal. Au moment où il a écrit son poème, en 1828, Vigny travaillait à un projet de roman sur Les Français en Égypte (voir Springstub, 2007), mais la documentation mobilisée pour connaître les détails de la campagne militaire de 1798 n’est pas la seule source d’un poème aux influences multiples. Vigny s’inspire de chansons, de poèmes et de romans de marins (voir ŒC, t. I, 1986 et Vigny, 1914). Edmond Estève dans son édition2 relève notamment des emprunts au Pilote, roman de James Fenimore Cooper dont le journaliste du Globe remarquait déjà la ressemblance avec « La Frégate La Sérieuse3 ». À Dieppe en 1827, Vigny a rencontré le poète écossais Thomas Campbell dont les odes célèbrent les victoires de la marine britannique. On a remarqué aussi la ressemblance du premier vers du poème avec celui du « Chant des pirates » de Louis-Marie Fontan4 et il faut peut-être mentionner aussi Victor Hugo. Dans une lettre du 15 avril 1828 qu’il lui adresse, Vigny cite le refrain de la « Chanson de pirates » des Orientales (« Dans la galère capitane / Nous étions quatre-vingt rameurs ») et il fait ce commentaire : « Voyez comme l’écho de vos beaux vers et de vos moindres chansons va loin » (Vigny, 1989, p. 2945). Ces inspirations suggèrent que l’imaginaire des aventures en mer a davantage compté dans la genèse du poème que son objet proprement historique.
3Le contexte de la campagne d’Égypte s’éloigne encore davantage si l’on prend en compte deux motivations biographiques importantes. La première est l’histoire de l’oncle du poète, Joseph de Vigny, qui fut capitaine de frégate et dont le drame fut un combat perdu face aux Anglais pendant la guerre d’indépendance américaine en 1782. Contraint de se rendre et d’abandonner son navire, il avait ensuite été emprisonné en France. Christiane Lefranc remarque que le poète avait certainement connu et écouté cet oncle, qui mourut quand il avait quinze ans. Elle y voit non seulement un modèle pour « la plainte du capitaine6 », mais aussi une inspiration possible pour « La Prison » (Lefranc, 1982). La deuxième motivation biographique est encore plus personnelle : Vigny compose « La Frégate La Sérieuse » quelques mois après avoir abandonné la carrière militaire où il avait atteint le grade de « capitaine ». Dans une lettre à Paul Foucher du 20 avril 1828, il écrit :
Amoureux (mais en vain) de la gloire et de la gloire des armes, élevé au bruit des canons et des Te deum de Bonaparte, je n’atteignis l’âge de porter l’épée qu’en 1814, c’est-à-dire lorsqu’elle était inutile. Je la pris cependant, et j’entrai au service, que je viens de quitter, las d’attendre ces guerres que j’avais rêvées dans mon enfance et qui semblent refusées à ma génération (Vigny, 1989, p. 297).
4L’actualité a pu enfin jouer un rôle. La bataille navale de Navarin a fait grand bruit en octobre 1827, mais elle a vraisemblablement moins marqué Vigny qu’un épisode de la guerre d’indépendance grecque survenu en novembre de la même année : un enseigne de vaisseau français nommé Bisson fait sauter son navire plutôt que de se rendre aux pirates qui l’ont attaqué. Vigny consigne l’événement dans son journal : « Bisson se faisant sauter avec les pirates qui ont pris son vaisseau pendant la nuit et le sommeil. […] Il s’éveille, il combat ; puis se fait sauter, et se rendort sous les flots pour toujours. » (J, p. 886.)
5Voilà bien des inspirations pour ce poème et autant de pistes de lectures pour son étude ! Dans un tel ensemble, le contexte historique de la bataille d’Aboukir peut sembler accessoire. Pourquoi Vigny a-t-il choisi une bataille navale de 1798, c’est-à-dire de la Révolution ? Le contexte de publication donne une partie de la réponse : Charles X est de plus en plus contesté à la fin de son règne. Un peu plus d’un an avant la Révolution de Juillet 1830, Vigny participe à l’expression d’une exigence libérale lorsqu’il célèbre les marins de la République et le pavillon tricolore. Son éditeur et le dessinateur de la page de titre ajoutent à la provocation, non seulement par la représentation du drapeau, mais aussi parce que le capitaine a les traits de Napoléon Bonaparte au pont d’Arcole7. En 1829, l’évocation de la gloire militaire exprime à la fois le regret d’un passé révolu et une aspiration au changement.
Page de titre de l’édition de 1829 des Poèmes d'Alfred de Vigny.
6Les marins qui crient « Vive la patrie » (« La Frégate La Sérieuse », v. 182, GF, p. 171) incitent aussi à s’interroger sur une autre inspiration possible du poème en considérant la frégate La Sérieuse comme un avatar du vaisseau Le Vengeur. À la bataille navale du 13 prairial an II (1er juin 1794), les marins de ce navire s’étaient illustrés, dit-on, par leur fin héroïque, préférant mourir plutôt que se rendre aux Anglais qui les avaient vaincus. Bertrand Barère avait rapporté le fait à la Convention et il avait invité les poètes à le célébrer, ce que beaucoup avaient fait. Vigny connaissait certainement cet épisode célèbre et vraisemblablement les poèmes qu’il avait inspirés à Parny, Marie-Joseph Chénier, Lebrun et Rouget de Lisle8.
7Certes, la Restauration est un temps faible dans la postérité de cette tradition, mais un journal de février 1828 avait écrit : « La mort héroïque de l’enseigne de vaisseau Bisson est un des plus beaux actes de dévouement, après celui du vaisseau Le Vengeur, dont la marine française puisse s’enorgueillir » (Le Messager des chambres, 20 février 1828, p. 4). Il existait aussi une mémoire populaire de l’événement dont témoigne un spectacle représenté de 1820 à 1822 dans le Jardin du Delta, sorte de parc d’attractions installé au faubourg Poissonnière9. L’« Ode sur le vaisseau Le Vengeur » de Lebrun avait été rééditée en 1827. Quelques années plus tôt, elle avait été publiée dans un volume de poèmes sur les campagnes militaires françaises (Victoires, conquêtes des Français, 1821, p. 116). On y trouvait aussi « Le Chant des victoires » de Marie-Joseph Chénier dont une strophe commence par ces vers : « Lève-toi ! Sors des mers profondes, / Cadavre fumant du Vengeur » (p. 77). « Le vaisseau Le Vengeur » de Parny figurait quant à lui dans les Œuvres choisies publiées en 1826. Mais l’événement éditorial le plus susceptible d’avoir attiré l’attention de Vigny est la publication par Rouget de Lisle en 1824 de Cinquante chants français, volume où celui-ci a réuni ses propres compositions à d’autres chants. On y trouve « Les Héros du Vengeur » entre l’« Hymne des Marseillais », devenu bien plus tard l’hymne national, et « La Jeune captive » d’André Chénier ! Le chant présente aussi une autre particularité remarquable : il est une variante de « Roland à Roncevaux », composé en 1792 par Rouget de Lisle et publié en tête du recueil de 1825, dont il reprend le refrain : « Mourons pour la patrie ! / C’est le sort le plus beau, le plus digne d’envie. » Vigny a-t-il lu le « Roland » de Rouget de Lisle avant d’écrire « Le Cor » ? « La Frégate » prend en tout cas la place occupée par ce poème en 1826, la dernière du recueil. Une histoire de fin glorieuse prend le relai de l’autre.
Une défaite héroïque
8Comme les poètes du Vengeur, Vigny transforme une défaite en victoire lorsqu’il écrit que les Anglais sont « Vaincus par notre mort » (« La Frégate La Sérieuse », v. 276, GF, p. 174). Rouget de Lisle joue du même renversement quand il écrit : « Approche, superbe vainqueur, / Approche, les vaincus t’attendent ». Comme ses prédécesseurs, Vigny s’écarte de la réalité des faits pour grandir la bataille et son issue : le récit historique qui lui a servi de source indique par exemple que la mer était trop peu profonde pour que La Sérieuse soit entièrement submergée (Vigny, 1914, p. 221). On peut remarquer aussi de nombreux traits communs aux poèmes du Vengeur et au « combat » de Vigny, même s’ils procèdent peut-être davantage d’un imaginaire commun que d’une filiation directe : ici le mot « étincelle », présent à la rime chez Lebrun comme chez Vigny, là le tableau saisissant de la destruction des navires. On lit ainsi chez Lebrun :
Près de se voir réduits en poudre,
Ils défendent leurs bords enflammés et sanglants.
Voyez-les défier et la vague et la foudre
Sous des mâts rompus et brûlants.
9Et dans le poème de Parny :
La voile déchirée aux vents laisse un passage ;
Le rapide boulet emporte le cordage ;
La vergue, sans appui, frappe les mâts rompus ;
Ils se brisent, et le navire
Au gouvernail n’obéit plus.
10Si l’on retrouve les mêmes images chez Vigny (« Sans gouvernail, sans mât, on n’eût pu reconnaître / La merveille de l’art ! » — « La Frégate La Sérieuse », v. 263-264, GF, p. 174), la comparaison entre les textes révèle la recherche d’une plus grande précision matérielle dans « La Frégate ». Ainsi le mot poudre désigne-t-il chez lui l’explosif plutôt que le résultat indistinct de la destruction et les boulets sont « enchaînés », c’est-à-dire reliés deux à deux pour faire de plus gros dégâts : « Ses boulets enchaînés fauchaient des mâts énormes, / Faisaient voler le sang, la poudre et le goudron » (v. 241-242, GF, p. 173).
11La disproportion des forces en présence est un autre moyen de rendre le combat héroïque. Parny écrit :
Le Vengeur combat seul, de la ligne écarté.
Quatre flottantes citadelles
De leur canon sur lui dirigent tous les feux.
12Vigny semble répondre par le cri indigné de son capitaine : « Trois vaisseaux de haut bord — combattre une frégate ! » (v. 233, GF, p. 173.) Il multiplie d’ailleurs les indications chiffrées, opérant un dénombrement des navires, des canons et des hommes que l’on retrouvera plus tard dans le roman Quatrevint-treize de Victor Hugo (livre II, chapitre VIII).
13La forme même du « combat » sert l’écriture héroïque. Alors que les seize autres sections numérotées du poème comportent chacune un unique groupe de vers — strophe ou bloc comprenant entre douze et vingt-quatre vers — la section XVI est composée de vingt-deux quatrains aux rimes alternées. C’est l’une des formes possibles de l’ode héroïque telle que l’a pratiquée Lebrun pendant la Révolution. L’« Ode au vaisseau Le Vengeur » est, elle aussi, composée de quatrains d’alexandrins aux rimes alternées, avec une organisation métrique légèrement différente : 8, 12, 12 et 8 syllabes dans ce poème ; 12, 12, 12 et 6 syllabes chez Vigny. Les strophes III à XIV, réunies sous le titre « la traversée », forment une autre ode dans le poème puisqu’elles sont, selon la définition donnée par Brigitte Buffard-Moret, « semblables entre elles par le nombre et la mesure des vers, et destinée […] à célébrer de grands événements ou de hauts faits » (Buffard-Moret, 1997, p. 135). L’heptasyllabe utilisé dans cette partie du poème, plus cadencé que l’alexandrin, rappelle plutôt les odes de Ronsard que celles des poètes de la Révolution, mais toujours il s’agit d’exprimer un élan et une forme d’enthousiasme que traduit notamment l’exclamation répétée : « Quel plaisir ! » (« La Frégate La Sérieuse », v. 101 et 113, GF, p. 169.)
14La comparaison est l’un des procédés caractéristiques de l’écriture héroïque. Chez Lebrun, qui avait pris le nom de Lebrun-Pindare, elle est souvent mythologique et permet de convoquer dieux et héros dans le poème. Vigny privilégie pour sa part les comparaisons qui renvoient à la nature ou à des scènes que l’on pourrait qualifier de quotidiennes si l’on vivait dans le monde d’Homère. Dans la strophe X, la mer qui porte la frégate est comparée d’abord à un lion (« Comme un vieux lion abaisse / Sa longue crinière épaisse ») puis à une mère portant un berceau sur sa tête (v. 129-137, GF, p. 170). Pendant le combat, les boulets « S’enfonçaient dans le bois, comme au cœur des grands ormes / Le coin du bûcheron » (v. 243-244, GF, p. 173). La comparaison la plus développée est celle du cygne, qui occupe les seize alexandrins de la section XV (« Le repos »). Elle est véritablement homérique ou épique, développant un tableau de la nature dont les beautés grandissent les objets du récit. Vigny utilise souvent des comparaisons de ce genre, lui qui veut donner « une forme épique » à « une pensée philosophique » (préface de 1837, GF, p. 59).
15Le caractère héroïque de « La Frégate La Sérieuse » rend ce poème relativement exceptionnel dans l’œuvre de Vigny. On ne retrouve guère un tel élan que dans les deux élévations qui le suivent — mais alors la chute est plus terrible — et surtout dans « La Bouteille à la mer », ode au progrès et à la gloire d’un autre capitaine. De ce point de vue, les deux poèmes de marins de Vigny sont moins éloignés l’un de l’autre qu’on ne l’a parfois dit (ŒC, t. I, p. 1016). L’un et l’autre célèbrent une marche en avant et ce que Lebrun appelle un « naufrage victorieux ».
Ne mourons pas pour la patrie
16Si les points communs entre « La Frégate » et les poèmes du Vengeur mettent en évidence cette caractéristique, les différences importent encore davantage. Les poètes de la Révolution évoquent tous les deniers « cri » des marins : « Vive la liberté ! » chez Lebrun, « France ! Liberté ! République ! » chez Parny et bien sûr le refrain de Rouget de Lisle : « Mourons pour la patrie ! ». Si les marins de Vigny crient eux aussi « Vive la patrie ! », c’est lorsqu’ils arrivent à « Alexandrie » après une traversée « sans avarie » (« La Frégate La Sérieuse », v. 181-183, GF, p. 171). L’illusion d’une conquête sans effort ni revers, soulignée par la rime, motive un cri patriotique qui n’est pas renouvelé au moment du naufrage. Les mots « Liberté » et « République » sont eux absents du poème. Certes, Vigny reprend un mot du calendrier républicain quand il évoque la journée « Du quinze Thermidor », mais le nom de ce mois rappelle alors un autre Thermidor, celui de la chute de Robespierre. Dans la deuxième section, l’énumération glorieuse des ports de France ne renvoie pas particulièrement à la Révolution, mais rappelle les Vues des ports de France réalisées par le peintre Joseph Vernet à la demande de Louis XV, sans même parler de la mention explicite de Richelieu : « Du grand Cardinal-Duc La Rochelle a la digue » (v. 38, GF, p. 167). L’éloge final de Toulon, plus glorieuse que les autres villes pour avoir « lancé la Sérieuse en mer », fait cependant signe vers des combats de la Révolution et peut-être même, à cet endroit du poème, vers Napoléon Bonaparte, qui y connut pour la première fois la gloire.
17Les strophes les plus patriotiques sont la strophe XIV — celle de l’arrivée à Alexandrie, déjà mentionnée — et la strophe VII : aux noms des navires qui rappellent les combats pour l’indépendance de la Grèce antique (« Le Spartiate ») et de l’Amérique (« Le Franklin ») s’ajoutent les trois couleurs, « Le bleu, le blanc, l’écarlate », dont la valeur symbolique est soulignée par le vers suivant : « De cent mâts nationaux » (v. 95-96, GF, p. 169). Les trois couleurs ont été adoptées officiellement par la Révolution et utilisées d’abord dans la marine. Le combat de Prairial — celui du Vengeur — est d’ailleurs le premier où l’on a utilisé le nouveau pavillon. Mais lorsque Vigny publie son poème, la France de la Restauration est revenue au drapeau blanc. On lit dans le poème de Lebrun : « Voyez ce drapeau tricolore / Qu’élève, en périssant, leur courage indompté » ; Parny écrit : « De tous côtés leur main déploie / Les pavillons aux trois couleurs » ; et Rouget de Lisle emploie le mot « pavillon » à plusieurs reprises. Chez Vigny même, le mot apparaît quatre fois. Pendant la traversée, c’est lui que suit l’escadre (v. 69, GF, p. 168) et que l’on voit « aller si vite » (v. 101, GF, p. 169). Il est ensuite un élément central de la fin du combat, mais alors Vigny s’éloigne de ceux qui célèbrent Le Vengeur. Les marins de 1794 se dressent au moment de mourir et ils élèvent leur drapeau. Le capitaine de La Sérieuse fait un geste opposé : « Et je revins tout seul me coucher sur la poupe / Au pied du pavillon » (v. 271-272, GF, p. 174). Le drapeau lui-même est à la fois submergé et renversé par le naufrage : « Mon pavillon noyé se montrait en dessous » (ibid., v. 286). Pas de « joie » comme chez Parny et Rouget de Lisle à ce moment du récit, mais le gémissement du navire et les pleurs du marin. On est loin des poèmes du Vengeur et même de l’image de la page de titre du recueil de 1829, peu fidèle à la scène imaginée par Vigny.
18Le capitaine disparaît auprès de son pavillon, mais pas pour celui-ci. Il n’est pas un « enfant de la patrie », mais un « vrai marin » (v. 144, GF, p. 170), c’est-à-dire si l’on en croit la définition qu’il donne dans la strophe XI, un homme sans patrie puisqu’il n’a ni père ni terre :
Ma naissance est un mystère ;
Sans famille, et solitaire,
Je ne connais pas la terre,
[…]. (Ibid., v. 145-147).
19Le capitaine meurt d’autant moins pour la patrie qu’il ne meurt pas du tout ! Au lieu de s’achever par la disparition du navire sous les eaux, dans une fin qui pourrait rappeler celle du « Déluge », le poème est relancé par l’ajout d’une section supplémentaire. Les marins du Vengeur refusaient de se rendre. Ceux de Lebrun s’indignaient à l’idée d’être faits prisonniers : « Captifs ! … la vie est un outrage : / Ils préfèrent le gouffre à ce bienfait honteux ». Le capitaine de Vigny exprime certes un regret (« Hélas ! », v. 289, GF, p. 175), mais il se résigne quand il doit vivre sur un « ponton » (v. 291, ibid.), c’est-à-dire sur un bateau-prison. Il y a déjà chez lui quelque chose du Loup et de la Louve de « La Mort du Loup ». S’il est un homme de devoir (« Nous nous sommes conduits comme il fallait, lui dis-je », v. 283, GF, p. 174), il est aussi prêt à mourir que disposé à vivre.
20La différence est grande avec le poème qui précède « La Frégate » : le Trappiste engage ses hommes au « martyr volontaire » (« Le Trappiste », v. 202, GF, p. 164) par fidélité à une cause politique. C’est lui, plutôt que le capitaine de La Sérieuse, qui reproduit le geste des marins du Vengeur : « Pour le Roi la couronne, et des tombeaux pour nous. » (v. 227, GF, p. 165.) Faut-il en tirer des conclusions sur les partis pris politiques de Vigny ? On peut certes remarquer que la cause des rois est portée plus haut que celle du drapeau tricolore, mais on peut lire aussi « La Frégate » comme un correctif au « Trappiste ». L’héroïsme sage du capitaine est préférable à un héroïsme sacrificiel et vain. L’enseigne de vaisseau Bisson qui se fait sauter avec son bateau n’a pas servi d’exemple, non plus que les nombreuses morts héroïques de la bataille d’Aboukir. Jean-Joseph Ader, l’auteur de l’Histoire de l’expédition d’Égypte et de Syrie que Vigny a consultée, raconte la fin de l’amiral Brueys (« Un amiral français, dit-il, doit mourir sur son banc de quart »), et celle « du jeune Casa-Bianca [qui] a voulu rester pour mourir avec son père » (Ader, 1826, p. 94-9710). Vigny mentionne à peine le nom du navire amiral qui a été le théâtre de ces deux sacrifices, l’« Orient » (« La Frégate La Sérieuse », v. 60, GF, p. 168). Il a préféré un héroïsme d’un autre genre, celui du capitaine qui, d’après les mots d’Ader, « se dévoua pour ses compagnons, en offrant de rester prisonnier, pourvu qu’on leur laisse la liberté » (Ader, 1826, p. 93). Dans le poème, il est repêché malgré lui, mais il a bel et bien assuré le salut des hommes qui lui restaient avant de se laisser couler : « Je les fis mettre en mer à bord d’une chaloupe » (« La Frégate La Sérieuse », v. 269, GF, p. 174).
La solitude du capitaine
21Le Trappiste est entouré d’hommes prêts à mourir ensemble, ce que souligne le dernier vers du poème : « Amen ! dit l’assemblée en tombant à genoux. » (« Le Trappiste », v. 208, GF, p. 165). De la même manière, les poètes du Vengeur parlent des marins au pluriel et si Rouget de Lisle isole une voix — celle du « capitaine » dans le texte original de 1796 devenu un « matelot » dans l’édition de 1825 — c’est pour mieux mettre en valeur le chœur qui lui répond. Le poème de Vigny fait au contraire entendre la voix d’un seul homme.
22Dans la strophe XII, cet homme a les attributs d’un roi. Par une étrange inversion symbolique, la cocarde révolutionnaire devient même sa couronne (« La Frégate La Sérieuse », v. 153, GF, p. 171). Doit-on alors lire « La Frégate » comme l’histoire d’un roi ou d’un empereur déchu ? Le poème ne serait plus le récit littéral d’une défaite de la marine républicaine, mais l’allégorie d’un monarque qui, dans la section XVI, ne parvient plus à se faire obéir. Ce serait là encore un déplacement remarquable des motifs développés par les poètes du Vengeur. Tandis que Lebrun veut que la poésie « Entraîne les sceptres des rois », Vigny fait entendre la plainte de celui qui perd son royaume.
23Mais le capitaine est plus sûrement une figure du poète, fût-il aussi un roi déchu, que la représentation d’un personnage historique. Il est un « solitaire » (« La Frégate La Sérieuse », v. 146, p. 170) dont la seule famille est sa frégate — « fille » (v. 163 et 219, GF, p. 171 et 173) et « enfant » (v. 140 et 284, p. 170 et 174) —, image possible de son œuvre. Il est à sa place sur la mer, où il peut donner libre cours à sa pensée, et il craint la terre, lieu des servitudes sociales. Et bien sûr il chante, ou du moins il fait entendre « la plainte du capitaine », comme l’indique le sous-titre du poème. Le je lyrique, plutôt rare dans les Poèmes antiques et modernes, est ici très présent pendant la traversée, à partir de la strophe XI, puis pendant le combat.
24La dernière section fait aussi du capitaine un conteur, avec la présence exceptionnelle dans le recueil d’une deuxième personne qui peut être adressée à son public : « Votre voix m’anime et me flatte, / Aussi je vous dirai souvent » (« La Frégate La Sérieuse », v. 299-300, GF, p. 175). L’adverbe distingue encore une fois Vigny des poètes du Vengeur, qui disaient contribuer à la mémoire d’un événement unique. Chez Parny par exemple, la colonne qui doit être installée au Panthéon est le modèle de ce qu’accomplit la poésie :
Et sur l’immortelle colonne
Elle écrit vos noms glorieux.
Ces noms éclatant dans l’Histoire,
De nos jeunes marins orneront la mémoire.
25Dans le poème de Vigny, le capitaine n’a pas de nom. La bataille est nommée au premier vers du « combat » (« Ainsi près d’Aboukir reposait ma Frégate », v. 201, GF, p. 172), mais son résultat importe peu. Les soldats du poème ont déjà pris les « Pyramides » (v. 211, ibid.) et ses lecteurs savent que d’autres batailles ont changé depuis le sort de la France. Seule reste « La Sérieuse » dont l’importance historique est nulle et qui sans « la plainte du capitaine » serait tout à fait oubliée. Reste surtout une répétition ou un retour qui contraste avec le finale solennel des poèmes du Vengeur. Grâce au destin prolongé du capitaine, les deux vers qui encadraient la première section peuvent être repris à la fin du poème : « Qu’elle était belle ma Frégate, / Lorsqu’elle voguait dans le vent ! » Ce qui importe n’est pas la mémoire d’un moment de rupture, mais le souvenir répété d’histoires touchantes. Le capitaine aime évoquer « souvent » sa frégate comme le poète du « Cor » se remémore l’histoire de Roland : « Âme des chevaliers, revenez-vous encor ? » (« Le Cor », v. 25, p. 150). Il aime aussi multiplier les histoires (« Nous causons de combats, de prises », v. 296, GF, p. 175) et pourrait bien reprendre à son compte les vers qui encadrent « La Neige » : « Qu’il est doux, qu’il est doux d’écouter des histoires / Des histoires du temps passé » (v. 1-2 et 68-69, GF, p. 146 et 148).
26Alors que les poèmes du Vengeur sont des éloges funèbres, « La Frégate La Sérieuse » est un chant d’adieu. Les premiers sont collectifs et solennels : ils relèvent des genres de l’ode, nous l’avons vu, ou encore de l’hymne ou du panégyrique. Le poème de Vigny est une « plainte » qui, par son pseudo-refrain et ses strophes d’heptasyllabes aux triples rimes, a quelque chose d’une chanson. Chant d’adieu, donc, à la première personne (« Adieu donc, mon enfant », v. 284, GF, p. 174) ou plutôt chant d’au revoir et chant à réentendre, puisque le capitaine reste là pour le reprendre.
27La survie du capitaine ne fait cependant pas disparaître la gloire. Elle subsiste par des mots, par des images et aussi par la forme de ce que Vigny désigne lui-même comme un « poème », c’est-à-dire comme une épopée. La gloire n’est pas celle du mythe — celui du vaisseau Le Vengeur (voir Schneider, 2005) ou un autre — mais précisément celle de l’épopée qui, dit Esther Pinon, « ouvre la voie d’un héroïsme à taille humaine » (Pinon, 2024, p. 15).
28Dès lors, la Révolution peut appartenir au présent. Elle n’est pas une rupture passée, un événement catastrophique ou admirable, mais la manifestation d’un problème contemporain traité dans « Le Trappiste » et « La Frégate », mais aussi dans « Le Bal » et plus tard — à partir de 1837 — dans « Les Amants de Montmorency » et « Paris ». La Révolution de Juillet 1830 et l’écriture de Stello ont fait évoluer le point de vue de Vigny sur les faits historiques11, mais toujours il travaille la tension entre l’aspiration (à la gloire, au progrès, au bonheur…) et la certitude du naufrage.