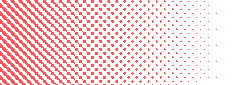« La Prison », un imaginaire tragique du pouvoir
1Une réflexion du Journal d’un poète, liée à Stello, propose cette description de l’existence humaine :
Dans cette prison nommée la vie, d’où nous partons les uns après les autres pour aller à la mort, il ne faut compter sur aucune promenade, ni aucune fleur. Dès lors, le moindre bouquet, la plus petite feuille réjouit la vue et le cœur, on en sait gré à la puissance qui a permis qu’elle se rencontrât sous vos pas.
Il est vrai que vous ne savez pas pourquoi vous êtes prisonnier et de quoi puni ; mais vous savez à n’en pas douter quelle sera votre peine : souffrance en prison, mort après. (J, p. 945.)
2Cette pensée est à nouveau formulée l’année suivante :
De la vie. — C’est une prison perpétuelle. Les captifs n’ont que deux états : Léthargie ou Convulsions, Ennui ou Inquiétude, et vont toujours de l’un à l’autre. […] — Les Captifs ne savent pas pourquoi ils sont en prison, quelle a été la faute, le procès et le juge, mais ils savent qu’ils sont cruellement traités.
[…].
Voilà l’état vrai de l’homme dans la vie. (J, p. 993.)
3De façon récurrente, Vigny semble concevoir l’existence comme une geôle, qui engendre une « souffrance » et une « mort », d’autant plus terribles que les « captifs » ignorent pourquoi ils sont détenus. Vision noire, désespérée, dont rend compte, dans les Poèmes antiques et modernes, « La Prison, xviie siècle ». Au sein d’un dialogue aux accents théâtraux, qui oscille entre drame et tragédie, un mourant emprisonné, qui s’avère être le Masque de fer, refuse l’extrême onction que lui propose un prêtre. La violence d’État, incarnée par la légende du jumeau caché de Louis XIV, engendre ainsi une rupture avec Dieu.
4La métaphore de la vie comme prison n’est pas neuve. On la rencontre déjà par exemple sous la plume d’Agrippa d’Aubigné ou de Pascal. Elle s’enrichit toutefois chez Vigny d’une dimension politique et historique qui l’inscrit au cœur des préoccupations de l’époque romantique : la prison, en même temps qu’elle représente la condition humaine, se conçoit comme la matérialisation de l’arbitraire qui la régit, et se colore des nuances de la tyrannie. De cette double métaphore — prison/existence humaine ; prison/pouvoir coercitif — naît une perception profondément désenchantée du politique qui conditionne, selon Vigny, l’inscription de l’homme dans le monde : dès lors que les dieux et les rois sont violents et aveugles, dès lors que leur transcendance défaille, l’homme n’est-il pas condamné à un monde-prison privé de Providence ? Cruauté et arbitraire sont alors les instruments de la déréliction. Premier poème à inscrire l’époque moderne dans une perspective historique, le texte pose ainsi, à l’orée de la carrière poétique de Vigny (le texte est écrit en 1821), l’équation entre désenchantement politique et désenchantement métaphysique. On peut se demander si en organisant la légende des siècles autour du motif central de la prison, reflet d’une vision tragique du pouvoir, le poème ne propose pas une clé de lecture de l’ensemble de l’œuvre poétique vignienne.
Prisons du pouvoir : une légende noire des siècles
5En 1824, Vigny inscrit dans son Journal le projet suivant : « L’idée-mère du roman sur Louis XIV : que le pouvoir absolu est l’anarchie politique et la barbarie. » (J, p. 879.) Si « l’idée » originelle n’aboutit pas sous sa forme romanesque puisque Cinq-Mars, le grand roman historique de Vigny, se déroule sous le règne de Louis XIII, elle révèle la profondeur des interrogations sur le pouvoir. Le paradoxe est notable : l’identification entre « pouvoir absolu » et « anarchie », c’est-à dire l’« état d’un peuple qui n’a plus ni chef, ni autorité à laquelle on obéisse, ni lois auxquelles on soit soumis » (Dictionnaire de l’Académie, 1832, p. 72), superpose et assimile ordre et désordre. Contradiction majeure que vient redoubler l’association entre « absolu[tisme] » et « barbarie », plus convenue, certes, mais qui peut surprendre sous la plume d’un auteur royaliste. Le jeu des oxymores et des antinomies reflète la complexité de la pensée politique du poète, laquelle se structure, comme l’a bien montré Sophie Vanden Abeele, autour d’une opposition nette entre pouvoir et liberté (Vanden Abeele-Marchal, 2024, p. 244-245) que la figure de Louis XIV vient incarner. Si, comme l’expose Vigny dans les « Réflexions sur la vérité dans l’art », « L’Idée est tout. Le nom propre n’est rien que l’exemple et la preuve de l’idée » (Vigny, 2006, p. 49), de quelle « idée » Louis XIV est-il ici le nom ? Non pas celui de la gloire royale mais bien plutôt celui de la violence, qui accompagne l’existence-même de tout « pouvoir absolu », voire de tout pouvoir. En effet, la monarchie, littéralement « gouvernement d’un seul », n’est-elle pas, par essence, susceptible de verser dans l’absolutisme ? Vigny, qui projette d’écrire une Histoire de la grandeur et du martyre de la noblesse de France, est avant tout un féodal qui oscille, vis-à-vis de la royauté, entre fidélité et défiance (voir Vanden Abeele-Marchal, 2019). Certes, sa prévention envers la monarchie s’accentue après l’échec de la Restauration et la révolution de Juillet. Mais on en rencontre les indices dès la décennie 1820, dans le trajet poétique qui se dessine au sein des Poèmes antiques et modernes. Car à défaut d’écrire un « roman sur Louis XIV », il inscrit avec « La Prison » l’examen de la coercition absolutiste au cœur de son œuvre poétique.
6Le texte, qui succède dans l’économie du recueil à « Dolorida » et au « Malheur », est en effet le premier des « Poèmes modernes » à proposer un chronotope identifiable, puisqu’il met en scène le jumeau de Louis XIV en prison, victime expiatoire de la raison d’État. Or, en le situant à l’orée du trajet qui mène de l’époque de Charlemagne (« La Neige », « Le Cor ») à la période contemporaine (« Le Trappiste », « Paris ») Vigny définit une chronologie toute personnelle qui fait fi de la linéarité historique et substitue, selon les préconisations de la préface de Cinq-Mars, la « vérité d’observation sur la nature humaine » à « l’authenticité du fait » (Vigny, 2006, p. 49). « La Prison » dont le sous-titre fait une allégorie du « xviie » représente un espace matriciel, un creuset de la tyrannie politique qui irrigue la poésie vignienne tout entière. Ainsi, dans les Poèmes antiques et modernes, les noirceurs de la Saint Barthélemy (« Madame de Soubise, Poème du xvie siècle ») succèdent au xviie siècle du Masque de fer. Certes, au cours de ce cheminement à rebours de l’histoire objective, rayonne la figure de Charlemagne qui inscrit, au cœur des « temps modernes », la possibilité d’un pouvoir positif. Mais la légende dorée elle-même révèle sa part d’ombre : l’empereur fait preuve de clémence envers Emma et Éginard, mais il « craint sa colère et surtout son pouvoir » (« La Neige », v. 12, GF, p. 46) susceptible de transformer la royauté bienveillante en force négative. Vision désenchantée du politique que redouble la méfiance envers un autre pouvoir : celui du peuple. Aux dangers de la tyrannie monarchique, répond celle de la foule, en un mouvement qui annule toute alternative : responsable d’une eucharistie cannibale dans « Madame de Soubise », elle charge ses « bourreaux sanglants » de mettre à mal les défenseurs du roi dans « Le Trappiste » (v. 168, GF, p. 163). De cet univers où la tyrannie répond à la tyrannie, émerge une seule valeur positive : celle de la noblesse des « Paladins antiques » (« Le Cor », v. 8, GF, p. 149) que Charlemagne n’a pas su défendre contre la mort et que l’absolutisme incarné par Louis XIV a fini d’anéantir. Par le jeu de la superposition du présent et du passé les deux poèmes consacrés à la figure tutélaire de Charlemagne emprisonnent les espoirs révolus dans un présent délétère : désormais, à la douceur des « histoires du temps passé » (v. 2 et 69, GF, p. 146 et 148) répond un présent « glacé » (v. 4 et 148, ibid.) tandis que les accents guerriers du cor de Roland se sont mués en thrènes funèbres (« Le Cor », GF, p. 149-151). Si le « xviie siècle » de « La Prison » est l’initiateur de ce délitement dans l’économie du recueil, c’est sans doute parce qu’il a, selon Vigny, consacré la rupture entre monarchie et noblesse, cassant ainsi « les bras du trône » sans « rien » mettre « à leur place » (Vigny, 2006, p. 62). En substituant des solliciteurs à ses « pairs », il a sapé les bases de la royauté et conduit « les peuples » à « se révolter » (ibid., p. 63)1.
7Désormais vidé de son substrat grandiose, le pouvoir s’incarne dans les espaces de l’oppression. « La Prison » exerce ainsi son attraction sur l’ensemble de l’œuvre poétique vignienne, révélant un motif central de son imaginaire : obscurité, solitude, poids des chaînes résonnent de la Bastille du Masque de fer en 1821 à la Sibérie de « Wanda » en 1847 et 18572. Entre les deux poèmes, la pensée politique de Vigny s’est, certes, profondément modifiée au gré des changements de règnes et des déceptions successives3. Mais l’angoisse d’asservissement demeure, dessinant d’un poème l’autre une terrible géographie carcérale. « La Prison » entraîne ainsi le lecteur « Dans un étroit cachot dont les torches funèbres / Ont peine à dissiper les épaisses ténèbres » (v. 25-26, GF, p. 130). À la rime « funèbres » / « ténèbres », qui creuse une sape obscure, répond l’univers glacé et souterrain de « Wanda » (GF, p. 241-248) dans lequel l’isotopie carcérale (« esclave » v. 14, « forçat » v. 30, « boulet » v. 35, « mains enchaînées » v. 61…) se double du motif de la catabase. Présent dans le discours rapporté de la princesse — « J’irai dans les caveaux, dans l’air empoisonneur » ; « Je descendrai vivante au tombeau du mineur » (« Wanda », v. 44 et 49, GF, p. 242-243) — il apparaît également dans celui du « Français », destinataire du récit tragique qu’il commente pour en élargir la portée :
Éponines du Nord, vous dormez dans vos tombes,
Vous soutenez l’esclave au fond des catacombes
Dont vous ne sortirez qu’au dernier jugement.
(« Wanda », v. 103-105, GF, p. 245.)
8La rime « tombes » / « catacombes » organise un trajet funèbre par lequel l’emprisonnement rejoint la mort tandis que la princesse victime du Czar se mue en allégorie des victimes d’un pouvoir absolu. L’antonomase, la double référence à l’antiquité romaine4 et à la Bible ainsi qu’aux persécutions chrétiennes, le pluriel associé au vocatif, mettent en scène le martyrologe de ceux — « Seigneurs » (v. 114) ou « Peuple » (v. 113) — qui sont confrontés au tyran. Dans ce poème, comme dans « La Prison », l’absolutisme est bien le moteur de l’injustice qui règne sur l’univers carcéral. Cependant, si dans « Wanda » « Les épouvantements du fatal souverain » (v. 88, GF, p. 244) sont clairement désignés, le pouvoir auquel le détenu de « La Prison » est soumis est bien plus complexe. La forme dialoguée du poème en témoigne : en confrontant « Le Mourant » et « Le Prêtre » au sein d’un lieu commun de l’imaginaire romantique, elle ouvre pour le lecteur un espace théâtral dans lequel se joue le drame de l’histoire dont nul discours ne vient organiser le sens.
« La Prison », un drame romantique ?
9Dans « La Prison », l’injustice affreuse dont le Masque de fer est victime, est révélée à travers une forme mi-poétique, mi-théâtrale qui laisse le lecteur seul face aux interrogations suscitées par le dialogue. La narration (dans laquelle les échanges s’insèrent) s’apparente en effet souvent à des didascalies et ne propose pas un sens à l’intrigue. Dès le premier vers, « Oh ! ne vous jouez plus d’un vieillard et d’un prêtre ! » (v. 1, GF, p. 131), la notion de « jeu » s’inscrit au cœur du texte. Elle révèle l’incompréhension du personnage dont on « se joue » tout en questionnant l’appartenance générique du poème. Le décor de la prison convoque en effet un référent dramatique : si dans la littérature du xixe siècle, le motif carcéral occupe une place de choix (voir Brombert, 1975)5, il irrigue tout particulièrement l’imaginaire théâtral du drame et du mélodrame. Témoin, en 1817, le facétieux Traité du mélodrame qui s’amuse à répertorier toutes les topiques du genre accorde ainsi à la prison une place de choix :
D’abord, nous voulons voir une prison ; car rien n’est plus propre à captiver notre esprit et notre cœur qu’une prison de Mélodrame ! À l’aspect de cette porte de fer, de ces énormes barreaux, de ces petites ouvertures qui laissent à peine entrer un rayon de lumière, vous vous figurez peut-être que là gémit le crime, damné à de justes châtiments ; eh bien ! pas du tout : cette prison ne vous offrira qu’une innocente réunion de bonnes gens : [une] pauvre victime, couronnée de malheurs et de vertus, véritable couronne d’épines, est réduite à vivre, tant bien que mal, au pain sec (A A A, 1817, p. 37).
10La geôle est un décor prisé, porteur du frénétisme et des tensions propres à séduire un public avide de sensations fortes. Il oppose une « pauvre victime » et un bourreau, selon le canevas mélodramatique qui confronte le traître et l’innocence persécutée. De cette esthétique des débords, « La Prison » adopte tout à la fois la « victime » et le cadre qui décuple le pathétique d’un sort injuste : « corridor humide » (v. 18, GF, p. 131), « ponts mouvants », « pierre glissante », « gonds de fer » (v. 12, 21, 20, ibid.) dessinent un espace du danger conforme aux promesses de son titre. Le poème s’inscrit ainsi dans les attendus du drame romantique, héritier du mélodrame, qui voit dans le « personnage muet6 » (Hugo, 1827, p. 82) de la prison un espace propice à la représentation de l’histoire et de ses errements7. Par le biais des filiations thématiques et esthétiques « La Prison » ouvre ainsi le poème à un horizon d’attente dramatique. Le phénomène est d’autant plus notable que la légende du Masque de fer, mise à la mode par Voltaire8 et très en vogue à l’époque romantique, est représentée au théâtre sous la Révolution — Louis XIV et le Masque de fer, ou les Princes jumeaux de Jérôme Le Grand est ainsi joué en 1791 — puis souvent reprise au théâtre après 1830 : L’Homme au Masque de fer d’Arnould et Fournier en 1831, Les Jumeaux inachevés de Hugo en 1839 en témoignent. L’intrigue dans laquelle le frère tue le frère questionne en effet la légitimité monarchique et les mécanismes sordides de la tyrannie, tandis que la geôle matérialise l’écart, omniprésent sur la scène romantique, entre la fonction royale et le monarque chargé de l’incarner. C’est pourquoi, plus encore que dans « Wanda », la tyrannie absolutiste est ici dénoncée à l’aide du registre pathétique récurrent dans les propos du prisonnier dont le « masque de torture » est « rouillé » par les larmes (« La Prison », v. 169, GF, p. 135) et qui résume ainsi son malheur : « Seul, toujours seul, par l’âge et la douleur vaincu, / Je meurs tout chargé d’ans et je n’ai pas vécu » (v. 147-148, ibid.). La reprise de l’adjectif « seul », la rime « vaincu » / « vécu » ainsi que l’antithèse (« meurs » / « vécu ») qui prend un tour oxymorique renforcé par la structure en chiasme, inscrivent au cœur du texte une injustice fondamentale susceptible de provoquer chez les lecteurs/spectateurs « horreur » (v. 101, GF, p. 134) et pitié. L’innocente victime du mélodrame est prisonnière d’un pouvoir inique.
11Comment comprendre, au cœur du poème, cette incursion du théâtre dont Vigny adopte le décor, les personnages, les dialogues et les motivations ? Les raisons d’une telle hybridité générique sont complexes et ressortissent notamment aux spécificités de la production dramatique envers lesquelles, dans la Lettre à Lord ***, en 1829, l’auteur du More de Venise exprime ses réticences :
L’art de la scène appartient trop à l’action pour ne pas troubler le recueillement du poète ; outre cela, c’est l’art le plus étroit qui existe, déjà trop borné pour les développements philosophiques à cause de l’impatience d’une assemblée et du temps qu’elle ne veut pas dépasser, il est encore resserré par des entraves de tout genre. Les plus pesantes sont celles de la censure théâtrale, qui empêche toujours d’approfondir les deux caractères sur lesquels repose toute la civilisation moderne, le prêtre et le roi : on ne peut plus que les ébaucher, chose indigne de tout homme sérieux qui se sent le besoin de voir jusqu’au fond de tout ce qu’il regarde (ŒC, t. II, p. 399).
12Art social, art collectif soumis à « l’impatience de l’assemblée », le théâtre est avant tout un art politique victime d’une « censure » qui interdit, en 1829 et plus encore en 1821 au moment de l’écriture de « La Prison », « d’approfondir les deux caractères » du « prêtre » et du « roi ». Or ce sont précisément les deux personnages présents sur la scène imaginaire de « La Prison » : le masque de Fer « était peut-être Roi » (v. 68, GF, p. 133) et son destin est celui d’un prince écarté du pouvoir par son royal jumeau ; son visiteur est un prêtre. Pourquoi choisir de les réunir tous deux au sein d’un poème dramatique ? Sans doute parce qu’à l’époque romantique c’est avant tout au théâtre que l’histoire se représente et dévoile ses errements. Pour les dramaturges, il s’agit de relire le passé à la lumière du présent grâce à l’actualisation de la représentation9. Or, tel est bien l’un des enjeux du texte qui adopte, sur une scène imaginaire et ainsi libérée du carcan de la censure, la fonction du drame : donner à voir l’absolutisme du « xviie » comme le lieu originel d’une rupture avec la royauté que le présent consacre.
13De ce lien génétique avec le drame découle une adéquation formelle : « La Prison » s’organise selon une structure théâtrale. Après une exposition in medias res, durant laquelle le prêtre est introduit dans la prison (acte I), intervient l’agôn de la confrontation entre le mourant qui refuse la confession et le prêtre (acte II). Suit la révélation de l’identité du prisonnier célèbre et de sa tragique histoire (acte III). Le prêtre qui « Cherchait du prisonnier la figure cachée » (v. 94, GF, p. 133) est alors confronté à une terrible vision :
Un flambeau la révèle entière : ce n’est pas
Un front décoloré par un prochain trépas,
Ce n’est pas l’agonie et son dernier ravage ;
Ce qu’il voit est sans traits, et sans vie, et sans âge :
Un fantôme immobile à ses yeux est offert,
Et les feux ont relui sur un masque de fer.
(v. 95-100, GF, p. 133-134.)
14Le coup de théâtre est ici très fortement dramatisé : la structure anaphorique, le glissement de la négation à l’affirmation entretiennent un suspense que renforcent aux vers 95 et 96 le rejet interne « entière » et le contre-rejet externe. Le « flambeau », « les feux » mettent littéralement en lumière la révélation. Fascination visuelle « offert[e] » aux « yeux » du lecteur-spectateur tout comme à ceux du prêtre. En abolissant la possibilité des représentations humaines — le rythme ternaire « sans traits, et sans vie, et sans âge » (v. 98) en témoigne — le tableau semble d’abord verser dans le fantastique avant de révéler sa portée historique et politique : la tyrannie refuse l’humanité des êtres. Après le clou du spectacle, les deux derniers actes sont ceux de l’agonie et de la mort du Masque de fer. Le rideau tombe sur un tableau-comble de la captivité éternelle que construisent les derniers vers du poème, et en particulier le distique final :
Un moment lui restait, il eût voulu du moins
Voir le mort qu’il pleurait sans ses cruels témoins ;
Il s’approche, en tremblant, de ce fils du mystère
Qui vivait et mourait étranger à la terre ;
Mais le Masque de Fer soulevait le linceul,
Et la captivité le suivit au cercueil.
(v. 291-296, GF, p. 139.)
15Par cette ultime confrontation du vivant et du « mort » la révélation autour de laquelle le poème se construit est prolongée et infléchie vers une morale désespérée : contrairement aux promesses vaines de « liberté » du prêtre (v. 56, GF, p. 132), la mort n’a pas délivré le mourant de sa « captivité ». Nulle résurrection possible pour ce « fils du mystère » (v. 293). Contrairement au Christ, « fils de l’homme » auquel le renvoient sans cesse les propos du vieillard, sa mort comme sa vie ont été inutiles. Le masque qui soulève « le linceul » (v. 295) révèle ainsi les mensonges et les impostures du ciel qui sont les corollaires de la tyrannie. Il fait signe vers une métaphysique du pouvoir qui transforme le drame en tragédie.
Tragédie de l’absence
16Du drame, le poème adopte certes la structure et certains codes, mais il en réfute aussi des mécanismes essentiels. Au temps ouvert de l’histoire positive, il superpose celui de l’enfermement éternel.
17Contrairement à la promesse étymologique du drame, toute action est ici enlisée, littéralement « bris[ée] », comme le bras du prisonnier, par le « mur de la prison » (v. 260, GF, p. 138). Dans le cours du poème, en effet, rien ne se passe hors la mort. Les mouvements, les échappées, sont renvoyés à un passé qui surgit à travers la remémoration des deux protagonistes : les souvenirs du prêtre qui s’organisent en micro-récits au passé (v. 101-132, GF, p. 134-135) ; le délire du mourant qui prend la forme d’une hypotypose (v. 208-248, GF, p. 136-137). Dans les deux cas, la violence d’État met fin à toute velléité de liberté et broie les innocents : la « Provençale » (v. 113) emprisonnée dans un couvent, le « vieux Bénédictin » (v. 123) assassiné pour avoir trouvé un « vase d’or » (v. 125) viennent ainsi redoubler l’injustice du sort du prisonnier. Les virtualités du passé mettent en lumière les violences du présent. Le discours du prisonnier en témoigne : « Je n’eus point d’avenir et n’ai point de passé » (v. 152, GF, p. 135) annule, à travers le parallélisme, toute ouverture vers une temporalité alternative. Le futur céleste proposé par le prêtre est un leurre, et les stichomythies du dernier échange entre les deux protagonistes en témoignent :
Le prêtre
[…]
Le Seigneur vous pardonne.
Le mourant
O prêtre ! laissez-moi !
Le prêtre
Dites : Je crois en Dieu. La mort vous est ravie.
Le mourant
Laissez en paix ma mort, on y laissa ma vie.
(v. 256-258, GF, p. 137-138.)
18L’impossible résolution de l’âgon achève d’anéantir toute action et renvoie à une autre inversion des codes théâtraux : l’univers dans lequel le spectateur est plongé est celui d’un aveuglement qui perdure jusqu’au tomber de rideau. La vision nécessaire au spectacle, pourtant incessamment convoquée, est toujours empêchée. La scène se déroule dans une obscurité obsessionnellement soulignée par le poème lors de l’entrée du prêtre : « sombres artifices », « épaisses ténèbres » (v. 6 et 26, GF, p. 131), sont encore renforcés par l’« importun bandeau » qui presse ses « yeux souffrants » ainsi que par le décor qui s’offre à sa vue lorsque « de leur bandeau on délivre ses yeux » (v. 3, 4 et 24, GF, p. 131) :
Cependant, vers le lit que deux lourdes tentures
Voilent du luxe ancien de leurs pâles peintures,
Le prêtre s’avança lentement, et, sans voir
Le malade caché, se mit à son devoir.
(v. 33-36, GF, p. 132.)
19Le jeu de voilement/dévoilement qui s’organise autour des rideaux permet, certes, de dramatiser la révélation de l’identité du Masque de fer et d’introduire dans le texte un procédé théâtral. Mais elle propose aussi une lecture symbolique du décor. Le contre-rejet « et sans voir » autorise en effet une double analyse du verbe de vision. Si celui-ci est transitif (voir/ Le prisonnier) il est aussi, et peut-être avant tout, intransitif : car la question majeure est bien ici celle de la cécité du pouvoir dont les deux recueils poétiques font état de façon récurrente : dans « Les Oracles » il est un « aveugle Pharaon » (v. 21, GF, p. 205) ; de même, le prêtre, malgré son ministère, a des yeux mais ne voit pas, tout comme les idoles de la Bible10. En cela, la révélation de l’identité du prisonnier, inscrite au cœur du poème, n’est une anagnorisis que pour le lecteur/spectateur : le prêtre voit le Masque de fer mais ne tire pas les bonnes conclusions de ce qu’il a découvert puisque, malgré l’inexcusable injustice que les pouvoirs temporel et divin ont autorisée, il s’obstine à proposer une lecture chrétienne de l’existence. Sa parole inefficace procède de l’injonction paradoxale : il faudrait se repentir alors même que l’on n’a pas péché. Le pouvoir divin, se signale dès lors par une illégitimité que souligne le « blasphème » du prisonnier (v. 62, GF, p. 132) : « Il est un dieu ? J’ai pourtant bien souffert » (v. 60, GF, p. 131). À l’illégitimité divine répond celle du pouvoir temporel dont « le crime est bien grand » (v. 243, GF, p. 137) et que le discours rapporté de la Provençale, dans les souvenirs du prêtre, vient révéler. La jeune fille, en effet,
[…] avait dit en pleurant,
Qu’elle prenait la Vierge et son Fils pour garant
Que le masque de Fer avait vécu sans crime,
Et que son jugement était illégitime ;
Qu’il tenait des discours pleins de grâce et de foi,
Qu’il était jeune et beau, qu’il ressemblait au Roi,
Qu’il avait dans la voix une douceur étrange,
Et que c’était un prince ou que c’était un ange.
(v. 115-122, GF, p. 134.)
20La rime « sans crime » / « illégitime » signale un abus de pouvoir qui remet en cause l’association entre « foi » et « Roi ». Car la « grâce » est du côté de la victime du pouvoir et non de celui-ci, qui, comme dans « Le Déluge » ou « Le Mont des oliviers », détruit l’« ange » et ne répond pas aux appels qu’on lui adresse. Le motif est incessamment repris dans l’œuvre poétique vignienne : le Ciel du « Mont des Oliviers » est « Muet, aveugle et sourd au cri des créatures » (v. 142, GF, p. 233).
21La violence absolutiste est ainsi répartie entre « le Prêtre » et « Le Roi », sujets centraux de la « civilisation moderne » qui s’y détruisent l’un par l’autre et finissent par laisser les « trônes vides » (« Les Oracles », v. 17, GF, p. 205). Certes, dans la dramaturgie de l’invisible ainsi mise en place, les codes de la tragédie sont apparemment inversés : celui qui est puni n’est, semble-t-il, pas l’aveuglé (le prêtre, le Roi) mais celui que son aveuglement prend pour cible (le Masque de fer). Cependant, le Pouvoir se détruit aussi lui-même : l’absolutisme annule Dieu, de même qu’il annule la présence du roi, absent du théâtre du « xviie siècle » tout comme il est absent de La Maréchale d’Ancre en 1831. La légende du Masque de fer révèle dès lors sa charge symbolique : par la mise en scène d’un jumeau royal détruisant l’autre, elle scinde les deux corps du roi et anéantit son corps glorieux en laissant place à un simple corps mortel11. En défaisant le lien originel entre théâtre et regard, entre théâtre et action, « La Prison » propose peut-être ainsi, par le biais d’une forme dramatique, un théâtre désenchanté de l’histoire qui se propage au sein des deux recueils poétiques. Plus qu’une tragédie du dieu caché, il s’agit d’une tragédie du dieu absent, d’autant plus douloureuse qu’aucune transcendance ne s’y dessine. Les abysses de la prison se situent en hauteur ; le haut et le bas se confondent.
***
22Tragédie sans transcendance, drame sans action, récit sans narrateur, poème sans sujet lyrique, « La Prison » propose au seuil de la carrière poétique de Vigny une réflexion désenchantée sur les errements de tout pouvoir dans un monde désormais vidé de ses espoirs et de ses illusions. Monde sans rois, sans dieux, dans lequel l’homme est livré à l’arbitraire de puissances nécessairement injustes et illégitimes, dans lequel le ciel est noir, tandis que seuls subsistent « Mal et Doute » (« Le Mont des Oliviers », v. 87, GF, p. 231). Dans cet univers d’où le sens s’est absenté, le Masque de fer n’est pas seulement le symbole d’une royauté déchue. Il est également la figure identificatoire du poète12, prisonnier d’un monde rendu incompréhensible. Au sein de cet univers effrayant, seule demeure la possibilité du rêve, et celle du poème, échappatoire éphémère qui, parfois, au cœur de « la prison qu’est la vie », permet de « réjoui[r] la vue et le cœur » (J, p. 945).