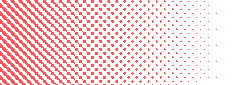« Sciences du désert » : une lecture épistémocritique des Poèmes antiques et modernes
1Dans l’œuvre de Vigny, la science est abordée avec une perspective ambivalente. Dans le recueil des Destinées, elle est envisagée à la fois comme responsable de la fin des grands idéaux chers au poète (qu’ils soient socio-politiques, philosophiques ou religieux) en même temps que comme une voie possible pour retrouver un autre idéal fait de dévotion, d’oubli et de dépassement de soi en vue de servir le bien commun et le progrès universel. Si, sur le plan collectif, le poète s’effraie, dans le sillage de Chateaubriand, des avancées scientifiques et de leur mise en application technique, le scientifique, travailleur isolé, explorateur héroïque et désintéressé, peut apparaître, dans « La Bouteille à la mer », par exemple, comme un avatar du martyre qui offre sa vie pour une nouvelle forme d’idéal, que Vigny nomme « le Dieu des idées » (GF, p. 240 ; voir Ringuedé, 2024).
2Rien de tel, semble-t-il, dans les Poèmes antiques et modernes. L’homme qui sait est un homme qui souffre, un homme qui erre au désert. Toutefois, derrière cette apparente simplicité se cachent une hésitation qui porte sur la science et sa fonction dans la société en même temps qu’une interrogation poétique sur la fertilité d’un dialogue renouvelé entre sciences et poésie. Si la science est un ferment de ruine, qu’elle détruit les individus en même temps que les peuples, il n’empêche que les poèmes de ce premier recueil manifestent une fascination pour la connaissance scientifique, qu’elle soit allégorique ou réelle. Le charme de la science joue ici une double partition. Le poète le met en scène dans des pièces où mages, pâtres, archéologues ou voyageurs reconnaissent l’attrait esthétique puissant des sciences. D’un point de vue poétique, c’est la poésie elle-même qui s’abreuve à la fontaine d’une source savante lorsque le poète puise ses nouvelles images dans des éléments du savoir scientifique contemporain.
Le pasteur, la comète et le colibri
3Dans la première section du recueil (le « Livre mystique »), le savoir est tout de suite exposé comme problématique. Moïse, dans le premier texte revêt l’habit du berger. Or le berger va devenir, dans la littérature du xixe siècle, la figure du premier savant, de celui qui le premier observa les étoiles au ciel et en comprit la régularité. On le verra dans l’œuvre de Victor Hugo, qui voit dans le pâtre chaldéen celui « qui épelle l’étoile » (Hugo, [1864] 2002, p. 292), et, par exemple, dans le poème de Sully Prudhomme, « La Grande Ourse » (Sully Prudhomme, [1866] 1872, p. 24). Chez Vigny, qui préfigure cette association, le berger peut renvoyer à une figure de savant en vertu de son lien avec Dieu (en effet, notons ici que Vigny opère une forme de superposition des temps : au crépuscule de sa vie, Moïse est encore le simple pâtre du moment de son appel).
4Quant au désert, il est le lieu de la révélation, celui où les prophètes peuvent se mettre à l’écoute, comme le pâtre, des symboles de la nature (et comme le poète, par ailleurs). Ainsi, celui qui guide le peuple hébreu au désert peut-il proclamer maîtriser la connaissance :
Hélas ! je sais aussi tous les secrets des cieux,
Et vous m’avez prêté la force de vos yeux.
Je commande à la nuit de déchirer ses voiles ;
Ma bouche par leur nom a compté les étoiles,
[…] (v. 71-74, GF, p. 65).
5Le savoir est ici décrit comme une violence, parce que la nature, pudique, porte le voile traditionnel de la déesse Isis. Par conséquent, l’acquisition d’une connaissance astronomique passe par la révélation coupable d’un secret. L’usage détourné que fait ici Vigny des sources bibliques est à cet égard révélateur. Le lecteur attentif pourra par exemple, dans le Livre de Job (xxxviii, 33), penser à ce reproche dans la bouche de Dieu : « Savez-vous l’ordre et les mouvements du ciel1 ? » Dans les Psaumes (cxlvi, 4), le motif de l’étoile est l’occasion d’un rappel de la maîtrise divine : c’est Dieu « qui sait le nombre prodigieux des étoiles, et qui les connaît toutes par leur nom. » Le Moïse de Vigny utilise donc ces formules bibliques pour suggérer qu’il est empli d’un savoir qui devrait être réservé à Dieu. Il exerce un pouvoir qui le dépasse, puisque sa parole nomme et inventorie l’univers, ce qui lui permet malgré lui de « commande[r] » à la nuit, derrière laquelle se cache, par le biais du symbole lunaire, la déesse Isis.
6Le savoir du pâtre lui vient donc de Dieu, ce que répétera, dans le poème suivant, « Éloa », le vers « Étoiles des bergers tombant des doigts de Dieu » (v. 146, GF, p. 71). Ici, le savoir est acquis selon le modèle violent de la chute et de l’abandon. Les temps du Christ, qui sont ceux qui ouvrent le poème, sont significativement ceux où l’homme a perdu Dieu, car celui-ci est exilé au désert (v. 18, GF, p. 67). La période est donc trouble et la voix divine ne résonne plus au milieu des hommes. Dieu crée alors un ange, Éloa, qui va être décrit en ayant recours à des éléments scientifiques contemporains de la composition du texte.
7Éloa est d’abord poétiquement comparée à un objet astral, après que Dieu a « soulev[é] les plis » de son « voile d’azur » :
Ses cheveux partagés, comme des gerbes blondes,
Dans les vapeurs de l’air perdent leurs molles ondes,
Comme on voit la comète errante dans les cieux
Fondre au sein de la nuit ses rayons gracieux ;
[…] (v. 55-58, GF, p. 68).
8Cette comparaison est doublement motivée. En effet, d’abord, le mot même de comète vient du grec κομήτης qui signifie « chevelu ». Vigny remotive donc cette étymologie pour décrire l’ange comme un objet astral que la science moderne est en train d’étudier. Effectivement, en 1819, l’astronome français François Arago comprend que les rayons de lumière qui émanent d’une comète ne viennent pas de son corps même mais de la réflexion des rayons du soleil, phénomène de polarisation dont il fait état plus tard dans son Astronomie populaire (Arago, 1854-1857, t. II, xvii, « Les comètes », ch. 28, p. 417-437). Les mots « ondes » et « rayons », au centre des théories sur la diffusion de la lumière, depuis Newton et Laplace, sont chargés d’un poids scientifique. Or les vers précédant ce passage, dans l’économie du poème, relatent précisément la naissance d’Éloa, et cette naissance se fait tout en éclat et en lumière, dictée qu’elle est par le verbe divin. Vigny profite de la découverte récente de la polarisation par Arago pour décrire la lumière qui se reflète sur le corps éclatant de l’ange. Que peut bien représenter cette lumière ? Si Dieu envoie l’ange comme une réponse au vide, dans ces temps troublés, c’est peut-être pour que l’ange répande sur terre la pitié divine. En ce cas, ces rayons peuvent être perçus comme un symbole : ils représentent la compassion dont Dieu le pare et qu’il renvoie autour de lui, jusqu’à l’ange maudit. La puissance de pitié qu’il dégage dans la suite du poème serait donc d’inspiration divine. C’est une réponse, par réfraction stellaire, au malheur provoqué par la mort symbolique de Lazare (symbole d’un monde à soigner).
9Par la suite, le poème s’appuie sur un tout autre élément de savoir, inattendu celui-ci, car plus éloigné des sciences bibliques traditionnelles. Toutefois, ce savoir vient aussi du désert. En effet, Vigny interrompt son récit par une longue digression :
Ainsi dans les forêts de la Louisiane,
Bercé sous les bambous et la longue liane
Ayant rompu l’œuf d’or par le soleil mûri,
Sort de son nid de fleurs l’éclatant Colibri ;
Une verte émeraude a couronné sa tête,
Des ailes sur son dos la pourpre est déjà prête,
La cuirasse d’azur garnit son jeune cœur ;
Pour les luttes de l’air l’oiseau part en vainqueur…
Il promène en des lieux voisins de la lumière
Ses plumes de corail qui craignent la poussière ;
Sous son abri sauvage étonnant le ramier,
Le hardi voyageur visite le palmier.
La plaine des parfums est d’abord délaissée ;
Il passe, ambitieux, de l’érable à l’alcée,
Et de tous ses festins croit trouver les apprêts
Sur le front du palmiste ou les bras du cyprès ;
Mais les bois sont trop grands pour ses ailes naissantes.
Et les fleurs du berceau de ces lieux sont absentes ;
Sur la verte savane il descend les chercher ;
Les serpents-oiseleurs qu’elles pourraient cacher
L’effarouchent bien moins que les forêts arides.
Il poursuit près des eaux le jasmin des Florides,
La nonpareille au fond de ses chastes prisons,
Et la fraise embaumée au milieu des gazons.
(v. 195-218, GF, p. 72.)
10Edmond Estève a bien établi, dès son édition (Vigny, [1826] 1914, p. 34-36), que les détails botaniques de ce passage étaient largement empruntés au prologue d’Atala. Un nombre important de vocables vient de la description que Chateaubriand établit des bords du fleuve Mississipi, qu’il s’agisse de noms issus de la botanique (« érable », « alcée », « jasmin des Florides »), ou d’animaux (« serpents oiseleurs »). De même, l’organisation de l’espace est très fortement inspirée du même texte : une rive sur laquelle s’étendent les « savanes » toutes en verdure, et « rougi[e]s par les fraises », tandis que de l’autre bord s’étend la sauvage et trop encombrée forêt d’altitude. J’ajoute que Vigny trouve probablement sa première association rimique, « Louisiane »/« liane », dans l’ouverture du texte de Chateaubriand où les deux noms sont proches. Vigny s’inspire donc de cette description exotique pour créer un tableau idyllique.
11En ce qui concerne plus spécifiquement le colibri, en revanche, force est de constater que le poète a probablement puisé à des sources différentes, plus scientifiques. François Germain et André Jarry, dans leur édition, se contentent de suggérer que cette description ornithologique est inspirée de Buffon (ŒC, t. I, p. 956). Un examen approfondi révèle que cette modalisation est inutile, tant il semble effectivement que les informations et les vocables utilisés sont tirés de l’Histoire naturelle (tome vingt-et-unième, sixième des volumes consacrés aux oiseaux, dont la première partie est consacrée à l’oiseau-mouche). Pour la description anatomique, Buffon commence par employer une comparaison joaillière qui inspire Vigny : « [l]es pierres et les métaux polis par notre art, ne sont pas comparables à ce bijou de la nature » (Buffon, 1770-1783, t. VI, p. 1-2). Vigny reprend en outre le motif de « l’émeraude » et des habits brillants (ibid., p. 2). Le naturaliste associe par la suite dans sa description « l’éclat » et le « feu », que l’on retrouve associés dans le poèmes (« soleil »/« éclatant »). Les précisions anatomiques renforcent le caractère idyllique de cette scène.
12L’inspiration se fait encore plus précise pour l’analyse éthologique que pour la description anatomique. Effectivement, les vers « Il promène en des lieux voisins de la lumière, / Ses plumes de corail qui craignent la poussière » sont une conjugaison de deux passages différents du traité de Buffon. Évoquant les habits splendides de l’oiseau, le naturaliste précise qu’« il ne les souille jamais de la poussière de la terre » (ibid., p. 3). Par ailleurs, à la même page, il précise : « ils semblent suivre le soleil, s’avancer, se retirer avec lui et voler sur l’aile des zéphirs à la suite d’un printemps éternel. » Ces éléments, condensés dans les deux alexandrins qui mettent à la rime des mots à la connotation inversée (« lumière »/« poussière »), permettent d’éclairer la métaphore.
13Ce passage est donc riche d’un intertexte qui évoque un exotisme à la fois bucolique et scientifique. Le colibri est un oiseau incroyable dans sa forme anatomique autant que dans ses mœurs éthologiques. Il peut alors devenir l’image de l’ange de compassion car non seulement il fuit les contingences terrestres (voir « Éloa », v. 140-149, GF, p. 71), mais aussi, comme nous l’avons vu plus tôt, il cherche la lumière divine et la reflète comme une comète, ou, désormais, comme un oiseau-mouche. En effet, Buffon explique que les indiens appelaient le léger volatile « rayon ou cheveux du soleil » (Buffon, 1770-1783, t. VI, p. 3). Vigny s’appuie donc sur une métaphore à trois termes qui est puissamment motivée : colibri et comète, outre qu’ils commencent par la même syllabe, peuvent être rapprochés pour une autre raison que la légèreté, le vol instable et la lumière éclatante. Une analyse lexicale attentive montre qu’ils partagent aussi la particularité de refléter, comme une chevelure, les rayons du soleil. Voilà pourquoi, peut-être, Vigny fait rimer son « Colibri » avec « l’œuf d’or par le soleil mûri ». Ainsi, comme Éloa se dévoile sous la lumière de Dieu, le colibri perce l’écaille d’un œuf fécondé par la puissance paternelle que représente le soleil. L’épistémocritique, qu’elle s’appuie sur des connaissances astronomiques récentes ou des éléments de la littérature en sciences naturelles précises, permet donc ici de mettre en place une figure poétique étonnante et à plusieurs fonds.
14C’est en papillonnant comme l’oiseau-mouche qu’Éloa descend ensuite dans les « Cieux inférieurs » (v. 226, GF, p. 73). Elle volète d’une planète à l’autre dans une exploration cosmique qui, en lui dévoilant du savoir, l’éloigne de Dieu.
15Dans le troisième chant, c’est désormais l’ange rebelle qui porte le message de cette chute dans l’hybris que constitue la connaissance :
Triste amour du péché ! sombres désirs du mal !
De l’orgueil, du savoir gigantesques pensées !
Comment ai-je connu vos ardeurs insensées ?
Maudit soit le moment où j’ai mesuré Dieu !
Simplicité du cœur à qui j’ai dit adieu,
[…] ! (v. 666-670, GF, p. 84-85.)
16Qu’il s’agisse probablement d’un discours de tentation visant à attendrir Éloa ne change pas la teneur du message : Satan reconnaît que la malédiction dont il est la victime est le fruit de son désir de savoir. En rejouant l’épisode du jardin d’Éden, il met l’accent sur l’opération d’arpentage (« mesuré Dieu ») que, multipliant les motifs de compas, Vigny évoque à plusieurs reprises dans toute son œuvre. L’ange de compassion, à son tour, suivant l’exemple de Satan, va succomber comme le colibri affamé qui descend des hauteurs de la forêt, autre image possible du paradis.
17Ainsi la connaissance du monde conduit-elle au désenchantement dans le « Livre mystique », tout empreint encore de la notion de chute. On le voit dans le poème suivant, « Le Déluge », où le savoir exhaustif sur le monde est considéré comme un malheur.
Les peuples déjà vieux, les races déjà mûres,
Avaient vu jusqu’au fond des sciences obscures ;
Les mortels savaient tout, et tout les affligeait ;
[…] (v. 21-23, GF, p. 88-89).
18La lassitude de Moïse, fatigué d’une connaissance qui le submerge, trouve ici un précédent dans l’histoire de l’humanité telle que décrite par la Bible. Dès les temps prédiluviens, tous les hommes sont déjà frappés du sceau de la décrépitude. Le savoir est décrit comme catastrophique, puisqu’il s’agit de voir « au fond », raison pour laquelle les sciences sont « obscures ». On assiste ici à un renversement des sèmes de la lumière, traditionnels pour décrire les avancées de la connaissance humaine. L’éclat qui parait les ailes du colibri ou celles d’Éloa est dégradé en ombre. Là où l’oiseau-mouche et l’ange appartenaient au monde de l’éclosion, le savoir des hommes dans « Le Déluge » les a flétris et les renvoie désormais, par le biais de la rime significative entre « mûres » et « sciences obscures », à l’agonie. L’avènement du savoir est donc positivement décrit dans les autres poèmes, mais, dans ce cas précis, c’est leur portée totalisante qui est problématique. Ainsi le pasteur du poème se plaint-il, comme Moïse, du savoir qui lui a été imposé :
Oh ! pourquoi de mes yeux a-t-on levé les voiles ?
Comment ai-je connu le secret des étoiles.
Science du désert, annales des pasteurs !
Cette nuit, parcourant vos divines hauteurs
Dont l’Égypte et Dieu seul connaissent le mystère,
Je cherchais dans le Ciel l’avenir de la Terre ;
Ma houlette savante, orgueil de nos bergers,
Traçait l’ordre éternel sur les sables légers,
Comparant, pour fixer l’heure où l’étoile passe,
Les cailloux de la plaine aux lueurs de l’espace.
(v. 125-134, GF, p. 91-92.)
19Là encore, le poème fait une allusion au voile d’Isis. Ce à quoi s’adonne le pasteur, c’est à des exercices de modélisation qu’il trace par terre, et qui lui permettent de calculer le retour des astres dans le ciel. Ce faisant, il prend là-encore la posture du démiurge. En représentant le mouvement astral il semble comme le faire advenir véritablement et provoquer le retour des étoiles dans le ciel. La part orgueilleuse de cette opération est dénoncée par des figures d’antithèses, en particulier dans le vers contradictoire « traçait l’ordre éternel sur les sables légers », mais aussi dans les balances déséquilibrées du dernier vers cité où sont comparés « [l]es cailloux de la plaine aux lueurs de l’espace ».
20À la fin de « La Femme adultère », c’est Jésus qui trace dans le sable des vérités mystérieuses qui entrent en écho avec les vérités du ciel. Plus tard, dans « L’Esprit pur », la langue de l’écrit que Vigny envisage comme une trace qu’il lègue pour réparer des générations de silence se dessine aussi dans le sable. Le poète est donc aussi celui qui, comme le berger savant, comme le Fils de l’Homme, écrit des vérités dans les sables du désert. Tel que Vigny l’envisage dans Stello, il est celui qui « entend la voix secrète » et « cherche aux étoiles quelle route nous montre le doigt du Seigneur » (ŒC, t. II, p. 547). Mage, solitaire et maudit, le poète partage ces caractéristiques avec le savant tel qu’il apparaît dans ces bergers observateurs d’astres, ou, plus tard, dans le jeune capitaine du poème « La Bouteille à la mer ».
Le « compas d’Isis » : lecture d’un poème archéologique
21Force est de constater que les références à la science sont beaucoup moins présentes dans le deuxième livre (« Livre antique »). Il faut même attendre la dernière pièce pour trouver une allusion au savoir. Allusion fort discrète par ailleurs. En effet, « Le Bain d’une dame romaine » est une scène de genre, un « pur tableau » pour reprendre l’expression de Paul Bénichou (2003-2004, t. i, p. 332) :
Une Esclave d’Égypte, au teint luisant et noir,
Lui présente, à genoux, l’acier pur du miroir ;
Pour nouer ses cheveux, une Vierge de Grèce
Dans le compas d’Isis unit leur double tresse ;
Sa tunique est livrée aux Femmes de Milet,
Et ses pieds sont lavés dans un vase de lait.
Dans l’ovale d’un marbre aux veines purpurines
L’eau rose la reçoit ; puis les Filles latines,
Sur ses bras indolents versant de doux parfums,
Voilent d’un jour trop vif les rayons importuns,
Et sous les plis épais de la robe onctueuse
La lumière descend molle et voluptueuse :
Quelques-unes, brisant des couronnes de fleurs,
D’une hâtive main dispersent leurs couleurs,
Et, les jetant en pluie aux eaux de la fontaine,
De débris embaumés couvrent leur souveraine,
Qui, de ses doigts distraits touchant la lyre d’or,
Pense au jeune Consul, et, rêveuse, s’endort.
(v. 1-18, GF, p. 119.)
22Derrière cette scène semble se jouer quelque-chose qui dépasse pourtant le pur tableau. En effet, comme l’a bien montré, dans son édition, Edmond Estève, la source première de ce texte est un ouvrage d’archéologie, écrit par Karl August Böttiger, composé en 1803 et traduit en français dix ans plus tard sous le titre Sabine, ou la Matinée d’une dame romaine à sa toilette à la fin du ier siècle de l’ère chrétienne, par Alexandre Clapier2. La plupart des détails dont il est question ici sont inspirés de cette étude savante. En revanche, la référence à Isis est détournée. En effet, Böttiger évoque une « épingle d’Isis » (Böttiger, 1813, p. 85), et non un « compas ». François Germain et André Jarry, dans leur édition, se contentent de remarquer que le « compas » « évoque à la fois l’encornure de la vache et le croissant de lune, deux attributs d’Isis qu’on peut imaginer prêtant leur forme à tout ou partie du bijou » (ŒC, t. I, p. 985). On ne peut s’empêcher d’ajouter que le mot, sous la plume de Vigny, n’est pas choisi uniquement pour sa forme. Le compas est toujours l’outil, dans ses écrits, d’une entreprise d’arpentage du monde, et, souvent d’une entreprise qui relève de l’automutilation3. Ici, le compas est associé à la déesse de la nature, tandis que les poèmes du livre mystique ne faisaient que de discrètes allusions à son voile. Les dames romaines, selon l’étude de Böttiger, vouaient effectivement un culte à cette déesse qui devient, sous l’empire romain, une divinité universelle, bienveillante et maîtresse des éléments. Elles se coiffent donc de bijoux portant ses attributs (corne de vache ou lune). Toutefois, il n’y est fait nulle part mention d’un compas. Il faut aller puiser à une autre source pour trouver cette association entre le compas et Isis. Il s’agit de la page de titre du livre du mathématicien Andreas von Segner, Introduction à la théorie de la nature 4, dont la première édition, en allemand, date de 1750, mais l’illustration de 1754. Comme l’explique Pierre Hadot, qui reproduit et commente l’image :
On y voit Isis, s’avançant de profil, couronnée, portant le sistre, revêtue d’une robe constellée de figures d’animaux et de plantes et à demi voilée par un ample manteau, près d’un monument en ruines, sur le socle duquel on aperçoit des lettres grecques et une figure géométrique. Trois putti observent la déesse, l’un près du monument, le doigt sur les lèvres, un autre mesurant avec un compas la trace des pas d’Isis, un autre, enfin, tenant dans sa main la frange inférieure du manteau. En bas du médaillon, on lit la devise : Qua licet, signifiant « Dans la mesure où cela est permis » […]. La scène laisse entendre que l’on ne peut dévoiler la Nature que dans la mesure où cela est permis et que, finalement, ce n’est pas la nature elle-même que l’on connaît, mais seulement, en les mesurant mathématiquement, la trace de ses pas, c’est-à-dire les phénomènes, qui ne sont que les résultats de son action. (Hadot, 2004, p. 315.)
23Cette image était connue car Kant lui avait consacré une note demeurée célèbre dans Critique de la faculté de juger 5. Il s’agit de la note du paragraphe 49, « Des facultés de l’esprit qui constituent le génie », dans laquelle Kant, commentant la vignette de Segner, insiste sur le fait que le voile d’Isis ne fut jamais complètement soulevé. Or on sait que Vigny a lu attentivement Kant (pour le méjuger surtout ; voir Jarry, 1993), il y a donc fort à parier qu’il ait eu connaissance de cette image. L’association entre le compas et Isis s’inscrit donc dans une pensée du savoir qu’il s’agit ici d’interroger.
24À y regarder de plus près, le poème de Vigny dialogue précisément avec cette question du voile. À quoi assiste-t-on, en fin de compte, dans ce tableau vivant ? Il s’agit d’un jeu de dévoilement et de revoilement du corps de cette femme, objet d’une reconstitution archéologique. Sa tunique lui est ôtée, laissant apparaître, pudiquement, ses pieds et ses bras. Puis des esclaves la recouvrent « d’une hâtive main » avec des pétales colorés. Pour mesurer la signification de ce poème, il faut peser les ajouts de Vigny par rapport au texte source. La parure de pétales, d’une part, puis le fait que la dame ainsi rhabillée joue avec une « lyre d’or », d’autre part, ne sont pas des éléments imputables à Böttiger. Si le corps de cette dame peut être comparé à celui d’Isis, c’est qu’il n’est découvert que « dans la mesure où cela est permis », pour paraphraser la sentence latine utilisée par Segner. Les courbes pudiquement esquissées de cette dame romaine représentent une forme de savoir, celui que l’archéologie du texte source permet de révéler. Le poème, quant à lui, renforce cette idée de mystère dont l’épaisseur ne peut être réduite. Bien plus, et c’est là que l’étude épistémocritique éclaire l’analyse poétique, et peut-être métapoétique, le corps qui représente ce savoir est voilé à nouveau, dans la réécriture de Vigny, par l’objet traditionnel qui représente l’embellissement dont est capable le vers. Ainsi dit-on traditionnellement, lorsque la poésie reprend à son compte des éléments du savoir, qu’elle le pare des pétales du vers. Il n’est que de prendre un extrait du poème de Chénier, « L’Invention », grand inspirateur de Vigny. Le poète, en 1787, y encourage ses pairs à « je[ter] une rose » « [s]ur l’aride buisson » (Chénier, [1787] 1958, p. 127) que constitue le langage scientifique6. Il semble que Vigny se souvienne de cette prescription. Ainsi le corps dévoilé par la science archéologique revêt-il les attributs poétiques, puisque la « lyre d’or », là-aussi, est un ajout de Vigny : seuls les chantres l’utilisent dans le texte de Böttiger. En revanche, dans cet ouvrage d’archéologie, l’épingle d’Isis permet de cacher dans la coiffure des vers galants du poète Martial dont la poésie est valorisée parce qu’elle s’attache à décrire dans des formes simples la beauté complexe du monde : beauté, mathématique et simplicité sont donc entrelacées dans cette tresse, reprenant l’idée romantique (Pierre Hadot la trouve chez Goethe, Schelling et Novalis) que la nature est un poème chiffré, sorte de hiéroglyphe dont le chantre doit rendre compte (Hadot, 2004, p. 269-272).
25Cette association entre la science et la poésie permet au poète de déployer, plus haut dans le texte, un double jeu de lumière et de voilement. Les « filles latines », par le biais des parfums, que l’archéologue ne peut que rêver, apposent un premier voile sur cette peau trop dénudée. On peut comprendre ainsi que l’imagination poétique sauvegarde ici le mystère de cette Isis romaine. Un intertexte, interne au recueil, s’esquisse également avec les « rayons importuns » « d’un jour trop vif » qui font descendre, « sous les plis épais de la robe » une « lumière ». Cette dame romaine est donc un double d’Isis, mais aussi d’Éloa, qui reflète, comète et colibri, les rayons du jour pour suggérer la diffusion du savoir.
26Cette figure poétique permet donc à Vigny de préciser sa pensée sur le rôle du poème vis-à-vis du savoir : le poème, dans le sillage des préconisations de Chénier, doit prendre en compte le savoir et ses connaissances, mais il doit les parer d’un voile pudique pour conserver le mystère du monde. En somme, avec « Le Bain d’une dame romaine », le jeune Vigny mettait déjà en œuvre, poétiquement, les leçons à venir (chronologiquement) des poèmes mystiques.
« Paris » ou Babel ? La confusion des langages mathématiques
27Le troisième livre du recueil, quant à lui, se penche sur le savoir contemporain. On en aperçoit la trace dans le dernier poème, « Paris », ajout tardif de l’édition de 1837. Le poète mène le voyageur sur des hauteurs surplombant la capitale. Ce dernier, découvrant la ville, la décrit d’abord en termes curieusement mathématiques :
Et pourtant je ne vois nulle part la nature,
Mais partout la main d’homme et l’angle que sa main
Impose à la matière en tout travail humain.
Je vois ces angles noirs et luisants qui, dans l’ombre,
L’un sur l’autre entassés, sans ordre ni sans nombre
Coupent des murs blanchis pareils à des tombeaux.
(v. 16-21, GF, p. 180.)
28Plusieurs remarques s’imposent. D’abord, comme le voile d’Isis est levé d’une façon violente dans les autres sections du recueil, le travail humain sur la matière est décrit comme une action coercitive. Poétiquement, la répétition du substantif « main » suggère l’omniprésence de cette action en même temps que l’effet de discordance (l’enjambement externe) qui sépare le sujet de son prédicat évoque la désarticulation forcée à laquelle aboutit cette activité. Par ailleurs, la réitération du mot « angle » permet de comprendre que le voyageur observe la scène urbaine avec un compas dans l’œil, c’est-à-dire comme un géomètre. Là où les compas, dans les autres sections du livres, permettaient de dévoiler des connaissances sur la nature (parfois abusivement, on l’a vu), la réalisation au compas (à force d’angles) d’un nouveau paysage aboutit paradoxalement au désordre. C’est que ce travail s’est fait en jouant mathématique contre mathématique. La géométrie a pris toute la place et semble s’être passée de l’algèbre, puisque l’entassement des angles s’est fait « sans nombre », et donc sans « ordre ». L’harmonie des formes arrondies de la nature a ici disparu à cause de la géométrie. Ce nouveau paysage est donc décrit comme un lieu de mort, précisément parce que le savoir déployé n’a été que partiel. Le voyageur continue ainsi :
En le [le cercle] traçant jadis, c’est ici, n’est-ce pas,
Que Dieu même a posé le centre du compas ?
(v. 37-38, GF, p. 181.)
29Il reprend un thème cher à Vigny : le déploiement du savoir, l’arpentage du monde, est une opération d’automutilation. Ainsi, si Paris est bien le lieu d’où part, centrifuge, tout le savoir du monde, c’est aussi le lieu qui se condamne lui-même à la mort à cause de cette recherche effrénée. Le poète lui répond en ayant recours à une explication cosmique qui est double, d’abord géométrique :
— Oui, c’est bien une Roue ; et c’est la main de Dieu
Qui tient et fait mouvoir son invisible essieu.
[…]
Quand la vivante Roue hésite dans ses tours,
Tout hésite et s’étonne, et recule en son cours.
Les rayons effrayés disent au cercle : Arrête.
(v. 41-42, 45-47, GF, p. 181.)
30Puis mécanique :
Le cœur du ressort bat, et pousse la bascule ;
L’aiguille tremble et court à grands pas ; le levier
Monte et baisse en sa ligne, et n’ose dévier.
(v. 56-58, GF, p. 181.)
31Vigny enrichit l’image de la roue (que François Germain et André Jarry attribuent à Shakespeare, dans Hamlet) de tout un vocabulaire scientifique novateur et inquiétant, en particulier parce qu’il le conduit à créer poétiquement une sorte de monstre chimérique, mi-organique, mi-mécanique. Les éléments de la mécanique semblent prendre chair et agir comme des êtres vivants. Le « ressort » se biologise et son cœur « bat », au beau milieu du vers dodécasyllabique, comme pour marquer la pulsation de l’alexandrin en même temps que de la machine organique. Quant à l’« aiguille » et au « levier », ils sont étonnamment personnifiés, curiosité dont fait état rythmiquement le poème en multipliant les effets de discordance (le complément « à grands pas » est rejeté dans le second hémistiche tandis que « le levier » est séparé du vers dans lequel il semble prendre vie par un contre-rejet interne).
32Les responsables de ce désordre sont décrits plus bas. Il s’agit de l’école saint-simonienne, avec laquelle Vigny entretient des rapports ambivalent (Bénichou, 2003-2004, t. ii, p. 1099-1105) :
N’importe ! Autour de lui des travailleurs sans nombre,
Aveugles, inquiets, cherchent à travers l’ombre
Je ne sais quels chemins qu’ils ne connaissent pas,
Réglant et mesurant, sans règle et sans compas,
L’un sur l’autre semant des arbres sans racines,
Et mettant au hasard l’ordre dans les ruines.
(v. 119-124, GF, p. 183.)
33L’acharnement de ces travailleurs (suggéré par la multiplication des participes présents qui crée un éloquent homéoptote) n’a d’égal que leur cécité. Ils sont manifestement les artisans de ces angles entassés sans ordre du début du texte. Un vers comme « Réglant et mesurant, sans règle et sans compas » opère comme un véritable contre-exemple à méditer. Ici, la mesure en 2/4//2/4 permet de souligner le polyptote qui dit précisément le caractère antithétique d’une action qui règle sans règle, de cette mesure effectuée sans compas. L’instrument rime avec le forclusif du vers précédent pour souligner l’aberration que constitue son absence.
34Toutes ces opérations paradoxales aboutissent, dans la pensée du poète, à une hésitation profonde :
— Je ne sais si c’est mal, tout cela ; mais c’est beau !
Mais c’est grand ! mais on sent jusqu’au fond de son âme
Qu’un monde tout nouveau se forge à cette flamme,
Ou soleil, ou comète, on sent bien qu’il sera ;
Qu’il brûle ou qu’il éclaire, on sent qu’il tournera,
Qu’il surgira brillant à travers la fumée,
Qu’il vêtira pour tous quelque forme animée,
Symbolique, imprévue et pure, on ne sait quoi,
Qui sera pour chacun le signe d’une foi,
Couvrira, devant Dieu, la terre comme un voile,
Ou de son avenir sera comme l’étoile,
Et, dans des flots d’amour et d’union, enfin
Guidera la famille humaine vers sa fin ;
Mais que peut-être aussi, brûlant, pareil au glaive
Dont le feu dessécha les pleurs dans les yeux d’Ève,
Il ira labourant le globe comme un champ,
Et semant la douleur du levant au couchant ;
Rasant l’œuvre de l’homme et des temps comme l’herbe
Dont un vaste incendie emporte chaque gerbe,
En laissant le désert, qui suit son large cours
Comme un géant vainqueur, s’étendre pour toujours.
(v. 158-178, GF, p. 184.)
35Seule la portée esthétique de cette opération est objet de certitude pour le poète. C’est bien à cela qu’il s’adonne d’ailleurs, dans la description de cette cité superbe aux allures de Babel. Reprenant les grandes figures du savoir développées dans les autres sections (« soleil », « comète », « voile »), l’hésitation de Vigny se fait fondamentalement éthique. Le poète, un temps enthousiasmé par les promesses saint-simoniennes de développements scientifiques qui annoncent un progrès social universel, laisse affleurer une pensée du doute. Elle aboutit une nouvelle fois à ce motif primordial, déjà abordé, celui du « désert », lieu de l’origine auquel l’homme risque de retourner. Le poème se clôt sur un modèle apocalyptique (voir v. 215-222, GF, p. 185) qui n’est pas sans préfigurer les développements parnassiens d’un Leconte de Lisle, liant lecture du passé et annonce de la fin du monde. Vigny demeure en revanche au stade du questionnement. Face à cette science de la démesure, le poète ne sait que présenter stoïquement sa suspension de jugement.
Une source au désert
36Vigny emploie l’expression « science du désert » dans le poème « Le Déluge », achevé en 1825 pour caractériser le savoir des premiers hommes. Or ce savoir, trop grand, les conduit à la condamnation diluvienne. Il paraît alors possible d’envisager cette expression comme révélatrice du dialogue épistémocritique qui se tisse tout au long de Poèmes antiques et modernes et qui se poursuivra, en évoluant, dans Les Destinées. Dans ce recueil somme, à l’ambition totalisante, les sciences bibliques côtoient des connaissances scientifiques plus modernes. Dans le même temps, l’allégorisation toute romantique d’une science qui soulève le voile de la pudique nature permet de rattacher Vigny à la naturphilosophie des penseurs allemands, et lui fait prendre ses distances avec le morcèlement délétère que produit la vision atomiste et mécaniste des sciences modernes.
37La science vient du désert, traditionnellement, comme le montre la multiplication des images de pâtres astrologues dans les poèmes du « Livre mystique ». Elle lui est liée, de surcroît, parce que c’est le lieu par excellence de la révélation, ce que Vigny met poétiquement en scène, en particulier dans « Éloa ». Enfin, dans le « Livre moderne », et en particulier dans « Paris », la science devient un ferment possible de création du désert, puisque le poète s’interroge sur l’avenir qu’elle offre à l’humanité, entre jardin d’Éden et Apocalypse.
38Si « le monde de Vigny n’est pas un monde heureux », comme l’explique François Germain (ŒC, t. I, p. 905), c’est parce qu’il est hanté par la culpabilité et le péché originel. En ce sens, une lecture épistémocritique de ces poèmes ne peut faire l’économie de ce questionnement primordial : comment mettre en scène, dans sa représentation du monde, du modèle biblique jusqu’au Paris de la révolution de Juillet, la faute que représente la science vis-à-vis d’un univers qui est une création divine dont l’homme n’a eu de cesse de dévoiler les secrets ? La science, dans une perspective icarienne, est alors objet d’élévation en même temps que de chute.
39Par ailleurs, en même temps que le poème interroge cette double dynamique, il se l’applique à lui-même en allant puiser dans la science l’occasion de sa propre poétique. Le jeune Vigny s’inspire, plus encore que le poète philosophe des décennies suivantes, des discours scientifiques. Il forge ce faisant de nouvelles images poétiques et pose à nouveaux frais les bases d’un discours métapoétique qui relève du transdisciplinaire, oscillant entre la célébration de la magie innovante de ce dialogue et un questionnement autour de la cohabitation conflictuelle entre l’esthétique et la morale.