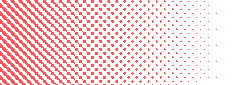Pour une lecture de « La Fille de Jephté » (v. 1-54)
1« La Fille de Jephté » fait saillie dans l’économie des Poèmes antiques et modernes en raison de son statut de double seuil : le poème ouvre en effet à la fois le livre antique et la section de l’antiquité biblique. Or il est frappant de constater que chez Vigny le seuil n’est pas coupure, mais transition : le lien est fortement travaillé entre ce texte et ceux qui le précèdent immédiatement. « La Fille de Jephté » a une valeur récapitulative. Le choix du cadre désertique dans lequel l’action prend place (« À l’hymne universel que le désert répète », v. 11, GF, p. 101) rappelle le « stérile Nébo » (« Moïse », v. 6, GF, p. 63) autant que le « sommet solitaire / Du mont sacré d’Arar » (« Le Déluge », v. 37-38, GF, p. 89). De même, on retrouve dans « La Fille de Jephté » à la fois le personnage de la femme sacrifiée, perdue par une figure masculine, présent dans « Éloa », et celui du père qui abandonne son enfant déjà mis en scène dans « Le Déluge » (« Mais sur le mont Arar, encor loin du trépas, / Pour sauver ses enfants l’ange ne venait pas », v. 223-224, GF, p. 94). Le poème approfondit de surcroît la question du silence de Dieu, que soulève « Moïse », et celle de sa justice pour le moins problématique. Dans « Le Déluge », le châtiment divin apparaît ainsi comme un acte arbitraire. Comme le remarque Isabelle Hautbout, la démotivation de la punition y est du reste sans doute annoncée de façon plaisante par le sous-titre générique « mystère ». Dans « Éloa », la possibilité du rachat est fortement mise en cause. L’ouverture des Poèmes antiques et modernes fait en somme unité en tant que, chaque fois, Vigny s’empare du texte biblique pour le subvertir de l’intérieur.
Un hypotexte biblique étoffé
2« La Fille de Jephté » se présente comme la réécriture d’un épisode du livre des Juges. L’hypotexte est explicitement identifié par l’épigraphe. Vigny retravaille sa source selon une logique de reprise et de variation. Cette réécriture se fait dans le sens d’une forte expansion : les versets 32 à 35 du onzième livre des Juges deviennent 54 vers.
3« La Fille de Jephté » manifeste une volonté de dramatisation maximale. Vigny retarde le moment de la révélation en insérant dans son poème divers éléments absents de l’hypotexte : d’abord une description de Jephté (v. 16-22, GF, p. 101-102), puis celle des réjouissances du chœur féminin (v. 23-30, GF, p. 102), enfin un premier discours de la fille de Jephté (ibid., v. 35-46). Le texte joue de fait sur une tension entretenue. Le suspens que Vigny étire maximise les émotions que le lecteur peut ressentir. Étienne Kern remarque, à juste titre, que « le poème vignyen, poème concentré, cherche d’abord l’effet. »
4« La Fille de Jephté » témoigne également d’un souci d’embellissement pittoresque. Pour donner une couleur locale à son évocation, Vigny s’appuie essentiellement sur deux ouvrages : les Mœurs des Israélites de Fleury (1712), et les annotations à la Sainte Bible de Vence de Dom Calmet (1748). Ces sources sont tout particulièrement utilisées pour décrire les rites festifs adoptés par le chœur des vierges (v. 20-30, GF, p. 101-102), sur lesquels l’Ancien Testament ne s’appesantissait pas. C’est par exemple chez Dom Calmet que Vigny trouve une description des instruments de musique à cordes utilisés par les Hébreux, parmi lesquels il retient le « Nebel » et le « Kinnor », probablement en raison de leur sonorité harmonieuse.
Un hypotexte biblique hybridé
5Cette réécriture repose non seulement sur un étoffement de l’hypotexte mais aussi sur une volonté d’hybridation générique. Vigny travaille la porosité des genres. Si, aux XVIIe et XVIIIe siècles, comme nous le rappellent les définitions successives proposées par le Dictionnaire de l’Académie française1, le poème ne se distingue pas vraiment de l’épopée, force est de constater que le poème vignyen tend progressivement à gommer cette synonymie. Le titre, « La Fille de Jephté », est proleptique car il déplace l’héroïsme, du guerrier célébré par l’Ancien Testament vers le personnage de la jeune victime innocente. Il programme en quelque sorte dès le seuil l’évidement de l’épopée que l’on trouve à l’œuvre dans la suite du texte, et son remplacement progressif par une grandeur morale, tout intérieure, liée à l’acceptation et au renoncement. La prise de parole du chœur des vierges (v. 2, GF, p. 101) s’ouvre sur une problématisation de la matière épique. La bataille est passée, Vigny n’en montre que le résultat, au passé composé : « Jephté de Galaad a ravagé trois villes » (ibid., v. 3). Cette évocation est fort resserrée : elle ne représente que 8 vers, là où la prise de parole de la fille de Jephté inventée par Vigny (v. 35-46, p. 102) s’étend sur plus de 12 vers, indice que l’action qui intéresse le poète est déplacée des combats vers le terrain offert par la parole. On peut du reste remarquer que Vigny insiste moins sur les blessures infligées aux ennemis, que sur les dommages causés aux cultures :
Abel ! la flamme a lui sur tes vignes fertiles !
Aroër sous la cendre éteignit ses chansons,
Et Mennith s’est assise en pleurant ses moissons !
(v. 4-6, GF, p. 101.)
6Cette contraction de l’épique est également sensible par la modification de l’hypotexte. Des « vingt villes » évoquées par l’Ancien Testament, il n’en reste plus que « trois » ici (ibid., v. 3).
7Si les liens entre poème et épopée tendent à être amoindris, les allusions à la tragédie abondent en revanche dans tout le texte. Le choix de placer les versets 39 et 40 du livre des Juges en épigraphe n’est pas anodin. Ces derniers disent, immédiatement, que la mort du personnage éponyme a eu lieu :
Et de là vient la coutume qui s’est toujours observée depuis en Israël,
Que toutes les filles d’Israël s’assemblent une fois l’année, pour pleurer la fille de Jephté de Galaad pendant quatre jours. (GF, p. 101.)
8Avant même que le texte ne commence, tout est déjà joué. Jephté est victime d’une fatalité connue à l’avance et contre laquelle il est impuissant. Vigny multiplie par ailleurs les effets proleptiques. L’insistance sur la destruction des moissons et la stérilité des terres qui ouvre le texte annonce discrètement l’extinction de la lignée de Jephté (ibid., v. 3-6). Le personnage est traversé par un pressentiment, sorte de douleur sans cause, absente du texte biblique. L’antithèse est travaillée entre sa solitude et sa gravité (il « […] marche en baissant la tête ; / […] seul, silencieux », ibid., v. 16-17) et la liesse de la foule qui l’entoure (« Le peuple tout entier tressaille de la fête », ibid., v. 15). On pourra remarquer que le texte s’immobilise, de manière très mimétique, en même temps que son héros, grâce au retour d’un même hémistiche (« il a fermé ses yeux »), d’abord au gré d’une anadiplose puis d’une antépiphore (ibid., v. 18-19). Cet effet de clôture rejoue la déliaison entre Jephté et ceux qui l’entourent. Le héros refuse de voir la fatalité s’accomplir. Des éléments d’ironie tragique ponctuent également le poème (on peut par exemple penser à la mention du sacrifice effectué par la fille de Jephté au v. 44 : « J’offrais pour vous hier la naissante génisse »). Le choix des strophes d’alexandrins à rimes plates, par la monotonie du rythme qu’il fait naître, inscrit dans la forme même du texte le sentiment de l’implacable.
9L’hybridation générique entre poème et tragédie n’est pas seulement liée au thème de la fatalité. Elle a également une profonde incidence sur la structure du texte dans la délimitation que nous avons choisie. Du vers 1 au vers 54, « La Fille de Jephté » repose sur le passage d’une instance énonciatrice à l’autre. Ces instances énonciatrices peuvent être rapprochées des trois pôles autour desquels la tragédie antique s’organise : du vers 1 au vers 2, le poète-coryphée délègue la parole au chœur féminin. Puis, du vers 3 au vers 34, le chœur des femmes propose le récit du retour de Jephté. Enfin, du vers 35 au vers 54, les deux protagonistes (Jephté/sa fille) dialoguent.
Une réécriture subversive
10Claude Millet, dans son ouvrage sur Le Légendaire au XIXe siècle, a bien montré que le romantisme est, en ses débuts, une véritable révolution mythologique, dans la mesure où il détrône les dieux de la Grèce, qui fournissaient le répertoire des classiques, au profit de la mythologie chrétienne. Ballanche, puis Chateaubriand témoignent de cette volonté d’abandonner les fables antiques qui n’ont plus rien à dire à la France post-révolutionnaire pour promouvoir le génie du christianisme. Vigny s’inscrit dans cette tendance, avec ses Poèmes antiques et modernes, mais avec cette particularité qu’il déchristianise le légendaire chrétien. À ce titre, « La Fille de Jephté » est moins une défense et illustration qu’une réécriture subversive du texte biblique.
11Vigny n’est pas le premier à s’inspirer du livre des Juges et à en proposer une adaptation. L’un des opéras les plus joués au XVIIIe siècle est la Jephté de Montéclair (1732 pour la première version ; 1737 pour la seconde). Or l’abbé Pellegrin, l’auteur du livret de cette tragédie biblique, a recours, dans les deux versions de son texte, à un deus ex machina pour éviter la mort de la jeune fille. Vigny choisit quant à lui de faire aboutir le sacrifice pour souligner la cruauté de Dieu. Comme dans « Le Déluge », le poème évide la justification du châtiment divin. Rien ne vient rappeler la raison pour laquelle Jephté doit sacrifier sa fille (il s’agit, dans le livre des Juges, d’un remerciement pour les victoires remportées) : on peut remarquer que ni l’épigraphe, ni la lettre du poème ne disent explicitement pourquoi Jephté « doi[t] une hostie » à son Seigneur (« La Fille de Jephté », v. 54, GF, p. 102). De fait, Vigny travaille à problématiser les liens logiques. Puisque rien n’explique en quoi les regards de Jephté sont dangereux, la coordination en « car » au vers 19 demeure énigmatique : « Il a fermé les yeux, car au loin, de la ville, / Les vierges, en chantant, d’un pas lent et tranquille, / Venaient ; […]. » (v. 19-21, GF, p. 101-102.) Il en va de même de la conséquence introduite ensuite par « c’est pourquoi » : « […] il entrevoit le chœur religieux, / C’est pourquoi, plein de crainte, il a fermé ses yeux » (v. 21-22, GF, p. 102). L’incompréhension du lecteur se trouve comme inscrite de manière spéculaire dans la question que formule la fille de Jephté au vers 45 : « Qui peut vous affliger ? » (Ibid., v. 45.)
12Le personnage du père exprime, face à ce qui apparaît comme une punition gratuite, une révolte très vive. Dans le livre des Juges, Jephté ne s’en prend jamais à Dieu, mais bien plutôt à sa fille (« Ah ! malheureux que je suis ! ma fille, vous m’avez trompé, et vous vous êtes trompée vous-même »). Il se résout par ailleurs sans regimber (« j’ai fait un vœu au Seigneur de lui offrir ce qui se présenterait à moi, et je ne puis faire autre chose que ce que j’ai promis »). Chez Vigny, les récriminations de Jephté tendent à rapprocher le Dieu de l’Ancien Testament de la figure de Moloch (le dieu des Ammonites, qui réclamait le sacrifice d’enfants) : « C’est la vapeur du sang qui plaît au Dieu jaloux ! » (« La Fille de Jephté », v. 53, GF, p. 102.)
13On pourra remarquer qu’aucune voix ne vient contredire, dans le texte, cette mise en accusation : ni celle de la jeune femme, ni celle du poète. Les propos de Jephté (« Seigneur, vous êtes bien le Dieu de la vengeance, / En échange du crime il vous faut l’innocence », v. 51-52) trouvent tout au contraire un écho, neuf poèmes plus loin, dans les paroles du Masque de Fer face au prêtre venu le confesser :
Oui, regardez-moi bien, et puis dites après
Qu’un Dieu de l’innocent défend les intérêts ;
Des péchés tant proscrits, où toujours l’on succombe,
Aucun n’a séparé mon berceau de ma tombe.
(« La prison », GF, p. 135.)
14Le poème est caractérisé par un montage énonciatif complexe. Vigny met en place un enchâssement des voix : le poète ouvre le texte dans un bref distique où il délègue la parole au chœur des femmes, qui rapporte à son tour les propos de Jephté et de sa fille. Ce fourmillement est inscrit, de manière spéculaire, avec le motif de « la lyre aux dix voix » (ibid., v. 25) qui résonne aux portes de la ville. Ce dialogisme renvoie, de manière métatextuelle, à la méthode d’écriture de Vigny et à son recours massif à des hypotextes qu’il combine. Cependant, ces délégations successives de la parole ont peut-être surtout la vertu de permettre la mise en accusation de Dieu, en éloignant son expression de la première personne.
15La réécriture de Vigny tient donc de la correction : ce dernier substitue au texte biblique le texte poétique. L’allusion à la tragédie antique n’a ici rien de fortuit. Vigny montre, par cette hybridation, que fatalité et providence ne sont que deux noms pour désigner une même puissance aveugle qui fait de l’homme son jouet. La vie humaine tient de toutes les façons de la prison. Dans son Journal, le poète note en 1832, de façon fort hétérodoxe :
À tout prendre, je ne vois guère en les analysant profondément dans la Fatalité et la Providence que des effets dont la cause est la lutte des caractères les uns contre les autres. Ces effets extraordinaires étonnent, et on les attribue, par effroi, à des puissances inconnues, l’Orient et l’Antiquité à la Destinée fatale, l’Occident à la volonté providentielle, ce qui revient au même en changeant de nom et l’appelant Livre de Dieu où l’avenir est inscrit. (J, p. 965.)
16Vigny fera de cette pensée déjà implicitement présentée dans « La Fille de Jephté » le thème même du poème d’ouverture des Destinées.