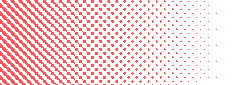Remarques sur quelques tensions dans l’œuvre de Vigny
1De manière bien convenue j’aurais envie de dire qu’après 160 ans tout a été déjà dit à propos de Vigny, dans un sens comme dans l’autre, alors de manière peut-être guère originale, mais que je crois intellectuellement intéressante, je parlerai ici de la rencontre d’un sens et de l’autre, autrement dit je voudrais interroger de manière non réductrice la, ou plutôt les tensions à l’œuvre dans les poèmes de Vigny.
2Il s’agira donc de prendre à rebrousse-poil l’œuvre de Vigny, de souligner les contradictions dans lesquelles ce dernier est le plus souvent empêtré malgré, ou en raison de, sa volonté de « pensée pure ». Ces contradictions sont inscrites dès le début de son œuvre dans cette phrase de 1832 : « Le silence est la Poésie même pour moi. » (J, p. 941), qui ne peut que poser problème de la part de quelqu’un qui use de la parole en poésie. Mais j’y reviendrai.
3Il ne s’agira pas, ici, de condamner ou de réduire ces contradictions, mais de voir que ce sont elles qui construisent l’œuvre « telle qu’en elle-même ». De plus, plutôt que de contradictions peut-être vaut-il mieux parler d’ambiguïtés, ou simplement de tensions.
4J’en poserais deux pour commencer. D’abord en rapport avec la vision des femmes selon Vigny. D’un côté il chante la femme pâle et fragile, frêle héroïne romantique, dans « La Maison du Berger » comme dans « Éloa », ou « Le Déluge », soumise à l’homme, incapable d’agir par elle-même, mais aussi la traitresse en la personne de Dalila, « Et, plus ou moins, la femme est toujours dalila » (« La Colère de Samson », v. 60, GF, p. 218). Cependant, dans Le Journal d’un poète, à l’année 1844 on trouve cette extraordinaire remarque pour l’époque : « Après avoir bien réfléchi sur la destinée des femmes dans tous les temps et chez toutes les nations, j’ai fini par penser que tout homme devrait dire à chaque femme, au lieu de Bonjour : — Pardon ! car les plus forts ont fait la loi. » (J, p. 1226.)
5Ce qui prend le contre-pied, d’une certaine façon, de la femme idéale des poèmes, soulignant l’écart existant entre la réflexion sur l’époque et sa « mise en vers ».
6Par ailleurs alors que le loup, dans « La mort du loup », et plus encore la louve, est décrit comme un animal particulièrement noble, figure véritable de l’héroïsme stoïque selon Vigny, de l’humanité, dans Le Journal d’un poète les loups sont opposés aux lions et considérés comme lâches :
Poème :
Le lion marche seul dans le désert.
Les animaux lâches vont en troupes.
Qu’ainsi marche toujours le poète.
(Peindre le Lion et les Loups.)
(J, p. 1214.)
7Ambiguïtés suffisamment fortes pour être prises pour de véritables contradictions. À moins qu’il s’agisse d’autre chose, l’opposition entre deux écrits au statut contradictoire. À la poésie, c’est-à-dire au vers, l’expression de l’idéal, la vision de l’idéal, au journal, c’est-à-dire la prose, les considérations sur le « réel », les deux entrant en conflit de toute évidence. Ainsi d’une certaine façon l’œuvre de Vigny met aux prises moins l’immobilité et le mouvement, (comme chez Bonnefoy par exemple) que l’idéal (l’immobile) et le réel (le mouvement). Cependant assigner à la poésie l’idéal et au journal le réel, serait faire œuvre de simplisme.
8Cette remarque néanmoins, et tirée toujours du Journal d’un poète : « De la poésie et de la prose. — La poésie doit être la synthèse de tout. La prose l’analyse de tout. L’une le sommaire, l’autre le détail de la pensée. » (J, p. 1223.)
9De cette synthèse que serait la poésie découle l’image du diamant ou de la perle qui, outre le temps qu’il lui faut pour se façonner, est d’abord concrétion, matière dure irréfragable, et par là même matière issue du temps pour le nier et s’en extraire. Sans remettre en question les analyses de Georges Poulet, les propos de Vigny semblent tenter de concilier la durée et l’instant, à la fois la durée par
Le DIAMANT ? c’est l’art des choses idéales,
Et ses rayons d’argent, d’or, de pourpre et d’azur
Ne cessent de lancer les deux lueurs égales
Des pensers les plus beaux, de l’amour le plus pur.
Il porte du génie et transmet les empreintes.
Oui, de ce qui survit aux Nations éteintes
C’est lui le plus brillant trésor et le plus dur.
(« Les Oracles », v. 127-133, GF, p. 210.)
10mais aussi l’éphémère par la vision de l’humain : « Aimez ce que jamais on ne verra deux fois. » (« La Maison du Berger », v. 308, GF, p. 204.)
11Ce faisant il semble que l’Idéal selon Vigny sorte du temps.
12Considérons l’évolution de cette œuvre. Elle s’inscrit d’abord résolument dans l’Histoire à travers les Poèmes antiques et modernes. Certes la première partie de ce livre porte le titre anhistorique de « Livre Mystique » mais il ne fait que correspondre, en cela, à l’avènement du temps historique en puisant ses sources dans la Septante, soit les tout premiers textes fondant la religion juive (sur laquelle Vigny a « réfléchi »), autrement dit la Torah. Le second livre, Les Destinées est, lui, plus hésitant sur sa construction. Il fait se succéder les poèmes selon une organisation peu claire si l’on excepte le premier et le dernier poème, qui jouent le rôle d’ouverture et de fermeture. Entre les deux la succession des textes ne paraît pas obéir à un quelconque principe de rationalité, puisqu’on passe d’un lieu à un autre, d’une époque à une autre sans bien percevoir la logique de la continuité. En cela Vigny qui affirme souvent dans Le Journal d’un Poète ses qualités de « compositeur » entre en contradiction avec lui-même (même si le titre pluriel du livre laisse à penser à une « succession » de destinées). De plus, il mêle, à l’intérieur de nombre de poèmes, le réel, autrement dit l’Histoire, et l’Idéal, autrement dit l’au-delà de l’histoire, là encore il suffit de se référer à « La Maison du Berger ».
13En effet, que la poésie soit diamant, qu’elle soit perle, elle est toujours le fruit d’un travail qui « prend du temps », s’inscrit résolument dans le temps, est le fruit d’une histoire, mais sa capacité à durer le fait sortir du temps humain puisqu’il « survit aux nations éteintes » et, ce faisant, au temps de l’Histoire. Il y a donc une double aspiration contraire chez Vigny, la volonté de s’inscrire dans son temps (voir « Le Livre moderne » et certains poèmes des Destinées, tels que « La Sauvage », « Wanda » ou le « Post-scriptum » des « Oracles ») mais aussi la volonté de s’en extraire par le diamant, ou la perle et d’atteindre à, d’abord la postérité (voir les strophes IX et X de « L’Esprit pur », et notons que cette postérité est d’abord du temps à rebours puisqu’il se présente comme l’ancêtre de ses ancêtres : « C’est en vain que d’eux tous le sang m’a fait descendre / Si j’écris leur histoire, ils descendront de moi » — « L’Esprit pur », v. 13-14, GF, p. 249), invoquant une volonté résolument démiurgique, pour finir par sortir du temps lui-même à travers la figure « apocalyptique » (au sens étymologique du terme) de « L’Esprit pur » qui marque un au-delà du temps humain, un au-delà de l’Histoire donc. Les deux se contrarient ainsi que le montre nombre de passages du Journal d’un Poète.
14Il est une seconde opposition, tout aussi fondamentale, qui traverse toute l’œuvre. Elle repose sur cette phrase célèbre tirée du Journal d’un poète à la date de février 1832 : « Eh quoi ! ma pensée n’est-elle pas assez belle pour se passer du secours des mots et de l’harmonie des sons ? Le silence est la Poésie même pour moi. » (J, p. 941.)
15Si, dans un premier temps, Vigny semble assimiler la poésie à la pensée (« Poésie ! ô trésor ! perle de la pensée ! » — « La Maison du Berger », v. 134, GF, p. 199), il la prive pourtant de tout véhicule sonore, ce qui est pour le moins paradoxal, voire incompréhensible. Est-il une poésie qui ne relève pas du langage, de la forme donnée au langage, et peut-il s’en passer, lui qui aspire à la postérité ? Pour survivre à soi, il faut bien léguer au futur au moins un semblant de quelque chose de perceptible qui durerait autant que dure l’humanité, voire au-delà (selon la conception du temps énoncée plus haut).
16On s’aperçoit vite que cette question du silence est au cœur de l’œuvre de Vigny. En négatif d’abord si l’on considère l’absence quasi totale de référence à la musique dans Le Journal d’un poète et ce malgré le poème « La Flûte », tandis que celles à la peinture ou la sculpture abondent. En positif ensuite, et il suffit pour cela de se souvenir des vers fameux de « La Mort du Loup » :
À voir ce que l’on fut sur terre et ce qu’on laisse,
Seul le silence est grand ; tout le reste est faiblesse.
[…]
Gémir, pleurer, prier est également lâche.
— Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le Sort a voulu t’appeler.
Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler. »
(« La Mort du Loup », v. 77-78 et 85-88, GF, p. 224.)
17Ce silence de la vie humaine relève bien sûr d’une posture stoïcienne, la même qui lui fait dire « J’aime la majesté des souffrances humaines » (« La Maison du Berger », v. 321, GF, p. 204). Vers qui soulèvera dans le tome I de Tel quel la critique de Paul Valéry. Et elle est reprise sur un mode plus « religieux », avec la strophe du « Silence » qui achève « Le Mont des Oliviers » :
S’il est vrai qu’au Jardin sacré des Écritures,
Le Fils de l’Homme ait dit ce qu’on voit rapporté ;
Muet, aveugle et sourd au cri des créatures,
Si le Ciel nous laissa comme un monde avorté,
Le juste opposera le dédain à l’absence
Et ne répondra plus que par un froid silence
Au silence éternel de la Divinité.
(« Le Mont des Oliviers », v. 143-149, GF, p. 233.)
18Mais ce silence dédaigneux relève d’une posture morale non d’une « certaine idée de la poésie ». Or le silence marque de son empreinte les symboles mêmes qui incarnent la poésie. Matières minérales, diamant et perle sont matières silencieuses. Cela va de soi. Mais elles sont, en revanche, surtout choses visibles, susceptibles d’être décrites. Et là se joue un autre silence, celui de la peinture qui donne à voir mais que l’on n’entend pas. Pour reprendre Claudel, si « l’œil écoute », il ne parle pas.
19C’est à ce point qu’il faut sans doute faire intervenir la préface aux Poèmes antiques et modernes, datée d’août 1837. Vigny, qui veut prendre date, achève sa préface sur la phrase suivante :
Le seul mérite qu’on n’ait jamais disputé à ces compositions, c’est d’avoir devancé en France toutes celles de ce genre, dans lesquelles une pensée philosophique est mise en scène sous une forme Épique ou Dramatique. (GF, p. 59.)
20L’expression même de « mise en scène » nous renvoie à la notion de théâtre, semblable à celui qui commence la prosopopée de la nature dans la dernière partie de « La Maison du Berger » :
Elle me dit : « Je suis l’impassible théâtre
Que ne peut remuer le pied de ses acteurs ;
[…]
Je sens passer sur moi la comédie humaine
Qui cherche en vain au ciel ses muets spectateurs.
[…] »
(« La Maison du Berger », v. 281-282 et 286-287, GF, p. 203.)
21Il est vrai que l’usage de la métaphore théâtrale est fréquent dans l’œuvre puisque Vigny est aussi « homme de théâtre ». Mais en l’occurrence il est difficile de ne pas penser également à une phrase célèbre de Victor Hugo dans La Préface de Cromwell : « Le vers est la forme optique de la pensée ». Et c’est bien ce que sous-entend dans la préface aux Poèmes antiques et modernes Alfred de Vigny : il s’agit, par le vers, de « donner à voir » la pensée, de la rendre « spectaculaire ». Déjà, en 1826, dans Le Journal d’un Poète, il écrivait : « Voir est tout pour moi. Un seul coup d’œil me révèle un pays et je crois deviner, sur le visage, une âme ». (J, p. 883.) D’où les nombreuses références à des tableaux et à l’art pictural. Là encore « La Maison du Berger » est exemplaire (mais nombre des Poèmes antiques et modernes répond à ce dispositif pictural) qui s’achève sur
Tous les tableaux humains qu’un Esprit pur m’apporte
S’animeront pour toi, quand, devant notre porte,
Les grands pays muets longuement s’étendront.
(« La Maison du Berger », v. 327-329, GF, p. 204.)
22Difficile également de ne pas souligner que les deux citations énoncées ci-dessus, renvoient explicitement au silence, « muets spectateurs » et « grands pays muets ». Que l’on soit acteur, que l’on soit spectateur, que l’on soit auteur, on est réduit au silence. Si la méditation nécessite du temps pour devenir diamant ou perle, elle nécessite aussi du silence :
Jamais la Rêverie amoureuse et paisible
N’y verra sans horreur son pied blanc attaché ;
Car il faut que ses yeux sur chaque objet visible
Versent un long regard, comme un fleuve épanché ;
Qu’elle interroge tout avec inquiétude,
Et, des secrets divins se faisant une étude,
Marche, s’arrête et marche avec le col penché.
(« La Maison du Berger », v. 127-133, GF, p. 199.)
23Le silence, compagnon de la mélancolie et du rêve, de la marche hésitante, s’étend sur tous objets et ne trouve meilleure expression que dans la forme, en particulier celle très étroite de la terza rima ; il suffit de considérer les mots à la rime de la précédente citation pour voir le sens se développer : paisible/visible ; attaché/épanché /penché ; inquiétude/étude. Les mots à la rime se répondent, se prolongent, s’opposent aussi, résumant en quelque sorte la strophe même et la clôturant sur elle-même, véritable perle irréfragable, susceptible pourtant de diverses interprétations. Dans le diamant, différentes lumières courent, et font se jouer ces tensions, voire contradictions, qui hantent l’œuvre.
24Mais quel tableau décrire, quel paysage, dès lors que le « théâtre » de la nature est rejeté ? On retrouve ici l’opposition radicale entre l’idéal et le réel, et il n’est pas surprenant que Vigny réécrive le Déluge en le transformant en une fin du monde négative qui voit la disparition totale de l’innocence. Pour que l’Idéal soit, il lui faut renoncer au réel, mais en renonçant au réel, il se prive du moyen d’atteindre l’Idéal. Il ne peut résoudre cette contradiction que par un pari abstrait sur le futur, tel qu’il le décrit dans « L’Esprit pur », achevant ainsi son œuvre sur une hypothétique postérité, une prétention de maîtrise du temps futur.