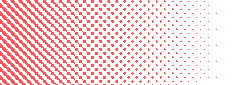Peur de la bombe atomique ou peur des Enfers ? Les choix d’Hannah Arendt et de Karl Jaspers
1. 1957 : Une nouvelle étoile dans le ciel
1Le 4 octobre 1957 — il y a 65 ans — alors que la course aux armements et aux essais nucléaires battait son plein, une fusée russe plaçait sur orbite une petite sphère de 58 cm de diamètre qui se mit à tourner autour de la Terre comme une nouvelle lune. L’intelligence humaine venait de créer le premier astre artificiel ; elle faisait du ciel son laboratoire. Mais l’admiration est aussi faite d’inquiétude, sur un plan politique d’abord, mais plus profondément encore sur le plan de l’imaginaire social. A qui appartient le Ciel ? Aux dieux, aux rêveurs, aux philosophes, aux scientifiques, aux militaires ? En 1957, Spoutnik vient déranger des croyances de toujours1.
2La colonisation du ciel n’est pas neutre et les satellites ne sont pas des étoiles innocentes. En 1957, Spoutnik 1 confirme non seulement la maîtrise humaine de la loi de la gravitation et de la force centrifuge, mais aussi la capacité de s’installer dans l’espace. L’ère spatiale est ouverte. Les vieux dieux célestes sont sommés de laisser la place aux machines ; la science-fiction peut concevoir de nouveaux scénarios. Sur le plan politique, l’URSS exhibe sa puissance. Plus que le satellite lui-même dont les fonctions pourront être multiples, la menace vient de la fusée qui a placé le satellite sur orbite : un missile balistique intercontinental qui pourrait tout aussi bien emporter, au-dessus d’un océan, une bombe atomique, comme celle qui sera larguée à Hiroshima : les missiles à tête nucléaire sont annoncés.
3L’URSS prouve les progrès de sa technologie spatiale et démontre sa capacité de nuisance militaire. L’Amérique mesure l’ampleur du danger ; l’Europe aussi. Reprenant la formule d’Edward Teller, le père de la bombe H, les journaux américains parlent d’un « Pearl Harbor technologique »2. En 1957, les Américains échouent à revenir dans la course : le 6 décembre, leur fusée, Vanguard TV3, explose avec le satellite qu’elle portait. « Kaputnik ! », commente le lendemain le London Daily Express3 ; l’humour britannique ne dissipant nullement la désillusion4.
4Khrouchtchev pour l’URSS et Eisenhower pour les USA jouent chacun double jeu, évoquant des trèves, alors que, de chaque côté, les essais se multiplient dans des programmes secrets5. Il faudrait freiner la course, mais pas avant que les négociateurs ne se soient assurés de l’équilibre des forces. En novembre 1957, Lyndon B. Johnson, futur président du pays, s’exprimait au Sénat : « Bientôt, les Russes nous lâcheront des bombes depuis l’espace comme des enfants lâchent des cailloux sur des voitures depuis les viaducs des autoroutes »6.
5Au Ve siècle avant notre ère, alors qu’on lui demandait pourquoi il était né, Anaxagore répondait « Pour regarder le soleil, la lune et les étoiles »7. Trois siècles plus tard, Hipparque, inventeur de l’astrolabe, découvrait une étoile qui venait de naître. Au début du XVIIe siècle, Galilée perfectionne son invention du télescope et les navigateurs portugais utilisent l’astrolabe et le quadrant pour évaluer la hauteur des astres et déterminer les latitudes. Durant les deux guerres mondiales, le ciel devient théâtre de batailles aériennes. En 1957, le premier astre artificiel regarde la terre d’en haut. En mai 2023, l’UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs) recense depuis 1957 près 15'500 satellites lancés dans l’espace8, générant des dizaines de milliers de déchets spatiaux : des programmes sont désormais envisagés pour nettoyer le ciel pollué9. Objet de contemplation, le ciel est aussi un miroir d’activités humaines qui le menacent et qui appellent, pour éviter sa pollution, une écologie spatiale. Les satellites remplissent grand nombre de missions, plusieurs servent aux prévisions météorologiques, mais le meilleur météorologue ne peut jamais prévoir une infernale pluie de missiles.
2. 1957-1958 : Hannah Arendt regarde la nouvelle étoile
6En 1958, à New York, Hannah Arendt publie The Human Condition. Elle est forte de la notoriété que lui a value son livre précédent, The Origins of the Totalitarism. Après avoir reconnu l’effacement d’une conscience politique dans l’expérience encore très récente du nazisme et du stalinisme (deux régimes totalitaires qu’elle distingue du fascisme), elle réoriente sa réflexion pour interroger la condition humaine et réaffirmer le sens d’une action politique inhérente à cette condition : quelles garanties la société humaine peut-elle trouver pour éviter ces régimes totalitaires qui la déshumanisent et qui désormais possèdent des armes de destruction planétaire ?
7Ni vraiment historienne des idées, ni non plus philosophe politique affirmée, Arendt devient l’une et l’autre, dans un style à elle, pour faire le bilan d’un monde menacé et concevoir une éthique possible, celle d’une vita activa où la pensée serait action10. Dès la première ligne du prologue, elle choisit, comme exemple emblématique du changement irréversible, le spectacle du satellite artificiel : « un objet terrestre, fait de main d’homme fut lancé dans l’univers ; pendant des semaines, il gravita autour de la Terre conformément aux lois qui règlent le cours des corps célestes, le Soleil, la Lune, les étoiles. »11 De façon surprenante vu le contexte politique, elle s’intéresse peu aux implications stratégiques de l’événement — elle omet d’ailleurs de dire, ce que tout le monde sait, que le satellite est russe et qu’il s’appelle Spoutnik — mais elle insiste en revanche sur les conséquences d’une aventure de l’espace qui éloignerait l’humain (sans distinction de nationalité) de la Terre et de sa condition première. L’événement est tel, commente-t-elle, que « rien, pas même la fission de l’atome, ne saurait [l’] éclipser »12.
8Fidèle à une conception biblique, mais aussi grecque, qui rappelle que l’homme est né de la Terre13, Arendt s’inquiète d’un progrès technologique qui inciterait l’humanité à oublier sa condition originelle. Elle se scandalise d’entendre un journaliste américain se réjouir de ce premier acte d’une « évasion des hommes hors de la prison terrestre »14. Elle rappelle l’épitaphe gravée sur la tombe d’un grand savant qu’elle ne nomme pas : « L’humanité ne sera pas toujours rivée à la Terre »15. Il n’est pas difficile de reconnaître le savant qui rêve de conquérir l’espace : Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, mort en 1935, savant russe devenu aujourd’hui figure iconique, aux côtés de Nikolaï Fiodorov, des Cosmistes et du mouvement New Age16. Le 23 juillet 1935, Tsiolkovsky écrivait dans la Komsomolskaïa Pravda : « Rien ne m’intéresse autant que le problème de l’évasion du champ de la pesanteur terrestre et les voyages cosmiques. […] Y a-t-il quelque chose de plus noble que de se rendre maître de l’énergie totale du soleil ? »17 De plus noble ou de plus fou ? De plus deinon aurait répondu Sophocle, qui disposait, dans la langue grecque ancienne, d’un mot pour dire la folie merveilleuse du terrible génie humain18. Pourquoi certaines langues possèdent-elles les mots qui manquent aux autres ?
9Pour Tsiolkovsky qui sera suivi par tant d’autres, ni la mort, ni l’attachement à la Terre ne doivent rester des limites éternelles pour l’humanité. Le 29 mars 2007, Vladimir Poutine, toujours si fier d’exhiber et de louer son arsenal nucléaire, se trouvait à Kaluga, devant la tombe de Tsiolkovsky, pour lui rendre hommage ; les photos du site Sputnik le montrent en train de déposer une gerbe de fleurs, sous l’épitaphe qui scandalisait Arendt19. Poutine a sa logique : si les armes atomiques sont massivement employées et que la Terre devient inhabitable, il faudra bien migrer ailleurs dans le cosmos. Rien d’étonnant non plus si certains multimilliardaires de la Silicon Valley sont aussi de fervents admirateurs de Tsiolkovsky et de Fiodorov20. Elon Musk et Vladimir Poutine ont des points communs. Les oligarques et les archi-multimilliardaires ont des raisons de vouloir se rencontrer pour partager leur ambition de puissance totale.
3. Arendt et la perte d’un lien premier à la Terre et au Ciel
10En 1957, Arendt dénonce la mystification d’une humanité cosmique. Elle n’est pas la seule, mais elle le fait à sa façon, en soulignant que nous sommes tributaires d’une histoire occidentale qui détermine notre condition socio-politique. Elle remonte le temps : « Si les Chrétiens ont parlé de la Terre comme d’une vallée de larmes et si les philosophes n’ont vu dans le corps qu’une vile prison de l’esprit ou de l’âme, personne dans l’histoire du genre humain n’a jamais considéré la Terre comme la prison du corps, ni montré tant d’empressement à s’en aller, littéralement, dans la Lune. »21 Penser la terre comme une prison humaine relève d’un non-sens total ! La Terre est la « quintessence même de la condition humaine »22. Le problème est formulé dans toute sa force : « L’émancipation, la laïcisation de l’époque moderne qui commença par le refus non pas de Dieu nécessairement, mais d’un dieu Père dans les cieux, doit-elle s’achever sur la répudiation plus fatale encore d’une Terre, Mère de toute créature vivante ? »23 L’humain ne doit pas oublier qu’il est d’abord créature terrestre24. Le ciel est à contempler, non à traverser ou à occuper. Et Arendt déroule son argumentaire en empruntant à Kafka son concept du « point d’Archimède » : ce point extérieur à la Terre depuis lequel, avec l’instrument voulu, on pourrait agir facilement sur le globe terrestre, pour le lever, le peser, le transformer en objet d’étude. La Terre n’est plus ce centre du monde, mais un point du cosmos que l’on peut regarder depuis n’importe quel autre point qui lui est extérieur. Arendt donne l’exemple, non pas du levier, mais du télescope de Galilée qui permet de regarder les étoiles de plus près comme si l’observateur était dans le ciel : le télescope est accusé de « dévoiler ce qui aurait dû à jamais échapper [à l’œil humain] »25. L’ère de la technologie a-t-elle jamais eu un début ? Arendt le pense et, trois siècles après Galilée, elle en constate les conséquences devenus irrémédiables.
11Pour la philosophe, la fabrication du satellite ne fait que prolonger et confirmer le progrès promis par le télescope. Le télescope permet de regarder le ciel autrement ; il offre à l’homme un point de vue divin : « œuvre des mains humaines », il force « la nature, ou plutôt l’univers, à livrer ses secrets »26. Désormais, la connaissance du monde ne dépend plus des seules facultés sensorielles humaines, mais d’instruments techniques. La condition humaine est transcendée par la technologie. L’humanité va devoir apprendre à dépendre de la technologie qui l’augmente. Le ciel n’est plus l’objet d’une contemplation immédiate. Il est regardé avec des instruments plus précis qui permettent de le mesurer, de le délimiter, de l’occuper, de poser des questions nouvelles. La question — que Galilée ne pouvait prévoir — est, avec Arendt, de savoir jusqu’où cette exploitation pourra se faire sans détruire les ressources mêmes dont la vie dépend. En exergue de son dernier chapitre, elle cite Kafka : « L’homme a trouvé le point d’Archimède, mais il s’en est servi contre soi ; apparemment, il n’a eu le droit de le trouver qu’à cette condition. »27 Jusqu’où faut-il s’inquiéter de cette colonisation du ciel ? Faut-il craindre un ciel qui deviendrait infernal ?
4. Bâle, 1957-1958 : Jaspers et le regard de Gorgô
12Arendt n’est pas une intellectuelle solitaire. Son infatigable activité épistolaire révèle une œuvre qui se construit au fil d’un dialogue continu avec ses correspondants : Karl Jaspers, Günther Anders, Heinrich Blücher, Martin Heidegger, Mary McCarthy, Kurt Blumenfeld, Gershom Scholem28, entre autres. Évoquons ici la figure de Jaspers. Formé à la psychologie et à la philosophie, conservateur et anticommuniste jusqu’à affirmer que Marx était un homme néfaste29, interdit d’enseignement et de publication par le régime nazi en 1938, ancien ami et collègue de Heidegger dont il continuera jusqu’au bout de critiquer le silence sur sa compromission avec le national-socialisme, l’un des premiers à avoir évoqué clairement en 1945 la culpabilité allemande30, Karl Jaspers rencontra Arendt en 192731. À la demande et sur la recommandation de Heidegger, qui après sa relation amoureuse avec Arendt ne pouvait devenir son directeur de thèse, il avait accepté d’assumer cette fonction ; le sujet retenu était le concept de l’amour chez Saint Augustin. Ce fut le départ d’une longue et constante amitié. Dans les années 1950, ils s’écrivent régulièrement et correspondent sur leurs travaux réciproques32. Jaspers a 75 ans et habite Bâle quand il publie en 1958 un livre monumental, La Bombe atomique et l’Avenir de l’homme33. Il y développe, dans toute leur ampleur, des arguments tirés de plusieurs conférences qu’il a données à la radio pour un grand public. Malgré un accueil réservé dans le monde académique, critiqué notamment par Günther Anders et par Maurice Blanchot, le livre remporte un vrai succès public et reçoit le prix de la Paix 1958 décerné par les libraires allemands. Il revient à Hannah Arendt de prononcer, à Francfort en septembre 1958, la laudatio officielle34, occasion pour elle de reprendre tout ce qu’elle lui disait dans les lettres qu’ils s’échangeaient.
13Dans ce livre loué par Arendt, Jaspers dénonce deux dangers majeurs menaçant le monde : la bombe atomique qui peut conduire à l’auto-anéantissement de l’humanité et les formes de domination totalitaire, deux menaces qui peuvent se renforcer ou s’équilibrer ; la bombe atomique, acceptable dans le camp américain, apparaît monstrueuse dans le camp des communistes. Attentif sans cesse au contexte politique, Jaspers, philosophe, reste psychologue pour blâmer ces malades qui préfèrent oublier leur mal que le soigner35. Il appelle à regarder les choses dans leur réalité, à considérer non seulement la possibilité, mais la probabilité de la catastrophe. Il faut remettre en question la pensée et surtout la raison, dans leur fonctionnement même, pour trouver, par-delà les a priori, des solutions à une menace nouvelle qui définit aussi une condition nouvelle humaine. Dieu est mort, mais la bombe est là qui se substitue à lui comme nouvelle puissance exterminatrice. Le satellite permet d’épier la Terre, la bombe qui tombe du ciel permet de la détruire sans utiliser aucun levier d’Archimède36. Faut-il revenir à la prophétie de Kafka et poser que l’humain n’a pu inventer la bombe qu’à la condition de la retourner contre lui-même ? Pour Jaspers, la situation de crise offre une chance : l’urgence de la menace doit inviter à l’introspection et à l’invention de nouvelles politiques pour « écarter la catastrophe »37 ; « catastrophe », c’est aussi le mot employé pour traduire la « Shoah » ou pour indiquer le génocide des Arméniens. Mais a-t-on jamais pu trouver un moyen d’obliger la raison à devenir plus raisonnable ? Qui nous dit que la pensée pense bien du seul fait qu’elle pense ? Ou que le danger dénoncé par Jaspers dépend d’abord d’un conflit entre une politique, pour ne pas dire une pensée, communiste et une société démocratique qui penserait mieux ?
14Le livre de Jaspers sur la bombe atomique est aussi et nécessairement un livre sur la raison, mais marqué d’un parti pris idéologique. Il proclame l’urgence d’affronter une menace entièrement nouvelle, dès lors qu’il constate l’impossibilité d’un retour à un monde sans bombe ; l’histoire n’est pas cyclique ; inutile de vouloir chercher un précédent. Platon et Aristote ignoraient cette menace. Auraient-ils seulement pu concevoir que l’intelligence humaine irait si loin ? L’époque atomique (ou « ère atomique ») pourra être suivie d’autres époques (informatique, post-informatique, robotique, transhumaine), mais la bombe atomique (longtemps impensable) est désormais là pour toujours. En 1949, quatre ans après Hiroshima et Nagasaki, Sartre reconnaissait déjà l’inéluctabilité de ce destin : « Il fallait bien qu’un jour l’humanité fût mise en possession de sa mort. »38 Invention humaine — ou « création humaine » — la bombe confronte l’humanité à elle-même dans ce qu’elle a de plus fragile, l’obligeant à penser, par-delà la mortalité de chaque individu, la possibilité d’une fin ou d’un suicide collectifs (un humanicide humain). Il a fallu rendre concrète la menace de la disparition totale de l’humanité pour que les populations comprennent (et déjà oublient) qu’elles existaient de façon solidaire et que la folie d’un seul tyran peut entraîner une fin commune. Jaspers voit bien que, pour empêcher l’usage d’une bombe désormais existante, il ne suffit pas d’une réglementation internationale ou d’accords politiques. N’importe quelle instance dirigeante d’un pays détenteur de l’arme nucléaire peut décider, au nom de son seul jugement, de son idéologie, de déclencher un processus de destruction incontrôlable. La survie de tous demande la raison de chacun.
15Comme Heidegger et Arendt, Jaspers en revient à cette conclusion, ce credo déjà platonicien, qu’il faut placer la science sous le contrôle de la pensée philosophique39. Mais tandis que Heidegger est devenu factuellement complice intellectuel du tyran, accordant sa philosophie élitiste aux idées du plus fort, Jaspers et Arendt ne se laissent pas aveugler par l’ambition de devenir les penseurs d’un Führer. Face à la bombe, le philosophe doit aspirer à une réflexion collective : « Seule la raison peut unir les hommes dans la totalité de leur nature. »40 Après Freud et après Nietzsche, et en regardant surtout les hordes nazies saluer le Führer, bras droit tendu, on peut se demander si l’irrationnel n’est pas une force plus puissante encore pour unir les hommes. Pour Jaspers, la dimension irrationnelle est désormais celle du communisme ; son projet est alors de définir une nouvelle forme de raison : un projet qui risque de s’enfermer dans son propre piège.
16D’abord, Jaspers évoque l’initiative de Freda Wuesthoff, physicienne pacifiste et fondatrice du cercle de la paix de Stuttgart ; il lui reproche d’ignorer, dans son approche trop théorique, le contexte politique et militaire. Les États, souligne-t-il, ne partagent pas une « même conscience idéale » et l’usage de la bombe ne se fera pas en fonction d’une théorie absolue mais en fonction d’une situation concrète41. Contrairement à Platon qui conçoit, dans la République, une cité théorique, Jaspers analyse la pluralité du monde dans lequel il vit. Le recours à l’abstraction, dit-il, n’aboutit à rien : le danger est de rester « prisonnier de l’abstraction et de se détacher de la réalité »42. Jusque-là, on le suit43. Multipliant images et métaphores, il évoque ces guerres dont on ne veut pas voir l’imminence44 ; il dénonce ceux qui affirment détenir des solutions, « les faiseurs de projets, les fanatiques d’une abstraction »45. Il faut alors, insiste-t-il, avoir le courage de s’en remettre à la raison, parce qu’elle seule oblige à considérer la réalité comme elle est. On le suit toujours. Une raison, note-t-il, qui est sans doute difficile à regarder « dans sa pleine lumière »46. La « pleine lumière » de la raison ? L’expression est plus compliquée, et sans doute Jaspers pense-t-il à une raison idéale, telle que le philosophe de la République de Platon, sorti de la caverne, pourrait la découvrir, dans son ascension vers la lumière, en contemplant l’idée du Bien assimilée au soleil.
17Jaspers ne croit pas aux Idées, ni aux abstractions ontologiques d’un Heidegger devenu plus que jamais son rival, mais il n’en idéalise pas moins la raison47. Comment croire à une raison idéale ? Avançons lentement. La raison vers laquelle Jaspers veut tendre et dont il veut fonder l’autorité est celle qui rappelle les humains à leur condition même, celle qui doit oser regarder une réalité devenue terrifiante. Il se peut, dit-il, que la pensée de la raison « effarouche ceux qui se plaisent dans leur tranquillité »48. La raison devient ici une puissance à conquérir et à dompter. Il faut des héros de la raison et Jaspers reconnaît qu’il est le premier à peiner pour parvenir à cette forme de pensée qui est celle de la raison, mais il veut oser49.
18Survient alors dans la démonstration et pour expliciter ce qu’il faut entendre par « pensée de la raison [das vernünftige Denken] » une figure mythologique ; le recours à la mythologie est suffisamment rare chez Jaspers pour qu’on y prenne garde. Pour illustrer l’effort que devra fournir « la pensée de la raison », il évoque la face terrifiante de la monstrueuse Gorgô dont il faudra désormais apprendre à soutenir le regard pétrifiant. Il faut, explique-t-il, que la pensée « ose regarder la vérité en face » : « C’est seulement lorsqu’on supporte de regarder le visage de Gorgô qu’on peut créer le sérieux autant que le savoir nécessaires pour prendre des décisions dans la marche du monde. »50 La métaphore est forte et appelée par une série d’associations d’idées. Jaspers parle de « la marche du monde » : une menace est là qu’il faut gérer. Il faut prendre acte d’un contexte politique inquiétant pour les USA et le monde occidental. Tournoyant autour de la Terre, le satellite symbolise ce danger, il est cette nouvelle Gorgô qu’il faut apprendre à regarder en face, sans être paralysé.
19L’image mythologique est d’autant plus forte qu’elle est fondée sur une contradiction à dépasser. Dans l’imaginaire grec, le regard de Gorgô est impossible à soutenir, il transforme celui qui le voit en pierre. Mais Jaspers demande de soutenir et de vaincre le regard de Gorgô ; il oblige le penseur à affronter la face monstrueuse pour « produire [hervorbringen] » une nouvelle forme de raison dont le monde a besoin : « le sérieux autant que le savoir nécessaires pour prendre des décisions dans la marche du monde »51. Du courage de regarder Gorgô naîtrait la raison, une raison devenant, dans cette théogonie philosophique, fille d’un monstre. Gardienne de l’Hadès dans l’Odyssée, Gorgô, repensée par Jaspers, gravite désormais dans le ciel, semblable à une arme nucléaire ou à un satellite espion. La mythologie est réinventée et Gorgô oblige l’humain à devenir animal raisonnable.
20Demander aux humains de soutenir le regard de Gorgô, c’est leur demander de transcender leur condition, leur demander donc de se doter d’un pouvoir divin. Jaspers demande un exploit. Peu avant la parution de son livre, le 29 décembre 1956, il écrivait à Arendt et s’inquiétait, dans sa lettre, de l’inertie d’Eisenhower et de « l’aventurisme d’un général ivre d’histoire mondiale » : « Au moins — ajoutait-il — au lieu de la peur des flammes de l’enfer, nous avons la peur de la bombe H. »52 La peur de la bombe plutôt que la crainte des flammes infernales ? La peur d’un tyran fou plutôt que celle d’un jugement divin ? Pourquoi cette substitution ? On pourrait presque se demander si les humains n’ont pas inventé (créé) la bombe pour remplacer d’autres craintes qui avaient perdu leur force. Conçu et développé pour anéantir en quelques fractions de secondes des villes, des régions et des pays entiers, l’armement nucléaire confère aux puissances qui s’affrontent un pouvoir surhumain. Finalement, dans le ciel imaginé par Jaspers, c’est Gorgô qui regarde Gorgô. Tandis que les satellites se croisent dans le ciel, les puissances nucléaires qui s’observent n’ont plus besoin des dieux.
21Dans sa laudatio du livre de Jaspers, Arendt souligne la portée politique de la position philosophique : « Tout comme, selon Kant, rien ne devrait jamais arriver à la guerre qui rendrait une paix future et une réconciliation impossibles », de même — poursuit-elle — la position de Jaspers demande que rien n’arrive en politique qui soit contraire à « l’existence réelle d’une solidarité de l’humanité »53. Mais le problème est bien là : quelle autorité faut-il pour assurer et garantir un « ordre fédéral mondial »54 ? Le pouvoir de la raison ou la menace atomique ? La menace qui se substitue au principe de raison ? Malgré sa laudatio sincère, Arendt, et d’autres avec elle55, constate que la discussion reste dans l’impasse, et l’on imagine la grimaçante Gorgô en train de sourire ; elle sait qu’Hitler n’est pas le dernier à penser que « seule la terreur peut briser la terreur ». Heidegger d’ailleurs citait le Führer pour l’approuver dans une lettre du 7 mars 193356.
5. Mais que sont devenus les Enfers ?
22Attachée à une tradition culturelle qui remonte à la Grèce, Arendt ne pense pas la condition humaine sans interroger son rapport à la Terre et au Ciel. Mais comment penser le Ciel et la Terre sans impliquer le monde d’en-bas ? N’oublions pas que la tête de Gorgô, que Jaspers déplace dans le ciel, appartenait d’abord, dans l’Odyssée, au monde infernal57. Quelle corrélation entre un ciel que la technologie humaine colonise et un enfer qui n’effraie plus ? Revenons au constat que Jaspers formule dans sa lettre du 29 décembre 1956 : la peur de la bombe H comme substitut de la peur de l’enfer. La question se pose de savoir s’il peut y avoir un usage politique de l’une ou l’autre de ces deux peurs. La concession qui veut remplacer une peur transcendante par une peur immanente est pour le moins problématique et cela à plusieurs égards58. Dans l’œuvre d’Arendt, la peur infernale est un thème récurrent59, d’autant plus important que la philosophe, remontant les siècles jusqu’à la Grèce de Platon et à son mythe d’Er, n’hésite pas à recourir à l’imagerie de l’enfer pour parler des camps de concentration. En 1944, alors qu’elle conçoit le projet de son grand ouvrage, Les origines du totalitarisme, elle évoque comme titres possibles : « Les Éléments de la honte. Antisémitisme, impérialisme, racisme », ou plus simplement et directement « Les Trois Piliers de l’enfer [The Three Pillars of Hell] »60 : un titre qu’on aurait tort de vouloir réduire à sa dimension métaphorique. Arendt cite les ouvrages de David Rousset, ancien prisonnier de Buchenwald, qui dénonçait comme son ami Robert Antelme mais avec une stratégie différente61, l’impossibilité pour les témoins de faire comprendre une expérience que l’esprit humain ne peut humainement concevoir ou même imaginer62. Arendt cherche des points de référence. Si elle ne trouve aucun point de comparaison dans l’histoire, elle recourt à l’imaginaire religieux et choisit l’image de l’enfer, religieusement inacceptable si on le détache de l’idée de jugement dernier qui le justifie. La référence est risquée. Les camps de concentration sont un enfer au-delà de l’enfer ; les créatures qui y sont jetées ne sont plus destinées ni à la vie, ni à la mort, mais contraintes d’œuvrer dans la fabrique de leur extermination, la fabrique de leur négation absolue. Quel peut être le sens de l’enfer si on le dépouille d’une dimension religieuse susceptible de le justifier ? Dérivé d’un adjectif latin qui signifie « sous-terrain » (infernus), l’enfer sur terre prend la forme d’un piège contradictoire où l’état de vie terrestre ne se distingue plus de l’état de mort pour celui qui est devenu un « cadavre vivant »63. Sans distinction de la vie et de la mort, à quoi peut servir l’enfer et la possibilité pour le damné de payer après la mort le prix des fautes commises durant la vie terrestre ? Cette description contradictoire d’un enfer sécularisé et non métaphorique apparaît à Arendt comme l’ultime moyen pour suggérer la dimension impensable et indicible des camps. Et ces camps infernaux sont la conséquence inéluctable d’un régime totalitaire niant les individus en tant que tels. La domination totalitaire ne peut s’achever que dans « les tourments et l’enfer des camps totalitaires »64.
23Concédons qu’il faut des mots pour dire l’horreur extrême. Le terme « enfer » et son imagerie est à disposition, mais est-ce si simple ? Arendt admet que « rien ne peut être comparé à la vie dans les camps de concentration » et qu’aucun récit ne peut dire une monstruosité qui dépasse le dicible dès lors que cette monstruosité « se tient hors de la vie et de la mort »65. Reste que, pour dénoncer l’indicible horreur des camps, il faut, contre l’oubli, le silence et le négationnisme, trouver des mots et des images pour essayer de penser jusque dans ses extrêmes limites l’expérience du totalitarisme. Le but est de comprendre. Arendt fait sien ce paradigme inattendu pour décrire les différents types de camps concentrationnaires. Écoutons-la : « Vus de l’extérieur, ceux-ci [les camps], et ce qui s’y passe, ne peuvent être décrits qu’à l’aide d’images tirées d’une vie après la mort, d’une vie affranchie des soucis terrestres. On peut fort justement distinguer trois types de camps de concentration qui correspondent à trois conceptions fondamentales de la vie après la mort en Occident : l’Hadès, le Purgatoire, et l’Enfer. »66 L’Hadès, dans les pays non totalitaires, pour « mettre à l’écart […] des personnes devenues superflues et importunes » ; le Purgatoire, à savoir les camps de travail forcé en Union soviétique ; enfin, poursuit Arendt, « l’Enfer au sens le plus littéral a été incarné par ces types de camps réalisés à la perfection par les nazis : là, l’ensemble de la vie fut minutieusement et systématiquement organisé en vue des plus grands tourments possibles […] ; le résultat en est qu’un lieu a été créé où des hommes peuvent être torturés et abattus, sans que pourtant ni les tourmenteurs ni les tourmentés, et encore moins les autres à l’extérieur, ne s’avisent qu’il s’agit là de quelque chose de plus qu’un jeu cruel ou qu’un rêve absurde. »67
24Dans les camps de concentration, l’enfer fantasmé par la religion serait donc devenu réel : « Soudain, il devient évident que ce que l’imagination humaine avait depuis des milliers d’années rejeté dans un royaume hors du pouvoir humain peut se forger ici-bas maintenant : l’Enfer et le Purgatoire, et même l’ombre de leur durée éternelle, peuvent être créés grâce aux méthodes les plus modernes de destruction et de thérapie. […] l’homme peut réaliser des visions d’enfer sans que le ciel tombe ou que la terre s’ouvre »68. Plus loin, elle précise encore : « la réalité des camps de concentration ne ressemble à rien tant qu’aux représentations médiévales de l’Enfer »69. L’enfer, ses visions traditionnelles, constituent, pour Arendt, le paradigme pour penser ou décrire la réalité indicible des camps de la mort. Pour un peu, on pourrait suggérer que la pensée religieuse a offert, avec son imagerie de l’enfer, un modèle pour inventer l’horreur de l’extermination dans les fours. Comme si le fantasme, une fois perdue son efficacité symbolique et religieuse, était destiné à se concrétiser pour servir une idéologie de la race pure rompant avec la religion. Les camps de concentration veulent affirmer la supériorité aryenne.
25Les représentations de l’enfer, dans l’histoire de l’Occident, constituent un dossier aussi riche qu’hétéroclite70. Si inquiétantes ou terribles que les descriptions ou les images des tortures infernales puissent paraître, elles restent, dans la mesure où elles relèvent d’une imagination créative, sujettes à des interprétations multiples qui peuvent prendre une dimension esthétique, cathartique ou argumentative autorisant une mise à distance. L’horreur absolue des camps de la mort n’a rien d’une image : elle est un fait qui défie la comparaison et la représentation. Comment, pour reprendre une expression d’Arendt, dire avec une langue humaine l’histoire (ou la mise hors histoire) de ceux qui « furent expulsés de l’humanité et de l’histoire humaine, […] privés de leur condition humaine »71 ? Arendt sait bien sûr qu’elle dérange et elle répète qu’elle ne saurait écrire sur le totalitarisme et les camps de concentration sans exprimer aussi sa « colère », sine ira72, et sans chercher à ébranler son lecteur par des images appropriées, « tirées d’une vie après la mort »73.
6. Si Hitler et Staline avaient seulement eu peur de l’enfer au lieu de l’imposer…
26Mais une autre raison, plus profonde, invite Arendt à recourir à l’exemple de l’enfer. Elle est convaincue que la mythologie de la peur infernale, inaugurée par Platon dans la République et reprise par le christianisme, a exercé tout au long du Moyen Âge une autorité de dissuasion74. C’est un contraste radical qui l’intéresse. Elle développe sa comparaison en creusant un fossé entre les siècles et les sociétés qui ont connu la peur religieuse de l’enfer et un monde non seulement sécularisé mais où la civilisation désintégrée laisse place à un pouvoir qui peut agir sur des masses manipulables : « Rien peut-être ne distingue plus radicalement les masses modernes de celles des siècles passés que la perte de la foi en un Jugement dernier : les pires ont perdu leur peur, les meilleurs leur espoir. Aussi incapables qu’avant de vivre sans peur et sans espoir, ces masses sont attirées par toute entreprise qui semble promettre la fabrication par l’homme du Paradis qu’elles avaient désiré et de l’Enfer qu’elles avaient redouté. »75
27Ce paragraphe annonce un thème clé de l’important essai qu’Arendt publie sous une première forme en 1958, avant de le reprendre dans son recueil Between Past and Future : « What is authority »76. Sans entrer dans la lecture de cet essai, retenons un passage qui aidera à cerner la thèse d’Arendt. Tout en reconnaissant à la conscience historique moderne une origine religieuse chrétienne, Arendt identifie et décrit un processus de sécularisation, marqué au XVIIe siècle par la séparation de la pensée politique et de la théologie. Pour elle, distingués par ce processus, il y a clairement un monde d’avant et un monde d’après la croyance en l’au-delà. La perte d’un certain nombre de croyances religieuses a laissé, selon elle, un vide que le politique n’a pas comblé, sauf par la dérive d’une pensée totalitaire. C’est notamment cette conviction qui oppose Arendt à Eric Voegelin quand elle refuse de comparer le nazisme ou le stalinisme à des religions. Pour elle, « un chrétien ne peut pas devenir un partisan de Hitler ou de Staline »77. Comme si la religion chrétienne pouvait offrir un talisman contre la fascination politique. La perte de la religion a pour Arendt quelque chose d’irrémédiable ; toujours à Voegelin, elle répond : « Il n’y a pas de substitut de Dieu dans les idéologies totalitaires […]. Plus encore, la place métaphysique de Dieu est restée vide. »78 Platon le premier, rappelle Arendt, avait compris l’intérêt politique des croyances eschatologiques : mais c’est là un autre chapitre79.
28Complémentaire de la disparition de Dieu, la perte de la peur infernale constituerait donc l’événement capital marquant la fracture entre le monde ancien et le monde moderne : « Quoi qu’il en soit, le fait est que la conséquence la plus importante de la sécularisation de l’époque moderne est peut-être bien l’élimination de la vie publique, avec la religion, du seul élément politique de la religion traditionnelle, la peur de l’enfer. »80 Et aussitôt, elle ajoute pour signifier l’importance de cette perte : « Nous, à qui il fut donné de voir comment, durant l’ère de Hitler et de Staline, une espèce de crime entièrement nouvelle et sans précédent, qui ne rencontra presque aucune protestation dans les pays concernés, envahit le domaine de la politique, nous devrions être les derniers à sous-estimer son influence “persuasive” sur le fonctionnement de la conscience. »81
29La peur de l’enfer pour dissuader Hitler ou Staline de leurs folies ? Toute la démonstration d’Arendt tourne autour de cette exhortation centrale : s’interroger sur la « dimension persuasive » de la peur de l’enfer qui, si elle avait perduré dans l’Europe du XXe siècle, aurait pu inciter les criminels les plus fous à une prise de conscience. Le monde moderne aurait donc perdu en même temps que la peur de l’enfer cette forme de dissuasion que pouvait conférer une autorité transcendante : « Superficiellement parlant, la perte de la foi en des états futurs [paradis et enfer] est politiquement […] la distinction la plus importante entre la période présente et les siècles antérieurs. Et cette perte est définitive. Car si religieux que notre monde puisse se révéler à nouveau […], la crainte de l’enfer ne compte plus parmi les motifs susceptibles d’empêcher ou de déclencher les actions d’une majorité. »82
30Il serait facile de répliquer à Arendt que, tout au long du Moyen Âge et jusqu’aux temps modernes, les peintures et descriptions les plus spectaculaires de l’enfer n’ont empêché ni les guerres, ni la torture, ni l’inquisition, ni les persécutions, ni les pogroms, ni les massacres. Rien ne permet donc de prouver que la peur religieuse d’un enfer inventé aurait pu empêcher la fabrication réelle sur terre d’un enfer dépassant tout ce que l’imagination pouvait oser. Arendt voulait le croire au nom d’une nostalgie de valeurs perdues. Elle est pourtant parfaitement lucide quand elle pose que l’horreur ne peut servir une cause morale ou politique : « De même que l’horreur, ou l’insistance sur l’horreur, ne peut modifier un caractère, ni rendre les hommes meilleurs ou pires, de même l’horreur ne peut davantage devenir la base d’une communauté politique ou, en un sens plus restreint, d’un parti »83. Ni l’horreur de l’enfer, ni celle de la Shoah, ni celle d’un désastre atomique, ni même la conscience que l’homme détruit la terre qui le fait vivre, ne peuvent prévenir du pire et freiner l’humanité dans sa folie. Arendt a voulu croire à l’autorité d’une peur eschatologique, mais c’est une illusion et elle sait que « cette perte est définitive ». De façon plus inquiétante, elle nous invite à interroger la nature de « ces masses » de populations, modernes ou passées, incapables « de vivre sans peur et sans espoir, […] attirées par toute entreprise qui semble promettre la fabrication par l’homme du Paradis qu’elles avaient désiré et de l’Enfer qu’elles avaient redouté ». Depuis Platon, la question se pose de savoir pourquoi l’homme a besoin de penser ou d’inventer des enfers fantasmés ; de savoir si l’enfer fantasmé, faute d’avoir conservé son efficacité dissuasive, n’a pas servi de modèle à la fabrication d’enfers terrestres. Arendt, peut-être malgré elle, finit par suggérer la question. Mais à la suivre, on identifie aussi cette logique que Gorgô, chassée d’un territoire, s’installe dans l’autre. Gorgô que Marx retrouve quand il se demande qui gère l’économie et l’exploitation de l’homme par l’homme84.