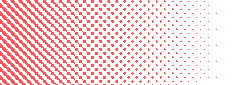Styles du crime, vision du mal
Pour Éric Bordas
1La légitimité du genre du roman policier ou du roman noir n’est heureusement plus à démontrer. Jacques Dubois a contribué à en faire une des inventions majeures de la modernité littéraire, l’une des seules aux côtés du poème en prose1. Et Benoît Tadié a, lui aussi, assuré au roman noir la dignité de son registre comme expression par excellence de la promesse démocratique américaine2. Mais si, pour la poésie en prose, la question du style s’avère d’emblée prioritaire, il n’en est pas de même avec le policier. Dans le lent processus de reconnaissance du genre, réfléchir à ses propriétés stylistiques est un geste tardif qui implique d’assurer les qualités artistiques d’une forme, en appréciant des spécificités individuelles, quand c’est plutôt la définition même du genre qui a retenu les critiques. Il a donc fallu préalablement circonscrire les limites du policier, constituer son histoire, en envisageant la variété de ses réalisations, la spécificité de son personnel3 et des mondes créés. Accentuer ou différencier des variations stylistiques singulières, c’est participer à la reconnaissance de la richesse d’une forme globale, comme cela a pu être le cas du jazz tout au long du vingtième siècle, dans un travail de légitimation culturelle qui passe par différents acteurs : auteurs, amateurs spécialisés, relais éditoriaux, critiques, théoriciens.
2Mais la question insiste peut-être encore plus pour le policier, de ses origines à aujourd’hui : lit-on vraiment un roman policier ou noir pour son style ? Et si on le fait avec cette visée, c’est selon quels publics, à partir de quelle époque ? La littérature légitime ou highbrow se donne explicitement depuis la modernité comme « une manière absolue de voir les choses »4 selon la formule de Flaubert qui définit ainsi le style comme nécessité artistique, nécessité qui devient même chez Proust le seul mode de communication de la monade subjective. Le roman policier n’investit pas directement cette catégorie de légitimation, et cherche surtout dans les premières décennies de son existence à s’affermir comme genre à part entière.
3L’approche stylistique n’est donc pas le premier réflexe pour une littérature de genre. Ou alors c’est moins une stylistique d’auteur qu’une stylistique d’époque et de forme modélisante. On sait que, dans l’histoire de la discipline, ressurgit régulièrement le vieux débat de la priorité à établir entre style singulier et style historique déterminé par les conditions d’énonciation des différents discours. De nouveau, c’est l’histoire des variations du policier et du noir qui est mobilisée pour répondre à des questions qui portent plutôt sur l’extension des possibilités du genre. On pourra par exemple se demander à partir de quand le genre implique nécessairement la violence (selon quels degrés, avec quels modes de représentations réalistes), la sexualité (selon quels codes, avec quels types de relations sexuelles représentées dans un genre longtemps caractérisé par son machisme).
4Si la question du style n’est donc pas prioritaire pour le genre policier ou noir (puisqu’il n’est pas à ce stade nécessaire de les distinguer), c’est peut-être parce que le genre est à lui seul porteur d’une vision du monde qui conditionne ses registres, et que les ressources expressives propres ne viendraient alors que de manière secondaire. On pourrait même avancer que le dispositif de mise en intrigue prime sur l’expression subjective. C’est pourquoi on peut caractériser avant tout ce que j’appellerai ici le style de l’enquête, en remarquant que c’est lui qui constitue, de fait, le premier niveau stylistique de différenciation. On en déduira que c’est le genre de crime représenté et les moyens mobilisés pour le résoudre qui déterminent les choix d’expression.
5Définir le roman policier par l’élément criminel peut sembler une simple tautologie, mais cela permet de souligner plusieurs traits essentiels. Cette définition minimale par l’enquête criminelle fait de tout le genre une variation sur une « ténébreuse affaire » pour reprendre le titre de Balzac. Moderne, le roman policier l’est avant tout parce qu’il dépend de cette nécessaire opacité du monde qui appelle à un déchiffrement de ses signes. La réalité résiste à son interprétation dans un monde de mensonges et de faux-semblants. Un bon roman policier nous confronte d’abord à un chaos d’indices dont « Le Double assassinat de la Rue-Morgue » figure l’un des exemples les plus provocateurs. C’est ce chaos que le détective doit ordonner, c’est lui qui fonctionne comme un véritable défi herméneutique.
6Le policier repose donc sur ce que Carlo Ginzburg a magistralement identifié comme « paradigme indiciaire »5 avec sa triade constituée de Morelli, Holmes et Freud, tous les trois d’anciens médecins, habitués à la lecture des signes, à la séméiologie comme à la sémiologie. L’historien italien mélange avec humour deux personnages réels avec la figure de Sherlock Holmes. Le crime vient en premier, il a la primauté dans une intrigue qui est, on le sait, construite à rebours par le romancier : elle nous est donnée dans son inintelligibilité initiale pour que le roman nous amène à redisposer les éléments de manière enfin rationnelle. Je crois que, dès les débuts du roman policier, cette nécessité d’une intrigue complexe, dont une partie essentielle reste encore cachée intentionnellement, suppose de ne pas ajouter un autre degré d’opacification du texte. Cela implique une certaine transparence de l’écriture qui se met au service de la complexité plus ou moins sophistiquée de l’enquête et du crime. Le style doit pour ainsi dire s’effacer comme niveau de singularisation de l’expression, ou comme affichage de ses idiotismes.
7L’opacité du monde que révèle le policier se double d’une extension vertigineuse du soupçon qui est la raison d’être du genre. Tous les personnages peuvent être coupables : tel est le fondement de tout roman policier qui nous incite à balayer nos premières impressions favorables pour privilégier plus de perspicacité. Nous nous trouvons de fait en concurrence active avec l’enquêteur, essayant nous aussi, dans un jeu faussement symétrique, de démêler les indices probants de l’écume des détails.
8La primauté du crime et de l’enquête peut même conduire à distinguer les deux grandes périodes historiques du roman policier. Dans sa formule classique et première, le policier repose en effet sur l’énigme à résoudre. C’est ce que Boileau et Narcejac appellent justement le « roman-problème »6 qui domine toutes les années 1900-1930. Prédomine, alors, le style de l’enquêteur, ou même le style propre à l’enquêteur. Ce primat s’affaiblit dans le roman noir, et les deux rameaux du genre divergent quant à leur dénouement, dans la manière dont ils cherchent ou non à restaurer l’ordre social et herméneutique du monde.
9Parler de style du policier, c’est presque prendre au pied de la lettre la formule et créditer l’enquêteur lui-même, tel que l’écrivain l’invente, de toute la charge singularisante de sa manière. On sait comment les variations nationales du policier ont fonctionné sur cette spécialisation de l’enquête : enquêteur régulier (commissaire ou inspecteur) pour la France, mais aussi reporter comme Rouletabille, armchair detective de la tradition anglaise dans le sillage de Sherlock Holmes, et privé hardboiled du noir américain. Toutes les déclinaisons des conditions intellectuelles (où brillent pour longtemps Dupin et Hercule Poirot), professionnelles et institutionnelles (de l’amateur au spécialiste du crime) permettent de raffiner l’éventail des enquêteurs, et plus tard des enquêtrices. On voit aussi comment, dans les années 1980-90, commence à apparaître de nouvelles spécialités : le médecin légiste ou le profiler deviennent rapidement, avec leurs outils technologiques nouveaux, des clichés du genre.
10Cette primauté de l’enquête a une conséquence que je crois essentielle pour ce qui concerne la question d’une stylistique du récit policier. Elle établit en vérité une concurrence de fait, voire même une rivalité entre l’écrivain et son personnage délégué dans le roman. On pourrait dire qu’un bon auteur (qui est resté longtemps majoritairement un homme) de policier est d’abord un bon inventeur d’enquêteur, et donc d’un style d’enquête reconnaissable. Là encore des sous-catégories du genre apparaissent comme une conséquence directe de ces choix : meurtre en chambre close comme variante très intellectuelle de l’énigme conçue à la façon d’un puzzle, ou le récent sous-genre de la dark academia caractérisé par son cadre et son personnel spécifique d’étudiants de la Ivy League. La valorisation de l’enquêteur explique que, pour beaucoup de lecteurs et de lectrices, le nom du détective est souvent plus célèbre ou plus vendeur que celui de l’auteur. On connaît la légendaire rivalité entre Conan Doyle et Sherlock Holmes, et l’échec de sa tentative pour s’en débarrasser. Holmes a acquis un tel prestige qu’on visite même son fictif appartement du 221 Baker Street. De la même manière, on parle d’un Maigret, plutôt qu’on ne met en avant le nom de Simenon. Cette signature de l’enquêteur explique pourquoi le genre policier s’ouvre spontanément à la sérialité puisque, une fois trouvé les caractéristiques originales du personnage, on peut varier les milieux, les décors et les types de coupables à loisir. C’est sa méthode qui est la marque de distinction du livre, sinon dans le cas de Maigret, sa non-méthode qui s’apparente justement à un style : s’imprégner lentement des atmosphères pour élucider l’opacité des apparences trompeuses.
11Cette sérialité concerne d’abord une série d’enquêtes livresques (du Juge Ti, de Maigret, de Holmes, d’Adamsberg pour Fred Vargas, de Brunetti pour Dona Leone, etc.), mais elle peut facilement s’adapter à d’autres médias et passer au cinéma, à la télévision, aux séries sur les plateformes. Cette transposition est facilitée par la possibilité de copier le style propre à l’enquêteur, de reproduire les excentricités du personnage. L’adaptation peut sous-estimer les traits qui relèveraient plutôt d’une écriture au sens plein de terme.
12Le style de l’enquête, tout amateur de policier le sait, n’est pas réduit au seul enquêteur, mais à la constellation qui l’accompagne et le conditionne, selon le modèle inusable du couple Watson-Holmes. Le commissaire Montalbano (dont le nom est un hommage à Montalban, l’écrivain catalan) n’est pas dissociable de l’ensemble du personnel de son commissariat, et de leurs drolatiques manières de parler. Il y a bien un effet métonymique du nom de l’enquêteur que Jacques Dubois souligne aussi quand il remarque : « Et lorsque nous disons ‘un Maigret’, nous désignons par là plus qu’un personnage, tout un univers fictionnel et tout un mode narratif » (Dubois, 1992, p. 71)7. Étudiant, sur dix-sept romans de Simenon, les entorses par rapport au genre classique, Dubois met en avant la qualité d’« analyseur social » de Maigret, observateur attentif de la lutte des classes, du franchissement transgressif des intangibles barrières entre les groupes sociaux.
13Il existe donc, j’y insiste, une concurrence qu’on pourrait dire structurale entre l’écrivain et l’enquêteur. Elle porte d’abord sur l’élucidation même du crime, fictivement accomplie dans le livre, imaginée par le romancier. C’est elle qui domine l’histoire du policier en Europe en déterminant sa ligne classique, toujours en vigueur. Le basculement principal qu’opère une certaine tendance du roman noir me paraît être de changer la nature de cette concurrence en la déplaçant de l’enquêteur vers le criminel, qui devient le nouveau maître de l’intrigue. Cette inflexion peut expliquer pourquoi la forme longtemps resserrée du récit policier adopte depuis trente ans les formats plus dilués du thriller, où c’est justement la course contre la montre des héros contre les manœuvres diaboliques du méchant qui rythme le déroulement de l’action.
14Il faudrait donc considérer, pour le policier contemporain, une véritable stylistique du crime qui repose, cette fois, sur les talents hors-normes du génie du mal. La vogue des serial killers a promu cette figure maléfique, notamment avec Hannibal Lecter, passé rapidement au cinéma, où il impose un sous-genre qu’illustre aussi le film de David Fincher Seven. On conçoit le risque de confusion morale qu’entraîne fatalement le développement de cette fascination pour le criminel à l’intelligence sans limites8.
15Dans le modèle classique du policier, la fonction d’analyseur social que souligne Jacques Dubois pour Maigret permet de caractériser un style qui déborde même celui de l’enquête proprement dit pour concerner une certaine façon d’être au monde du personnage principal. La fonction éminemment réaliste du roman policier s’y incarne dans ce qu’on pourrait appeler des géographies sociales9 qui forment plus que le simple cadre de l’action, puisqu’elles deviennent parfois le centre d’intérêt de la lecture. À ce moment-là, on peut sans doute facilement reconnaître un style qui est partagé entre l’auteur et son enquêteur. Je crois que c’est l’explication du succès des livres de Fred Vargas, dont les intrigues parfois relâchées comptent moins que le plaisir de retrouver le commissaire Adamsberg et sa fine équipe composée de Danglard, Tetancourt ou Veyrenc. Adamsberg, on le sait, rêve les solutions des crimes dans des moments d’absence où il se laisse envahir par la brume particulière de son esprit, brume dont émergera la figure exacte d’une intrigue alambiquée à souhait.
16Cette fonction d’analyseur peut aussi bien se dégrader dans une certaine spécialisation géographique du roman noir ou policier, telle qu’on peut l’observer depuis près de trente ans. L’enquêteur devient avant tout l’habitant d’une région dont il se fait le représentant plus ou moins exemplaire : Juan Vasquez Montalban a lancé le mouvement avec Pepe Carvalho arpentant Barcelone. C’est à lui aussi qu’on doit la sorte de spécialisation culinaire du roman policier récent, où chaque enquêteur rivalise de recettes de petits plats typiquement locaux. Andrea Camilleri a repris la formule avec son Montalbano et ses petits restaurants authentiques, comme Donna Leon pour Venise avec Brunelli.
17Chaque région compte maintenant son genre policier local10, avec enquête sur le terrain que les touristes de passage pourront lire comme un guide touristique décalé et plus animé…. On sait le succès du roman policier breton par exemple, et passant fréquemment mes vacances sur la côte basco-landaise, je rêve donc d’écrire à mon tour un Ça va saigner à Seignosse où je livrerai les secrets des chipirons, de la piperade, en plus de quelques dissertations sur les joies du surf.
18Au-delà du régionalisme, une véritable spécialisation mondialisée s’est mise en place qui détermine des invariants spécifiques aux aires géographiques concernées. C’est pourquoi on parle aujourd’hui du polar scandinave, sous-genre caractérisé par sa mélancolie profonde, des atmosphères neigeuses, et ses plongées dans le passé trouble de pays nordiques faussement tranquilles. L’un de ses maîtres est certainement Henning Mankell, créateur du commissaire Wallander.
19On voit donc, une fois encore, la priorité donnée à des éléments communs qui définissent un style de sous-genre rapidement marqué. Le renforcement de ces traits contribue à effacer le marquage stylistique qui serait propre à un auteur dont on privilégierait la langue personnelle11. Quand un écrivain s’essaye aux deux formules, celle du genre highbrow, en même temps qu’il pratique le genre policier, il est particulièrement intéressant de voir comment les traits stylistiques s’estompent ou non, comment ils sont mis en avant par le roman. Et l’exemple de Jean Meckert, alias Jean Amila, qu’étudie Marc Vervel12, s’impose comme un cas d’école particulièrement intéressant. On peut déjà noter que le choix d’un pseudonyme joue dans le sens de cet effacement de la singularité expressive, en se pliant d’emblée aux codes majeurs de réception qui formate le genre noir. Le style individuel est comme secondarisé derrière la maîtrise des lois de composition qu’impose la machine éditoriale du policier.
20Boileau et Narcejac témoignent avec acuité de la conscience de cet écart entre les contraintes du genre et la recherche d’une expressivité, la visée d’un véritable style, où le roman policier accèderait enfin à une dignité littéraire complète. Car la forme du récit policier peut même déboucher sur un ensemble de règles où il se sclérose en gimmicks. C’est bien ce à quoi entraînent les fameuses règles de Van Dine, qui a essayé de codifier entièrement les lois de ce qui finit par ressembler à un pur jeu intellectuel13. Si Pierre Boileau et Thomas Narcejac se sentent si concernés par cette antinomie entre intrigue et style, c’est aussi parce que leur mode singulier de production reproduit ce conflit latent pour tout récit policier : Boileau produisait ce que les Anglo-Saxons appellent le plot, le scénario du livre, puis Narcejac le mettait en écriture, sans se contenter de le rédiger, mais en accentuant ce qui revient à la subjectivité tourmentée de leurs héros et héroïnes. Tout l’effort du tandem a justement consisté dans les années 1950 à sortir le roman policier de l’impasse du « roman-problème » en lui donnant une complexité psychologique nouvelle, une atmosphère d’angoisse qui tient au point de vue limité et anxieux des personnages. Pour cela, ils mettent au centre de leurs récits la conscience d’une victime14, en déplaçant essentiellement le centre de gravité du policier : ce n’est plus la recherche du coupable qui compte le plus, mais la façon dont le personnage est pris dans le piège d’une machination dont il est à la fois l’acteur et la cible.
21Il s’agit pour eux de répudier l’idée d’un simple jeu intellectuel et de ramener au premier plan l’angoisse dont ils font le moteur essentiel du roman policier dans leur essai de 1964. Ils le font avec une conscience historique très forte du moment où ils écrivent, au sortir de la guerre mondiale qui impose de comprendre que le monde a terriblement changé. Ils notent avec force : « Le temps des bourreaux rendait ses chances au roman noir. Il lui apportait ce qui lui avait toujours manqué : la haine » (Boileau-Narcejac, 1964, p. 152). C’est en termes d’atmosphère affective que les deux auteurs théoriciens du genre caractérisent la nouvelle manière du policier moderne. Mais elle ne peut, à elle seule, régler le conflit latent entre ce que la critique anglaise désigne comme le dilemme du plot et du character, selon que c’est l’intrigue qui détermine la tenue du texte, ou le choix du point de vue du personnage.
22Si la résolution ambiguë que proposent Boileau et Narcejac ne rétablit pas une incontestable aura littéraire au genre, c’est parce que l’habileté du scénario est encore ce qui le distingue. Le succès des adaptations de leurs livres au cinéma, des Diaboliques à Vertigo, est la preuve de l’exportabilité heureuse de l’intrigue, qui assure au roman policier et noir sa formidable puissance de transfictionnalisation. Il reste possible de conserver la rouerie de la machination, aussi bien que ce que j’ai appelé plus haut le style de l’enquêteur (style brouillon et empêché pour celui de Vertigo, paralysé par ses phobies).
23Les potentialités du roman policier ou noir résident donc peut-être moins dans une stylistique particulière que dans la vision que le genre porte de façon intrinsèque. J’en reviens donc à l’opposition que je faisais d’abord entre la « manière absolue de voir les choses » définissant le style à partir de Flaubert, et ce qu’on pourrait appeler la vision que porte le genre comme tel, vision que chaque roman doit respecter pour être fidèle à son esprit essentiel. Le genre policier repose fondamentalement sur le conflit entre la loi et le mal, conflit qu’il articule à sa manière propre. En ce sens, il s’agira moins de définir une stylistique qu’une sorte de morale de la forme du récit policier ou noir, en tant que roman du crime par excellence.
24Je propose donc de caractériser le genre par sa puissance expressive même, et de considérer que sa nouveauté renouvelée réside dans la vision du mal moderne qu’il ne cesse de nous proposer. Non pas du mal pour lui-même dans sa violence barbare ou gratuite, mais dans son rapport problématique à la loi, telle qu’il s’incarne dans la version classique du policier, ou telle qu’il se pervertit dans l’accentuation proprement noire du genre. C’est à mes yeux le contenu véritablement philosophique du roman policier noir15, celui qu’il décline dans l’immense variétés de ses figures. Certaines œuvres explicitent ce contenu radical et atteignent, ce faisant, à la pleine réalisation de leur forme. C’est notamment le cas, je crois, des romans de Henning Mankell. On le voit avec la méditation de Wallander dans Les Morts de la Saint-Jean, sorte de thriller très sombre où le commissaire doit prendre de vitesse un tueur imprévisible. Décontenancé par la violence apparemment gratuite de crimes qu’il n’arrive pas relier, le commissaire est envahi par un questionnement métaphysique :
Wallander contemplait fixement la pénombre. J’ai peur, pensa-t-il. Je n’ai jamais cru à l’existence du mal. Il n’y a pas de gens mauvais, de brutalité inscrite dans les gênes. En revanche, il y a des circonstances mauvaises. Le mal n’existe pas. Mais cet acte-ci semble renvoyer à quelque chose d’autre – comment décrire cela ? Un cerveau enténébré. (Mankell, 2001, p. 196)
25Le criminel devient un révélateur d’un moment de bascule tragique de la société suédoise, quand l’égalité sociale longtemps maintenue s’effrite en laissant dans ses marges haineuses des laissés-pour-compte qui regardent avec ressentiment le bonheur des autres. Car curieusement dans ce thriller nordique, le motif réel du criminel tient dans son envie inassouvissable devant la vie heureuse de ceux et celles qu’il assassine. Le roman poursuit donc son questionnement aporétique sur la nature du mal et Wallander y revient dans la fin du livre :
Oui, dit Wallander. C’est ça la vraie question : dans quel monde vivons-nous ? Mais la réponse est trop insoutenable, on n’a pas la force de la penser jusqu’au bout. Ce que nous redoutons est peut-être déjà là : l’étape suivante si on peut s’exprimer ainsi. Après l’effondrement de l’État de droit. Une société où de plus en plus de gens se sentent inutiles, voire rejetés. Dans ces conditions, nous pouvons nous attendre à une violence entièrement dénuée de logique. La violence comme aspect naturel du quotidien. (Mankell, 2001, p. 507-8).
26Les Morts de la Saint-Jean se tient en équilibre instable entre le roman policier puisque le commissaire réussit à arrêter le criminel et qu’il restaure donc un semblant d’ordre, et le roman noir en relayant un message de désespoir social.
27Lier le roman noir à la question du mal, c’est aussi l’approche de Jean-Patrick Manchette qui y réfléchit ainsi dans son Journal le dimanche 15 septembre 197416. Là encore il s’agit plutôt d’identifier la nature du genre par son contenu, contenu qui dictera ensuite les choix formels. Manchette réfléchit le stylo à la main et note :
On pourrait peut-être définir, ou du moins déterminer le roman policer comme une branche de la littérature consacrée au Mal – je ne veux pas dire une branche consacrée au Mal, je veux dire une branche de ce qui, dans la littérature, est consacrée au Mal (Manchette, 2005, p.213).
28De cette définition, découle un parallèle possible avec la tragédie ou le western, trois genres où « la mort seule peut arrêter le mouvement des personnages ». La comparaison permet de saisir ce qu’il faudrait presque appeler l’essence du genre. Manchette ajoute, en effet, avec la lourdeur voulue du raisonnement qu’on se tient à soi-même :
Ce qui est spécifique au roman policier, à l’intérieur de la littérature consacrée au Mal, c’est que le Mal se présente, dans le roman policier, très généralement et assez médiocrement sous la forme d’un délit juridique, d’une infraction aux lois existantes (Manchette, 2005, p. 213).
29Cette spécification est capitale et recoupe ce que j’ai appelé le style du crime car le Mal (pour l’écrire aussi avec la majuscule) n’a aucune grandeur de type romantique ou transgressif, selon le modèle de Méphistophélès. Il est un « délit » qui réclame enquête, résolution et arrestation. Le criminel peut être n’importe qui. Manchette en déduit « deux façons de considérer les choses, qui déterminent deux genres à l’intérieur du roman policier. La première voie est de ne pas remettre en cause la loi et de traiter le délit comme un désordre passager, « qu’il faut réparer ». C’est l’aspect si l’on veut conservateur du roman policier classique qui voit la restauration finale de l’ordre. Restauration que le « rétablisseur d’ordre » doit cependant payer de sa souffrance ou du risque de la folie, comme Holmes consommant de l’opium en proie à sa fondamentale neurasthénie.
30La deuxième voie, on s’en doute, est celle du roman noir (mais que Manchette ne distingue pas du groupe plus général du roman policier auquel il continue d’appartenir). J’en cite le long extrait suivant :
L’autre façon de prendre les choses, c’est de ne pas considérer comme bonnes les conditions d’application de la loi. On est amené alors à relativiser ma loi, à l’historiciser, à faire en quelque sorte une philosophie du Droit, et à noter que la loi est l’expression d’un rapport de forces sociales, dans une situation historique donnée. Et donc, l’on va décrire, à travers le roman policier – qui est ici un roman noir – on va décrire socialement et historiquement la loi et l’ordre qui ont cours au moment du délit, et l’on va souligner les grandes différences qu’il y a entre l’existence pratique des citoyens – serviteurs ou adversaires de l’ordre – et la juridiction. On montrera par exemple que les serviteurs de l’ordre sont pourris ; et/ou que les délinquants ont des raisons d’être délinquants. D’une manière générale, la loi va être définie comme « une couverture trop petite sur un lit à deux places où l’on dort à trois » (Penn Warren).
31Comme toujours chez Manchette, la rigueur théorique ne va pas sans humour. L’inventeur du néo-polar met donc la barre très haut, et dégage un peu à la Lukács, l’essence du roman policier, terrain où je veux le suivre et lui donner raison. C’est bien dans l’articulation du délit et de la loi que se situe l’originalité renouvelée et inépuisable du genre. Ce point de vue particulier constitue sa vision (sombre) du monde et supplée la question du style comme « manière de voir les choses ».
32Pour Manchette, il ne découle aucunement de ces axiomes que le roman noir devrait être du bon côté, de bonne gauche, et on sait le mépris qu’il a pu avoir pour certains de ses descendants. C’est la radicalité de ce point de vue qui doit même servir de critère pour juger la littérature policière dans ce qu’elle implique ou non de renoncement à son essence. La fin du passage est éloquente à cet égard :
Je laisse de côté, dans cet exposé, ce que j’appellerai le roman nihiliste-réactionnaire qui, considérant que tout est permis (ce qui est une bonne présupposition), propose une simple mystique de la force, et voit avec mépris le Mal et la dépravation des individus, et, au lieu de se situer par rapport à la loi, suppose le problème résolu, place ses héros au-dessus de toute morale, et les montre persécutant les faibles (les femmes qui sont toutes des salopes, les gens, qui sont tous achetables, poltrons ou vicieux). Ici, nous avons simplement affaire à une littérature du mépris – c’est-à-dire à une littérature de mépris du lecteur, et l’on donne à celui-ci des scènes sadiques et des scènes pornographiques pour qu’il jouisse par procuration. Et on cache au lecteur la question de la légitimité du Droit (Manchette, 2005, p. 215).
33On me pardonnera d’avoir longuement cité cet « exposé » en tous points remarquables, et dont la portée n’a, hélas, rien perdu de son actualité. En hissant le genre policier à une véritable perspective sur le Droit, envisagé dans sa confrontation au délit, Manchette ne dit pas que le style n’importe pas17, mais qu’il dépend d’abord d’une morale, d’un rapport authentique au lecteur qu’on ne prend pas par ses bas instincts. Il en découle une admirable leçon de critique, de stylistique de la lecture pourrait-on dire, où il en va du respect que le genre policier se doit à lui-même, et doit à l’intelligence de sa singularité. C’est, après lui, ce que j’ai voulu rappeler.