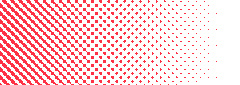Repenser le temps des œuvres, ou l’hypothèse d’un régime littéraire de transhistoricité
Lecteurs, critiques et professeurs face au « scandale de la survie »
Personne a‑t‑il jamais lu la Vie de Rancé comme elle fut écrite, du moins explicitement, c’est‑à‑dire comme une œuvre de pénitence et d’édification ? Que peut dire aujourd’hui à un homme incroyant, dressé par son siècle à ne pas céder au prestige des « phrases », cette vie d’un trappiste du temps de Louis xiv écrite par un romantique ? Cependant nous pouvons aimer ce livre, il peut donner la sensation du chef‑d’œuvre, ou mieux encore (car c’est là une notion trop contemplative) d’un livre brûlant, où certains d’entre nous peuvent retrouver quelques‑uns de leurs problèmes, c’est‑à‑dire de leurs limites. Comment l’œuvre pieuse d’un vieillard rhéteur, écrite sur la commande insistante d’un confesseur, surgie de ce romantisme français avec lequel notre modernité se sent peu d’affinité, comment cette œuvre peut‑elle nous concerner, nous étonner, nous combler ? Cette sorte de distorsion posée par le temps entre l’écriture et la lecture est le défi même de ce que nous appelons littérature : l’œuvre lue est anachronique et cet anachronisme est la question capitale qu’elle pose au critique : on arrive peu à peu à expliquer une œuvre par son temps ou par son projet, c’est‑à‑dire à justifier le scandale de son apparition ; mais comment réduire celui de sa survie ? À quoi donc la Vie de Rancé peut‑elle nous convertir, nous qui avons lu Marx, Nietzsche, Freud, Sartre, Genet ou Blanchot1 ?
1Parmi tous les défis et questions que la littérature lance à la critique, Barthes a plusieurs fois évoqué ce « scandale » qu’est la « survie » des œuvres à travers les siècles. Mais la « sensation du chef‑d’œuvre » et la question de sa durée appartenaient si évidemment au lexique des « anciens critiques », à leur éloge du classicisme national, qu’il lui fallait inventer une autre langue pour dire, dans la modernité, la dualité de la littérature. Il n’était pas question, pour Barthes mythologue, de réitérer sans le soupçonner le poncif pontifiant de l’éternité des Classiques, ni d’ajouter sa voix au concert de leurs thuriféraires sans interroger son propre « plaisir » — pas question, donc, de « naturaliser » le canon scolaire, de passer sous silence les déterminations à l’œuvre dans l’histoire, ou de placer ces textes et leur(s) valeur(s) sur un piédestal hors des atteintes du temps, comme miraculeusement libérés des appartenances sociales, des intérêts économiques et politiques, qui conditionnent leur production et leur première réception, autant que leurs appropriations successives. Héritiers, bon an mal an, de cet antihumanisme de la modernité, nous non plus ne pouvons adhérer à l’idée d’un passé panthéonisé, qui resterait à jamais « pertinent2 » sous prétexte d’illustrer des qualités esthétiques et/ou des préoccupations morales valables de tout temps, en tous lieux. Mais comment dès lors penser « les deux corps » du littéraire ? Comment prendre en charge son étude comme fait historique sans ignorer ses effets anachroniques ?
2La « question capitale que [l’œuvre] pose au critique » prend une acuité plus vive encore lorsqu’on la formule du point de vue de l’enseignant. Car celui‑ci fait souvent l’épreuve de cette « distorsion posée par le temps entre l’écriture et la lecture », non seulement dans la sélection et l’élaboration des savoirs à transmettre, mais aussi, avant toute chose, par le geste même de faire lire, par l’adresse renouvelée du texte qu’implique la consigne de lecture. Comme Barthes le réclamait, le professeur de français ou l’enseignant‑chercheur en littérature se doit d’aborder ce qu’il fait lire comme un objet à historiciser3, un objet de connaissance qui se trouve séparé du présent par le regard historien et dont « l’apparition » peut être justifiée en raisons, le « scandale » réduit en une chaîne de causalités — et ce, quels que soient l’échelle ou le support envisagés (corpus, œuvre, texte, genre, forme, trope, lexie, livre, journal, performance, etc.). Mais comme Barthes lisant Chateaubriand, le professeur est aussi tenté d’affirmer, avec tout autant de force, que la littérature est littérature parce qu’elle a la capacité de « nous concerner, nous étonner, nous combler », à contretemps et à contresens — et ce, quelles que soient les difficultés posées par ce nous. Cette distorsion‑là est telle, qu’on a quelquefois l’impression d’une dangereuse schizophrénie, ou du moins d’une inconfortable sujétion à des injonctions contradictoires dans le jeu des appropriations multiples — quand, dans une salle de classe, le partage collectif d’un texte se trouve empêché par le refus d’un anachronisme et l’identification d’un contresens ; quand, au contraire, la contextualisation se révèle indispensable face à des actualisations indésirables4…
3Mais suivons encore un moment la leçon barthésienne. Controverse oblige, la nature même du « scandale » s’énonce plus fermement qu’ailleurs dans son essai Sur Racine, puis dans sa suite polémique Critique et vérité. L’avant‑propos et la troisième partie du premier recueil, intitulée sans ambages « Histoire ou littérature », sont sans doute les lieux les plus connus où se formule la dualité des études littéraires comme de leur objet. D’un côté, la promotion d’un programme pensé sur le modèle des Annales : l’œuvre de Racine, parfaite illustration de l’impératif moderne d’une démythification de la littérature, doit être considérée comme le « signe d’une histoire5 ».De l’autre, la reconnaissance d’un sentiment, dont l’apparente universalité pourrait bien sûr être discutée : « tout le monde sent bien que l’œuvre échappe », elle est « autre chose que son histoire même », elle est « résistance à cette histoire »6. Certes, Racine traverse les siècles car il est « ce qui s’enseigne, un point c’est tout7 », mais ce « point » final ne l’est guère et la position relativiste, même chez un « Moderne » comme Barthes, est ébranlée par ce « scandale de la survie ». Le Classique, le texte qui traverse les siècles, est autre chose ; la littérature, telle que l’incarnerait Racine (mais aussi Chateaubriand, et bien d’autres encore évidemment), serait aussi l’œuvre et la trace d’« un art inégalé de la disponibilité », qui expliquerait son « être trans‑historique »8.
4Le mot apparaît dans l’avant‑propos du Sur Racine, mais il se trouve comme décliné par Barthes, au fil de ses textes critiques, par une série de métaphores plus ou moins topiques. En effet, dès qu’il commente les auteurs dits « classiques » (la plupart du temps sur commande), ce scandale de la survie éclate, évoqué et expliqué à grand renfort d’images : c’est le « fleuve plus durable que le marbre9» ; c’est aussi la « flèche qu’à travers les siècles ils m’ont décochée10 » ; c’est encore la « ligne de crête », les « sommets », laissés « debout » par le « délabrement » de l’œuvre11 ; c’est enfin, en termes plus conceptuels mais toujours habités par l’image, le « punctum (ce qui me point12) »… La métaphore apparaît sous la plume de Barthes comme une ressource nécessaire pour désigner cette capacité des textes à traverser les siècles, pour dire cette autre chose qu’est la littérature (la littérarité ?), apte à survivre au passage du temps ou plutôt à être transmis dans le temps comme tend à le souligner la graphie du terme choisie par Barthes — « trans‑historique ». Mais pouvons‑nous dire cette historicité spécifique de la littérature, son « art de la disponibilité », autrement que par la métaphore ? Si l’on veut expliquer « le scandale de la survie », n’est‑on pas tenu de rendre intelligible ce quelque chose — ce je‑ne‑sais‑quoi, auraient dit les hommes du xviie siècle —, autant que le mouvement de traversée lui‑même ? Ne serait‑ce pas la tâche du littéraire par opposition à celle de l’historien, que d’expliquer les effets de liaisons produits par les textes littéraires entre des contextes supposés hétérogènes ?
5De fait, certaines œuvres traversent mieux les siècles que d’autres13 ; de fait, le récit que tout commentaire critique ébauche ou parachève se construit à partir de questions, si ce n’est de valeurs, en partie anachroniques. Mais la contestation des lectures historiennes et/ou anhistoriques d’antan, comme leur renouvellement, ne nous décharge pas de la question du temps : il faut tenter de dire, positivement, le « régime de (trans‑)historicité14 » que présupposent ou construisent nos manières de lire et de faire lire — déclarer le rapport au passé et à l’avenir qui se trouve ainsi promu. Les efforts que nous faisons, nous « littéraires », pour un partage actuel des textes du passé (ou pour un partage futur des textes du présent), impliquent une forme d’engagement sur ces questions‑là, engagement motivé par des considérations pédagogiques, épistémiques, éthico‑politiques. Comment, dans nos travaux, articulons‑nous passé, présent et avenir de la littérature et de ses effets ? Comment pensons‑nous le temps de la littérature et à quelles fins ? Que reste‑t‑il aujourd’hui de l’antagonisme barthésien entre histoire et littérature, et plus précisément de cet appel à penser la « distorsion » fondamentale qui caractériserait l’être « (trans‑)historique » de la littérature ?
6Tel était le point de départ de ce numéro, né de la fréquentation de Barthes et de ma réflexion sur la catégorie de « classicisme15 », autant que de mes activités au sein du mouvement Transitions fondé par Hélène Merlin‑Kajman16 et rassemblé, notamment, autour de ce « scandale de la survie ». Certaines œuvres traversent les siècles. Comment l’expliquez‑vous ? C’était en effet la « question capitale » de Barthes, mais naïvement formulée, que nous adressions à tous les usagers de la littérature dans le questionnaire qui avait inauguré le site du mouvement en septembre 201117. C’était aussi, plus indirectement, le défi qu’avait lancé Hélène Merlin‑Kajman aux historiens et littéraires réunis lors d’une série de tables rondes sur Théophile de Viau, dès 2010, dans la préhistoire de Transitions18. L’expérience de ces journées de discussion avec le GRIHL auxquelles Brice Tabeling et moi avions participé, l’intersection des questions soulevées alors avec nos propres objets de recherche ont été séminales dans notre réflexion19, comme a été déterminant, dans mon parcours personnel, le croisement de ces problématiques avec le programme de la revue Fabula‑LhT, l’Atelier de théorie littéraire de Fabula ou les intentions du séminaire « Anachronies » organisé à l’ENS entre 2011 et 2014, relancé en 2015‑201620. Il fallait repenser l’histoire littéraire car il apparaissait impossible de « défendre la littérature sans défendre la spécificité de son être historique21 » ; il fallait repenser l’histoire littéraire car plus de cinquante ans après l’affaire Picard, le temps lui‑même — le temps des œuvres — n’était plus ce qu’il avait été…
Histoire ou littérature : le temps serait-il encore ce qu’il était ?
7Et pourtant, le « paradoxe fondamental » évoqué par Barthes paraît s’être figé en un éternel malentendu, en un véritable dialogue de sourds. Historique et anachronique, inscrite dans l’histoire et vouée à lui échapper : la contradiction intenable de la littérature et des discours qui l’accompagnent, continue de former les termes d’un différend, et sans doute d’une différence utile, entre deux disciplines, l’histoire et les études littéraires22. Mais où en sommes‑nous aujourd’hui de ce débat entre « histoire » et « critique » à l’intérieur même de la discipline littéraire ? La familiarité de ces questions, l’écho que les paradoxes et les partitions de Barthes rencontrent encore en nous, n’empêche pas de repérer quelques écarts de taille entre ce moment polémique et notre présent. Historicisons, donc, tant l’air du temps a changé : de l’eau (et beaucoup d’encre) a coulé sous les ponts depuis la querelle de la Nouvelle Critique, ou même depuis ces tables rondes sur Théophile !
8À vrai dire, des interrogations et suggestions anachroniques de Roland Barthes — « pourquoi parler de Racine aujourd’hui ? », comment « parler à neuf de Racine23 ? » —, la puissance polémique s’est peu à peu émoussée : la nécessité d’une « actualisation » des Classiques paraît dessiner un nouveau consensus dans l’enseignement de la littérature, du moins quand on exerce au collège ou au lycée24. Plus fondamentalement, le régime du contretemps pour penser l’historicité particulière de la littérature paraît s’être largement imposé dans la théorie : témoins les efforts variés menés dans les dernières décennies pour faire sortir l’histoire littéraire de ses gonds, la « désituer » ou la resituer en contestant la panoplie des manuels et l’assignation des œuvres aux périodisations héritées25; témoins aussi les nombreux ouvrages collectifs, numéros de revue et autres ateliers conçus pour penser l’histoire de l’histoire littéraire ou analyser les différentes manières que l’on a eues d’en temporaliser les objets26; témoins, enfin, toutes les réflexions visant à promouvoir une forme d’a(na)chronie dans la transmission des textes, irréductible aux vieux rêves d’intemporalité et d’universalité de la littérature27. Le site Fabula.org, comme le rappellent nombre des contributeurs de ce numéro, s’est souvent fait l’écho de ces travaux, diversement inspirés par une certaine philosophie de l’histoire ou par les historiens eux‑mêmes, et plus particulièrement par des historiens de l’art28. On en connaît les repères essentiels : la défense de l’« anachronisme contrôlé29 » en histoire et la promotion des lectures « anachroniques » ou « actualisantes » dans l’interprétation des textes littéraires30 ; l’attention accordée par la critique littéraire à des textes déjà anciens de Walter Benjamin, ou à des pensées du temps plus contemporaines comme celles de Paul Ricœur, Hans Blumenberg et Reinhart Koselleck ; la redécouverte des travaux d’Aby Warburg sous l’impulsion de Giorgio Agamben et Georges Didi‑Huberman, l’écho que ses propres réflexions sur l’histoire de l’art ont eu dans les études littéraires31 ; la réédition en 2008 de l’essai de Judith Schlanger sur La Mémoire des œuvres, etc. Même mis en récit, le « temps des œuvres » échapperait toujours à la linéarité et à la téléologie de l’Histoire hégélienne, l’étude de la littérature devrait donc en finir avec le positivisme déterministe et l’idéal de la « consonance euchronique ». Selon les mots de Georges Didi‑Uberman que je reprends ou paraphrase ici, chaque œuvre (re)compose le temps, chaque lecture en révèle le « montage anachronique » et participe, à son tour, au montage mémoriel et au temps différentiel de la réception, stratifié en diachronie comme en synchronie ; chacune des catégories d’analyse que nous employons reposerait elle‑même sur un « choix de temps », « un acte de temporalisation » dont le contretemps ne serait pas forcément contresens32.
9Toutefois, parallèlement à ce vaste ensemble théorique, bien moins homogène qu’une telle présentation, trop sommaire, ne pourrait le laisser croire33, continue de s’opérer « un entêtant retour, présumé, à l’histoire34 », au nom duquel, contre les théories de la clôture du texte, contre les « critiques internes » héritières du formalisme ou du structuralisme, on promeut face au fait littéraire le recours (plus ou moins exclusif) à des modes d’explication socio‑historiques. Évoquant plus particulièrement le corpus critique produit sur les siècles anciens, sur cette « littérature » d’avant la Littérature, Hélène Merlin‑Kajman soulignait naguère à quel point « depuis [l]es réflexions [de Barthes], le commentaire n’a cessé de s’ouvrir à l’histoire, peut‑être même de reculer devant elle35 », jusqu’à faire disparaître du champ universitaire la dualité évoquée dans Sur Racine, jusqu’à « dissoudre » peut‑être la littérature elle‑même comme « discipline36 ». Or, dans cette perspective socio‑historique, justifier le « scandale de la survie », c’est toujours le réduire : la « survie » de l’œuvre, ses différentes appropriations au fil du temps, ne seraient jamais que le résultat d’appartenances sociales et institutionnelles, d’intérêts économiques et politiques ; l’idée même de littérature et l’hypothèse de sa transhistoricité sont des faits historiques, que les littéraires devraient apprendre à traiter comme tels et (re)connaître comme des marques de leur propre quête de légitimité. Dans cette perspective encore, la spécificité des textes dits « littéraires », leur « autonomie » ou la possibilité qu’ils engagent un mode d’être au temps spécifique, « trans‑historique », peut bien faire l’objet d’une croyance, mais certainement pas d’une connaissance37 — encore moins, par conséquent, d’une discipline scientifique… À la partition de Barthes se superposerait donc aujourd’hui, ou se substituerait, une nouvelle scission dans les études littéraires. D’un côté, les spécialistes des siècles postérieurs à la Révolution tendent à considérer le temps des œuvres en rompant avec le régime d’historicité moderne (linéaire, téléologique, déterministe) : ils privilégient un régime qu’on peut nommer « contemporain » ou « post‑moderne », volontairement anachronique car nécessairement désorienté. D’un autre côté, les spécialistes des siècles antérieurs à la Révolution tendent à considérer le temps des œuvres en se distanciant, certes, du régime d’historicité ancien (celui de l’Historia magistra vitae, celui des Belles‑Lettres et de leurs modèles à imiter, venus d’un passé prétendument exemplaire et porteur de leçons pour le présent ou l’avenir) ; toutefois, pour beaucoup, ils accréditent encore le régime d’historicité moderne, nécessairement anachronique car volontairement « séparatiste » et « progressiste », si je puis dire. Hélène Merlin‑Kajman l’a suggéré dans un article récent : les approches socio‑historiques qui, par exemple, réfutent comme anachroniques le mythe classique ou l’idée de « littérature » pour parler des textes du xviie siècle, le font en commettant à leur tour un anachronisme et en essentialisant le concept d’histoire, dont Reinhart Kosseleck et François Hartog, notamment, ont montré les variations38.
Le projet du numéro (i) : deux partis pris théoriques
10Ce numéro consacré à la « (trans‑)historicité de la littérature » n’entendait pas, pour sa part, refaire le match entre littérature et histoire : il ne s’agissait ni de trancher ce différend épistémologique à l’intérieur d’une discipline éclatée, ni même de défendre la pertinence de tel ou tel « anachronisme contrôlé ». Nous proposions plutôt d’explorer, d’interroger et d’évaluer les différentes manières de considérer « l’être trans‑historique » de la littérature, ou plus précisément, les façons diverses dont les lecteurs et commentateurs articulent le tempo des textes à leur propre expérience du temps. Que les différents régimes d’historicité présupposés par l’objet « littérature » soient eux‑mêmes historiques39, que l’on puisse historiciser chacune des abstractions ou des figures par lesquelles le temps des œuvres a été modélisé (le Panthéon, le « progrès », la « tradition », la « mémoire », la « survivance », la « résonance », la « revenance », la « hantise », la « spirale », le « feuilletage », etc.) n’obère pas toute réflexion sur la productivité critique et éthique d’une conception transhistorique de la littérature. Au contraire, ce double constat de l’historicité de l’idée de littérature d’une part, et de l’historicité de la conscience historique d’autre part, peut être une invite à penser la décision individuelle ou collective sur laquelle repose tout partage d’un texte littéraire : qu’est‑ce qui motive cet acte de temporalisation foncièrement — mais diversement — transhistorique, qui consiste à lier ensemble, dans le commentaire critique et/ou sur la scène pédagogique, des êtres et des expériences passés, présents et futurs ?
11Le choix même du terme « transhistoricité », les parenthèses prudentes dont nous avions entouré le préfixe, aussi bien que sa mise en évidence, malgré tout, par la reprise du trait d’union utilisé par Barthes, affichaient un certain nombre de partis‑pris. Cette introduction a pour vocation d’en éclairer les raisons ; la postface de Brice Tabeling viendra encore les étayer en entamant un premier dialogue avec les textes réunis40. L’argument accompagnant notre appel à contribution soulignait quelques‑uns de nos présupposés, sur lesquels je reviendrai, mais laissait dans l’ombre deux décisions théoriques qui méritent d’être explicitées : d’une part, le choix d’un terme, « transhistoricité », contre d’autres notions appartenant à l’air du temps et dotées d’un destin critique plus flamboyant (l’« anachronie », l’« (in)actualité » ou le « (non‑)contemporain » par exemple) ; d’autre part, l’usage, a contrario, d’une tournure très à la mode (trop à la mode, diront certains…) : l’expression « régimes d’historicité » empruntée à l’historien François Hartog.
12L’hypothèse d’un « être trans‑historique » de la littérature paraît étroitement liée à une constellation de notions qui permettent toutes de qualifier le « temps des œuvres », mais dont on doit cependant distinguer les implications. Repartons une dernière fois de Barthes, de ses considérations sur Racine et Chateaubriand, et des qualificatifs qu’il employait dans sa défense d’une critique intéressée des Classiques : « anachronique »/« trans‑historique ». Dans un premier mouvement, la tentation est grande de faire des deux termes des parasynonymes. En effet, du commentaire de Racine à celui de Chateaubriand, de « l’être trans‑historique » de la littérature à « l’œuvre lue […] anachronique », les termes varient sous la plume de Barthes mais c’est d’abord leur mise en contraste avec les modèles d’explication historiens qui semble importer dans son style critique. Qualifier une œuvre littéraire d’« anachronique » ou la littérature de « transhistorique », c’est tout un, semble‑t‑il, dans ce conflit de méthodes41 : Barthes s’oppose ainsi à l’anhistoricité larvée des travaux de l’Ancienne critique, qui ne contextualisent que pour conclure à l’inanité du contexte et toujours réaffirmer l’exception du chef‑d’œuvre ; il peut dès lors mieux distinguer entre deux disciplines nécessaires : une histoire renouvelée de la littérature, dont le programme est largement inspiré par Lucien Febvre, et une Nouvelle Critique, assumant ses partis pris idéologiques — ce que Barthes nomme positivement son « dogmatisme ». Face au « scandale de la survie », l’essentiel pour les littéraires, par opposition aux historiens, résiderait donc dans la promotion de lectures « vivantes, concernées42 » des textes du passé : lectures anachroniques parce qu’elles n’hésiteraient pas à fonder leurs raisons sur ce qui nous concerne (encore, ou désormais) ; lectures transhistoriques parce qu’elles sauraient prendre acte du « vieillissement » des textes et de leur altérité, de la distance qui nous sépare d’eux, mais toujours dans la perspective de montrer et défendre leur valeur pour nous. Cette dialectique, importante, est déclinée par Barthes dans tous les textes qu’il écrit sur les Classiques43.
13Toutefois l’écart entre les deux qualificatifs, « anachronique » et « transhistorique », importe à plus d’un titre, afin de mesurer les ressources que chaque terme peut fournir pour penser le temps des œuvres et l’être (trans‑)historique de la littérature. Sur le plan lexical, et de manière assez sommaire, l’anachronisme implique une erreur contre la chronologie, y compris quand cette faute est volontaire — « essayons sur Racine […] tous les langages que notre siècle nous suggère44», réclame Barthes — ou quand cette méprise est nécessaire — « l’œuvre lue est [inévitablement] anachronique ». Dans ce dernier cas, le renvoi au substantif « anachronie » serait sans doute plus judicieux qu’une assimilation pure et simple de cet écart à un « anachronisme » : il s’agit, en effet, de désigner un état de décalage, une « distorsion » entre les temps, comme l’écrit Barthes, plutôt que le mouvement de pensée ou le geste critique qui consiste à appliquer un langage ou une théorie moderne à un texte ancien45. Toutefois l’une et l’autre acceptions du qualificatif impliquent une même rupture, un même bond dans l’ordre temporel ainsi malmené, un coup porté à la succession des temps que le préfixe ana‑ suffit à signaler mais dont la productivité critique a été largement réhabilitée ces dernières années46.
14Qu’en est‑il du terme « transhistorique », bien moins usité ? La « résistance à l’histoire » qu’évoque Barthes au sujet de la « transparence classique » et de sa déclinaison racinienne (« art inégalé de la disponibilité ») laisse pareillement entrevoir un mouvement contre l’histoire, un affranchissement de ses limites. Mais cet affranchissement ne consiste pas (ou pas uniquement) à « assurer le saut ou la connexion d’une ligne de temporalité à une autre47 », il implique un passage, une continuité, une permanence. Le terme « transhistorique » signale que la connexion anachronique se fait sur fond de transmission : quelque chose se transmet du passé au présent — « les sens passent, la question demeure48 », suggère Barthes. Surgit alors, et de manière plus attendue, une autre ambiguïté à lever : considérer « l’être trans‑historique » de la littérature, chercher à éclairer ce qui assure dans le texte littéraire cette capacité de connexion et transmission, équivaut‑il à vouloir sortir du temps ou de l’Histoire (comme le font plus ouvertement les termes « achronique » ou « anhistorique ») ? Qu’est‑ce que cette question qui « demeure », si ce n’est le retour masqué de quelques grands invariants ?
15La lecture de Barthes ne suffit pas complètement à lever ce soupçon, car éprouver dans le partage d’une œuvre littéraire son « être trans‑historique » — « répond[re] assertivement à la question de l’œuvre49 » — c’est toujours faire valoir, ce qui, à travers les temps, échappe à l’ordre historique, à sa discontinuité et plus particulièrement à la séparabilité du passé, comme à la discipline qui se voue à son étude. Mais on peut, avec Barthes et au‑delà même de ce qu’il en dit, défendre l’hypothèse selon laquelle la transhistoricité n’est pas réductible à un antonyme de l’historicité. À partir du constat barthésien et de la partition des disciplines qui s’ensuit, la notion peut en fait servir à requalifier l’historicité elle‑même : s’il y a du transhistorique, c’est dans l’histoire elle‑même — ou plus précisément : l’histoire elle‑même n’est pas que succession, elle est aussi transhistorique. Le phénomène de la réception littéraire, l’histoire des diverses appropriations dont un texte peut faire l’objet en témoignent. En effet, la façon dont le lecteur se rapporte à l’œuvre passée comporte toujours, mais dans des proportions variables, « de l’historique » (au sens « moderne » du terme : la conscience d’une discontinuité) et du transhistorique (la reconnaissance d’un commun, manière plus ou moins consciente d’articuler passé, présent et avenir). Manière plus ou moins consciente ou « assertive », manière plus ou moins pertinente également. Chez Barthes, l’« être trans‑historique » désigne un état, certes, mais semble aussi pouvoir comporter des degrés : « il faut d’une part que l’œuvre soit vraiment une forme, qu’elle désigne vraiment un sens tremblé ; et d’autre part (car notre responsabilité n’est pas moindre), il faut que le monde réponde assertivement à la question de l’œuvre, qu’il remplisse franchement, avec sa propre matière, le sens posé50 ». Si toutes les œuvres lues sont anachroniques du fait même de la position du lecteur, certaines d’entre elles, douées de cette qualité « transhistorique » que Barthes nomme « tremblement » ou « disponibilité », traversent les siècles mieux que d’autres. Plus disponibles, mais aussi — et c’est essentiel — reconnues dans leur disponibilité par le critique « responsable », ces œuvres littéraires sauraient altérer l’épaisseur des temps pour concerner le lecteur, pour le lier, lui et son présent, à d’autres temps, à d’autres êtres dans le passé et dans l’avenir. Ce contact‑là est anachronique assurément, mais pas achronique, car il fait percevoir au lecteur, ou au lecteur devenu passeur, commentateur, sa propre historicité… transhistorique ! Quoiqu’assertive, quoique faite de « sa propre matière », la réponse formulée face à l’œuvre est toujours, en effet, le fruit d’une historicité plurielle ou « feuilletée », faite de plusieurs passés, de plusieurs présents aussi, que le commentaire vient articuler, comme l’œuvre elle‑même et « sa question » jetaient des ponts entre les temps.
16N’est‑ce pas une telle expérience de lecture — et une telle expérience du temps — que relate précisément Barthes dans sa préface à la Vie de Rancé ? Ou plus encore, n’est‑ce pas ce type de « feuilletage » que nous pouvons expérimenter face au commentaire que le critique délivre, « nous qui avons lu Marx, Nietzsche, Freud, Sartre, Genet ou Blanchot », nous qui depuis notre siècle devons nous saisir de « cette vie d’un trappiste du temps de Louis XIV écrite par un romantique »… et préfacée par un « moderne » ? Le contact avec Chateaubriand se noue autour de la question du temps et de cette « situation existentielle d’abandonnement51 » qu’est la vieillesse : c’est ce qui, selon Barthes, peut encore « nous concerner, nous étonner, nous combler » à sa lecture. Mais trois articulations différentes sont ménagées dans son commentaire entre le texte de Chateaubriand, la conscience ou l’expérience du temps qu’il déploie, et la nôtre : la première, achronique, nous fait en réalité sortir du temps (c’est le lieu commun de la vanitas et son « attirail classique52 ») ; la deuxième, anachronique, fait se télescoper au moins trois moments dans la mémoire de Barthes lecteur (Rancé — Chateaubriand — Sartre) et suggère d’appliquer à La Vie de Rancé les catégories existentialistes de La Nausée (ennui et néant53) ; la troisième, proprement transhistorique, part de l’altérité radicale du passé, de ces deux passés composites que sont les xviie et xixe siècles de Chateaubriand, pour saisir ce que la littérature — la littérarité même d’un tel texte, qu’on n’étudie guère dans les classes — fait à cette histoire, comment elle « substitue […] à une vérité contingente une plausibilité éternelle54 ». En effet, si les deux premières articulations sont suggérées par Barthes, elles sont tour à tour amendées : le « thème sapiental » tel qu’il est développé par Chateaubriand, ce « long supplice » de la vieillesse doté d’une « consistance propre » et « nouveau par rapport au topos classique55», échappe au lieu commun et se trouve par là même rendu à son devenir historique (au « mal du siècle », pourrait‑on dire), autant que transhistorique56; la lecture anachronique, existentialiste, est pour sa part compliquée par la stratification des temporalités et par « l’immixtion de Chateaubriand dans la vie de Rancé ». Celle‑ci, explique Barthes, ne fonctionne pas, en effet, par « ressemblances », par la projection anachronique et « romantique » de sentiments, mais par « l’entrelacs […] des souvenirs57 » de Chateaubriand dans la vie de Rancé, par un « ressassement brisé, qui est le contraire d’une assimilation » et qui vient illustrer l’éloquent exergue extrait du texte par Barthes : « Je ne suis plus que le temps ». Anamnèse et anacoluthe, métaphore et antithèse : Barthes analyse les figures rhétoriques qui manifestent ce « ressassement brisé », ce « tremblement du temps » et transmettent quelque chose de ce double passé, de sa consistance phénoménologique comme des émotions de Rancé et Chateaubriand, dans notre présent. Il est par exemple question de l’irruption du mot « algue » dans la vie de Marcelle de Castellane, d’un « gant » dans celle de Rancé, de quelques « orangers » dans la vie de Retz58, anacoluthes qui illustrent toutes ce que la littérature peut faire sentir du passé, en transgressant la séparation des temps et des expériences. Barthes entraîne le lecteur dans le jeu des incongruités et des récurrences formelles qui caractérisent la prose de Chateaubriand, qui font « frissonner » le sens « sans l’arrêter59 », et déploie ainsi, dans son commentaire, la « puissance » transhistorique de ce « langage inutile60 » qu’est la littérature.
17De même, si Barthes avoue, à propos de Racine, qu’il « n’[a] pu [s’]y intéresser qu’en [s]e forçant à y injecter des problèmes personnels d’aliénation amoureuse61 », le montage des discours amoureux dans les Fragments, « morceaux d’origine diverse », révèle sans doute ce qui passe des tragédies raciniennes au lecteur‑scripteur qu’il est : les figures du sujet amoureux, ces « bouffées de langage » ou ces « bris de discours » qui « se découpent selon qu’on peut reconnaître, dans le discours qui passe, quelque chose qui a été lu, entendu, éprouvé ».
[…] le propre d’une Topique, c’est d’être un peu vide : une Topique est par statut à moitié codée, à moitié projective (ou projective parce que codée). Ce qu’on a pu dire de l’attente, de l’angoisse, du souvenir, n’est jamais qu’un supplément modeste, offert au lecteur pour qu’il s’en saisisse, y ajoute, en retranche et le passe à d’autres : autour de la figure, les joueurs y font courir le furet ; parfois, par une dernière parenthèse, on retient l’anneau une seconde encore avant de le transmettre. (Le livre idéalement, serait une coopérative : « Aux lecteurs — aux Amoureux — Réunis)62.
18Autour des figures de la tragédie racinienne, Barthes, bien avant les Fragments d’un discours amoureux,faisait courir le furet, le transmettait à son lecteur : hypotyposes qui, dans la « scène » érotique, font que le passé redevient présent ; antithèses, « vieille[s] comme le monde » ou « comme le langage63 », qui laissent croire à l’atemporalité du revirement, sans histoire ni durée, sans « épaisseur épique » ; images et métaphores de la langue classique, qu’on dote d’un « caractère réputé conventionnel » mais qui disent l’équivocité même du langage et des signes, les difficultés de la communication, jamais transparente, jamais simultanée64… Il y a bien dans cette « coopérative » une forme d’universalité mais celle‑ci ne se situe pas hors du temps, elle a à voir avec le langage lui‑même, avec ses équivoques et sa propre (trans‑)historicité. Les récurrences que Barthes, après Racine, fait reconnaître dans ces figures de discours et scènes de langage tendent non seulement à rappeler les affres du temps, les décalages et distorsions imposés au sujet (amoureux) dans « l’attente », l’« angoisse », le « souvenir », etc. — tous ces modes parfois douloureux d’être au temps, « cette manie poisseuse de souffrir », lit‑on encore dans son commentaire de Chateaubriand ; mais elles pointent aussi ce qui, dans la langue, dans ses usages littéraires topiques et/ou incongrus, dessine une communauté d’expériences et d’émotions à travers les temps.
19En plus d’illustrer ce qui rapproche et distingue a(na)chronie et transhistoricité, ces deux exemples suggèrent donc que le passage s’opérant du texte passé au présent du lecteur ou à son futur n’est pas forcément le fait d’un thème (les formes aussi peuvent lier entre elles des expériences), encore moins d’un retour à l’identique de ce thème ou de cette forme. Barthes parle ailleurs, et à plusieurs reprises, d’un mouvement de « spirale » pour désigner cette modalité transhistorique d’être au temps — de faire retour dans le temps, mais à une autre place :
[…] sur la spirale les choses reviennent, mais à un autre niveau ; il y a retour dans la différence, non ressassement dans l’identité (pour Vico, penseur audacieux, l’histoire du monde suivait une spirale). La spirale règle la dialectique de l’ancien et du nouveau ; grâce à elle, nous ne sommes pas contraints de penser : tout est dit, ou : rien n’a été dit, mais plutôt rien n’est premier et cependant tout est nouveau65.
20Contrairement aux postulats des lectures achroniques ou anhistoriques, la part du commun qu’on éprouve dans la lecture, face au texte d’un autre, passé, ne serait pas forcément à chercher du côté du même, identique et immuable. Barthes le dit avec force, par exemple, au sujet de La Bruyère66 ; il le dit aussi, plus largement, à propos de l’écriture classique elle‑même, en s’appuyant encore sur un exemple de Chateaubriand :
Notre attitude, notre décision : nous n’avons plus à concevoir l’écrire‑classique comme une forme qu’il faut défendre en tant que forme passée, légale, conforme, répressive, etc., mais au contraire comme une forme que le roulement et l’inversion de l’Histoire sont en train de rendre nouvelle […]. Autrement dit, nous devons concevoir aujourd’hui l’Écriture Classique comme déliée du Durable, dans lequel elle était embaumée. N’étant plus prise dans le Durable, elle devient Neuve ; ce qui est fragile est toujours nouveau ; il faut la travailler, cette Écriture Classique, afin de manifester le devenir qui est en elle. […] C’est encore une fois parce que l’écriture littéraire n’est plus durable qu’elle est allégée de son poids conservatif, et peut être pensée activement comme un devenir, quelque chose de léger, d’actif, d’enivrant, de frais : où est le Nouveau, l’Inédit ? Est‑ce dans telle phrase de mon journal de ce matin (l’Universel reportage) ou dans cette phrase écrite, cueillie parmi mille autres de Chateaubriand (à propos de l’Amérique) : « Tout était éclatant, radieux, doré, opulent, saturé de lumière67 ».
21Faire l’hypothèse, avec Barthes, de « l’être trans‑historique » de la littérature — et non simplement reconnaître le caractère anachronique de l’œuvre lue —, c’est donc affirmer qu’il y a bien, dans ce qui nous vient et point des textes passés, une sorte d’« universalité », mais celle‑ci, déliée du Durable, apparaît comme « faillée » et restituée à l’indétermination du devenir. C’est là ce qu’ont montré, à mon sens, les deux derniers livres d’Hélène Merlin‑Kajman à qui j’emprunte cette dernière métaphore68. Lire dans la gueule du loup et surtout L’Animal ensorcelé ont éclairé la nature de la transhistoricité de la littérature, bien plus systématiquement que ne permettent de le faire, sans doute, ces quelques morceaux choisis chez Barthes. La théorisation anthropologique de la transmission qu’elle y développe, et qui s’appuie autant sur la factualité du langage que sur celle de la culture, vise à comprendre la nécessité des permanences et le rôle de la littérature face aux menaces diverses de déliaison. L’essai qui ouvre ce numéro continue d’explorer ce qui fait selon elle la transhistoricité de la littérature ou, plus précisément, d’après ses propres mots dans L’Animal ensorcelé :
ce qui, à l’intersection des propriétés du texte lui‑même,du cerveau humain (logos, phonè, imagination...) et des dispositifs detransmission, concourt à rendre un texte précisément transmissible, c’est‑à‑direnon seulement apte à déployer des effets dans différents contextes, mais encorefait pour relier invisiblement ces contextes entre eux69.
22L’ambition théorique de notre dossier était moindre, mais c’étaient précisément ces « dispositifs de transmission », et leur « intersection » avec les « propriétés du texte lui‑même », que nous entendions interroger, en confrontant les métalangages littéraires à la pensée du temps qu’ils impliquent. On l’a vu avec les commentaires de Barthes sur Racine et Chateaubriand, le partage des textes peut se faire selon des régimes de (trans‑)historicité divergents et concurrents, qui ne s’excluent pas forcément : son approche des textes semblait tour à tour, ou tout ensemble, historisante, achronique ou anachronique, malgré l’hypothèse générale d’un « être trans‑historique » de la littérature et des « questions » que les œuvres portent. Mais l’objet « littérature » réclame‑t‑il, en vue de sa transmission, de choisir un mode de temporalisation plutôt qu’un autre ? Cette décision doit‑elle être prise en fonction du texte que l’on commente et demeurer, ainsi, éminemment singulative70 ? Ou peut‑elle faire l’objet d’une montée en généralité, afin de dégager un régime de transhistoricité propre au fonctionnement (ou au partage) littéraire des textes ?
23C’est cette dernière piste de réflexion qui motivait, dans notre argument, le recours à la catégorie métahistorique promue par François Hartog et forgée dans le sillage de plusieurs anthropologues, philosophes et historiens (Sahlins et Koselleck, mais aussi Lévi‑Strauss et Ricœur). Sans qu’il y ait à tracer ici la généalogie complète de la notion71, un rapide rappel des conditions de son émergence et des intentions qui en déterminent l’usage paraît nécessaire. Toutefois, je ne reviendrai sur ces éléments qu’à partir de nos propres motivations et des raisons qui peuvent pousser des littéraires à s’emparer de la notion72. Malgré les critiques dont, très vite, elle a fait l’objet chez les historiens73 — malgré les problèmes que son usage ne manque pas par ailleurs de soulever, dès qu’on importe la catégorie dans les études littéraires74 —, la notion forgée par François Hartog était pour nous le moyen efficace de rassembler une série de questions (voir infra). Recourir à cette notion, c’était surtout affirmer le désir qui animait notre appel, d’une intelligibilité plus grande de « l’être trans‑historique » de la littérature, au‑delà des possibles études de cas — au‑delà, aussi, des formulations métaphoriques que j’évoquais plus haut et qui parcourent encore mon propre texte : le feuilletage, la spirale, la faille…
24La notion nous intéressait de prime abord pour sa matrice anthropologique : différencier des régimes d’historicité revient d’emblée à défendre l’idée selon laquelle il existe des expériences du temps, à l’échelle individuelle ou collective, qui ne reposent ni sur la notion de processus ni sur la stricte séparation entre passé et présent — autrement dit : sur ces éléments déterminants pour l’élaboration de l’histoire comme discipline, et pour ceux qui s’emploient à étudier la « littérature » (son idée, ses œuvres, ses auteurs, ses supports, etc.) comme des faits historiques. Les régimes d’historicité que dégage François Hartog désignent en effet plusieurs articulations possibles entre le passé, le présent et le futur, lesquelles compliquent ces principes de séparabilité des temps, de succession ou de causalité reliant les événements. Selon ses propres mots, « un régime d’historicité n’est ainsi qu’une façon d’engrener passé, présent et futur ou de composer un mixte des trois catégories75 ».
25L’historicisation de l’histoire que son essai construit est désormais bien connue, elle s’appuie sur la thèse déjà défendue par Koselleck et résumée ainsi par François Dosse :
une mutation fondamentale […] s’effectue au cours du xviiie siècle avec l’avènement des temps modernes qui pensent leur horizon d’attente en rupture, dans une différence croissante avec le passé, la tradition et son espace d’expérience, alors que jusque‑là dans la société traditionnelle l’attente était envisagée comme une conservation de l’expérience accumulée76.
26En amont de ce régime d’historicité moderne, que François Hartog nomme « futurisme » car y prédomine le point de vue du futur : le régime « ancien », « passéiste », de l’histoire comprise comme maîtresse de vie, comme réservoir d’exemples reliant le passé au présent et à l’avenir (« le passé commande ») ; en aval : le régime qui caractériserait notre temps, le « présentisme », dans lequel le présent est « monstre », « omniprésent », face à la pesanteur du passé (mémoire et patrimoine) ou aux menaces de l’avenir.
27Si l’on peut interroger, dans le travail de François Hartog, cet effet de continuum entre des époques successives — effet qu’il a pourtant voulu éviter —, ainsi que les passages opérés du cas singulier (notamment à partir de Chateaubriand, encore lui…) à la généralité de tel ou tel rapport social au temps77, il apparaît tout à fait probant que l’intelligibilité des régimes d’historicité, leur visibilité et la fixation de leur traits définitoires dépendent de « moments de crise » ou de « figures d’entre‑deux », dans lesquels ce qu’on nomme « littérature » semble jouer un rôle essentiel. La querelle des Anciens et des Modernes, au tournant des xviie et xviiie siècles, a tout à voir, par exemple, avec le changement d’un régime d’historicité à un autre : la question du traitement des sources et des modèles, qui en est le cœur battant, éclaire le rôle particulier de la littérature dans cette problématique de la transmission culturelle, en même temps que la polémique rend apparents, par leur tension, par leur friction pourrait‑on dire, les différends régimes d’historicité qui peuvent venir justifier le partage des textes littéraires à travers les temps78. L’exemplarité de Chateaubriand dans la réflexion de François Hartog se comprend aussi comme la mise en évidence d’un conflit et de chevauchements entre plusieurs ordres du temps, « entre l’ancien et le nouveau régime d’historicité79». Il y a donc, chez François Hartog, une valeur heuristique attachée à cette notion‑outil80, qui nous a paru essentielle dans l’optique de ce numéro : les régimes d’historicité qu’il circonscrit valent sans doute davantage pour les discordances qu’ils révèlent81 que pour leur hypothétique portée référentielle. Parce que la catégorie de François Hartog a partie liée avec ces moments de crise ou ces figures d’entre deux, parce qu’elle permet aussi de « penser le temps en conjuguant les modes de subjectivation avec sa dimension impersonnelle82 », elle représente à notre sens un gain d’intelligibilité quand on fait l’hypothèse de plusieurs sortes de transhistoricités, quand on cherche à les distinguer en principes et en valeurs, et non pas simplement à opposer des méthodes critiques historicistes et anachroniques.
28Ainsi, il n’est pas certain que l’historiographie de la littérature, la manière dont une histoire littéraire ou un simple commentaire de texte temporalise son objet, dépendent du régime d’historicité apparu comme dominant à tel ou tel moment de l’histoire — ou du moins, comme le reconnaît lui‑même François Hartog, que cette relation soit « mécanique83 ». Mais on ne peut que constater le changement de paradigme qui nous pousse actuellement à fonder des histoires, ou des trans‑histoires de la littérature, détachées de la successivité et de la téléologie propres au régime moderne d’historicité, et plus aptes à rendre compte d’un rapport au temps désorienté ou « feuilleté » (celui du régime « anachronique » ou « contemporain », pas forcément présentiste…) — trans‑histoires qui doivent beaucoup aux analyses de l’historien Reinhart Koselleck sur l’enchevêtrement des durées dans l’expérience humaine du temps.
Chronologiquement, l’expérience scrute des pans entiers de temps, elle ne crée pas la moindre continuité au sens d’une présentation additive du passé. Elle est plutôt comparable au hublot d’une machine à laver, derrière lequel apparaît de temps à autre telle pièce bariolée du linge contenu dans la machine84.
29L’expérience comme hublot, le temps comme machine à laver… Autre métaphore, me direz‑vous, dont l’intelligibilité ne va pas de soi, mais dans laquelle je vois pour ma part une image possible de la puissance transhistorique du texte littéraire, faisant apparaître ici et là, « de temps à autre telle pièce bariolée », récurrente, aussi reconnaissable qu’incongrue.
Le projet du numéro (ii) : de quelle (trans-)historicité a-t-on besoin pour dire le fait/l’effet littéraire ?
30Le temps d’un numéro, et par le biais de cette catégorie empruntée à François Hartog, il s’agissait donc de faire tous ensemble un pas de côté par rapport aux controverses épistémologiques, et de suspendre (au moins provisoirement) les débats liés aux distinctions disciplinaires et aux désaccords méthodologiques85. Plutôt que d’opposer des régimes de preuve inconciliables, de défendre un style de démonstration contre un autre, ou de condamner telle ou telle manière de faire l’histoire du « fait littéraire », les contributeurs étaient invités à mettre au jour la pensée du temps que leurs propres discours et catégories d’analyse charriaient, et à explorer ainsi, en matière de (trans‑)historicité, les présupposés théoriques à l’œuvre dans la constitution de l’objet « littérature », dans les commentaires « littéraires » des textes et de leurs effets.
31Les questions que nous posions tenaient donc elles‑mêmes à un présupposé assumé, et largement tributaire des réflexions menées à Transitions : « l’hypothèse qui est la nôtre est la suivante : la littérature n’existe comme objet visé par un commentaire ou un savoir qu’à condition d’avoir d’abord existé comme pratique relationnelle, transitionnelle86. » Autrement dit, le texte littéraire est un objet de partage avant que d’être un objet de savoir ; donné à lire ou à commenter, il n’est pas un objet historique comme un autre, il est un objet toujours déjà transmis — un objet qui nous a, qui plus est, toujours déjà transmis ses interrogations. Reste à savoir si cette transhistoricité, commune à d’autres objets culturels, possède un régime qui serait propre aux textes littéraires ; si cette capacité à traverser les siècles est ménagée par le texte lui‑même ou par son commentaire, ou bien par le texte et le commentaire ensemble ; et surtout, si l’on peut (et si l’on doit) distinguer, dans le partage des textes, entre plusieurs régimes de transhistoricité possibles, afin de privilégier des manières plus désirables d’articuler notre présent au passé et au futur.
32Nous avions organisé la réflexion selon trois entrées, afin de considérer à la fois le(s) régime(s) d’historicité du discours critique et de ses catégories, le régime d’historicité de l’objet « littérature », et le rapport à établir entre le régime d’historicité du discours critique et celui de ses objets. L’appel proposait dès lors les questions suivantes :
33Le(s) régime(s) d’historicité du discours critique et de ses catégories : chaque discours critique présuppose un choix sur l’historicité de la littérature, et de là, la défense d’un type privilégié de partage. Ce choix et ses déterminations (pédagogiques, épistémiques, éthico‑politiques) peuvent‑ils être formulés ? Le discours critique littéraire présuppose‑t‑il un seul type d’historicité ou plusieurs ? Quelles sont les figures susceptibles d’en formuler l’éventuelle spécificité (récit ou contre‑récit, tableau, bibliothèque intérieure, plis ou feuilletages de la mémoire, etc.) ? Certaines notions théoriques impliquent de toute évidence un régime particulier de (trans‑)historicité (la figura d’Auerbach, les pathosformeln de Warburg, etc.). Mais qu’en est‑il de nos termes critiques les plus habituels, les plus scolaires ? Si des catégories comme le « classicisme » ou la « modernité » ont été remises en question pour les régimes d’historicité qu’elles favorisaient, d’autres outils (poétiques, génétiques, stylistiques, narratologiques), moins immédiatement soupçonnés, méritent peut‑être d’être considérés au prisme de la pensée du temps qu’ils véhiculent.
34Le régime d’historicité de l’objet « littérature » : indépendamment du régime d’historicité donné par le commentaire, l’objet « littérature » a‑t‑il un régime d’historicité propre, qui serait singulier par rapport à d’autres objets culturels ? Ce régime a‑t‑il pu varier selon les époques ou les genres ? (Autrement dit : quelle est l’historicité de l’historicité de la littérature ?) La littérature met‑elle en jeu un élément — affect, émotion, sentiment, trace, trauma, voix, valeur, etc. — qui déterminerait un régime spécifique de (trans‑)historicité ? Ou revient‑il au commentaire de le présupposer ?
35Rapport entre le régime d’historicité du discours critique et celui de ses objets : soient donc, d’une part, le régime d’historicité du commentaire et, d’autre part, celui de son objet. Comment formuler leur articulation : discordance ou relance ? Y a‑t‑il un enjeu (pédagogique, épistémique, éthico‑politique) à interrompre dans le commentaire le régime d’historicité de certains textes littéraires ? Ou, à l’inverse, à en préserver la singularité ? En quoi ce rapport littéraire entre les régimes d’historicité se distingue‑t‑il de celui qui relie le commentaire historien à son objet ?