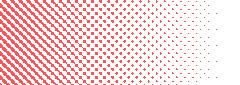L’éternel retour des paradigmes critiques
1En 1972, le médiéviste Paul Zumthor prévenait au début de son Essai de poétique médiévale que « ce livre a été écrit entre octobre 1969 et mars 1971. Du train dont nous allons, certaines parties en seront probablement démodées lorsqu’il paraîtra1. » Une telle attitude témoigne de la pente extrême d’une « nouvelle critique » alors en pleine santé, temps béni de la théorie littéraire, où les livres les plus abscons se vendaient comme des petits pains et où le rythme d’obsolescence des découvertes en sciences humaines avait quasiment rejoint celui des sciences dures. Nous en sommes loin aujourd’hui, mais les raisons de regretter cet état des choses peuvent être contrebalancées par quelques avantages dont la possibilité d’un regard réflexif apaisé sur nos pratiques herméneutiques n’est pas le moindre. L’emballement critique des années 1960-1970 a en effet masqué la fragilité de l’analogie conceptuelle — trop souvent affirmée pour ne pas être suspecte — entre les sciences humaines et les autres sciences ; et si le modèle paradigmatique de Kuhn peut, à l’instar de la succession foucaldienne des épistémès, se montrer opérationnel dans les unes comme dans les autres2, il s’en faut cependant de beaucoup que la force contraignante des paradigmes scientifiques s’impose au même degré dans les deux cas. La façon dont la thèse de l’autotélisme du texte littéraire, qui semblait avoir définitivement triomphé vers 1970, a depuis lors reflué illustre bien cette difficulté à s’entendre sur des positions acquises dans le domaine de la critique littéraire.
2De fait, depuis plusieurs décennies déjà, les synthèses sur l’histoire de la critique et sur la distinction des principales écoles théoriques se sont multipliées3, signe que l’analogie qui l’emporte aujourd’hui largement assimile bien davantage ces approches à des écoles philosophiques qu’à des paradigmes scientifiques. Descartes était persuadé d’être en progrès sur Aristote, Kant sur Leibniz, Marx sur Hegel ; avec le recul, nous en sommes moins persuadés aujourd’hui, et qu’Aristote, Leibniz ou Hegel aient encore quelque chose à nous dire est une évidence pour tout étudiant en philosophie.
3Il n’en reste pas moins que le réflexe de défiance envers le potentiellement obsolète dont témoignait l’avertissement de Zumthor reste encore bien vivant dans les cercles dédiés à l’analyse de la littérature ; d’une part, parce que (comme dans les cercles philosophiques, et en particulier chez ces nouveaux scolastiques que sont les philosophes analytiques) la tentation évolutionniste n’est pas morte ; d’autre part, et peut-être à plus juste raison, parce que le discours critique est par essence un discours second dont les tenants battent régulièrement leur coulpe en rappelant que la lecture des textes « littéraires » reste l’objet premier de la jouissance livresque et qu’il est par conséquent dommageable à notre appréhension de la littérature de s’encombrer de toute la critique accumulée par les siècles, les plus récentes études étant largement suffisantes4.
4De fait, un jeune chercheur qui se montrerait trop ostensiblement attiré par l’histoire de la critique a toutes les chances, aujourd’hui encore, de se voir paternellement conseillé par ses maîtres de s’intéresser davantage à la « vraie littérature » s’il veut trouver à s’insérer dans le monde académique. On pourrait évidemment invoquer, pour remettre en cause ce partage des discours, le dogme barthésien du primat de l’écriture sur la volonté qui y présiderait, mais n’est-ce pas le même Roland Barthes qui prétendait tracer une frontière entre les écrivains et les écrivants5? Certes ces deux catégories ne recouvrent pas celles des auteurs et de leurs exégètes, loin s’en faut, mais le fait est que le chercheur qui travaille sur un poète oublié continue de susciter plus de bienveillance, dans le monde de l’enseignement universitaire, que celui qui s’est spécialisé dans l’étude des grands maîtres de la théorie littéraire.
Entre constantes de l’esprit humain et histoires particulières
5Il n’est donc pas vain de réaffirmer ici que l’histoire de nos disciplines scientifiques est aujourd’hui plus nécessaire que jamais, car elle seule peut garantir à l’activité herméneutique une légitimité que deux millénaires au moins d’intenses polémiques ont menacé de faire sombrer dans une gratuité dommageable à sa crédibilité. Et cette histoire est d’autant plus urgente à entreprendre qu’on ne peut pas se contenter de la retracer de manière linéaire. La généalogie de certains problèmes est si reculée que le lecteur non prévenu peut légitimement s’étonner de découvrir l’ancienneté de certaines réponses données à certaines questions parfois aussi vieilles que la littérature. Le regard historien a donc pour tâche première de replacer dans leur contexte ces questions et ces réponses — étude de réception s’il en est — en déjouant à la fois les analogies trompeuses et les tentations téléologiques qu’elles suggèrent. Autrement dit, il ne s’agit ni de dire que l’on n’invente jamais rien ni d’affirmer que rien n’est jamais comparable à rien. Les analogies ne sont pas toujours complètement fallacieuses, mais il reste certain que toute répétition est ontologiquement différente de ses antécédents.
6On reste étonné de voir à quel point les virulentes attaques de Nietzsche contre une méthode historique et un esprit philologique qu’il connaissait mieux que quiconque6 sont restées lettre morte dans un milieu universitaire que l’on ne peut par ailleurs pas taxer d’anti-nietzschéisme, comme en témoigne la masse imposante de travaux académiques consacrés à l’auteur du Zarathoustra. Mais, quoique bien connus et régulièrement cités, ses pamphlets contre l’historicisme de la science allemande de la fin du xixe siècle semblent passer aux pertes et profits des mouvements d’humeur d’un philosophe qui n’est peut-être pas mort fou pour rien. À vrai dire, ce que Nietzsche dénonce est moins la méthode historique en soi que l’idéologie qui la sous-tend et les conséquences désastreuses auxquelles elle mène lorsqu’elle empêche ceux qui la pratiquent de réfléchir sur le monde dans lequel ils vivent. Plus exactement, c’est l’incommunicabilité instituée entre présent et passé qui paraît contre nature à Nietzsche. Or, plutôt que de réformer le positivisme à la lumière de ses Considérations intempestives, les historiens du xxe siècle ont trop souvent aggravé ce divorce en proclamant l’impossibilité radicale de comprendre le passé depuis notre point de vue de modernes. La pente de l’« histoire des mentalités », postulant l’étanchéité des « mentalités » successives, a ainsi été de jeter le soupçon sur toutes les tentatives empathiques de comprendre le passé, comme si les différences de conception du monde empêchaient radicalement, dans la lignée de l’hypothèse de Sapir-Whorf7, toute communication. Les mentalités ne sauraient pourtant être des entités monolithiques ; une société vivante voit toujours coexister en son sein des façons de penser plus ou moins contradictoires qu’il n’est pas toujours impossible de subsumer sous des catégories plus générales, lesquelles ne sont pas forcément l’apanage d’une époque en particulier8. Sous couvert de respecter le passé « tel qu’il était », on en a en fait barré l’accès en le déclarant « tout autre » ; du même coup, — dans un geste qui n’est paradoxal qu’en apparence et qui recouvre précisément les accusations de Nietzsche contre ses collègues philologues — on en a fait un refuge, son altérité garantissant, si l’on s’y abandonne, la certitude de ne pas se commettre avec le présent.
7La critique nietzschéenne implique donc moins le rejet de la méthode historique qu’un usage renouvelé, on est tenté de dire « écologique », de ses principes : il faut décloisonner le passé pour l’ouvrir sur nos attentes les plus vitales. Dans cette perspective, on comprend mieux le sens qu’il me semble urgent de donner à l’histoire de la critique : non un tableau des écoles de pensée révolues, mais une mise en perspective sur la longue durée des tendances qui se sont succédé et dont la fécondité n’est aujourd’hui encore pas totalement tarie. Éviter le double écueil de l’analogie trompeuse et de l’embaumement muséal revient ainsi à articuler deux pans que l’on ne songe pas toujours à mettre en rapport de la pensée de Nietzsche : son combat contre l’historicisme et sa conception de l’éternel retour du même comme impossibilité du retour de l’identique9. L’histoire de la critique se construit ainsi en spirale comme retour périodique des mêmes problèmes auxquels sont données des solutions comparables quoique jamais exactement superposables, en vertu de l’accent mis, d’une époque à l’autre, sur des déterminations ou simplement des phraséologies différentes. Déceler le semblable sous des oripeaux divers ou le divergent derrière des formulations parentes détermine ainsi deux gestes symétriques également indispensables à la reconstitution et à la comparaison des paradigmes critiques. Chemin faisant, on écarte les rapprochements indus, tout en en provoquant d’autres, moins attendus, et qui peuvent, dans le meilleur des cas, renouveler en profondeur, la compréhension de nos objets d’études. On peut du même coup réévaluer les prétendues révolutions, les coups de force ou les effets de manche d’exégètes parfois moins scrupuleux qu’on ne l’aurait cru, mais aussi remettre en lumière des devanciers ignorés, rendre justice à d’humbles artisans dont la contribution s’avère, aux yeux des développements qu’ils ont permis, plus substantielle qu’ils ne l’ont parfois eux-mêmes pressenti. De ce point de vue, l’histoire de la critique ne diffère pas fondamentalement de l’histoire des sciences dont elle n’est, à bien des égards, que l’une des branches, à cette différence près que son objet restera toujours plus fuyant, moins palpable et plus évanescent — quoique non moins exaltant pour l’esprit — que celui des sciences dites dures.
La querelle de l’épopée
8J’illustrerai ici mon propos en proposant quelques remarques autour d’une polémique littéraire qui est sans doute celle dont l’histoire est la plus longue, puisqu’elle trouve son origine dans l’œuvre de l’auteur (si du moins il est permis de le désigner de ce terme) qui inaugure la littérature occidentale — je veux dire Homère. Il s’agit de la question de l’épopée. On me reprochera sans doute la banalité de mon choix, mais c’est précisément cette banalité qui en fait le prix, car dès l’Antiquité les deux positions autour desquelles allait, pendant deux millénaires, se polariser le débat avaient été clairement énoncées : les uns soutenaient qu’Homère avait composé d’une traite l’Iliade et l’Odyssée en en soignant la cohérence et en en pesant bien tous les détails ; les autres démembraient le corpus homérique en postulant une genèse longue et chaotique des deux poèmes. C’était poser d’emblée les deux principes antithétiques de l’individualisme et du traditionalisme qui se sont affrontés jusqu’au xxe siècle. Mais en fait, sont-ils vraiment antithétiques ? L’examen détaillé des positions nous montrerait rapidement que les choses ne sont pas si simples, car des solutions de compromis sont vite venues s’immiscer dans le débat, ménageant la possible intervention d’aèdes géniaux, sans pour autant nier le caractère hétérogène de la tradition textuelle. Le passage d’une vision embrassant d’un seul coup d’œil la dichotomie fondamentale structurant le débat, à l’examen minutieux des nuances individuelles des positions ne va pas sans évoquer le principe du cercle herméneutique : le mouvement de généralisation permet d’échapper à l’illusion de l’incommensurabilité des paradigmes, mais le retour aux contextes particuliers de chaque reprise de l’une des positions de base relativise à son tour la tentation d’avoir saisi un invariant de l’esprit humain.
9On pourrait aussi invoquer le principe exégétique de la lecture typologique : toutes les incarnations successives des points de vue individualiste ou traditionaliste pourraient représenter autant de figures d’une même attitude de base, à cette nuance près que ces figures sont toujours décalées les unes des autres par des polarisations et des tendances spécifiques qui en désignent la singularité.
10À des rapprochements épistémologiques relativement simples s’opposent aussi de loin en loin des variantes plus difficiles à classer. Ainsi, pour en rester à la question homérique, l’individualisme défendu par Madame Dacier traduisant Homère en prose au lendemain de la Querelle des Anciens et des Modernes, entre en résonance évidente avec l’exaltation classique des « grands auteurs », tandis que le dépeçage des poèmes homériques préconisé par Wolf à la fin du même xviiie siècle s’explique aisément dans le cadre du romantisme naissant qui va massivement privilégier la poésie primitive et populaire au détriment de la littérature trop « artiste » des modernes. En revanche, si l’on relève que l’attitude traditionaliste dominait plutôt chez les grammairiens d’Alexandrie, le fait semble moins immédiatement explicable contextuellement, la période alexandrine étant généralement considérée comme une période favorable aux figures d’auteurs. Une telle constatation dénonce ainsi l’insuffisance des explications unilatérales et nous met sur la piste d’un point commun peut-être non immédiatement entrevu entre l’époque de Wolf et celle des Ptolémées : ce qui les relie est l’importance donnée dans les deux cas à la philologie10. Malgré de grandes différences de contexte, ces époques se rejoignent en ce qu’elles prétendent toutes deux découvrir ou redécouvrir l’analyse minutieuse des documents, qui caractérise l’attitude philologique, attitude qui pousse naturellement à la critique et au scepticisme, par hantise de ne pas être dupe de l’apparence trop lisse des supports de l’écriture. Ainsi la conjonction du romantisme et du renouveau philologique n’est-elle sans doute pas due au hasard, mais elle demande à son tour à être interrogée, car à la fin du xixe siècle l’exaltation romantique retombée ne s’accompagnera nullement d’un relâchement de l’acribie philologique, laquelle en se radicalisant sera même brandie comme arme contre le désordre de la Weltanschauung romantique, reniant donc ce qui en avait favorisé l’émergence.
11Par ailleurs, la piste philologique nous remet en mémoire l’opposition farouche que manifestèrent à son égard les cartésiens, maîtres du champ philosophique français à la fin du xviie et au début du xviiie siècle, période des traductions d’Homère par Madame Dacier11 et de l’apogée du classicisme. À la fin du xixe siècle, le critique Ferdinand Brunetière continuera d’ailleurs d’entretenir contre les philologues et le scientisme triomphant une méfiance qu’il serait naïf de croire dénuée de lien avec ses positions farouchement classicistes et cartésiennes12.
Le cas de la chanson de geste
12Mais encore une fois, mon intention n’est pas ici de brasser la totalité des positions qui se sont affrontées dans la querelle de l’épopée, et je me focaliserai maintenant sur l’une de ses actualisations, à mon sens les plus emblématiques : celle qui anime depuis deux siècles le débat sur les origines de la chanson de geste. Un historique de la question en a été proposé en 1913 par Joseph Bédier dans ses Légendes épiques, mais on se gardera de le suivre aveuglément, car on sait qu’il faut lire les mises en perspectives et les périodiques « états de la question » dressés par ceux qui se targuent de proposer sur des sujets prétendument épuisés des solutions nouvelles non comme des exemples d’historiographie objective, mais comme des éléments constitutifs de l’argumentation qu’ils construisent, et qu’il convient d’historiciser elle-même de toute nécessité.
13Tout au long de son œuvre critique, Bédier s’est montré un infatigable constructeur de mythes épistémologiques13, et nous allons voir que son historique de la question épique ne peut être dissocié de l’autre « grand récit » (au sens que Jean-François Lyotard donne à ce terme14) qu’il a proposé, celui des méthodes de l’édition critique.
14Pour Bédier, l’historique des théories sur la chanson de geste se résume au triomphe progressif dans le champ francophone d’une idée d’origine allemande, due à Wolf et aux frères Grimm15, et qu’on peut rattacher à l’invention d’Ossian par Macpherson, idée voulant que la poésie des premiers temps naisse spontanément et organiquement dans le peuple (c’est la notion de Naturpoesie), et qu’elle s’épanouisse peu à peu en « cantilènes » jusqu’à donner les chefs-d’œuvre épiques que nous connaissons. Bédier précise néanmoins « qu’avant Fauriel [le passeur français, dans ses cours de 1830-1836, de la théorie allemande] ce sont de tout autres opinions qui s’expriment en France sur la matière16. » On devine d’emblée que ces « tout autres opinions » ont la faveur de Bédier, qui tire du Discours sur l’état des lettres en France au xiie siècle de Daunou (1824) une citation significative, proposant de « rattacher les romans du xiiie siècle, et plus généralement du moyen âge, aux usages et aux intérêts de ce temps17. » Accordant comme toujours à son maître Gaston Paris une place d’honneur (qui est en même temps généralement une place piégée18), Bédier crédite l’auteur de l’Histoire poétique de Charlemagne (1865) d’avoir renouvelé « cette doctrine, pour une grande part héritée19 » en la rapportant à un effort d’histoire littéraire rigoureux, que Bédier commente d’une manière qui rejoint ce que je disais plus haut de l’aversion manifestée par la philologie rationaliste pour le romantisme : « Cela revient à dire que la théorie des cantilènes créée par des mystiques, propagée par des romantiques, est maintenant venue aux mains d’un grand réaliste, mais par là même, puisqu’il la rationalise, à son insu il l’affaiblit20. » Cette flèche du Parthe est caractéristique de l’attitude de Bédier envers son ancien maître à qui il reproche en fait, ici, de ne pas être allé au bout de ses idées, c’est-à-dire de ne pas s’être rendu compte que la théorie des cantilènes était incompatible avec les faits observables.
15Nouveau rebondissement en 1884 : l’Italien Pio Rajna propose carrément de considérer les chansons de geste comme étant d’origine germanique et en en reculant l’invention jusqu’à l’époque des premiers envahisseurs francs21. Bédier commente : « les chansons de geste du xiie siècle seraient l’aboutissement de l’épopée mérovingienne, héritière elle-même de l’épopée franque22. » Gaston Paris résistera à cette thèse, en opposant une fin de non-recevoir à l’idée qu’il puisse exister une « tradition historique orale », et en affirmant fortement que « l’histoire n’existe que par l’écriture23 », certitude pré-derridienne (si l’on ose dire) que l’auteur des Légendes épiques lui-même allait faire sienne.
16En fin de compte, Bédier résume l’état de la question après 1884 à trois positions tenues par les trois plus grands médiévistes de l’époque : Rajna considérait que le genre des chansons de geste était déjà parfaitement constitué dès avant l’époque de Charlemagne ; Gaston Paris pensait que de primitifs « chants lyrico-épiques » avaient commencé par fleurir au lendemain des événements dont ils s’inspiraient, mais n’étaient devenus des chansons de geste qu’à partir du xe siècle ; Paul Meyer soutenait que seule la tradition orale avait travaillé jusqu’à l’écriture, au xe ou au xie siècle, des premières chansons de geste24.
17Bédier proposa donc à son tour une nouvelle théorie niant à la fois les « chants lyrico-épiques » et la force de la tradition orale : les chansons de geste étaient nées au xie siècle des souvenirs historiques conservés dans les chartes des monastères et s’étaient développées le long des routes de pèlerinage. C’était en fait assez exactement revenir, en lui donnant un contenu, à l’idée de Daunou selon laquelle la littérature médiévale devait être étudiée en référence « aux usages et aux intérêts de ce temps ». La théorie de Bédier s’effrita cependant assez vite face à l’évidence que les chansons de geste avaient conservé des éléments historiques négligés par les chartes et que, parallèlement, elles ne faisaient parfois aucun usage d’éléments monastiques qui auraient été, si l’on ose dire, du pain béni pour leurs auteurs. La tradition orale ayant été remise à l’honneur avec fracas par Jean Rychner dans son ouvrage sur La chanson de geste, significativement sous-titré Essai sur l’art épique des jongleurs (1955)25, ainsi que par Ramon Menendez Pidal dans sa Chanson de Roland y el neotradicionalismo (1959)26, le paradigme individualiste imposé par Bédier céda dès lors la place à ce que l’on a appelé, à la suite du second de ces érudits, le néo-traditionalisme. En 1970, Pierre le Gentil proposa une solution de compromis consistant à dire qu’une « mutation brusque » avait affecté le genre épique au xie siècle lui donnant alors la physionomie que les manuscrits nous ont conservée27. Depuis cette époque, les fronts ont peu évolué, l’influence du structuralisme et de la nouvelle critique ayant déplacé l’épicentre des études épiques de la question des origines vers celle de la critique interne des textes. Mais ce déplacement n’était-il pas déjà inscrit en puissance dans le coup de force bédiériste ?
18De fait, dégager de toutes ces données une axiologie claire n’est pas chose aisée. Pour Bédier, les choses s’articulent nettement en trois époques, non sans analogies avec les hypostases d’une triade hégélienne : au début du xixe siècle, les érudits français tiennent pour une étude synchronique de la littérature médiévale, qu’ils ne peuvent cependant mener que de manière vague et intuitive. C’est la thèse. Puis interviennent les Allemands qui insufflent aux Français le démon diachronique de l’historicité. C’est l’antithèse. Bédier retourne alors à la première position, mais en l’argumentant grâce aux acquis de la méthode historique. C’est la synthèse. Une vision toute proche gouverne d’ailleurs aussi sa compréhension de l’histoire de l’édition de texte : à une première période empirique durant laquelle les éditeurs se débrouillaient comme ils pouvaient avec la variance manuscrite, en privilégiant les manuscrits qui leur étaient les plus accessibles a succédé, sous l’influence des érudits allemands, une seconde période dite « lachmannienne » où des critères scientifiques ont présidé à la comparaison de tous les manuscrits dans le but de reconstituer leur archétype28. Enfin Bédier est venu qui a dénoncé l’illusion scientiste du lachmannisme et a proposé de reproduire le texte du meilleur manuscrit plutôt que de forger une version parfaite, n’ayant probablement jamais existé, de l’original. L’intéressant, dans ce débat, est que Bédier a candidement avoué que sa méthode renouait dans une certaine mesure avec la première pratique : « Dès lors, il faut convenir, avec les anciens humanistes, qu’on ne dispose guère que d’un outil : le goût29. »
19Passons sur l’aspect nationaliste et revanchard de l’antipathie que nourrit Bédier envers ce qui vient d’outre-Rhin pour souligner l’un des leitmotivs de sa pensée : la défiance envers l’idée d’origine et la proposition de recadrer l’étude des œuvres du passé dans une perspective immanente. On peut l’interpréter de deux manières : soit comme le retour à une position préromantique, auquel cas l’apparence hégélienne de sa démarche ne serait qu’un trompe-l’œil et le « progrès » réalisé ne serait qu’une « répétition » au sens nietzschéen (pour le dire avec Verlaine, « ni tout à fait la même ni tout à fait une autre30 ») ; soit comme une réelle Aufhebung d’une position purement intuitive, rendue par-là réelle et effective de simplement latente qu’elle était primitivement. La seconde solution satisfait évidemment beaucoup mieux notre désir de voir l’humanité s’améliorer constamment dans la compréhension d’elle-même, mais l’évolution même de la question dans les décennies qui ont suivi l’énoncé de la théorie de Bédier est propre à nous faire douter de son effectivité, et Bédier lui-même dans la citation un peu mélancolique que l’on vient de produire sur l’importance du critère du « goût » semblait plutôt pencher pour l’idée qu’il n’y a décidément pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Mais il ne faudrait peut-être pas prendre pour une réflexion profonde ce qui pourrait n’avoir été, de la part de Bédier, qu’une boutade. De fait, le bédiérisme éditorial n’a d’intérêt que s’il présuppose une étape lachmannienne servant au moins à déterminer avec rigueur le « meilleur manuscrit » qu’il prétend vouloir suivre !
20Cela dit, la situation actuelle du débat épique31 semble dessiner à son tour une nouvelle triade hégélienne où la théorie des cantilènes représenterait la thèse, l’individualisme bédiériste l’antithèse et le bien nommé néo-traditionalisme la synthèse. À y regarder de plus près, cependant, les choses apparaissent bien plus complexes : la plus vivante des trois études post-bédiéristes que l’on a citées plus haut est sans aucun doute aujourd’hui celle de Jean Rychner qui — en dépit d’un plaidoyer appuyé en faveur d’une diffusion, voire d’une composition orale des chansons de geste (ce en quoi celle des anciennes théories définies par Bédier à laquelle elle s’apparenterait le plus serait celle de Paul Meyer) —, a (définitivement ?) déplacé l’étude de l’épopée médiévale sur le terrain synchronique en développant à cet effet un structuralisme ad hoc, qui inspire aujourd’hui plus que jamais les exégètes de la chanson de geste. Le livre de Menendez Pidal, pour sa part, apparaît plutôt comme une réactivation, appuyée de considérations historiques plus solides, de la théorie de Pio Rajna. Si l’on précise que Menendez Pidal avait quatre-vingt-dix ans au moment où il a écrit ce livre, on pourrait même soutenir qu’il n’était justement pas un « néo-traditionaliste » comme il le prétendait, mais bien un « traditionaliste » tout court, qui n’avait jamais pu prendre au sérieux le travail de Bédier (lequel n’était que de cinq ans son aîné).
21Quant à Pierre Le Gentil, il est certainement le moins novateur des trois philologues récents que nous avons évoqués, puisque sa solution de compromis, prétendument nouvelle, n’est, à peu de choses près, que la reprise de l’idée de Gaston Paris. Celui-ci, même s’il n’a pas écrit les mots de « mutation brusque », semble bien, en fin de compte, toujours être, après plus de cent ans, l’auteur du meilleur modèle d’explication de la genèse des chansons de geste. Bien sûr, sa phraséologie date, mais la question reste si obscure que même des exégètes plus récents n’ont pas pu apporter beaucoup plus de lumière sur un processus de transformation dont les termes et la chronologie exacts nous resteront sans doute à tout jamais inconnus. En l’occurrence, le « progrès » de notre discipline semble bien se résumer à un changement de perspective qui tend à reléguer la question des origines hors de la science… jusqu’au prochain rebondissement de la polémique ! De fait, cet épisode de l’histoire des études médiévales reste exemplaire, car il permet de détailler un certain nombre d’attitudes savantes récurrentes dans le domaine des sciences humaines : l’homme à idées enthousiaste et désordonné (Fauriel), l’érudit soucieux de nuances et de précision, mais peu désireux de chambouler les paradigmes reçus (G. Paris), le savant fasciné par le gouffre des âges (Rajna), le faiseur de synthèses hégéliennes aspirant à la fin de l’Histoire (Bédier), l’obstiné qui nie les révolutions inutiles (Menendez Pidal), le renouveleur de perspectives (Rychner), l’honnête ouvrier avide de compromis, quitte à ne pas être très original (Le Gentil) : ces types sont de toutes les époques, ou presque ; leur distribution inégale dans les différents moments des querelles érudites contribue à la variété de celles-ci et nous aide à comprendre le caractère particulier de chaque polémique. Mais que chaque génération contribue à préciser les débats par de nouveaux arguments n’empêche ni les piétinements, ni les oublis, ni parfois même les retours en arrière32. À cet égard, la réversibilité axiologique des triades hégéliennes que l’on peut par jeu s’amuser à multiplier devrait donner à réfléchir.
22Marie de France, qui nous invitait, au xiie siècle déjà, à « gloser la lettre » en lui ajoutant notre « surplus de sens33 » semble prouver que l’idée de progrès critique a ses lettres de noblesse. Neuf siècles après elle, nous avons pourtant des raisons de nous montrer nuancés sur cette question, et peut-être devrions-nous nous demander — alertés par les considérations de Derrida sur le « supplément34 » — si le « surplus de sens » promis par la poétesse des Lais désigne une accumulation ou un simple remplacement ; les sens s’enrichissent-ils mutuellement ou ne font-ils qu’indéfiniment se suppléer ? Une chose est certaine : ils n’ont pas fini de se métamorphoser. Au gré des attentes toujours renouvelées d’une société en constante mutation, ils sont toujours simultanément le reflet de leur époque et la réactualisation de quelques postulats de base dont l’humanité n’est pas près de se débarrasser35.