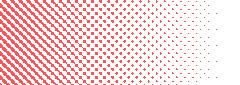Le discours indirect libre 300 ans avant sa naissance
1Le discours indirect libre (désormais dil) apparaît, à juste titre, comme une forme de prédilection de la langue littéraire des xixe et xxe siècles. Son attestation, ou du moins la présence de formes apparentées, dans des textes littéraires français antérieurs au xixe siècle est pourtant un fait bien connu, et ce dès la naissance de la notion1. L’observation de cette présence à une époque où l’étiquette n’est pas disponible soulève un certain nombre de questions : a‑t‑on affaire, dans ces occurrences anciennes, à une forme stabilisée et si oui, s’agit‑il de celle‑là même qui a retenu l’attention des linguistes à partir de la fin du xixe siècle ? Autrement dit, si l’étiquette de discours indirect libre a désormais un peu plus de cent ans, il est encore permis de s’interroger sur le passé de la chose à laquelle elle renvoie : est‑ce bel et bien l’apparition d’une forme nouvelle qui attira l’attention des linguistes du siècle dernier ? Et si tel n’était pas le cas, pourquoi le dil fit‑il une entrée si tardive dans notre métalangage ?
2Ces questions soulèvent à leur tour des problèmes de méthode : l’œil qui compare l’usage d’une forme à deux époques différentes aura tendance à observer dans l’une les traits et les fonctions auxquels il a été acculturé par l’autre, fût‑ce pour en constater l’absence. Pleinement intégré à notre imaginaire de la langue littéraire, le dil tel qu’il fut conçu à l’époque de Flaubert et de Zola conditionne notre lecture des textes anciens, et nous fait peut‑être trouver remarquables des configurations qui, pour le lectorat de cette époque, ne l’étaient pas, ou l’étaient différemment. Le risque serait grand, à vouloir retracer une histoire des formes au long cours, de nier leur historicité, de les essentialiser en cherchant leur trace dans des corpus informés par des pratiques et des imaginaires langagiers tout autres. Inversement, renoncer à écrire cette histoire, c’est prendre le risque d’essentialiser une certaine pratique du dil et de poser comme définitives et absolues des caractéristiques qui sont peut‑être seulement relatives à une époque. Une réflexion sur le passé ancien du dil ne peut donc être menée que si elle s’ajuste aux représentations méta‑ et épilangagières qui informent les corpus de l’Ancien Régime : une fois repérée la présence de formes qui font intuitivement penser au dil moderne et contemporain, seules la compréhension et l’analyse de leur contexte d’apparition rendent véritablement lisibles et interprétables les occurrences recueillies.
3Cette perspective endogène a peut‑être parfois manqué à l’approche historique du dil. Le patron pour ainsi dire canonique de cette forme, tel qu’on le trouve chez Flaubert et Zola, fut rapidement rattaché, en particulier par Charles Bally et Marguerite Lips, à l’impersonnalité du roman réaliste. Dans cette perspective, les narrations fictionnelles de l’époque classique, prises en charge, dans la plupart des cas, par des narrateurs indiscrets, ne pouvaient guère apparaître comme des candidates plausibles à l’élaboration d’un dil assimilable aux pratiques des romanciers naturalistes. Dans son ensemble, la littérature de l’époque classique, parce qu’elle appartient à une culture rhétorique de l’écrit en vertu de laquelle l’énoncé littéraire est assumé par une instance incarnée, tint lieu de cousine pauvre dans l’historiographie du dil. Le rationalisme dit cartésien de la période semblait lui aussi contrevenir à la pratique d’une forme énonciativement ambivalente. Le dil étant perçu comme la manifestation d’une esthétique et parfois d’une psychologie d’époque, celles de la deuxième moitié du xixe siècle, c’est plutôt dans une perspective auteuriste que sa trace fut cherchée dans les textes de l’Ancien Régime : foncièrement opposé à l’esprit et aux pratiques de ces siècles reculés, il pouvait à la limite apparaître sous la plume de quelques rares génies.
4Ayant constaté, pour ma part, la présence de formes qui ressemblent à du dil dans la prose fictionnelle du premier xviie siècle, je me suis demandé comment analyser et interpréter ces occurrences. J’ai déjà proposé une synthèse des résultats de cette enquête, dans laquelle j’ai défini les traits stylistiques et pragmatiques qui caractérisent les formes du dil dans la prose fictionnelle de l’époque classique (Duval 2018). Je voudrais à présent montrer comment ces formes s’inscrivent dans le système des figures rhétoriques de cette époque et dans la dynamique textuelle de la fiction narrative en prose, en me penchant sur un corpus plus resserré de romans du premier xviie siècle. Je rappellerai d’abord de quelle manière la représentation du discours autre (désormais rda) est appréhendée par les catégories métalangagières et poétiques de l’Ancien Régime, avant de me pencher sur quelques occurrences de paroles et de pensées représentées dans deux romans des années 1620.
Figures de la polyphonie dans les rhétoriques classiques
5Que le dil ait pu connaître, avant la forme plus stabilisée qui est la sienne à partir du xixe siècle, des configurations plus mouvantes et analysables comme des figures, c’est ce que nous invite à penser la célèbre querelle qui, en 1913‑1914, opposa Charles Bally à Theodor Kalepky. Bally définit le style indirect libre (désormais sil) comme une forme grammaticale qui exclut la présence énonciative de l’auteur, même déguisée. Il entendait ainsi réfuter la position de Kalepky pour qui le sil est un « discours voilé », au sein duquel le narrateur déguise sa propre voix en lui donnant les inflexions d’une autre :
Le narrateur adopte la forme qu’il attribuerait à ses propres pensées et à ses propres paroles (en prise directe avec les événements passés qui l’occupent), mais il laisse à son lecteur le soin, et même le devoir, de les interpréter et de les reconnaître comme étant les pensées et paroles des personnages. Comme dans un système crypté, le lecteur doit donc les décoder correctement. (Kalepky [1913] 2018, 142‑143)
6Pour Bally, le procédé que décrit Kalepky s’apparente à une figure de pensée, c’est‑à‑dire à une forme expressive intermédiaire entre la pensée et la langue, dont les traits formels ne sont pas stabilisés. Le linguiste genevois insiste pourtant sur le fait qu’à chaque forme grammaticale correspond une figure, et que bien des expressions langagières se situent entre ces deux polarités. Ce continuum entre la pensée et la langue est observable en synchronie, mais aussi en diachronie :
L’évolution des types décrits dans cet article nous conduit, par une marche insensible, de la pensée pure à la forme linguistique pure. Tout dans le langage dérive de la pensée. Les types réguliers catalogués dans les grammaires et les vocabulaires ont été autrefois des formes de pensée sans expression linguistique adéquate. (Bally [1914] 2018, 207)
7Cette distinction opérée par Bally entre figure de pensée et forme grammaticale est intéressante pour ce qui concerne l’étude des corpus d’Ancien Régime, dans la mesure où la rda est presque uniquement envisagée, à cette époque, par le biais des figures de rhétorique. Laurence Rosier (1999, 27) date de la Grammaire générale et raisonnée de Port‑Royal, parue en 1660, la première occurrence d’une description grammaticale des formes de la rda, description dans laquelle seuls les discours directs et indirects sont envisagés. Représenter la parole de l’autre est en effet plutôt pensé, à cette époque, comme un artifice oratoire. La capacité à mettre en scène plusieurs voix au sein d’un même énoncé est considérée comme une marque insigne du génie poétique, et l’orateur lui‑même est invité à user de ce procédé pour plaire à son auditoire. Différentes formes de rda sont envisagées dans les sections consacrées aux figures de pensée, lesquelles se définissent traditionnellement par le fait qu’elles opèrent à l’échelle de la phrase et non du mot, qu’elles sont l’expression d’un « sentiment et d’une conception2 », et qu’elles jouent, comme l’a bien montré Florence Desbordes (1986), sur le détournement de l’un des paramètres de la situation d’énonciation. Dans cette perspective rhétorique, le discours indirect n’est pas une figure, puisqu’en son sein le locuteur parle en son nom propre (voir Weerdt‑Pilorge 2011). En revanche, le discours direct prend nécessairement la forme d’une figure, appelée prosopopée dans le cas où un seul personnage parle et dialogisme ou sermocination dans le cas où plusieurs personnages s’entretiennent. Le discours direct est ainsi perçu comme une fiction énonciative par laquelle le locuteur imite à la perfection le discours de ses personnages : il ne s’agit donc pas d’un cas de polyphonie énonciative, puisque seul l’énonciateur fictif doit être perçu par le public. Tout l’art du dialogisme rhétorique réside précisément dans la capacité de l’orateur à instancier la voix des autres en contrefaisant la sienne.
8La polyphonie est en revanche bien présente dans la figure d’occupation ou antéoccupation. Cette figure consiste à « prévenir ou à répéter d’avance une objection que l’on pourrait essuyer, ou qui peut donner lieu d’ajouter de nouvelles raisons à celles qu’on a déjà alléguées » (Fontanier [1827] 1977, 410). Le locuteur reprend dans ce cas le langage d’un autre locuteur dont il anticipe les paroles. Bally envisage ce procédé en s’appuyant sur des exemples de Marivaux et de Racine, lorsqu’il analyse plusieurs procédés qui sont selon lui intermédiaires entre la forme grammaticale du dil et la figure de pensée ([1914] 2018 : 117‑118).
9Enfin, la « substitution de sujet », qui selon Bally correspond à ce que Kalepky appelle discours voilé, est sans doute une étiquette qui renvoie à un cas particulier d’énallage. Cette figure est rarement répertoriée dans les rhétoriques. Fontanier l’aborde au chapitre des figures de construction, en adoptant un ton assez polémique :
Dumarsais prétend que l’Énallage n’existe point, même en latin, et que, si on pouvait l’y trouver, ce ne serait point une figure, mais une faute. Tel est aussi le sentiment de l’Académie dans son Dictionnaire. Il me semble, à moi, que l’Énallage est souvent très réelle, même en français, et que, loin d’être nécessairement une faute, elle peut être une beauté, une vraie figure. Mais elle ne peut consister en français que dans l’échange d’un temps, d’un nombre, ou d’une personne, contre un autre temps, un autre nombre ou une autre personne. (Fontanier [1827] 1977, 293)
10L’énallage de la personne prend notamment la forme d’une substitution de il(/s)/elle(/s) à je, ou inversement, d’une substitution de je à il(/s)/elle(/s). Je n’ai trouvé, cependant, qu’un seul exemple où une telle substitution s’inscrit dans le contexte d’une rda et présente par conséquent un cas de bivocalité : sous la plume du prédicateur Pierre de Joncourt, on trouve l’expression de « substitution de personne3 » pour décrire l’assomption à la première personne d’un discours manifestement attribué à d’autres. Dans le passage en question, l’auteur répond à une difficulté soulevée par un passage de l’épître aux Romains dans lequel saint Paul se présente comme un pécheur (Rm 7, 14). Pour Joncourt, l’apôtre parle « en sa personne, de choses qui ne le regardent pas personnellement4 ». Par cette « espece de fiction », saint Paul rend son discours « plus sensible, et plus touchant, que la froide exposition5 ».
11La faible représentation de l’énallage dans les rhétoriques est due à un débat grammatical ancien. En effet, au moins depuis le xvie siècle, l’énallage est en concurrence avec la figure de l’ellipse pour expliquer des phénomènes où l’apparition d’un cas, d’un temps ou d’une personne entre en conflit apparent avec les règles grammaticales de la langue concernée (voir Clerico 1983) : définie comme « la suppression de mots qui seraient nécessaires à la plénitude de la construction » (Fontanier [1827] 1977, 305), l’ellipse permet d’expliquer cette apparition apparemment agrammaticale par l’absence d’une expression dont le rétablissement redonnerait à l’énoncé sa cohérence morphosyntaxique. Les partisans de l’énallage voient au contraire dans ces phénomènes à première vue agrammaticaux une variation morphologique autorisée par l’usage ou par une recherche rhétorique d’expressivité.
12On peut alors se demander si l’absence du dil dans les traités de l’époque n’est pas due au fait que ce dernier soit perçu comme une ellipse, phénomène langagier longtemps considéré en France comme une faute de grammaire ou un vice de style, et auquel le père Lamy sera le premier à donner une pleine légitimité rhétorique (voir Le Guern1983). Cette hypothèse me paraît confortée par le fait que l’ellipse ou abruption est traditionnellement encouragée par les rhéteurs dans les contextes de rda, en particulier dans le cas où l’énoncé passe sans transition de la narration au discours direct, sans utiliser d’incise. Longin fait notamment un long éloge de ce type d’ellipse au chapitre xxvii de son traité Du sublime (voir Chanet 1983, 18). Fontanier en relève la présence fréquente chez La Fontaine et loue la vivacité du tour, en des termes qui rappellent la manière dont sera reçu, plus tard, l’usage que l’auteur des Fables fait du dil6. Dans cette perspective, il me semble remarquable que Beauzée, dans la Grammaire générale et raisonnée, analyse l’ellipse dans son ensemble comme une expression tronquée du point de vue, phénomène qui pourrait à mon avis fort bien recouvrir celui du dil :
Souvent une Ellipse n’est autorisée dans une langue, que pour indiquer un point de vûe qui n’y a point reçu une expression propre, quoiqu’il soit nécessaire à l’exposition analytique de la pensée : ainsi le mode suppositif ne s’exprime en latin que par le subjonctif employé elliptiquement ; ainsi dans presque toutes les langues, l’interrogation n’est rendue sensible que par l’Ellipse. (Beauzée 1767, II, 445)
13Ce trop rapide examen de la place de la bivocalité dans le métadiscours de l’Ancien Régime confirme donc un fait important : qu’il soit ou non pratiqué, le dil n’est pas représenté par les théoriciens du langage de cette époque. Le traitement de la rda dans les rhétoriques témoigne pourtant de la perception de formes de polyphonie et de bivocalité, tandis que le phénomène de l’ellipse pourrait, dans son étendue, recouvrir des occurrences de dil situées à la limite du bon usage, et par conséquent non retenues par les observateurs de la langue française. J’en observerai, à mon tour, quelques-unes, et j’essaierai d’en rendre raison.
L’ancien dil : forme brève et intermittente de la représentation des paroles
14Les exemples que je propose à l’analyse appartiennent à des fictions en prose du premier xviie siècle. Ce corpus n’a pas fait l’objet d’études systématiques pour ce qui concerne la rda, alors même que la polyphonie est à cette époque un trait structurant de la poétique romanesque (voir Duval 2017, 38‑42). Le dil, forme « interprétative » (Authier‑Revuz 1992, 41), ne dispose pas de la configuration syntagmatique qui rend les discours directs et indirects identifiables indépendamment de leur contexte d’apparition. À cette première difficulté, posée par n’importe quelle occurrence de dil, s’en ajoute une autre, propre aux routines rhétoriques des textes fictionnels du premier xviie siècle : au sein de ces derniers, le narrateur intervient fréquemment pour donner son opinion ou réagir à son propre récit, si bien qu’il est parfois difficile de trancher entre son énonciation et celle de ses personnages. En particulier, l’apparition de modalités exclamatives ou interrogatives à l’imparfait peut souvent aussi bien être analysée comme une intrusion de la voix narrative que comme un passage au dil.
15Plusieurs éléments contextuels permettent cependant d’atténuer cette ambiguïté. En premier lieu, lorsque l’occurrence apparaît dans un contexte au sein duquel interviennent, suivant un ordre variable, les discours direct, indirect et narrativisé, il semble plus économique d’interpréter l’ensemble de ces formes comme une séquence entièrement située sur le plan du discours autre. À cet argument d’ordre textuel s’en ajoute un autre qui a trait à la culture du récit fictionnel de l’époque : le narrateur de fictions baroques, y compris lorsqu’il exprime à l’égard de ses personnages une certaine sympathie, adopte rarement le même point de vue qu’eux. S’il s’émeut, notamment, de leurs passions, il ne les éprouve pas au même degré et il fait preuve de moins d’aveuglement, comme le montre le cas particulièrement fréquent où la voix narrative intervient de manière métaleptique pour réprimander un personnage et l’interroger sur les causes de sa folie. Dans ces conditions, l’observation du contenu propositionnel d’un énoncé permet souvent de désambigüiser les occurrences formellement problématiques et d’identifier sans trop d’hésitation leur énonciateur en fonction du point de vue exprimé.
16Les caractéristiques du patron de dil que j’ai pu dégager de mes sondages sont les suivantes :
17‑ indices de rda: coprésence d’autres formes de discours rapporté, incise à l’imparfait.
18‑ bivocalité : l’espace, le temps et la personne appartiennent à l’énonciation narratoriale, alors que le contenu propositionnel et les modalités de phrase sont assumés par le personnage.
19‑ faible marquage stylistique : lavoix du personnage n’est pas systématiquement caractérisée par des traits stylistiques remarquables.
20‑ brièveté : ces occurrences obéissent toutes à une rhétorique de la brièveté ; style coupé et paratactique, ellipses.
21L’apparition d’un dil au sein d’une séquence de discours rapportés ne doit pas être confondue avec un discours indirect libéré, c’est‑à‑dire un discours indirect avec ellipse de son verbe introducteur. Or la présence de modalités de phrase qui semblent être assumées par le locuteur cité n’offre pas toujours un critère discriminant pour identifier un dil, étant donné l’instabilité des usages typographiques pour ce qui concerne les points d’interrogation et d’exclamation. Ainsi, la possibilité de ponctuer une interrogative indirecte avec un point d’interrogation rend certaines occurrences ambigües, comme dans l’exemple suivant, tiré de La Pieuse Jullie. Histoire parisienne de Jean‑Pierre Camus, roman paru en 1625. L’interrogative indirecte intervient dans une séquence au sein de laquelle un père essaie de dissuader son fils d’entrer dans les ordres et lui vante les mérites du mariage. Ses paroles sont d’abord représentées au discours indirect :
Il luy fit voir par des lustres formez, par l’artifice d’une subtile eloquence, dont le monde n’est que trop pourveu, et qui seroit mieux nommée causerie ou cajollerie ; que les loix Civiles et les Canoniques, les Humaines et les Divines n’estoient pas si contraires, qu’elles ne se peussent concilier, […] Qu’il y avoit des fausses vertus aussi bien que des happelourdes entre les pierreries ; que tout ce qui a du lustre n’est pas de l’or, que le Cristal paroist comme un Diamant, bien qu’il n’en ait ny la valeur, ny la fermeté : Que l’impiété se masque quelquefois du nom et de l’apparence de piété ; que plusieurs confessent Dieu par la bouche qui le nient par les effects. Et quels effects plus funestes que de reduire ses parens avant terme au tombeau ? leur faire traisner une fin de vie triste, solitaire, languissante, et pire que mille morts, que de desoler une famille, perdre un bien, qui bien mesnagé et employé pour le service de Dieu pourroit conduire son possesseur au ciel aussi bien qu’une pauvreté affectée : Que les exercices de la Justice valoient bien ces menées et les emplois dont lon occupe & amuse plusieurs Moines dans les Convens : […]7
22La question rhétorique « Et quels effects plus funestes […] au tombeau ? » introduit une rupture syntaxique et modale, dans la mesure où elle n’est pas introduite par un conjonctif pur et que son énonciateur assume une modalité de phrase marquée. Le fait que cette interrogative soit en quelque sorte continuée au‑delà du point d’exclamation par une accumulation de subordonnées comparatives (« leur faire traisner […] affectée : »), comme si l’énoncé était progressivement réintégré dans la modalité neutre du discours indirect, laisse penser qu’on est plutôt dans une séquence de discours indirect avec une occurrence ponctuelle de discours indirect libéré motivé par une recherche de brièveté. Toutes les conjonctives qui environnent cette interrogative dépendent en effet de « il luy fit voir », or le sémantisme de cette principale est assertif. La représentation au discours indirect d’une interrogation impliquerait donc, normalement, celle d’une nouvelle principale du type il lui demanda, ce qui romprait la progression thématique de la séquence en substituant aux paroles représentées une indication du narrateur lui‑même. On observe en outre que la formulation même de cette interrogation est abrégée, puisque le conjonctif que de qui devrait introduire le complément de comparaison « perdre un bien » fait l’objet d’une ellipse. L’occurrence est donc caractérisée dans son ensemble par une recherche de brièveté. Au terme de la séquence, le narrateur mentionne d’ailleurs explicitement son intention de brièveté :
Je n’aurois jamais fait si je voulois repasser toutes les couleurs dont ce personnage paroit ses raisons : car nous naissons Orateurs, et Orateurs subtils pour exprimer ce qui nous touche, et nous persuader ce que nous desirons passionnement8.
23En renonçant à « repasser toutes les couleurs » du discours autre, le narrateur présente la séquence comme une représentation abrégée : la couleur est en effet, à cette époque, une métaphore lexicalisée pour désigner les procédés oratoires.
24Une occurrence moins ambigüe apparaît dans cet exemple tiré de La Chrysolite ou le secret des romans d’André Mareschal, roman paru en 1627 :
Avecque des discours semblables il l’entretenoit, sans venir plus particulièrement au fait ; il l’aymoit, disoit‑il, mais c’estoit en general avecque tout le monde qui devoit l’adorer ; qu’il n’estoit pas possible de ne l’aymer point, que ceste obeissance qu’on luy devoit estoit autant necessaire qu’agreable9.
25La rda commence bien avec un dil, mais celui‑ci est aussitôt suivi d’un discours indirect introduit par des conjonctives avec ellipse du verbe principal. Ce qui semble motiver l’intervention du dil, dans cette perspective, c’est la volonté de réduire la place et l’importance du discours citant en reléguant celui‑ci dans l’incise.
26Les différents exemples que je viens d’étudier font apparaître une rhétorique de la brièveté à l’œuvre dans les usages anciens du discours indirect et indirect libre, ainsi qu’une recherche de cohérence thématique : le discours autre est placé au premier plan de la représentation, tandis que l’instance narratrice a tendance à s’effacer. Cependant, la présence de l’indirect libre est rare et intermittente : cette forme intervient comme une variation ponctuelle du discours indirect, et le discours indirect libéré répond aussi bien que lui à sa fonction résomptive. Cette hypothèse me semble confirmée par les exemples de pensées représentées que je vais maintenant analyser.
Discrétion du narrateur et du dil d’Ancien Régime : les pensées représentées
27Les pensées représentées sont parfois considérées comme un trait discriminant de la langue de la fiction, voire comme ce qui signe la modernité de la prose fictionnelle postérieure au xviiie siècle : l’émergence du roman impersonnel favoriserait, dans cette perspective, celle d’une représentation toujours plus fine des mouvements de la vie intérieure (voir Philippe 2012). Pour Dorrit Cohn, une loi de discrétion établit une proportion inverse entre la présence du narrateur et celle de la vie intérieure du personnel de la fiction : « plus le narrateur est présent et individualisé, moins il est en mesure de révéler l’intimité psychique de ses personnages » (Cohn 1981, 23). Adrienne Petit (2016) a bien montré, cependant, l’existence à l’époque baroque de « psychorécits » énoncés par des narrateurs discrets. Le dil présente un autre biais énonciatif par lequel le narrateur s’efface pour mieux mettre en évidence les pensées de ses personnages, mais il est extrêmement rare dans le corpus du roman baroque. Je donnerai deux exemples de ce phénomène, également tirés de La Chrysolite d’André Mareschal.
28Dans le premier exemple, les pensées de Clytiman sont introduites au moyen d’un discours direct avec l’incise du verbe dire en soi‑même à l’imparfait, forme caractéristique des fictions en prose de l’époque (Duval 2017, 303‑304). Plus vraisemblables que les plaintes énoncées à haute voix, elles présentent une forme typiquement romanesque et alternative au monologue dramatique. La plainte prend ensuite la forme d’un dil puis d’un discours indirect :
Voila Clytiman en colere, et plus que l’on ne sçauroit dire ; il ne sçavoit contre qui il se devoit plus fascher, contre Clymanthe ou contre Chrysolite : pour celuy la, disoit il en soy mesme, il faut que ce soit le plus effronté de tous les hommes, de n’avoir point eu de respect ni des personnes qui assistoient en ce lieu, ni de celle à qui il addressoit ce pacquet, ni du Temple sacré, ni de la Divinité qui y presidoit. Mais Chrysolite à son advis estoit la plus blasmable, de recevoir d’un homme qu’elle disoit n’aymerpoint, ce qu’elle n’auroit deu recevoir de qui que ce fust, et en un lieu qui demandoit de la reverence mesme des plus meschants ; qu’en cela il falloit qu’elle fust non seulement la plus infidele, mais la plus impie de toutes les filles du monde […]10.
29Cette modulation des formes de la rda s’accompagne d’un progressif effacement des indications du locuteur citant : à l’incise du discours direct « disoit‑il en soy-mesme » succède un syntagme prépositionnel « à son advis » pleinement intégré à la phrase. Celui‑ci peut être considéré comme l’indication d’une modalisation en discours second, dont le narrateur serait l’unique énonciateur. Plus vraisemblablement, la présence de deux superlatifs (« la plus blasmable » et « des plus meschants ») marque l’énonciation passionnée du personnage. Il s’agit donc plutôt d’une indication discrète par laquelle le narrateur rappelle à son lecteur l’attribution de ce discours. Enfin, on observe un retour du discours indirect, mais avec ellipse du verbe introducteur. La mise au jour des pensées représentées va donc de pair avec, de la part du locuteur citant, un mouvement d’effacement.
30On observe un phénomène similaire dans une représentation des rêveries de l’héroïne. Je citerai d’abord la longue analyse par laquelle le narrateur rend compte du trouble de son personnage : Chrysolite est sur le point d’épouser son amant Clytiman, et pourtant elle n’est pas heureuse. Elle regrette certaines privautés qu’elle lui a accordées. Clytiman fera‑t‑il confiance à une épouse qui, jeune fille, s’est montrée si légère ? Chrysolite n’en est pas certaine :
Elle n’avoit aucun repos ; tandis que tout le monde estoit en joye dans Lyvronde, elle se retiroit tantost en un coin de sa chambre, et tantost au plus espais d’un verger, où elle pleuroit ses fautes passées par celles qui estoient à venir ; et son esprit estoit en une agitation si diverse sur cet accord qu’elle attendoit, qu’elle desiroit, et qu’elle eust encore reculé volontiers, qu’elle avoit les mesmes apprehensions à faire comme à manquer. Elle connoissoit Clytiman, qui n’estoit pas homme à souffrir et à se taire ; elle sçavoit les advantages qu’il avoit sur elle, dont il ne manqueroit pas de se servir pour la perdre, s’il entroit en connoissance de tout ce qu’elle faisoit contre luy ; ainsi ses desirs d’un costé, et sa crainte et son apprehension de l’autre, entretenoient son imagination dans une perpetuelle réverie11.
31Cette séquence est assumée par le point de vue synthétique d’un narrateur qui parvient à rendre compte de la complexité des sentiments de son personnage dans un tableau unifié : il s’agit donc d’un psychorécit. Ce qui est subjectivement vécu comme un désordre intérieur, le narrateur lui donne la cohérence d’une formule : « elle avoit les mesmes apprehensions à faire comme à manquer ». C’est alors qu’intervient la représentation du rêve :
Parfois elle songeoit qu’elle fuyoit, et que Clytiman la suyvant, elle perdoit l’haleine au milieu de sa course ; cette crainte la tenoit comme tousjours aux talons, elle ne pouvoit assez se haster, ce luy sembloit ; Clytiman la chassoit ; elle se desroboit ; Validor estoit paresseux ; et toutes ces inquietudes et ces réveries luy causant de veritables apprehensions, sa patience pour l’un, et sa crainte pour l’autre la porterent à la plus estrange invention qui puisse entrer en un esprit12.
32On retrouve ici le phénomène de l’effacement progressif de la voix narrative. Le discours indirect, introduit par « elle songeoit que », cède la place à un dil avec incise : la proposition « ce lui sembloit » fonctionne ici comme ce disoit‑il, type d’incise encore en usage au xviie siècle. On observe juste après une suite paratactique de brèves propositions à l’imparfait, temps canonique du récit de rêve. Tout se passe comme si le point de vue narratorial fusionnait progressivement avec la vision de l’héroïne. L’anaphore résomptive « toutes ces inquietudes » et le passé simple « porterent » marquent ensuite un retour brusque à la perspective globale de la voix narrative, dont la subjectivité s’exprime à travers l’épithète « la plus estrange ». Cette rupture d’ordre énonciatif s’accompagne d’un changement rhétorique : le style descriptif du récit de rêve, la brièveté avec laquelle les visions en étaient représentées rendaient compte de l’enchaînement irrationnel des imaginations de Chrysolite. Inversement, la syntaxe imbriquée du narrateur rend compte d’un point de vue rationnel qui décèle, sous les visions tourmentées de son héroïne, l’enchaînement causal des passions et des actions.
33Les exemples que j’ai analysés illustrent donc eux aussi la rhétorique de la brièveté propre au dil d’Ancien Régime. Utilisée pour représenter les mouvements de la vie intérieure, cette forme présente l’intérêt majeur de faire abstraction du point de vue du narrateur et d’entrer ainsi en communion avec l’affectivité des personnages mis en scène.
*
34En conclusion, la rareté des formes de dil observées laisse penser que leur fonction essentiellement résomptive fait du discours indirect un candidat bien plus intéressant pour répondre aux besoins des prosateurs de l’Ancien Régime.
35C’est aussi cette rareté qui explique que le dil n’ait pas été retenu par les rhéteurs de l’époque, alors même que ces derniers savaient, avec leurs mots et leurs catégories, appréhender la bivocalité. La présence discrète du dil était peut‑être perçue comme un vice de style, une négligence, voire une trace de style oral ‑ ce qui expliquerait, d’ailleurs, l’attestation de cette forme dans des corpus fictionnels, à une époque où les romans sont écrits de manière rapide et sont connus pour être des contre‑modèles stylistiques. Il serait donc intéressant de continuer à suivre la trace du dil en se penchant cette fois sur les corpus des peu lettrés. On pourrait ainsi déplacer le point de vue traditionnellement porté sur l’histoire du dil : la question ne serait plus de savoir quel heureux génie l’a inventé, quelle époque artistique a su le faire fleurir, mais plutôt comment il s’employait avant l’époque de sa valorisation comme forme littéraire, et quelle fut l’histoire de cette forme clandestine de la rda avant sa monumentalisation.