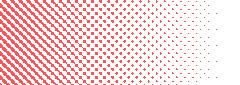1On hésite toujours un peu à rouvrir le dossier du discours indirect libre. L’histoire de la catégorie semble n’être que bruit et fureur. Au tournant des xixe et xxe siècles, les premiers débats furent des joutes, presque des rixes, entre des érudits suisses et allemands que l’on aurait attendus plus sages. Au tournant des xxe et xxie siècles, la même virulence accueillit la parution puis la traduction des Phrases sans parole d’Ann Banfield (1995). En outre, la triade scolaire que le discours indirect libre formait avec ses cousins direct et indirect semble avoir vécu. Depuis la fin des années 1970, la réflexion sur le discours rapporté s’est fondue dans un projet autrement ambitieux, qui vise à configurer de façon systématique l’ensemble des dispositifs dévolus à la représentation du discours autre. Dynamisée par l’émergence de notions telles que l’autonymie ou la connotation autonymique, la recherche a repensé ou délaissé les typologies héritées, qui lui semblaient trop rigides, désormais désuètes, peut‑être même erronées.
2Qu’importe : la catégorie a aujourd’hui cent ans.
3En 2012, Genève négligea de célébrer le centenaire de l’étiquette de style indirect libre, qu’un de ses professeurs, Charles Bally, avait proposée en 1912 dans un article fondateur. On s’en avisa à Lausanne, où l’on organisa en novembre 2015 deux journées d’étude sur le thème « Marges et contraintes du discours indirect libre », en faisant comme si la définition proposée par Bally suffisait encore : « style indirect qui donne l’illusion du discours direct tout en transposant les paroles et les pensées par l’emploi des temps propres au style indirect » (1912a, 552). Interroger chaque terme de cette définition, ou s’aviser de la compléter, c’est gratter des cicatrices, rouvrir de vieilles plaies et relancer la querelle.
4Bien sûr, la définition de Bally semble déjà précise. Certains la trouveront même trop précise, puisqu’elle considère implicitement que le discours indirect libre (désormais dil) est réservé à des contextes passés : les propos proférés ou pensés au présent sont alors transposés à l’imparfait, et l’ensemble des rapports temporels se déploient à partir d’un ancrage non actuel. S’étonnera‑t‑on de cette limite ? En 1912, les récits entièrement au présent étaient encore rares ; s’il en lut peut‑être, Bally n’y repéra en tout cas aucun exemple de dil. D’autres, à l’inverse, trouveront cette définition trop large : ainsi ne prévoit‑elle pas la transposition des pronoms de première voire de deuxième personne en pronoms de troisième rang. C’est que Bally a trouvé du dil à la première personne chez Marivaux ou Paul Margueritte, et chez le romancier genevois Victor Cherbuliez, qu’il cite autant que Gustave Flaubert ou Émile Zola.
5De fait, le geste qui consiste à avancer des critères pour asseoir une définition est à la fois intégratif et exclusif : intégratif, puisqu’il se propose, au nom des caractéristiques prévues, de rassembler sous une même étiquette des énoncés d’allures, d’époques ou d’esthétiques bien différentes ; exclusif, puisqu’il fixe, ce faisant, la marge au delà de laquelle l’étiquette ne s’appliquerait plus. Si l’on s’amuse à consulter Wikipédia, on s’aperçoit qu’à l’heure où ces lignes sont écrites, la page anglaise réserve ainsi l’étiquette de free indirect discourse aux textes à la troisième personne ; c’est également vrai pour la page allemande, à condition bien sûr d’admettre que l’expression erlebte Rede recouvre exactement la même réalité langagière et stylistique.
6Car, dans la mesure où elle délimite un domaine opératoire, une définition est d’abord une décision. Ainsi pourra‑t‑on décider qu’il n’y a pas de dil à l’oral parce que l’on n’y peut souvent conserver, au risque de créer une confusion énonciative, les embrayeurs temporels du discours cité ; ou bien l’on décidera que ce critère n’est pas définitoire, et que cette contrainte est simplement une spécificité du dil en contexte parlé. On ne cherchera donc pas ici à affiner la définition, et l’on fera comme si elle était acquise. Tel fut d’ailleurs le parti qu’adopta le romaniste allemand Eugen Lerch dès 1914, lorsqu’il voulut utiliser la catégorie sans relancer un débat encore houleux, et son projet est un peu le nôtre : « Le mérite revient à Charles Bally d’avoir relevé […] une particularité stylistique du français, qu’il appelle style indirect libre […]. Le repérage de la construction se trouve ainsi garanti. Mais il reste encore à faire valoir sa pertinence esthétique » (1914, 470).
7En outre, puisqu’elle ne s’impose pas dans l’absolu, toute décision définitoire risque d’être largement conditionnée par le corpus dont elle est appelée à rendre compte. Si l’étiquette de Bally a triomphé (avec l’intéressante substitution de discours à style), celui‑ci ne fut pas le premier à repérer le phénomène. On considère souvent qu’un autre linguiste suisse, Adolf Tobler, en avait donné, vingt‑cinq ans plus tôt, une première description et proposé une définition somme toute bien proche : il y aurait ici un « mélange de discours direct et indirect, qui emprunte au premier le temps et la personne du verbe, au second l’ordre des mots et le ton » (1887, 437). La première citation qui apparaît dans le grand débat européen qui devait se prolonger jusqu’au début des années 1930 est empruntée par Tobler à L’Assommoir ; l’énonciateur, Coupeau, est représenté en troisième personne: « Sa sœur avait peut‑être cru qu’il ne se marierait jamais, pour lui économiser quatre sous sur son pot‑au‑feu ? » (chap. 2). C’est à Zola et à Loti qu’un autre romaniste, Theodor Kalepky, devait emprunter la totalité de ses exemples, lorsqu’il s’avisa en 1899 de rebondir sur l’analyse de Tobler pour proposer une étude plus développée de ce qui ne s’appelait pas encore le style indirect libre. Pour l’un comme pour l’autre, le dil était une nouveauté, une invention de la littérature française la plus immédiatement contemporaine : leurs exemples sont empruntés à des romans qui viennent de paraître et dont l’Europe se délecte.
8Bally, lui, ne cite guère Zola et point du tout Loti. Alphonse Daudet et Romain Rolland sont en 1912 ses corpus de prédilection. C’est à peine s’il mentionne Flaubert, qu’ignoraient superbement Tobler et Kalepky. Or, regardons à nouveau Wikipédia : les pages allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise voient en Flaubert le grand maître du dil et presque le terminus a quo. Le test vaut ce qu’il vaut, mais il ne vaut pas rien : la célèbre encyclopédie en ligne donne accès à un double imaginaire, celui du prototype formel, celui du corpus de référence. Une comparaison plus attentive de ces pages ferait cependant apparaître des données et des nuances « parasites », qui se sont sédimentées autour de la catégorie au fur et à mesure qu’elle se patrimonialisait : telle parle de « figure de style », les autres non ; telle y voit plutôt une variante du discours direct, telle autre du discours indirect ; telle encore la rapproche du monologue intérieur, tandis que d’autres ne signalent pas de lien privilégié avec l’endophasie, etc.
9Dans tous les cas, le dil reste néanmoins présenté comme une forme proprement littéraire. Mais il en eût pu aller tout autrement. En 1904, le grammairien britannique Charles T. Onions proposait une des toutes premières attestations du phénomène dans une grammaire anglaise ; il n’y voyait qu’une forme, parmi d’autres, de discours indirect, mais surtout, loin de l’associer à un quelconque privilège de la prose romanesque, il soulignait que le dil (qui ne lui sembla point appeler d’étiquette spécifique) était usuellement pratiqué par les journalistes, dès lors que ceux‑ci voulaient rendre compte des débats parlementaires (1904, 83‑86). De fait, nombreux sont les travaux aujourd’hui consacrés au dil dans la presse écrite ; et l’histoire de la prose journalistique montrera peut‑être un jour que celle‑ci a utilisé la forme bien avant le roman. On sait par exemple désormais que l’imparfait dit « narratif » était fréquent dans le récit de fait divers bien avant de l’être dans le roman de la fin du xixe siècle, auquel nous le rattachons pourtant si volontiers aujourd’hui (Gonon 2012, 93‑94). Pour l’heure, en témoigne encore Wikipédia (que nous sollicitons une dernière fois comme miroir de la doxa), les imaginaires européens considèrent unanimement le dil comme une forme prioritairement voire exclusivement littéraire.
10Tel était déjà d’ailleurs le sentiment de Bally en 1912, qui voyait même dans le dil une attestation supplémentaire des velléités modernes d’« autonomiser » la langue de la littérature :
« Comme le phénomène étudié ici devient toujours plus fréquent à mesure qu’on se rapproche de l’époque contemporaine, on peut y voir une preuve de l’émancipation toujours plus grande du style littéraire, et une marque particulière qu’il s’adjuge pour se différencier de la langue parlée, tout en réussissant, par ce procédé, à rendre les nuances les plus délicates de la pensée » (1912b, 604‑695).
11On le voit sur ces derniers mots : il considérait que le développement du dil était lié à l’avènement d’une sensibilité qu’il qualifierait un jour d’« impressionniste ». La perception des faits stylistiques est en effet largement déterminée par des filtres et des imaginaires historiquement construits. Bally en était conscient : le projet linguistique pourra estimer, et sans doute à raison, que la même catégorie permet de rendre compte d’énoncés de La Fontaine et de Zola, mais ce rapprochement est‑il pertinent d’un point de vue stylistique ? La description d’une forme ne nous dit rien de son ressenti. Celui‑ci est contraint par des attentes et des conventions génériques, par la coprésence d’autres traits avec lesquels cette forme se stabilise au sein d’un faisceau, par l’état des sensibilités et des imaginaires langagiers et littéraires.
12En 1912, Bally était d’ailleurs sensible à une certaine banalisation du dil, qui le privait peut‑être déjà d’une part de son intérêt expressif au profit d’un simple rôle de marqueur de littérarité : le dil serait devenu « une sorte d’indice stylistique de la langue littéraire » (1912b, 604). Comme tel, il était donc appelé à l’usure. Ce type de phénomène n’est pas rare dans l’histoire stylistique : l’appariement de maintenant et de l’imparfait, qui put sonner si littéraire à la fin du xixe siècle, ne se retrouve plus guère aujourd’hui que dans les fictions « de genre », et notamment dans les romans sentimentaux. La littérature « restreinte » l’évite. La même usure s’observe pour les entrées en matière intempestives qui purent signer la modernité de la narration réaliste. Assurée par un pronom de troisième rang censé opérer une impossible anaphore, la première référence aux personnages demeurait opaque ; gommant le seuil du texte, elle simulait la continuité d’une narration déjà commencée ; la présomption de connaissance qu’implique la désignation pronominale convoquait une réalité supposée accessible mais qui ne l’était pas. Un temps, la nouveauté du procédé garantit son efficacité ; c’est presque l’inverse aujourd’hui. La manière de faire est devenue si fréquente qu’elle en est presque insignifiante sur le plan stylistique. Au seuil du récit de fiction, elle nous dit simplement : ceci est un récit de fiction. Ainsi en advint‑il peut‑être aussi du dil.
13Le geste définitoire – qui trace les limites externes du fait langagier – s’accompagne généralement d’un geste typologique, qui décide des limites internes du phénomène, pour en classer les réalisations attestées, en privilégiant tel ou tel critère, linguistique ou discursif. Notre but n’est ici nullement de contester ces deux gestes, mais simplement de prendre acte, pour en explorer les marges, de l’existence d’un prototype historique du dil comme mode citationnel apparaissant prioritairement dans les textes romanesques au passé, à la troisième personne et relevant d’une narration impersonnelle et subjectiviste (puisque Zola puis Flaubert en sont devenus les emblèmes). Ce mode citationnel serait indirect en ce qu’il exige la transposition du présent et des pronoms de premier et deuxième rang, même si les autres marqueurs embrayés et subjectifs peuvent ou doivent rester similaires à ce que l’on aurait au discours direct ; ce mode citationnel serait libre, au sens où il ne présente pas les propos rapportés dans le cadre d’une subordonnée régie par un verbe de parole. Mais l’adjectif avait chez Bally un sens plus large encore, et celui‑ci admirait que « cette forme d’expression jou[ît] d’une liberté syntaxique presque absolue » (1912b, 601).
14Ces données ne valent donc point pour nous comme définition du dil, mais simplement comme description du prototype tel qu’il nous a été légué par le xxe siècle. Nous n’entendons ni le contester, ni l’affiner ; nous ne souhaitons qu’interroger les marges du domaine qui s’organise autour du prototype, c’est‑à‑dire étudier des cas où, partant d’un constat de ressemblance, l’étiquette reste pertinente ou mieux adaptée que toute autre disponible, sans que les faits langagiers se conforment pour autant au prototype que l’on vient d’évoquer. Tel est, par exemple, le cas dès lors que l’on n’est plus dans de la prose romanesque (mais dans un scénario cinématographique, par exemple, ou dans la traduction d’un historien latin), ou alors quand cette prose romanesque n’est plus à la troisième personne (mais à la deuxième par exemple). Tel est encore le cas quand la dimension « citationnelle » n’est plus dominante (si le dil signale par exemple que des propos sont entendus plus que proférés et que la forme relève autant de la focalisation interne que du discours rapporté), ou encore quand l’énoncé ne respecte pas les quelques contraintes de formation dégagées dès les premiers débats sur le dil, celle qui veut par exemple que l’on évite de référer à l’énonciateur par une expression autre que pronominale. Tel est encore le cas quand la forme apparaît dans la prose romanesque contemporaine, dont l’esthétique semble a priori si éloignée des grands modèles flaubertiens et zoliens.
***
15Les organisateurs des journées d’étude qui se sont tenues à Lausanne en novembre 2015 remercient très chaleureusement Jacqueline Authier‑Revuz, Monique De Mattia‑Viviès et Sara Sullam, qui en ont encouragé, enrichi et animé les débats.
16Bien qu’il présente quelques résultats de ces deux journées de travail, ce colloque en ligne reste un colloque ouvert, qui se complétera de quelques textes dans les mois qui viennent et a vocation à accueillir tout article qui en partagerait l’esprit, le projet et les interrogations.