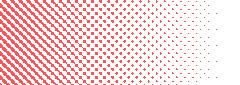La critique : ou Les stratégies de l’émotion
1Mouvement, force, masse, sortie hors de soi : si émotion et puissance1 se répondent et offrent une symétrie bien commode autour du rapport passif/actif aux affects (en subir : être assujetti, ou en provoquer : être sujet), elles s’opposent aussi très exactement sur quelques-uns de nos binômes existentiels : féminin/masculin, affect/raison, sujet/objet, nature/culture. L’articulation de l’émotion avec la dyade passion-raison en dérive directement : soit l’émotion est vécue comme dangereuse et incontrôlable, soit elle rend libre et symbolise la vie. Le critique, quant à lui, joue sur les deux tableaux : profitant du pouvoir du langage et du discours, il se sert à la fois de ses émotions de lecture et de sa raison critique. Il stigmatise ainsi la littérature (son pouvoir et ses modalités opératoires), peut-être même stéréotypise-t-il certaines de ses postures, révélant la façon dont elle exacerbe ses effets. Non seulement la critique utilise un certain type d’émotions pour parvenir à ses fins, mais elle profite de ce désir toujours latent d’institutionnalisation des émotions de lecture. Envisager l’interaction de l’émotion et de la puissance en littérature par le prisme de la critique, c’est chercher à comprendre ce qui se joue chez ce lecteur écrivant. La critique participe d’une stratégie sociale et culturelle qui s’appuie sur des débordements émotionnels dont elle profite, puisqu’elle en tire sa notoriété, ses valeurs et ses codes, par le biais de toute une « politique de la représentation2 », pour reprendre une expression de Louis Marin. La critique joue des effets de tribune — en cela, elle s’apparente à une volonté de juridiction des émotions et à une « rhétorique du contrôle3 », révélant d’une part à quel point le langage est contraint (il subit ce pouvoir-là), d’autre part dans quelle mesure il est le point de rencontre (la lutte) de l’émotion et de la puissance. Toute une rhétorique du contrôle accompagnant le discours des passions stigmatise cette confiscation du pouvoir que la critique cherche à récupérer (donner son avis sur l’œuvre d’un autre est un signe de puissance, mais aussi la reconnaissance d’une autorité) et dont les querelles critiques sont l’un des symptômes exacerbés. Qu’un livre fasse scandale signifie justement qu’on en parle plus qu’on ne devrait. Symptômes fort stratégiques d’un débordement de paroles qui révèle à la fois un surinvestissement et un déplacement des émotions, les réactions affectives du critique (je commente un livre parce qu’il m’a ému) se transforment parfois en puissance anticipatrice (je choisis de parler d’un livre pour qu’il ait un impact sur les autres, et le simple fait d’en parler n’est rien d’autre qu’une imitation préfigurative de cet effet). La vérification de son pouvoir intellectuel est source de plaisir pour elle, la critique exprime autant ce qu’elle a à dire que son goût (sa satisfaction) d’en être arrivée là. Elle fait partie d’une stratégie de répartition de la relation entre auteur et lecteur, dans laquelle elle s’immisce comme « un tiers bien disant4 » (Julien Gracq), plus ou moins gênant, puisqu’il crée une relation triangulaire qui ne s’imposait pas d’emblée.
2Il n’est guère surprenant, dès lors, que l’interaction de l’émotion et de la puissance confère une telle place aux pulsions et aux fantasmes. Plus encore, c’est cette relation triangulaire qui transforme l’émotion en libido (c’est-à-dire en puissance érotique), par un investissement pulsionnel dont on peut interroger la fonction et la valeur symbolique. L’émotion se déclenche par les jeux de l’imagination et par les anticipations qu’elle provoque, elle découle d’une représentation encouragée (excitée) par des fantasmes. Barthes et Doubrovsky n’ont pas parlé fortuitement du « plaisir esthétique » de la critique, de ce plaisir purement formel offert par la représentation de fantasmes qui, selon Freud dans ses Essais de psychanalyse appliquée5, déguisent ou recouvrent des jouissances moins avouables. Si l’émotion, la sensualité, l’érotisme et la sexualité ont été investis comme autant de modalités de la critique, le statut du désir et le pouvoir d’Éros dans l’activité littéraire (ce que le désir fait lire) ne sont pas uniquement les symptômes plus ou moins sublimés d’une relation maître/disciple. Il ne suffit pas que Platon ait motivé (et utilisé) la puissance et la vitalité de l’Éros dans l’acquisition de la connaissance. Soumis à la tentation des pulsions, l’esprit n’a pas seulement affaire à lui-même, mais à quelque chose qui ne semble pas être lui, qui le touche au plus profond de lui-même et qui provient du corps. Sous l’emprise de ses pulsions, le moi est poussé « vers quelque chose d’inconnu, sans avoir conscience de ce qui le pousse ni aucun sentiment de l’objet de la pulsion6 » (Fichte). La pensée tente alors de rationaliser la pulsion, en en faisant « une attente nostalgique, tournée vers l’impossible, vers l’altérité7 ». En cela, la pulsion ne relève jamais seulement de l’instinct, elle est le produit d’une réflexion du moi sur lui-même8. Quelle est la nature du désir critique ? Que peut la critique sur la littérature en termes de pulsions et de raisons ? Que font interpréter les émotions, comment font-elles lire, analyser le critique littéraire ? Que font-elles choisir ou retenir, ou au contraire qu’empêchent-elles de comprendre et à quoi empêchent-elles de réfléchir ? Dans quelle mesure l’émotion peut-elle être « génératrice de pensée9 » (Bergson) ?
1. « Je le veux, je l’ordonne » (v. 369)
3Si Britannicus (1669) est, de toute évidence, un objet de prédilection de la critique, c’est que cette pièce en révèle le pouvoir par la fascination qu’elle exerce. Elle est une formidable théâtralisation du rôle de l’activité critique quand émotion et puissance se libèrent pour s’affronter. Il n’est pas anodin que ce soit avec cette pièce que Racine ait voulu rivaliser avec Corneille, choisissant de situer les affects dans le champ des tragédies politiques. Corneille et Racine incarnent la dualité d’un modèle occidental fondé sur la toute-puissance d’affects que la volonté, la puissance et l’intellectualisation vont surmonter et maîtriser (Corneille). La culture est la manière dont nous cultivons nos émotions (elle les esthétise et les induit). Si l’émotion se caractérise par des réactions physiologiques qui relèvent pour la plupart d’une dépense énergétique, celle‑ci est perçue comme problématique quand son intensité et sa quantité entraînent une perte de contrôle, autrement dit lorsqu’il existe un décalage pour le sujet entre ses anticipations perceptives et cognitives et son répertoire de réponses disponibles. Exprimer ses émotions est un acte social qui correspond à une dramatisation des conduites. Depuis Platon, existe toute une psychologie politique de la passion qui va de pair avec une culture des émotions. Les culturaliser implique aussi qu’elles peuvent se dénaturaliser. L’émotion garde en mémoire l’histoire au sein de laquelle elle est s’est constituée. Le corps n’est pas l’unique herméneute des émotions ; le contexte social (les événements impliqués dans la situation) peut tout aussi bien l’être. L’authenticité des émotions renvoie donc à la vocation culturelle de l’homme mais, sous la forme du contraste (accès véridique à ce qui est vrai), elle renvoie à son contraire, le mensonge, c’est‑à‑dire à la capacité et la propension de l’être humain à se leurrer. Effet et construction d’un système sémiotique, l’analyse des émotions permet d’interpréter les usages qu’une société en fait et les valeurs qu’elle lui confère, deux formes de récupération,en quelque sorte, de l’émotion par l’intellect qui retrouve ainsi sinon une mainmise sur elle, du moins sa place auprès d’elle. La littérature réinvestit, pour sa part, ces émotions sous la forme des passions, dont l’une des expressions les plus archétypales, et probablement les plus rentables, est le « crime passionnel », comme pour nous rassurer sur notre capacité à commettre l’extrême (Racine). Les disputes et controverses des critiques entre eux montrent bien que l’appropriation d’un texte (en délivrant son sens) est une captation et un ravissement, autrement dit une forme de pouvoir symbolique : le texte doit émouvoir, de même que le critique doit emporter l’adhésion du public. Retenons pour l’heure trois des motifs majeurs de la critique racinienne : le ravissement (Doubrovsky), l’étonnement (Barthes) et la sidération (Starobinski). Le propre du héros racinien, selon Roland Barthes, consiste à s’autoriser à « convertir la passion en droit » ; « le rapport d’autorité est extensif au rapport amoureux10 ». Néron représente la fusion (confusion) de la passion et du pouvoir. Les premiers mots sur scène de Néron sont des ordres : « Pour la dernière fois, qu’il s’éloigne, qu’il parte,/ Je le veux, je l’ordonne » (v. 368‑369) ; ils font écho à Corneille faisant dire (sans complexe) à Auguste : « Je suis maître de moi comme de l’univers ;/ Je le suis, je veux l’être » (Cinna, v. 1696‑1697), vers qui fascineront les critiques et les écrivains. Ce n’est pas un hasard que Doubrovsky se soit tant attaché à la dialectique du héros chez Corneille. Ce vers est emblématique de sa propre fascination envers la toute-puissance de la volonté du héros cornélien, mais également de sa propre démarche critique en tant que dé-monstration du culte cornélien de la maîtrise, du fait que le héros cornélien confond (subordonne) son existence à sa volonté et que sa nature héroïque tient à cette évidente identification de l’être et du vouloir. Dès lors, le célèbre conflit cornélien de la passion (qui est d’abord corporelle, l’émotion ayant besoin du corps pour s’épancher) etdela volonté (qui dépend de l’âme) est aussi une représentation théâtralisée de la puissance émotionnelle de la littérature. Le théâtre du xviie siècle a mis l’émotion au premier plan de sa scène, postulant tout un héritage de la purgation des passions, qu’il s’évertue à maîtriser par un système de codification théâtrale particulièrement contraignant. Britannicus concrétise et sublime de façon exemplaire les enjeux esthétiques mais aussi moraux d’un théâtre classique qualifié par l’émotion et la puissance : « Écrire classique, c’est vouloir être en même temps l’agent d’une domination et l’objet d’un amour11 », autrement dit, c’est unir la poétique au pouvoir.
4« Commandez qu’on vous aime, et vous serez aimé » (v. 458) : peu importe, sans doute, que ce conseil de Narcisse à Néron soit si démesurément improbable, il ne peut que réjouir le public, tant il satisfait simultanément chez lui son désir de pouvoir et sa demande d’amour, se faisant gratification érotique et dessein politique. Mais ces deux conjonctions privent aussi le sujet de sa liberté ; il ne peut plus choisir, puisqu’il lui faut les deux : « il n’y a pas amour ou pouvoir, il y a amour et pouvoir. Désir et demande exigent une convergence que Narcisse, d’ailleurs, sait fort bien être impossible, et qu’en analyste pervers, il propose comme un leurre12 ». Racine invente un Néron qui y croit, ordonnantdoncl’impossible : « Éloigné de ses yeux j’ordonne, je menace » (v. 496). Mais cet avis de Narcisse à Néron est aussi la plus belle expression d’une « toute-croyance » en la puissance des mots sur les êtres, formidable et terrible mise en pratique d’une rhétorique qui « ordonne sa lecture13 », pour reprendre l’expression de Michel Charles. Comme si les pouvoirs de Néron sur les autres étaient infinis : illusion (ou erreur d’interprétation) que corrobore Burrhus dans une affirmation aux accents tout de même bien cornéliens : « On n’aime point, Seigneur, si l’on ne veut aimer » (v. 790).
2. « Madame, en le voyant, songez que je vous voi » (v. 690)
5Dans son commentaire de Britannicus, Serge Doubrovsky prolonge les analyses du Sur Racine de Barthes, dans un enchâssement critique qui est aussi l’un des pouvoirs discursifs de l’émotion sur la raison. Il s’attarde plus précisément sur cette « impuissance verbale » de Néron, sa perte de voix face à Junie, dont il fait le revers de la toute-puissance maternelle, révélatrice « de la pensée infantile et des régimes totalitaires14 ». Racine toutefois a conféré un (grand) plaisir à Néron, celui de la pulsion scopique que Doubrovsky qualifie de « dernière jouissance à consommer15 ». Racine dénonce les séduisants leurres (appâts) d’un « État-spectacle16 » qui joue des effets de captation d’un spectateur (voyeur) : « Madame, en le voyant, songez que je vous voi » (v. 690), déclare Néron à Junie. Le bénéfice est double pour l’auteur : il puise ses ressorts esthétiques dans l’érotisation d’un « plaisir de nuire ». « Scénographie sadique de Néron17 », commente Doubrovsky, qui n’est autre qu’une revanche sur l’enfance (sur Agrippine), renversant ce rapport de force en un « plaisir pris à l’exercice de la domination18 ». Junie est d’autant plus en son pouvoir qu’elle exerce un effet sur les images de Néron. Or « l’assujettissement de l’éros au pouvoir » et « la médiation de l’image pour assurer la jouissance19 » métaphorisent aussi certaines des spéculations et des abus de la critique à l’égard de la littérature. S’appuyant sur un lexique de la représentation et de la vue, Starobinski, dans L’Œil vivant, s’est attaché plus particulièrement à la place de la pulsion scopique dans le pouvoir sensuel de la littérature : « Voir ouvre tout l’espace au désir, mais voir ne suffit pas au désir. L’espace visible atteste à la fois ma puissance de découvrir et mon impuissance d’atteindre20. » La vision est le sens intermédiaire et intercesseur qui rend lisibles la nature et l’épanchement des émotions, elle atteste par là même leur puissance sur l’homme. Ainsi, « voir désigne un élan affectif incontrôlé, l’acte d’une convoitise qui se repaît amoureusement, insatiablement, de la présence de l’être désiré, dans la hantise du malheur imminent, et dans le pressentiment d’une malédiction ou d’une punition attachée à cette vue passionnée. Le verbe voir, chez Racine, contient ce battement sémantique entre le trouble et la clarté, entre le savoir et l’égarement21. » Non seulement voir contient cette interaction entre émotion et puissance, mais par sa façon même d’écrire et de critiquer, Starobinski reprend à son compte cette dualité : force rhétorique et explicative de ses analyses et immense séduction de sa parole. Il est l’un de ceux qui ont fait de l’activité critique l’espace discursif du primat des sens. Significativement, il revient, à la fin de son introduction intitulée « Le voile de Poppée », sur la fonction du critique, qu’il qualifie de « regard surplombant » et d’« intuition identifiante » : « Il ne faut refuser ni le vertige de la distance, ni celui de la proximité : il faut désirer ce double excès où le regard est chaque fois près de perdre tout pouvoir22. » Toute l’ambivalence de la posture critique est signifiée dans ce rêve de réciprocité, de face-à-face et d’immédiateté, alors même que la relation critique est forcément dissymétrique et diachronique : « Il n’est pas facile de garder les yeux ouverts pour accueillir le regard qui nous cherche23 », conclut Starobinski. La structure théâtrale décuple la puissance critique qui se complaît dans cette théâtralisation. Si la nature scénique du pouvoir repose très exactement sur la force des compensations narcissiques qu’elle peut prodiguer, peut-on affirmer pour autant qu’elle en révèle la nature ? Plaisir d’une dénégation qui ne signifierait pas forcément que le sujet doive lutter contre elle (Néron revenant sur ce qu’il vient de déclarer : « Que dis-je ? »), mais qui s’offre plutôt le luxe (le plaisir) de s’assumer comme dénégation. Cette impuissance verbale est aussi « la chance du fantasme24 », en ce qu’il est une des incarnations de l’idée de puissance (posséder l’objet comme par magie). Néron entend exercer son autorité sur le domaine érotique et sentimental, il cherche à assouvir « l’érotisation de son sentiment de pouvoir25 », grâce à la « puissance de captation » exercée par « l’image de sa domination26 ». Certains critiques, comme Doubrovsky et Jackson, se saisissent alors du terme racinien d’« idole », soulignant ce contrôle d’autrui par l’image qui révèle autant la fascination qu’exerce celle-ci que sa puissance de captation. Néron peut bien exhiber un « désir d’exercer le pouvoir, […] par fascination spectaculaire, de se constituer en idole27 », ce n’est jamais qu’un repli compensatoire : « le seul moyen, si l’on veut exercer la toute-puissance sur un ou des sujets impuissants, c’est de se constituer, pour eux, en idole. L’expérience amoureuse, dûment comprise et retournée, se convertit en leçon politique28 ». Mais la première ne vaut que pour autant qu’elle permet de pallier les déficiences, sinon les échecs, de la seconde. Doubrovsky cite alors le vers de Néron : « J’aime (que dis-je aimer ?) j’idolâtre Junie » (v. 384). L’idolâtrie est une captation exponentielle, « prise et surprise, vue médusante29 », une séquestration visuelle qui s’emballe. La paralysie est l’envers (le contraire) de l’émotion, et la puissance, elle, résulte, selon Freud dans ses Essais de psychanalyse30, de l’influence exercée par une personne toute-puissante sur un sujet impuissant. La conjonction du fantasme et de l’idole provoque la fétichisation du pouvoir, tout en permettant son esthétisation. Le fantasme se reverse en une pulsion scopique qui prend la forme d’une revanche voyeuriste à la fois érotisée et obsessionnelle — qui n’est autre que la définition du pouvoir littéraire. Néron joue d’une « médiation dans l’assouvissement du sentiment de puissance31 ». Charles Mauron — que cite Doubrovsky — souligne à quel point le public est voyeur des tourments de la jeune héroïne : « Néron derrière son rideau regarde voluptueusement souffrir Junie ; mais nous la regardons aussi, et Racine l’a regardée plus que personne32. » Freud insiste sur le renversement de l’actif au passif de la pulsion scopique : en regardant l’autre, je manifeste mon désir d’être regardé par l’autre ; l’autre vient ainsi à la place du sujet désiré ; c’est la forme narcissique de la pulsion scopique33. Le sujet qui voit l’autre ne se situe pas à sa place, mais il est représenté dans et par l’autre, ainsi l’activité de l’autre lui apparaît comme la sienne propre, et c’est seulement dans cette image qu’il peut se figurer comme désiré. Le critique joue en cela un rôle de premier plan, il « vient à son tour inscrire sa jouissance de la tragédie jouissant d’elle-même. Fantasme alors devenu réalité, créant l’objet d’un plaisir irremplaçable : jouir de jouer (se jouer, faire jouer, être joué)34 ». Se dévoilent la nature et l’efficace d’un critique initiant le lecteur et chargé d’authentifier ses fantasmes ; sa force et son pouvoir sont à leur comble, puisque c’est sa jouissance qui devient référentielle et mimétique : non seulement elle sert de modèle à toutes les autres, mais elle les légitime et les authentifie.
3. « Parlez. Nous sommes seuls » (v. 709)
6« Comment lire la critique ? » se demande Barthes, sinon comme un « lecteur au second degré », acceptant d’être le voyeur d’un plaisir pris par autrui ? « [J]’observe clandestinement le plaisir de l’autre, j’entre dans la perversion ; le commentaire devient alors à mes yeux un texte, une fiction, une enveloppe fissurée. Perversité de l’écrivain (son plaisir d’écrire est sans fonction), double et triple perversité du critique et de son lecteur, à l’infini35. » Et lorsque le critique, disant son plaisir (ou son déplaisir, mais c’est la même chose), laisse parler ses pulsions, c’est toute son activité intellectuelle qui prend la forme d’une transgression. Critique par principe conflictuelle puisqu’elle provoque le surgissement du refoulé : la satisfaction de la pulsion nécessite d’être déplacée pour pouvoir s’observer elle-même : le sadique est aussi le voyeur de son propre plaisir. « Vous êtes en des lieux tout pleins de sa puissance./ Ces murs mêmes, Seigneur, peuvent avoir des yeux,/ Et jamais l’empereur n’est absent de ces lieux » (v. 712-714). Comment Junie pourrait-elle être plus claire ? Junie, explique Barthes, « retourne le malheur de Britannicus en grâce et le pouvoir de Néron en impuissance, l’avoir en nullité, et le dénuement en être36 ». Comment ne pas entendre aussi dans cette réplique de Junie les pouvoirs de Néron, l’efficacité de son stratagème et la puissance de sa vengeance ? « La manipulation d’autrui exige du manipulateur qu’il fasse accepter à l’autre son désir à soi comme désir de l’autre et, inversement, que le manipulé prenne le désir de l’autre pour son propre désir37. » La passion est perçue comme une altérité faite à soi même, comme s’il fallait associer la passion et les autres pour l’extérioriser (et projeter loin de soi son pouvoir). En cela, elle est « une mainmise sur autrui, une mainmise destinée à maintenir l’autre dans sa fonction de miroir, dans la fonction spéculaire qui serait la sienne, et qu’on pourrait résumer dans une formule du type : “Je t’aime passionnément afin que tu me renvoies une image positive de moi-même38” ». De sorte que régner sur ses passions ne peut se faire sans les autres et que se maîtriser comporte toujours une gratification sociale et un impact communautaire, comme le rappelle Foucault dans L’Usage des plaisirs de son Histoire de la sexualité.
Parlez. Nous sommes seuls. Notre ennemi trompé
Tandis que je vous parle est ailleurs occupé.
Ménageons les moments de cette heureuse absence. (v. 709‑711)
7Le plaisir du spectateur est redoublé par l’incapacité de Britannicus à comprendre que « dans le monde intégralement politisé de la Cour, les relations d’éros sont inséparables de la lutte pour le pouvoir39 ». Britannicus est « coupable d’aveuglement40 » selon John E. Jackson : il ne voit pas ce qui saute aux yeux, piètre herméneute des émotions de Junie, incapable de décoder les doubles sens, les connotations et les implicites de ses répliques… Britannicus ne connaît pas la sémiotique, encore moins l’herméneutique, activité interprétative dont le spectateur profite pleinement. Le dramaturge expérimente scéniquement deux types de lecteur (critique). Néron, qui n’est pas aimé de Junie, en profite pleinement. Il excelle et jouit littéralement du spectacle des signes que celle-ci lui offre (il sait capturer des images dont son imagination bénéficie explicitement et il en tire du plaisir), quand Britannicus, l’heureux élu, ne sait qu’en faire. Néron le bon critique quand Britannicus serait le mauvais ? Est-ce à dire que l’amour ne serait donc ni un gage ni un guide herméneutique, qu’il serait donc insuffisamment signifiant ? S’opposent ainsi à une « critique sémantique» ce qu’Umberto Eco qualifie de « critique sémiosique », c’est-à-dire le « processus par lequel le destinataire, face à la manifestation linéaire du texte, la remplit de sens41 », et une « critique sémiotique », qui explique « pour quelles raisons structurales le texte peut produire ces interprétations sémantiques (ou d’autres, alternatives)42 ». Repoussé par Junie, Néron transforme ce rejet en un moteur dramatique extraordinaire, puisqu’il l’enlève à Britannicus. « La structure du désir est triangulaire : elle va du moi au moi par l’autre, du mâle au mâle par la femelle ; dans le monde racinien comme dans le monde freudien, il n’est de libido que phallique […]43. » Paralysie, fantasme et voyeurisme : ces modalités émotionnelles apparemment passives se traduisent par un rapt dont le corollaire esthétique et érotique est le ravissement, tous deux révélateurs des enjeux critiques de cette pièce. La critique a souvent vu dans la surpuissance manipulatrice et sadique de Néron un conflit des identifications sexuelles : « les rôles sexuels se distribuent, l’actif et le passif s’ordonnent au paradigme parler/obéir/se taire44 ». Et si dans cette pièce, c’est Agrippine (mère castratrice par excellence) qui incarne le fantasme d’une toute-puissance, elle n’en parle qu’à l’imparfait : « Et que derrière un voile, invisible, et présente/ J’étais de ce grand corps l’âme toute-puissante » (v. 95‑96). Agrippine, dépourvue d’affects, entend conserver le pouvoir qui opère sur elle comme une « compensation érotique » : d’un point de vue verbal, cette interaction passe par une métaphore d’un corps devenu le substitut de l’État : « Le Sénat fut séduit. Une loi moins sévère/ Mit Claude dans mon lit, et Rome à mes genoux » (v. 1136‑1137). Le processus s’inverse avec Junie, elle lit et interprète par cette émotion qui manque précisément à Agrippine pour garder toute sa lucidité (et donc rester en vie). Les qualités du critique seraient-elles donc d’être émotionnellement assujetti, contestable mais sagace ? Les rapports d’Éros et du pouvoir sont des rapports conflictuels : soit le conflit est l’indice d’un antagonisme propre à ces deux instances, soit il révèle leur solidarité véritable45. Avancer que l’un impose de renoncer à l’autre peut signifier deux choses : soit que l’un exclut l’autre, soit que le choix n’est crucial que du fait de leur trop grande proximité, d’où la tendance ou le désir de les confondre.
8« Dans ce qu’il écrit, chacun défend sa sexualité46 », écrit Roland Barthes : « Les images de la virilité sont mouvantes […]47. » La tentation (l’écart) entre un Barthes écrivant le plaisir (Le Plaisir du texte, ou Fragments d’un discours amoureux) et celui du Degré zéro de l’écriture n’est pas seulement à saisir la démarche d’un jeune critique cherchant à faire ses preuves théoriques, à s’écarter de la norme en transgressant un héritage critique classique. Qu’il s’agisse de S/Z ou encore de Sur Racine48, Barthes subvertit l’analyse critique des œuvres classiques par l’émotion, les sentiments, mais aussi la sexualisation de son écriture. Doubrovsky qualifie la critique barthésienne de « zone érogène » de la littérature49, appelant à sa rescousse le mot de Sartre dans Situations, II : « le rapport de l’auteur au lecteur est analogue à celui du mâle à la femelle50 » ; en sexualisant cette relation et en lui conférant une différence générique, Sartre laisse entendre que la littérature est toujours une émanation des pouvoirs de la libido. Pierre Bourdieu a mis en évidence, dans La Domination masculine, les ambivalences de la sexualité et des fantasmes de possession qu’on lui associe, et qui correspondent à la « somatisation des rapports sociaux de domination51 ». Le désir masculin est possession ou domination érotique, quand la libido féminine est « désir de la domination masculine, comme subordination érotisée, ou même, à la limite, comme reconnaissance érotisée de la domination52 » ; notre vision du monde divisée « en genres relationnels, masculin et féminin53 », en dérive exactement. La société légitime ainsi « une relation de domination en l’inscrivant dans une nature biologique qui est elle-même une construction sociale naturalisée54 ». En distinguant émotion et puissance et en séparant implicitement le féminin (du côté de l’émotion) et le masculin (du côté de la puissance), Doubrovsky dénonce ainsi « l’agressivité phallique », « l’arrogance systématique du discours autocratique et autosuffisant », quand l’écriture au féminin serait davantage « déstructuration, déconstruction du Logos55 ». Freud, dans sa leçon consacré à « La féminité56 », fait du masochisme un trait constitutif du féminin que Doubrovsky oppose au « sadisme57 » de la masculinité de l’écriture barthésienne, s’appuyant sur une phrase de Barthes dans La Chambre claire : « Il me fallait convenir que mon plaisir était un médiateur imparfait », la mort de la mère est vécue (ou plutôt écrite) comme une perte de la « féminité ultime, biologique ». « Chez Barthes, le style de Barthes est tout entier au masculin, l’écriture est tout entière féminine58 », écrit Doubrovsky. Barthes rend masculine la jouissance et l’oppose à l’émotion qu’il range du côté du féminin : cette opposition ne reprendrait-elle pas la distinction qu’il effectue entre plaisir et jouissance ? La critique, entre lecture et écriture, se positionne au croisement des tensions entre masculin et féminin, entre jouissance et plaisir :
L’émotion : pourquoi serait-elle antipathique à la jouissance (je la voyais à tort tout entière du côté de la sentimentalité, de l’illusion morale) ? C’est un trouble, une lisière d’évanouissement : quelque chose de pervers, sous des dehors bien-pensants ; c’est même, peut-être, la plus retorse des pertes, car elle contredit la règle générale, qui veut donner à la jouissance une figure fixe : forte, violente, crue : quelque chose de nécessairement musclé, tendu, phallique59.
4. « Elle va donc bientôt pleurer Britannicus ? » (v. 1311)
9Est-ce à dire que la littérature partage avec les femmes la modalité la plus visible et la plus littérale de l’émotion : les larmes ? « Depuis quand les hommes (et non les femmes) ne pleurent-ils plus ? Pourquoi la “sensibilité” est-elle à un certain moment retournée en “sensiblerie60” ? » Britannicus est « un prince qui pleure », rappelle Narcisse à Néron ; or non seulement les larmes vont à l’encontre de la virilité (vis : la force), mais elles sont perçues (interprétées) comme une faiblesse. Volontiers attribuées aux lectrices ou aux spectatrices, elles connotent un certain discours politique et social. En tant que débordement d’émotions,elles reflètent la façon dont nous utilisons notre image. En pleurant, nous affirmons « un être autre » qui est en réalité une façon d’affirmer un « n’être pas » (pour ne pas assumer la responsabilité de nos actes ou paroles) : les larmes participent donc de la stratégie d’un sujet qui se ment à lui-même pour mieux se défaire de ses responsabilités et de sa culpabilité. Et parce que les femmes sont plus émotives que leshommes, elles apprennent à contrôler et à négocier le pouvoir, montrant ainsi qu’elles n’ont pas besoin de contrôle externe. Freud fait de la culture une instance qui relie libidinalement les membres de la communauté les uns aux autres, de sorte qu’Éros est structurellement confronté à la loi avec laquelle il doit sans cesse composer ou ruser61. L’être humain détourne une partie de l’énergie de la pulsion sexuelle (ou de ses pulsions dérivées, comme la pulsion scopique) et l’emploie à des travaux intellectuels ou artistiques auxquels la culture accorde, sous une forme ou une autre, une rétribution. La sublimation est un des effets de culture, elle permet de se réapproprier des pulsions en les transformant en modalités créatrices. Si les pulsions ne sont pas de l’ordre de la morale, elles portent cependant ce que Nietzsche appelle « l’empreinte de nos évaluations62 ». La prééminence des instincts doit interroger aussi leurs conditions d’apparition et les valeurs qu’ils recouvrent. De sorte que si les larmes sont un des stéréotypes émotionnels de la littérature, elles opèrent également comme un signal social et mimétique pour le lecteur, comme pour le convaincre par avance que le livre a atteint sa cible. Répondant à la question de Narcisse : « Vous l’aimez ? », Néron évoque les larmes de Junie, à défaut de conquérir son cœur. Ses larmes sont l’emblème de son pouvoir auctorial : « Excité d’un désir curieux/ Cette nuit je l’ai vue arriver en ces lieux,/ Triste, levant au Ciel ses yeux mouillés de larmes,/ Qui brillaient au travers des flambeaux et des armes » (v. 385-388). Les larmes, souligne Jackson, « donnent à celui qui les perçoit un pouvoir sur celui qui les verse. Pleurer devant autrui, c’est à la fois lui avouer une émotion véritable et lui demander consolation, c’est manifester une transparence intérieure sur laquelle l’autre pourra dès lors choisir d’exercer ou non sa puissance63 ». Si Britannicus et Junie, lors de leur dernière entrevue (acte V, scène i), pleurent l’un devant l’autre dans une réciprocité amoureuse chère à la littérature des sentiments, leurs larmes diffèrent dans leurs causes : Junie pleure des dangers du pouvoir, des implications politiques de la focalisation fantasmatico-érotique de Néron ; quand Britannicus sanglote (un peu) sur son sort. Nul besoin de rappeler que Barthes, dans ses Fragments d’un discours amoureux, a fait l’« Éloge des larmes ». Pleurer, c’est d’abord « impressionner quelqu’un, faire pression sur lui (“Vois ce que tu fais de moi64”) ». En exerçant ce chantage, les larmes sont cette instrumentalisation des émotions qui signe (comme une signature) un pouvoir qui s’exerce subrepticement, de biais, non par l’argumentation mais par l’émotion. Mais pleurer, c’est aussi faire l’épreuve d’un pouvoir sur soi-même, c’est se laisser prendre par ses propres sentiments. Je pleure pour me prouver que ma douleur n’est pas une illusion : « les larmes sont des signes, non des expressions. Par mes larmes, je raconte une histoire, je produis un mythe de la douleur, et dès lors je m’en accommode : je puis vivre avec elle, parce que, en pleurant, je me donne un interlocuteur empathique qui recueille le plus “vrai” des messages, celui de mon corps, non celui de ma langue : “Les paroles, que sont-elles ? Une larme en dira plus65” ». Les larmes rendent visibles le pouvoir de l’illusion et la puissance affabulatrice de l’être humain, son goût des histoires valant sans doute autant que la séduction des images. Si les larmes diffèrent encore au théâtre selon qu’elles sont dites ou jouées, Jean-Paul Sartre rappelle toutefois, dans Esquisse d’une théorie des émotions, qu’un acteur qui pleure sur scène pleure toujours vraiment : « Si l’émotion est un jeu, c’est un jeu auquel nous croyons66. » Articulant l’émotion à la croyance en soulignant la dimension ludique et contagieuse de l’émotion, il déjoue et disqualifie par avance nos présupposés sceptiques d’une émotion provoquée : « La véritable émotion est tout autre : elle s’accompagne de croyance67. » L’émotion peut bien être subie, on choisit toutefois d’y croire, se soumettant aux modalités, aux impératifs et aux conséquences de cette adhésion. Le pari des émotions littéraires va consister à rendre visible ce qui est lisible, rendant ainsi les émotions à leur nature première : le corps. Mais la lisibilité de l’émotion renvoie aussi à une modalité sociale. L’émotion peut aussi bien trahir le sujet en se reversant sur lui. Au critique de départager les émotions (en les hiérarchisant) : il les verbalise, les qualifie et les interprète, autrement dit il leur donne du sens et des valeurs, effectuant un rapprochement entre les émotions fictives du texte et celles, réelles, du lecteur : il les rationalise, mais il les permet et les valorise également.Cette différence est emblématique de l’écart entre le pouvoir de la littérature et les moyens dont dispose la critique pour se faire aimer — fantasme qui est à même de provoquer de vraies larmes. Comme l’écrit Barthes dans Critique et vérité,« non point : faites-moi croire à ce que vous dites, mais plus encore : faites-moi croire à votre décision de le dire68 ».
10Les larmes du critique sont sans doute moins l’expression d’un quelconque abandon que la volonté de vérification d’un pouvoir sur la littérature. Ce qui se joue dans cette interaction entre émotion et puissance, c’est aussi la question de la forme et du genre, ou plus exactement le choix d’une forme par rapport à une esthétique, rapport qui se noue autour de la notion de genre (générique et sexuel) et de la nature du plaisir de lecture. On pourrait donc choisir dans ou par l’écriture de son genre sexuel, mais aussi dans ou par sa lecture ? Comme l’écrit Barthes que cite Doubrovsky, « le sens et le sexe deviennent l’objet d’un jeu libre, au sein duquel les formes (polysémiques) et les pratiques (sensuelles), libérées de la prison binaire, vont se mettre en état d’expansion infinie. Ainsi peuvent naître un texte gongorien et une sexualité heureuse69 », signes d’une « volonté de jouissance70 » que la critique convoite à la littérature et qu’elle entend lui prendre, parfois de plein gré, parfois de force, parfois en cachette. Barthes envisage la critique en termes de plaisir pris ou reçu (et non pas donné) : est-ce à dire que la critique ne pourrait accéder à la jouissance ? La critique« porte toujours sur des textes de plaisir, jamais sur des textes de jouissance71 », parce que l’activité critique est justement prise dans « une visée tactique, un usage social et bien souvent une couverture imaginaire72 ». Le « texte de plaisir […] contente, emplit, donne de l’euphorie ; celui qui vient de la culture, ne rompt pas avec elle, est lié à une pratique confortable de la lecture. Texte de jouissance : celui qui met en état de perte, celui qui déconforte73 ». C’est donc cet « état » que convoiterait, que jalouserait même la critique ? Le pouvoir émotionnel de la littérature tient à la façon dont elle laisse affleurer les processus primaires dans les processus secondaires, quand l’écrivain superpose à la scène ordinaire de la conscience « l’autre scène » (celle de notre inconscient). Lieu de décharge et de compensation narcissique, la littérature intercale entre les pulsions et les passions « la surface doublement réfléchissante d’un langage qui a, en même temps, la fonction d’un trait d’union » ; le « monde des pulsions » donne ainsi son sens à l’existence même de l’organisation de la conscience74. La critique reproduit cette ambivalence fondatrice des instincts et des affects qui sont le résultat d’une élaboration intellectuelle opérée par un processus corporel (comme un besoin de se reprendre ou de se ressaisir).
Ce sont nos besoins qui interprètent le monde : nos instincts, leur pour et leur contre. Chaque instinct est un certain besoin de domination, chacun possède sa perspective qu’il voudrait imposer comme norme à tous les autres instincts75.
11Selon Nietzsche, les pulsions interagissent en fonction de l’autorité qu’elles ont les unes sur les autres. Elles évaluent leurs rapports de force et elles reconnaissent leur maître. Les pulsions ne se déclenchent que si la structure hiérarchique ou les rapports de force en présence rendent probable l’exécution de l’ordre (donc de l’obéissance) : « Tout le phénomène de la volonté repose ainsi sur une logique de la passion et du commandement76. » Ce sont donc les pulsions qui déclenchent le processus de la volonté, et non l’inverse comme le croyait la tradition philosophique. L’affect (l’émotion) est autant affaire de sensibilité (capacité à être affecté) que capacité d’agir ou de commander, c’est-à-dire d’affecter de manière contraignante. Unir émotion et puissance est donc loin d’être saugrenu. La singularité du théâtre racinien tient à ce qu’il est fondé sur une « relation d’autorité », mais que « cette relation se mène, non seulement hors de toute société, mais même hors de toute socialité77 ». Or « la nature exacte du rapport d’autorité » mérite selon Barthes d’être précisée, elle n’est pas seulement une question de puissance ni d’abus de pouvoir : « A est coupable, B est innocent. Mais comme il est intolérable que la puissance soit injuste, B prend sur lui la faute de A : le rapport oppressif se retourne en rapport punitif, sans que pourtant cesse jamais entre les deux partenaires tout un jeu personnel de blasphèmes, de feintes, de ruptures et de réconciliations. Car l’aveu de B n’est pas une oblation généreuse : il est la terreur d’ouvrir les yeux sur le Père coupable78 », c’est-à-dire la Loi, c’est-à-dire l’Autorité. C’est Néron faisant l’aveu d’amour, c’est la relation triangulaire qu’il impose à Junie et Britannicus, mais c’est aussi le rapport des critiques contemporains à la pièce de Racine, et leur aveu d’une fascination non encore assouvie. En filigrane se pose la question de l’autorité en tant qu’« articulation entre les passions du moi et les passions de l’autre79 ». Platon explique dans le Gorgias (491d-e) que l’autorité est celle que l’on exerce sur ses plaisirs et sur ses passions, de sorte qu’il subordonne l’âme et la passion à un problème politique80. C’est le politique qui confère ainsi à la passion sa forme particulière. Un parallèle avec l’autorité littéraire semble s’imposer, tant ces données se transfèrent aisément dans le champ littéraire. Les émotions sont aussi « des moyens utilisés par des tendances inconscientes pour se satisfaire symboliquement, pour rompre un état de tension insupportable81 ». L’émotion peut également être considérée comme une réponse à des modalités inconscientes, elle est alors perçue comme un phénomène de refus ou de censure, exprimant une tension qui n’a pas conscience de sa signification, elle est mue par « un lien de causalité » et « un lien de compréhension82 ». Le paradoxe de l’émotion tient à la réunion des deux positions : on a conscience de l’émotion comme structure affective de la conscience, et en même temps « la conscience émotionnelle est d’abord irréfléchie83 ». En cela, perdure toujours une part médiatique de négociation et de rétribution dans l’émotion : « Passer de la lecture à la critique, c’est changer de désir, c’est désirer non plus l’œuvre, mais son propre langage. Mais par là‑même aussi, c’est renvoyer l’œuvre au désir de l’écriture, dont elle était sortie84. » Si on a tant fustigé le pouvoir de la critique, capable de faire ou défaire une carrière littéraire (pouvoir sans doute plus fantasmatique que réel), ce fantasme même est révélateur d’une tension entre émotion et raison perçue justement comme un enjeu de pouvoir, conférant au critique son aura et sa puissance. Et s’il profite tant des deux, c’est parce qu’il s’est dispensé de l’obligation de choisir.