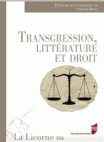
Représentation du droit, Interprétation de la littérature
1Épistémocritique dans son inspiration, ce volume dirigé par Christine Baron fait d’hétérogénéité vertu et s’efforce de faire dialoguer deux disciplines différentes par le détour d’une notion, la transgression, qui est aussi celle des frontières des deux champs — et son symétrique inarticulé : la censure. Mais l’ordre que le titre assigne aux notions indique d’emblée une hiérarchie : la littérature est le sujet de la réflexion, le droit, son objet. Cette subordination détermine les deux axes principaux du volume : la transgression du droit dans la littérature, la transgression du droit par la littérature. Soit deux définitions de la littérature, comme forme, comme force. Comme forme, la littérature accueille la transgression pour lui ouvrir un espace de réflexion. Comme force, la littérature transgresse le droit pour le provoquer ou le nier. Absente du titre, et pourtant tiers terme essentiel comme le montrent les contributions les plus intéressantes, l’éthique est, au moins autant que la transgression, le lieu le plus fécond de l’articulation entre littérature et droit, tant l’éthique est, non pas ce qui le fonde, mais ce qui le garde. À cet égard, l’occultation du point de vue éthique dans les articles les plus empreints d’un juridisme strict, si elle est cohérente, n’est pas sans poser question.
2Parcourant un vaste spectre (de l’étude de cas à la réflexion juridique en passant par la biographie intellectuelle) et couvrant un champ historique large (de l’Antiquité à la littérature immédiatement contemporaine, avec une prédilection néanmoins pour les années 1960-1970, peut-être en raison d’une transformation de la censure, dont plusieurs articles rendent compte), le volume nourrit un dialogue toujours fécond non seulement entre deux disciplines différentes mais aussi des approches diverses (historiques, philosophiques, sociologiques, etc.), qui ne cèdent jamais à la tentation de la simplification schématique ni à celle de l’assimilation d’une discipline par l’autre.
3En vertu d’un usage établi, mais toujours un peu artificiel, le volume regroupe les contributions dans quatre parties : la première, « Lieux de passages : évaluer la transgression », est consacrée à la question de la censure, légale ou religieuse, envisagée d’un point de vue théorique ou appliqué ; la seconde, « Légalité et légitimité : les périodes classiques », qui conjoint classification typologique et périodisation historique sans que la nécessité de leur association apparaisse clairement, s’intéresse à la tension entre morale et droit. C’est encore le cas dans la suivante, « Normes juridiques et normes politiques », mais avec une insistance plus marquée sur les moments du conflit ou de la délibération, qu’ils soient intimes (le cas de conscience) ou juridiques (le temps du procès). Une dernière partie, « Apories et paradoxes de la transgression », plus réflexive, s’efforce de préciser les conditions de possibilité — et d’impossibilité — du dialogue, où la mauvaise foi de l’écrivain (Sade, de façon emblématique) le dispute à l’incompétence du juriste (la question épineuse de la prise en compte de la spécificité du fait littéraire par le droit).
4Ce n’est pas cet ordre pourtant que nous privilégions dans notre présentation : une logique seconde, plus souterraine, parcourt en effet le volume et permet de lier autrement les études en les regroupant cette fois sous l’égide de deux catégories seulement. Le premier enjeu est celui de l’écriture du droit, entendue à la fois comme l’étude du traitement par le droit de l’objet littérature, sous la forme des limites assignées à la liberté d’expression, ou encore du scandale, et comme la mise en scène du droit dans la littérature. On notera à cet égard que le moment du procès, surreprésenté dans les cas étudiés ici (5 études sur 12), reste le lieu privilégié de la représentation du droit dans la littérature, sans doute parce qu’il est un moment éminemment romanesque. Il n’est pas sûr pour autant qu’il soit le lieu le plus propice, puisqu’il réduit le droit à un appareil et un apparat, entre agôn et dramatisation théâtrale, sans prendre en compte la spécificité de son écriture précisément, et les modèles et logiques herméneutiques qui le sous-tendent. Le second axe est consacré à l’esthétique et l’herméneutique de la transgression, il regroupe les études qui rapprochent, et en fait confrontent, les deux paradigmes et leurs éventuels débordements, que la notion de transgression permet de nouer.
L’écriture du droit
Aporie du juridisme
5« L’interprétation juridictionnelle d’un texte fictionnel » rappelle que l’art ne bénéficie d’aucun privilège d’extraterritorialité et explique, dans une vigoureuse discussion des thèses d’A. Tricoire (Petit traité de la liberté de création, 2011), pourquoi l’art est limité par les dispositions qui régissent la liberté d’expression. Balayant rapidement — et peut-être trop rapidement — les thèses de l’autotélisme et de l’autoréférentialité en s’appuyant sur Le Démon de la théorie (1998) d’Antoine Compagnon convoqué ici comme autorité, Thomas Hoffman rappelle, en concentrant son analyse sur la fiction littéraire, qu’un « écrit fictionnel » exprime des « opinions » et « véhicule des significations » (p. 27), qui sont susceptibles d’être jugées — sous réserve d’être explicitées par le recours à une série de fictions d’interprétation, qui définissent l’exégèse juridique comme une herméneutique et non une heuristique. Le juge doit ainsi imaginer la réception du texte litigieux à travers une « lecture standard » (p. 29) faite par un « lecteur moyen » (ibid.), qui sera aussi appelé « raisonnable » (p. 33) — sans que la tension entre ces deux termes soit développée —, qui ouvre sur une interprétation « prévisible » (p. 29). Mais ces critères d’évaluation, fondés sur les théories de la réception, n’empêchent pas qu’une conception plus ancienne soit violemment rabattue sur le pôle de la réception, et parasite le dispositif interprétatif, comme le montre par exemple l’évaluation juridique des propos de personnages fictionnels. Si Th. Hoffman rappelle que l’« intention de l’auteur » ne saurait entrer en ligne de compte car elle est « aussi indifférente qu’inaccessible » (p. 32), il affirme aussi, dans une contradiction qu’il ne relève pas, que « le juge doit établir si un lecteur moyen aurait considéré que les propos racistes étaient endossés par l’auteur, qu’ils étaient exprimés avec une “intention de sens” […] » (p. 33). L’intentio lectoris entre en conflit, insoluble, avec l’intentio auctoris (U. Eco) qui s’avère l’ultima ratio du paradigme interprétatif juridique.
Sans autre forme de procès
6« “Black people will judge me”. Le procès d’Amiri Baraka entre normes juridiques et normes poétiques » concentre son analyse sur le procès intenté à l’écrivain en 1967 à la suite des révoltes urbaines de Newark, où lui est reprochée la possession d’une arme (ou deux), et où l’un de ses poèmes est cité comme élément à charge. Ce moment consacre la radicalisation de l’écrivain : proche du mouvement Beatnik dans les années 1950, il épouse la cause du nationalisme noir après l’assassinat de Malcolm X en 1965, avant de rompre après son procès avec le progressisme blanc et de se rapprocher de la doctrine Kaxaida, « mélange d’islam orthodoxe et de religions africaines créé par l’intellectuel américain Ron Karenga » (p. 98). Ce moment est aussi celui d’une ré-invention de soi — LeRoi Jones devient Amiri Baraka — entre renaissance mystique, martyrologie révolutionnaire et élection divine : « Je me sentais transformé, littéralement propulsé dans l’œil de l’ouragan noir de la révolution à venir. J’avais traversé le feu et je n’avais pas été consumé » (p. 99). Dans le même temps, sa pratique littéraire évolue : connu jusqu’alors comme poète, il se fait dramaturge didactique pour mettre en scène son procès — et en cause la duplicité de la justice des Blancs. Parallèlement il affirme l’identité de la création et de la vie, rejetant l’autonomie de la littérature, dont Cyril Vettorato dit un peu rapidement qu’elle est la « vision de la littérature telle que nous la concevons, comme champ créatif autonome clairement distinct des discours du monde » (p. 104, et aussi p. 106 et p. 107). À cet égard, l’argument selon lequel Baraka est « sauvé » en appel par « l’autonomie du littéraire » (ibid.), puisque la lecture du poème engagé est supposée avoir indûment influencé les débats, est parfaitement réversible. Loin de consacrer l’autonomie de la littérature, elle peut se lire comme un argument en faveur de sa force et de son effectivité. « L’éloge de la désobéissance des filles dans la littérature patristique » examine, après un rappel de la position de l’Église au ive siècle selon laquelle le vœu de chasteté d’une fille est un motif légitime de rejet du mariage et de l’autorité du paterfamilias, deux versions du martyre de sainte Agnès en 305, qui refuse d’abjurer sa foi et du procès qui s’ensuit. La première version est rédigée par Ambroise vers 375, la seconde, par Prudence aux environs de 400. Dominique Lhuillier-Martinetti relève que dans la première version, le moment de la transgression de la loi fait l’objet d’une ellipse, qui s’explique par la proximité dans le temps du supplice, alors que la religion chrétienne a depuis triomphé :
Dans la société romaine officiellement christianisée de la fin du ive siècle il peut être délicat de rappeler la conduite des grands-parents dans de nombreuses familles, et pour la paix sociale mieux vaut oublier certains détails du passé. (p. 55)
7Prudence, qui écrit vingt‑cinq ans plus tard, n’a pas ce scrupule et met en scène un juge qualifié de « féroce tyran » (p. 56) ; il enrichit la scène d’un épisode, scabreux, où la vierge est menacée du lupanar, et lui prête enfin des propos à double entente où le supplice qu’elle appelle de ses vœux s’entend aussi comme métaphore d’un corps-à-corps érotique ardemment désiré. À la transgression juridique (le refus d’Agnès d’abjurer) fait donc écho, mais de façon contradictoire avec les buts hagiographiques de l’apologue, une transgression morale, qui fait de la martyre une femme ardente, et non plus une enfant, comme chez Ambroise. L’explication serait anthropologique : le récit est conforme aux théories médicales de l’Antiquité qui expliquent cet accès de fureur — qui peut être érotique ou suicidaire, comme la scène du supplice le dit dans son amphibologie — par une production de sang en excès à l’adolescence qui, empêché de s’écouler par l’hymen, reflue vers le cœur. Dans « Droit matrimonial et littérature sensible à l’âge classique. L’exemple des Époux malheureux de Baculard d’Arnaux », Gabrielle Vickermann-Ribémont souligne la concomitance entre le renforcement de la répression du mariage d’inclination qui s’oppose à la volonté paternelle (qualifié de « rapt par subordination » ou « de séduction ») et son accession au rang de thème majeur dans la littérature du xviiie siècle, notamment dans la comédie et le roman. Après avoir retracé, longuement, le procès dont s’inspire Baculard, elle montre comment ce dernier reprend et développe la dimension novatrice de la défense du fils La Bédoyère par lui‑même, fondée non seulement sur une argumentation juridique mais aussi sur un appel à la conscience des juges, à un rapport personnel à la loi, à l’émotion. Cette dimension reste pourtant marginale lors du procès, à la différence du roman, qui « poursuit une autre stratégie, clairement affichée : il ne déroule pas à nouveau les “faits” dans le sens du factum judiciaire, mais se concentre sur la représentation des sentiments, cette face cachée du plaidoyer de l’avocat La Bédoyère, car non admise ou non convenable au barreau » (p. 84). Le roman adopte pour ce faire un style dramatique et empathique, une composition en tableaux, une suite filée de dialogues où triomphe pourtant, à la fin, le silence, qui dit l’indicible du sentiment. Cette invention littéraire, qui éloigne Baculard du régime classique du récit, trouve sa motivation dans une analogie où la transgression de la rhétorique judiciaire fait écho à celle des règles littéraires : de même que le sentiment est au-dessus de la loi, le « langage du sentiment l’emporte sur toutes les règles de l’art poétique » (p. 87). « “Naufrage du droit” et crise de l’interprétation dans Spieltrieb de Juli Zeh » étudie le dispositif du roman de l’écrivaine allemande qui fait le récit d’une manipulation menée par deux adolescents « post-nihilistes », Ada et Alev, qui voient la vie comme un jeu dépourvu de sens et qui contraignent l’un de leurs enseignants, Smutek, à avoir des relations sexuelles avec l’une pendant que l’autre les photographie. La réaction violente de Smutek, qui passe à tabac Alev, le photographe, entraîne le procès de Smutek, pour coups et blessures et détournement de mineur, ainsi que celui d’Alek pour chantage, violence et complicité d’abus sexuel. Le procès est un « naufrage du droit » puisque Ada le manipule pour obtenir un verdict conforme à ses vœux. Le roman, qui se présente tout d’abord comme le récit fait par un narrateur omniscient, se révèle en fait être celui de la juge, la « froide Sophie ». Dans ce basculement de situation énonciative, qui renverse le récit supposé objectif en témoignage partiel et partial, voire en reconstitution imaginaire, Charline Pluvinet voit un dispositif de brouillage qui ne laisserait pas indemne la position du lecteur lui‑même :
Tout comme « la juge devrait se faire arbitre » [pour évaluer les actes selon les critères des adolescents pour qui tout n’est que jeu] et doit en tout cas assumer sa fonction, nous sommes ainsi amenés comme lecteur à prendre la responsabilité de l’interprétation que nous faisons du récit et à reconnaître les codes à partir desquels nous avons établi cette interprétation. (p. 169)
8« Le Marchand de Venise : une pièce et trois procès » est une remarquable lecture par strates de la pièce de Shakespeare, où chaque nouvelle analyse complète et approfondit, en les déplaçant, les enjeux des précédentes, mêlant analyse actantielle, représentations symboliques et réflexion politique et éthique. Philippe Zard montre, dans un premier temps, comment l’affrontement entre Shylock et Antonio mobilise les éléments classiques du « contentieux judéo-chrétien » (p. 111) : opposition entre la lettre (le contrat) et l’esprit, le Dieu d’amour et le Dieu de vengeance, l’« exigence barbare d’une incision dans la chair, qui renvoie implicitement au rite de la circoncision, mais plus profondément encore à l’accusation de meurtre rituel » (ibid.) et le sacrifice de l’innocent. Ou encore le juridisme formel et l’ingéniosité exégétique, comme le démontrera la fin de la pièce — et de l’étude. Cette « répétition de la passion » (p. 112) est aussi le moyen de dénier — de reconnaître et de nier — qu’une situation symétriquement inverse, un Juif converti cruellement mis à mort, s’est jouée dans l’actualité récente (Rodrigo Lopez). Une seconde lecture s’attache, par l’étude des interprétations critiques et de l’adaptation cinématographique de M. Radford, aux efforts pour dédouaner une pièce « où se trouve génétiquement encodée un scénario antijudaïque, voire antisémite » (ibid.), soit par une complexification des motifs, soit par une récriture orientée. Mais dans les deux cas, l’effort manque son objet, car « il est tout aussi vain d’imaginer que Shakespeare ait cherché à attiser l’antisémitisme que de songer qu’il pût vouloir le combattre […] » (p. 117). L’analyse s’intéresse alors à la solution à double détente qui permet de sortir de l’impasse juridique dans laquelle le contrat librement consenti plonge Antonio, et plus largement la société vénitienne, où n’existent plus que des « associés » et des « accords » (p. 120), c’est-à-dire une société libérale, où la loi et les normes éthiques qui la fondent sont remplacées par le contrat. L’enjeu de la pièce n’est donc pas seulement de sauver Antonio, ce que la ruse exégétique, qui est talmudique dans son principe comme le note malicieusement Ph. Zard, permet, mais la Loi elle-même en tant qu’elle garantit contre la barbarie, même librement consentie, et qu’elle affirme « un ordre nécessaire, inscrit dans la nature de l’humanité, comme la condition de celle-ci » (p. 123).
Esthétique & herméneutique de la transgression
L’art de transgresser
9Dans « Opinio juris in fabula. De l’art de savoir transgresser », Pierre-Yves Quiviger prend le contrepied de Léo Strauss qui examinait dans La Persécution et l’art d’écrire (1952), les caractéristiques d’une écriture cryptique qui permettait de tourner la censure pour s’intéresser à l’« art de transgresser » (p. 14). S’appuyant sur la notion d’opinio juris (l’expression latine complète, qu’il ne cite pas, est opinio juris sive necessitatis), soit « l’opinion sur ce qui est de droit », il distingue deux cas de transgression : un jeu avec la norme telle qu’elle est juridiquement et socialement déterminée ; un jeu avec la norme telle qu’elle est subjectivement et psychologiquement supposée chez le récepteur. Assise sur un corpus d’auteurs majoritairement français et contemporains, son analyse est tout d’abord typologique et historique. Trois postures transgressives sont distinguées, celle du libertin, fondée sur le plaisir de la transgression, celle du militant (conviction de la nécessité de la transgression), et celle de l’idiot (impertinence de la notion de transgression). Historiquement, il relève un changement dans la nature de ce qui fait scandale : autrefois, les atteintes aux bonnes mœurs ; aujourd’hui, les troubles à l’ordre public et les atteintes au respect de la vie privée, même si, selon lui, la justice ferait preuve d’une grande tolérance, dont le cas de Christine Angot serait exemplaire — l’auteur passant sous silence sa condamnation en 2013 pour atteinte à la vie privée pourtant (Les Petits). Déplaçant la réflexion, il ajoute que ce qui est toléré juridiquement n’est pas pour autant in-offensif moralement — et de retrouver la pornographie, et ces perversions (coprophagie, nécrophagie, pédophilie, inceste, etc.) qui choquent encore quand bien même elles ne sont plus incriminées ni condamnées, à l’exception notable de Georges Péridol. À le lire attentivement, il semblerait pourtant que le critère pertinent soit moins la nature de la transgression que le doute sur la réalité des faits dans ces récits en forme de confession (Matzneff, de façon emblématique). Dans un second temps, qui retrouve les conclusions du premier, l’étude se déplace du pôle de l’émetteur à celui du récepteur : la transgression devient alors provocation, et mettrait en scène une « infraction imaginaire » (p. 21), qui est aussi une effraction de l’imagination et de la sensibilité, dont les limites sont révélées, dans un mouvement presque socratique, au lecteur, qui est invité à répondre par son assignation. Dans« Michel Foucault, à l’épreuve de la littérature », Jean‑François Favreau propose une biographie intellectuelle du penseur centrée sur la période comprise entre deux moments importants de l’histoire de la censure : le procès fait à Pauvert pour la publication des œuvres complètes de Sade en 1958, celui qui est intenté à Guyotat après la parution d’Éden, Éden, Éden en 1970. J.‑Fr. Favreau définit la transgression selon Foucault comme une « consumation », non seulement de l’objet de la transgression, mais aussi du sujet de la transgression lui-même (p. 139‑140). Il s’attache à distinguer la transgression de la profanation en précisant que la première n’a de sens que dans un univers déserté par la transcendance, dont elle accuse le manque « en gardant vif “le défaut de Dieu” » (p. 140, citation non référencée de Dits et écrits qui emprunte la formule à Hölderlin, en la tronquant : « C’est le défaut de Dieu qui me manque »). La transgression vise ainsi à faire apparaître, selon la stratégie du pourtour, l’arbitraire de la Loi dans le moment historique où son expansion semble sans limite, pour définir par contraste le périmètre du possible. Le lieu et l’instrument de la transgression sont le langage même, qui serait transgressif par nature, ce qui est discutable, comme le confirme d’ailleurs l’hésitation entre une transgression qui serait de contenus (« fautes, mots interdits, représentation d’idées insoutenables », p. 144), d’énonciation (la parole sophiste, p. 145) ou encore de nature, et qui ferait du langage l’autre face de la folie :
[…] il est de la nature du langage de simuler, au sens étymologique du mot, c’est-à-dire présenter simultanément plusieurs sens. Le langage est un terrain glissant, il produit une diffraction et du dissensus. (ibid.)
10Enfin, l’article s’efforce de montrer que le parcours de Foucault lui‑même porte trace de ce questionnement, notamment sous la forme de la tentation de l’écriture critique et de sa réinvention (notamment dans « La pensée du dehors » où il mobilise la fiction théorique), qui le mène aux confins de sa perte même, et à une écriture de l’impuissance, de l’informe ou encore de l’implosion (p. 149). Pourtant, il dépasse cette position à l’orée des années 1970 : « Plutôt que s’identifier au héros écrivain, Foucault changera de rôle pour endosser lui-même, clandestinement, ce personnage de la foule et de l’anonyme […]. » (p. 151). « Transgression du droit dans des contextes fictionnels. Problèmes et paradoxes » est une mise au point précise et rigoureuse des enjeux de la représentation du droit dans et par la littérature, qui permet « réflexivement de penser ce qui la relie au droit » (p. 171). Christine Baron s’intéresse dans un premier temps à l’insertion littéraire de cas juridiques qui permettent d’ouvrir au droit un espace autre, hypothétique, pour thématiser la tension entre légalité et légitimité — droit et morale — dans un mouvement de subversion, ou de délimitation, de la loi et de sa suffisance. Elle s’intéresse ensuite non plus à la représentation de la transgression, mais aux écrivains de la transgression (Sade, Lautréamont), tels que les constituent, rétrospectivement, les tenants de la « littérature du mal » (Klossowski, Bataille, Blanchot, Foucault, etc.), pour affirmer la solidarité, voire l’identité, du mal et du droit quand il se réduit à une pure mécanique formelle. Symétriquement, la littérature est définie comme le lieu où tout est possible, contre l’interdit que définit la loi. Mais cette illimitation ruine par contrecoup la notion même de transgression. Dans le même temps s’affirme théoriquement en France, autour de Roland Barthes et de Tel Quel, l’autonomie de la littérature, qui trouve ses origines dans le romantisme allemand, mais qui la condamne, au mieux, à l’ornementation, au pire, à l’insignifiance. L’étude d’un dernier exemple, celui de l’« alterfiction », démontre si besoin était que la « référentialité nulle » (p. 180) de la littérature est un fantasme, notamment au regard du droit. Biographie imaginaire, ou mieux, inventée, d’une personne réelle, l’alterfiction, par les procès qui lui sont intentés, révèle que le droit ignore la distinction sémiotique entre personnage et personne, et qu’il pose comme seul critère discriminant la dimension fictionnelle ou non du récit : « […] il n’y a pas de fiction, mais des seuils de fictionnalité » (p. 182). Mais la définition de ce seuil est laissée, à rebours des procédures d’expertises judiciaires usuelles, à la seule appréciation du « lecteur moyen » qu’évoquait déjà Th. Hoffman dans son article, et qui est tout sauf un lecteur modèle.
Le conflit des interprétations
11« Le cas de la fiction juridique et ses inflexions littéraires (xvie-xviie siècles). Retour sur une transposition problématique » s’intéresse au statut des fictions légales dans les fictions littéraires. La réflexion, dense et parfois difficile, reprend des pans entiers d’un article déjà paru (« Fictions du droit et espace littéraire »1) : elle s’attache à distinguer les notions de fiction, de simulation et de feintise dans le droit romain puis dans la jurisprudence humaniste dans le moment où elle le redécouvre. Olivier Guerrier évoque notamment la notion légale de « transaction feinte » (p. 63), telle la remise de dettes, qui suppose à la fois un rituel codifié et une équivalence entre gestes, paroles et actes selon un régime d’échange symbolique qui définit une fiction, non pas vraie, mais légale : « un artifice usant du “comme si”, mensonge consenti et agréé [qui] disjoint la fiction (ou la simulation) du régime du mensonge en tant quel au sens strict » (p. 64). Il montre ensuite comment la façon dont Seigny Johan règle le différend entre le Rôtisseur et le Portefaix qui a humé le fumet de son rôti (Tiers livre) ressortit à la mobilisation de ce schème, dont il se joue dans le même temps pour proposer une solution doublement imaginaire au conflit — selon la logique juridique de la transaction feinte, selon la logique comique d’un plaignant payé avec la monnaie de sa pièce. Appliquée ensuite à Montaigne, la réflexion devient plus touffue, à l’image peut-être de la difficulté à cerner les fonctions des fictiones legis et des fictions poétiques dans son œuvre. Contre — ou en complément de — la définition aristotélicienne, redécouverte depuis 1540, de la fiction comme vraisemblable, les fictions légales, et plus largement les fictions poétiques, lui offrent un modèle formel, mais aussi théorique pour réfléchir les relations entre fiction et connaissance, entre feinte et fantaisie, entre énonciation subjective et certitude objective :
En substance, incluses désormais à une herméneutique de soi qui revendique en permanence la contingence de ses investigations et de ses acquis, les fictions sollicitent plus que tout autre modalité, l’assentiment du lecteur, devenu « juge fictif », selon l’expression de C. Biet. (p. 70)
12« Les Mystères de Paris transgressent-ils la morale ? Sur la contradiction entre deux censures de l’index » examine, à partir des archives du Saint-Siège, les décisions rendues en 1845 et 1852 par la Congrégation romaine de l’index et qui aboutissent la première fois à la relaxe, et la seconde à la mise à l’index. Étudiant les avis des deux consulteurs (qui sont reproduits dans l’article), Jean-Baptiste Amadieu s’efforce de comprendre comment deux lecteurs qui « partagent pourtant de mêmes valeurs, et non pas des valeurs “minimales”, mais un corps de doctrine précis, élaboré et institutionnalisé » (p. 46) aboutissent à une lecture diamétralement opposée. Cette divergence s’explique par une différence d’appréciation des caractéristiques proprement littéraires du roman, en l’occurrence son dispositif énonciatif et son style. Si les deux consulteurs s’accordent à reconnaître que les faits narrés sont transgressifs, le premier conclut que l’œuvre elle-même n’est pas immorale, car dominent dans le roman la figure supérieure du personnage positif, Rodolphe de Gerolstein, et du narrateur ; en outre, son style est sans séduction ; le second, à l’inverse qui méconnaît cette force d’unification, nie sa dimension de roman à thèse et privilégie une attention scrupuleuse à la lettre des propos des personnages, conforme à la « tradition censoriale, selon laquelle un examen relève les seuls énoncés incompatibles avec l’enseignement ecclésial » (p. 48). En un chiasme savoureux, le consulteur qui a la lecture la plus originale des Mystères, conçu comme roman polyphonique, est aussi celui qui en tire argument pour le condamner. Quant au style, « il rend délectable le récit des immoralités et mérite la mise à l’index » (p. 48). « Libérer le prisonnier, désobéir aux ordres ? Généalogie d’une mauvaise conscience (sur une nouvelle de S. Yizhar) » s’intéresse, dans une perspective qui associe critique thématique, anthropologie et éthique, au dilemme de l’exécutant. « Le Prisonnier » met ainsi en scène un soldat convoyant un berger vraisemblablement innocent. L’alternative est la suivante, qui reste irrésolue dans la nouvelle : le libérer et obéir à une conviction morale intime, le convoyer à bon port et obéir à une éthique de responsabilité, entée sur l’impossible universalisation de la maxime de son action : « Si tout un chacun s’avisait d’élargir les prisonniers, où irait-on ? » (on regrettera que les citations ne soient pas paginées). Mais la réflexion se déplace bientôt vers la question de l’« innocence » supposée du berger, et plus largement sur le sort des civils en situation de conflit — selon le point de vue du combattant, que Frédérique Leichter-Flak semble faire sien, ce qui n’est pas sans provoquer une certain trouble, notamment lorsqu’elle évoque à propos du film Démineurs (K. Bigelow) le « dilemme portant sur l’incertitude sur le statut des civils (innocents ou coupables) » (p. 129, nous soulignons). Elle s’attache ensuite à l’étude de cas réel rapporté par M. J. Sandel (Justice. What is the right thing to do, 2009) : un officier américain en Afghanistan voit son unité décimée pour ne pas avoir, pense-t-il, tué trois bergers dont ils ont croisé la route et qui ont « probablement » (ibid.) informé les talibans responsables de l’attaque meurtrière. Le dilemme est cette fois le suivant : tuer les civils selon une approche utilitariste, et commettre un acte immoral — mais aussi un crime de guerre, ce que le commentaire ne précise pas — vs voir ses hommes être tués, et « être dévoré par le remords » (p. 129). On s’étonnera là aussi que le dilemme prenne la forme d’une alternative (tuer/être tué), quand une troisième voie est possible, celle du repli après la rencontre avec les bergers, qui semble pourtant inconcevable tant pour le soldat que pour le critique. Enfin, l’analyse revient sur la nouvelle de S. Yizhar pour préciser les motifs intimes de l’hésitation, qui seraient liés à « l’image de soi à laquelle on se trouve renvoyé par la situation » (p. 131), entre fiction de toute-puissance et disqualification auto-ironique, et dont la tension, inconfortable, alimenterait honte et mauvaise conscience, que Fr. Leichter veut voir comme antidotes possibles à la barbarie.
***
13Si l’on devait formuler un reproche à ce volume, on relèverait que la perspective reste avant tout thématique, par le choix d’élire un thème commun bien sûr (la notion de transgression), mais aussi par la logique implicite de son raisonnement (le droit comme objet de la littérature, la littérature comme objet du droit) ; elle s’aventure donc peu sur les terrains, tout aussi féconds, de la poétique et de l’herméneutique2. À cet égard, on aurait aimé lire des éléments de réflexion méta-herméneutique, portant sur les paradigmes interprétatifs respectifs des deux disciplines, tant leurs histoires sont parallèles, voire intriquées, et leurs dispositifs, proches : primauté du texte, attention à sa lettre, pratique de l’exégèse, relation d’étroite connexité avec l’interprétation des textes sacrés, conflit des interprétations, etc. Mais ce serait reprocher à ce volume non ce qu’il est, un ensemble cohérent et rigoureux, mais ce qu’il aurait pu être.

