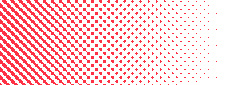Présentation : La philologie et le futur de la littérature.
À mon père
1En 1745, soit quelques deux cent seize ans avant la parution de Pale Fire et deux cent cinquante quatre ans avant qu’Éric Chevillard ne publie Les Œuvres posthumes de Thomas Pilaster, un certain Hyacynthe Cordonnier, dit Saint Hyacynthe, fit paraître sous le nom de Matanasius Chrisostome, un étrange et fantaisiste ouvrage intitulé Le Chef d’œuvre d’un inconnu, Poëme heureusement découvert, et mis au jour avec des Remarques savantes et recherchées1. À lire l’épais et bigarré apparat critique qui précède le « chef d’œuvre », en fait une innocente et plate chanson, à parcourir les remarques qui, de rapprochements en parallèles plus savants les uns que les autres, évoquent toute une bibliothèque composite et touffue, d’Homère à Fontenelle, on renoncera vite à prendre Matanasius Chrisostome au sérieux, pas plus que l’on ne prend au sérieux le John Shade de Nabokov ou le Marson de Chevillard. On se persuadera que ces gloses philologiques sur un texte fictif sont prétextes à divagation, que la fausse érudition n’est qu’une autre manière de donner voie au plaisir de la fantaisie et de l’écriture. Dans tous ces cas, et dans quelques autres, la fiction philologique est prétexte à l’écriture, le commentaire savant est imité pour l’invention verbale qu’il autorise. Du travail philologique, on ne retient donc pas qu’il vise à établir une vérité du texte – d’ailleurs les textes commentés eux-mêmes ne sont-ils pas forgés pour l’occasion ? – mais plutôt qu’il permet d’inventer des formes.
2Mais comment comprendre ces rencontres entre la science des textes et la créativité littéraire, qui laissent entrevoir l’idée d’une productivité littéraire, autrement dit d’une poétique, de la philologie ? Tiennent-elles de l’inversion satirique, l’écrivain renversant les fins et moyens de la philologie pour en présenter ironiquement l’envers – subjectivité exacerbée contre objectivité déclarée, instauration contre restauration, fantaisie contre rigueur de la science – ou constituent-elles plutôt une caricature à peine exagérée, une manière de suivre une tendance déjà inscrite dans la démarche philologique qui serait, par nature, toujours à la limite de l’écriture ?
3La réponse à cette question ne va pas de soi, car l’idée d’une poétique de la philologie tient à la fois de la tautologie et de la contradiction.
4De la tautologie si l’on prend philologie en son sens le plus général d’amour de la langue et de rapport verbal au monde, appréhendé à travers les mots qui le désignent, le décrivent et l’expliquent. En ce sens la philologie est bien un travail sur le matériau qu’est le langage, elle est une poétique et il n’y a guère à s’étonner que le philologue soit aussi un poéticien. Tout au plus nous faudra-t-il nuancer et hiérarchiser les deux notions, dire, par exemple, que la poétique est un aspect de l’élan vers le langage que suppose la philologie. Mais, dans cette optique, l’idée d’une productivité littéraire de la philologie, d’une rencontre, et même d’une identité entre l’état de poète et de philologue semble aller de soi.
5En revanche, si l’on entend par philologie, en un sens plus restreint et plus concret, le travail d’édition textuelle qui vise à restaurer le texte dans l’état originel voulu par l’auteur, à restituer donc ce qui est perdu ou mal connu – le texte, le contexte, l’intention auctoriale – sans le modifier aucunement, l’idée d’une poétique de la philologie devient pratiquement contradictoire, puisque la poétique serait du côté de l’auteur qui travaille la langue, quand le philologue ne fait que respecter et restituer la poétique de l’auteur sans être lui-même auteur, c’est-à-dire sans posséder une poétique propre.
6Par quoi faire l’hypothèse d’une poétique de la philologie, ou de poétiques de la philologie, c’est-à-dire de diverses pratiques toutes orientées vers la production de formes, c’est en quelque sorte projeter sur la version pratique de la philologie sa version ouvertement poétique, l’interroger dans son amour du langage et tenter de mettre à jour derrière le caractère apparemment conservateur de ses gestes une tendance à faire ou à refaire le texte, à travailler la langue comme le fait tout écrivain. C’est la possibilité de cette rencontre entre les deux faces de la philologie que mettent à l’épreuve les articles ici réunis.
Continuité : un même geste ?
7Si la philologie s’entend comme amour des mots, élan vers le verbe, la littérature ou encore appréhension du monde à travers le prisme des mots, on ne s’étonnera pas que le geste philologique et le geste de création littéraire se rencontrent, que les qualités de poète et de philologue ne fassent parfois qu’une. Les articles que consacrent Michel Briand à Callimaque, Jean-Christophe Jolivet à la poésie latine et John Nassichuck à Flaminius, mais aussi Vincent Ferré à Tolkien témoignent de ce que le geste de commentateur n’est pas séparable de la mise en œuvre d’une poétique et, plus largement, de ce que l’état de philologue n’est jamais très éloigné de l’état de poète. Flaminius va du commentaire à la paraphrase en prose, puis à la paraphrase poétique de manière continue : « le développement poétique […] procède du travail philologique d’un poète humaniste », et, dans son cas, le commentaire est déjà transformation, puis mise en écriture qui prépare le geste poétique, le prévoit peut-être ; la poésie de Callimaque est convoquée par les scholiastes pour expliquer Pindare, comme si la poésie avait valeur philologique, tandis que Callimaque poète fait usage de son savoir philologique dans le tissu même de son écriture. La frontière entre le métatexte et l’hypertexte est donc brouillée, voire sans grande pertinence : c’est au sein même de leurs réécritures d’Homère que les poètes latins mettent en scène et, parfois même résolvent, les problèmes homériques qui agitaient les savants. Plus largement, le travail de Tolkien sur la langue est inséparable de son imaginaire de la langue.
8Toutefois cette fluidité n’entraîne pas une identité parfaite. Dans les caractérisations de Callimaque, la distinction entre l’état de poète et l’état de philologue est toujours maintenue ; chez Flaminius, les différentes catégories de discours sont toujours séparées, d’autant plus que le passage à la paraphrase poétique s’accompagne d’une rupture esthétique. Bien plus, c’est en des lieux circonscrits que la poésie latine rejoint le commentaire. De même, l’œuvre romanesque de Tolkien reste évidemment distincte de son œuvre savante.
9Ces cas où philologie et création littéraire semblent se rejoindre sans se confondre tout à fait n’en invitent pas moins à interroger la face poétique d’une philologie qui n’est pas ouvertement créative.
Sous la restauration, l’instauration
10On se donne alors le droit de prendre à contre-pied l’intention déclarée du travail philologique, de détecter dans le travail savant qui vise à restaurer le texte, un travail sur les mots qui tend à créer des formes. La restitution du texte médiéval peut ainsi être considérée comme une réécriture (Gabriele Giannini) ; l’édition des discours politiques est une réinvention écrite de l’oralité (Dominique Dupart) ; le travail des philologues sur l’œuvre de Pessoa donne lieu à ce que Julia Peslier nomme une « inventivité philologique », où le savant se fait « fragmenteur », « faiseur de puzzle », « expérimentateur » – autant de figures qui disent son action créative. On s’étonnera moins, dans ces conditions, que la quête, ouvertement érudite, de l’anagramme chez Saussure puisse rejoindre le travail poétique de Tzara, comme le montre Pierre-Yves Testenoire, ou encore que le commentaire que Madame Dacier propose de l’Odyssée puisse préfigurer la réinvention du texte d’Homère par Joyce (Marc Escola). On se donne aussi le droit d’interroger des opérations philologiques pour ce qu’elles ont de créatif et non pour leur efficacité à revenir au texte authentique : ainsi par exemple de l’esquisse d’une poétique de l’interpolation, proposée par Sophie Rabau.
11La philologie n’est alors pas séparable de l’écriture et l’on s’explique mieux que des écrivains s’emparent de ses manières, de Hyacynthe Cordonnier à Chevillard ou Danielewski qu’évoque Claire Maussion. Ce n’est pas seulement une mimesis du travail philologique que ces auteurs mettent en œuvre : ils reconnaissent, plus radicalement, dans les moyens de l’édition textuelle et du commentaire, des procédés de création qui les conduisent à explorer de nouveaux territoires, à réorganiser, par exemple, l’espace de la page, ou à troubler le partage entre texte et paratexte.
12Qu’elle soit ou non déclarée, il existe donc peut-être une poétique de la philologie dont il reste à inventorier les traits propres.
Poétique(s) de la philologie
13En premier lieu, s’il existe une poétique de la philologie, elle a pour caractéristique d’intéresser des formes d’écriture secondaires : le philologue travaille toujours sur des textes qu’il réélabore, sur des œuvres déjà écrites. On parlera, plus précisément, d’une écriture de lecteur. Cette affirmation, qui semble aller de soi, est pourtant polémique car elle vient heurter une des prétentions souvent revendiquées de la philologie : par l’application d’une méthode, elle ne se livre pas une interprétation, mais à une observation ou à une démonstration (le terme « preuve » est courant en matière d’éditions textuelles)2. Définir la philologie comme une écriture de lecteur, c’est donc d’abord réintroduire de manière ouverte la part de subjectivité herméneutique qu’elle suppose, qu’elle a parfois revendiquée, notamment à la Renaissance3, mais souvent aussi occulté, notamment dans ses versions les plus positivistes4.
14Surtout l’idée d’une écriture de lecteur permet de mieux mesurer la part de transformation du texte que suppose toute interprétation. C’est un lieu commun de dire que le texte est modifié par les interprétations qu’il reçoit, de noter donc que du métatexte (commentaire) à l’hypertexte (réécriture), il n’y a pas de véritable solution de continuité et que les deux gestes participent également de la transmission du texte et des modifications de sa réception5.
15Mais dans le cas de la philologie, le travail de l’interprétation est inséparable d’un travail de transformation très concret : le savant a le pouvoir de transformer la lettre du texte en en éditant un état qu’il est capable d’interpréter ; il interprète, inversement, dans le but de produire un état du texte, toujours différent du précédent état. Le projet déclaré de revenir à une intention de l’auteur se comprend alors comme un geste herméneutique – il faut décider quel est cette intention – qui conduit à modifier le texte non pas en vertu de la seule intention de l’auteur, mais fidèlement à l’idée que s’en fait un lecteur donné. Interpréter, c’est transformer et parfois transformer c’est pouvoir interpréter, comme le montre Marc Escola à propos du commentaire de Madame Dacier : « Mme Dacier y dit ce qu’elle a compris et ce qu’elle a traduit – ce qu’elle a compris pour traduire comme elle l’a fait ; la justification n’est pas a posteriori : on ne traduit bien que ce que l’on sait pouvoir commenter. » De la même manière, on pourrait noter que l’on n’établit jamais que le texte que l’on sait pouvoir commenter et que l’on a déjà commenté : bien souvent, par exemple, la désignation d’une interpolation dans le texte repose sur une interprétation implicite (Sophie Rabau). Par quoi s’il est un lieu où se rejoignent sans plus se distinguer métatexte et hypertexte c’est bien dans le travail philologique, si on veut bien le considérer comme producteur et non pas seulement restaurateur des textes.
16Il n’est pas pour autant possible de ramener exactement la poétique de la philologie à une forme un peu particulière d’hypertextualité qui inclurait de manière systématique et explicite le geste herméneutique.
17Car le travail philologique n’est pas exactement un travail à partir de l’œuvre d’autrui, mais sur l’œuvre d’autrui. On opposera donc a priori deux gestes d’écriture assez différents : Fénelon écrit le Télémaque à partir de l’Odyssée d’Homère, Victor Bérard retravaille jusqu’à la rendre presque méconnaissable l’Odyssée d’Homère. Dans le premier cas, Fénelon ne prétend pas qu’Homère est l’auteur du texte qu’il a produit à partir de l’Odyssée, alors que Victor Bérard attribue en quelque sorte à Homère la variante du texte qu’il a produit. Non pas, on le verra, qu’une poétique inspirée de la philologie ne puisse se rencontrer dans un travail hypertextuel. Mais il n’en reste pas moins que, théoriquement au moins, une poétique de la philologie suppose un effacement du créateur : c’est ainsi que l’idée philologique de l’interpolation suppose une intervention anonyme sur le texte d’autrui, comme le rappelle Sophie Rabau. Cette curieuse manière d’attribuer son œuvre à autrui peut nous étonner au xxe siècle, mais elle est la norme, par exemple, à l’époque médiévale, ainsi que le montre Gabriele Gianinni : la production de variantes par le philologue doit donc bien se lire comme le versant « scientifique » d’une pratique littéraire, voire dans le cas de la littérature médiévale, comme la continuation par des moyens scientifiques d’un geste d’écriture. Or si la notion de variante est classique dans le discours et la pratique philologique, le fait est que la poétique contemporaine ne réserve pas une catégorie à la production de la variante qui n’est pourtant ni métatexte, ni hypertexte et appellerait peut-être une nouvelle case dans les tableaux des poéticiens.
18Cette action sur l’œuvre et non à partir de l’œuvre, s’accompagne d’un geste relativement inédit en matière de littérature secondaire : l’intervention matérielle sur l’œuvre et sa présentation concrète, et pas seulement la manipulation mentale ou idéale du texte.
19Cela serait le troisième trait spécifique d’une poétique de la philologie que cette possibilité d’agir sur la matérialité du texte et non seulement d’en discourir ou de le réécrire comme un objet idéal. Quand le même Fénelon réécrit l’Odyssée, lui « rajoute » un épisode comme l’on dit, il ne change en rien l’Odyssée et ne nous propose pas de lire une édition d’Homère où à la fin du chant V, comme Ulysse est parti de chez Calypso, il nous faut lire les aventures de Télémaque chez la Nymphe. C’est exactement à cette opération que se livre un philologue décidant, par exemple, que la Télémachie n’est pas d’Homère ou qu’entre les deux assemblées des dieux au chant I et au chant V, il faut choisir, l’une n’étant pas authentique : dans l’édition qu’il donne, la présentation matérielle du texte est immédiatement modifiée, inscrite sur la page, donné à lire dans la matérialité du texte ou au moins d’un état du texte.
20Plus modestement, mais dans le même sens, la note, l’obèle ou l’hypothèse de la lacune sont marqués concrètement sur la page, en modifient l’aspect visuel et l’architecture : ainsi « des cicatrices » que laisse sur la page les éditeurs de Pessoa dont Julia Peslier décrit le travail.
21Toute intervention philologique est donc une intervention matérielle qui modifie la page, la redessine. Claire Maussion montre comment la mise en œuvre dans la fiction d’une poétique de la philologie est de manière caractéristique un travail sur l’architecture de la page et Florian Pennanech cherche d’abord dans une inversion spatiale et visible entre la note et le texte les signes d’une antiphilologie chez Barthes. C’est également par le jeu de la typographie que s’inscrit ce que Dominique Dupart nomme « une greffe philologique » dans la transcription du discours politique au xixe siècle. De même une spéculation sur l’interpolation suppose de concevoir une manière d’écrire qui modifie l’œuvre non pas seulement idéalement mais aussi, si l’on peut dire, dans sa chair même, qui ait pour effet que l’œuvre ne soit plus lisible que dans l’état, modifié, où l’a plongée l’interpolateur (Sophie Rabau). Plus subtilement Jean-Christophe Jolivet rappelle aussi comment l’emploi d’un mot dans le poème peut faire signe à la manière du signe matériel qu’inscrivent les commentateurs antiques sur la page. Cette inscription matérielle, cette manière de dessiner la page ou de dessiner sur la page n’est évidemment pas le seul fait d’une poétique de la philologique, mais toute intervention philologique suppose une modification physique du texte et la philologie pourrait bien, en la matière, avoir valeur paradigmatique.
22Cette modification, qui touche jusqu’au corps du texte, ne va pas cependant sans regret. C’est qu’au moment où elle transforme, la philologie conserve, comme si la production de variante s’accompagnait d’une conscience aigue du fait que la variante est une parmi d’autres, et qu’en ce sens tout choix est une perte, qu’il faut donc préférer, sans jamais exclure tout à fait ce que l’on n’a pas choisi. Par le fait même de l’apparat critique, on lit toujours dans le texte édité « scientifiquement » plusieurs textes à la fois, celui qu’a choisi le philologue, mais aussi au bas du texte, les variantes qu’il a rejetées. La variante est choisie sans l’être dans la mesure où sa conservation ne suppose pas le rejet des autres possibilités. Cette conservation des variantes où le choix ne fait pas exclusion permet de concevoir un mode d’écriture inédit, une « poétique du non-choix », pour reprendre l’expression de Claire Maussion. Alors que toute création, et en particulier toute création littéraire, ne peut apparemment se penser que sur le mode du choix – choisir une fin heureuse c’est refuser une fin tragique, choisir l’alexandrin c’est refuser le vers libre ou l’octosyllabe, etc. –, alors de même que, selon Valéry, c’est la souffrance de l’écrivain que de devoir renoncer, au moment où son œuvre est dite achevée, à tout ce qu’elle ne pourra plus être, à tout ce qu’elle aurait pu être et qu’elle n’est pas6, la philologie suggère une autre manière de création qui ne se penserait pas comme abandon, mais comme conservation des possibles. De cette conservation, on ne tirera pas que le philologue reste dans un avant de l’œuvre, dans le champ des possibles et non de la mise en acte, mais bien plutôt qu’il montre, de manière exemplaire, que toute mise en acte suppose, dans les termes d’Agamben7, la conservation de la puissance. Ce que nous ignorons souvent dans la pratique du commentaire, cette idée de la contingence de l’œuvre que l’analyse ne prend pas en compte chaque fois qu’elle justifie le texte en y voyant un choix nécessaire, la philologie nous oblige à le prendre en considération. Il existe certes une hiérarchie entre la variante choisie par le savant, et celle qu’il indique mais rejette. Il n’en reste pas moins que l’indiquant, il en garde la trace et invite par là le lecteur à toujours penser l’ombre possible du texte actuel qu’il lit, à penser autrement dit qu’il offre un modèle de création où le passage à l’acte ne serait pas renoncement au règne des possibles. Claire Maussion montre comment l’écriture contemporaine joue de cette voie ouverte par le modèle philologique ; Vincent Ferré livre aussi à notre réflexion le cas troublant de Christopher Tolkien, qui, dans son travail philologique sur l’œuvre de son père, entend, en toute orthodoxie, être fidèle à l’intention de l’auteur, mais définit une intention qui serait aussi un regret de ne pas avoir fait et en vient à produire une version brève du « grand conte » de Túrin, pour « reproduire ce que [son] père n’a pas fait ». Christopher Tolkien pousse à la limite ce que nous venons de définir comme un trait saillant de la poétique philologique : non content de collecter les variantes qu’il n’aurait pas choisies, non content de recueillir les versions abandonnées par l’auteur, il va jusqu’à pénétrer mentalement dans la conscience de l’auteur au moment de la création, à reconstituer ses choix et ses abandons, pour retrouver non ce qui a été fait mais ce qui aurait pu l’être. On rêve alors d’autres réécritures, qui sans plus s’autoriser d’une reconstruction toujours aléatoire du processus mental de création, dirait des œuvres non ce qu’elles furent mais ce qu’elles auraient pu devenir, qui reviendraient à ces carrefours de la création pour y prendre un autre chemin, et produiraient alors non un seul texte mais bien une cartographie de tous les états possibles de l’œuvre. Non que la philologie classique prétende à une telle entreprise, mais sa tâche de conservation y tend de manière exemplaire et son travail sur l’espace de la page en suggère le cadre matériel, voire en propose des modèles comme le rappelle Julia Peslier à propos de la philologie pessoénne qui, entre dramaturgie et jeu de puzzle, travaille à l’agencement des variantes.
23La philologie ainsi comprise permettrait de poser une continuité entre le moment de l’élaboration, celui où l’on envisage toutes les possibilités d’écriture, toutes les variantes de l’œuvre et le moment de la diffusion, celui où l’œuvre existe parce que certaines de ses « variantes » n’ont pas été choisies. On écrirait une œuvre telle qu’elle porte encore en elle les marques de ce qu’elle n’est pas mais qu’elle aurait pu être, une œuvre achevée mais néanmoins encore en train de se faire.
24Cette remise en question de la notion d’achèvement de l’œuvre est peut être le cinquième trait marquant d’une poétique de la philologie. De fait, le travail philologique classique est comme tiraillé entre deux conceptions de l’achèvement de l’œuvre. D’une part, l’œuvre est considérée comme parfaitement achevée au moment précis où son auteur l’a livrée au public dans l’état exact où il voulait qu’elle soit : toute intervention postérieure sur l’œuvre, par exemple une interpolation, est donc comprise comme ne participant pas de son achèvement, mais comme un obstacle à son intégrité. Mais paradoxalement, l’œuvre est en même temps traitée comme si elle était à achever, car toujours à émender, à corriger, à éditer de nouveau. Certes, ce travail d’achèvement est perçu et présenté comme une restauration, mais cela ne va pas sans poser problème sur un plan théorique. En matière de littérature, pouvons-nous véritablement décider du moment où une œuvre est achevée ? Quelle distinction pouvons-nous faire entre une dégradation qui, si je puis dire, désachève l’œuvre et continuation d’une œuvre inachevée ?
25Ensuite, plus simplement, nous savons bien que les modifications apportées par la philologie ne sont parfois qu’une illusion de restauration, qu’elles tirent l’œuvre vers une nouvelle modification, l’achèvent tout en prétendant revenir à l’état antérieur où elle était achevée du point de vue de son auteur. Dès lors le travail philologique ne fait se rencontrer un poétique de la clôture – l’œuvre à un certain point a atteint sa forme définitive – et pour reprendre l’expression de Cerquiglini8, de la variance : l’œuvre ne cesse de se modifier après même son apparent achèvement. Si la philologie produit donc, on l’a vu, des variantes, elle n’invite pas pour autant exactement à une écriture de la variance, mais, de manière plus inédite à une écriture qui conjuguerait variation et achèvement. Que serait un projet d’écriture qui se donnerait pour tâche de continuer une œuvre pourtant achevée, de ne pouvoir même la continuer qu’à la condition même de penser son achèvement et son intégrité ? Cette perspective peut sembler étrange, voire contradictoire : c’est pourtant bien celle qui sous-tend la notion philologique d’interpolation, comme essaie de le montrer Sophie Rabau.
26Mais à spéculer ainsi sur des formes d’écriture que le travail philologique permet de concevoir, ne transformons nous pas à l’excès, en un coup de force inadmissible, le propos et l’intention des philologues, de ceux, en particulier, qui ne voient dans leurs opérations qu’un modeste travail de restitution de l’objet ? Ne rêvons-nous pas des formes qui n’existent pas, même si on peut en dessiner les contours en considérant la philologie comme un réservoir de formes et de procédés ?
27Il faut, pour répondre à cette question, préciser que la philologie est ici considérée non seulement pour ce qu’elle fait, mais bien aussi pour ce qu’elle permet ou suggère de faire, ce que nous appellerons la productivité, ou encore la puissance, de la philologie.
Productivité de la philologie
28Dans son livre Powers of Philology, Hans Gumbrecht dit avoir pensé à employer l’expression « poétique de la philologie » (poetics of philology) mais y avoir finalement renoncé pour parler plutôt de « powers of philology »9. Nous aimerions ici traduire le mot anglais « power », non pas par pouvoir mais plutôt par puissance, au sens de la dunamis grecque. Car s’il existe une poétique de la philologique, c’est autant en puissance qu’en acte, dans le fait qu’elle permet de produire des formes, autant qu’elle les produit effectivement. Certes on a vu que la philologie peut se penser elle-même dans sa dimension créative, mais, dans bien des cas, les transformations qu’elle fait subir au texte ne sont pas reconnues et désignées comme telles, les procédés qu’elle met en œuvre, et qui peuvent en appeler d’autres, sont présentés comme des gestes dont la fonction est de connaître et non de créer. Il faut donc pour qu’apparaisse la puissance poétique de la philologique qu’un regard extérieur la reconnaisse et la décrive. Ce regard peut-être celui de l’écrivain qui à l’instar de Nabokov, Chevillard ou Danielewski (Claire Maussion), mais aussi Barthes (Florian Pennanech) s’empare de la philologie non pas exactement pour la parodier – à moins de définir la parodie comme l’exagération et la révélation de ce qui existe déjà en puissance dans un objet –, mais bien pour en actualiser la puissance productrice. Ce regard peut encore être celui du poéticien, qui découvre dans la philologie un réservoir de formes. C’est sans doute d’abord cette découverte et cet examen de la productivité philologique qui relie les articles ici réunis. Que l’on étudie, comme John Nassichuck ou Michel Briand, Gabriele Gianinni ou Vincent Ferré, les chemins qui relient le philologue à l’écriture, que l’on indique comme Jean-Christophe Jolivet ou Claire Maussion comment certaines formes d’écriture peuvent s’emparer du travail philologique, que l’on révèle, comme Dominique Dupart, la part d’instauration que suppose l’apparence de restauration, l’on montre, plus radicalement, comme Pierre-Yves Testenoire, que la quête de l’anagramme chez Saussure est problématique d’un point de vue épistémologique mais, en même temps, extrêmement productive en termes poétiques, que l’on cherche à définir, comme Florian Pennanech une écriture comme une antiphilogie, voire que l’on pose, comme Sophie Rabau, qu’il n’y pas si loin de la dimension spéculative de la philologie à la poétique qui est toujours examen des possibles et non seulement des textes déjà écrits, ou, comme Julia Peslier, que tout travail philologique sur Pessoa comporte, en creux, une proposition d’écriture et une fiction de l’auteur, c’est toujours une même volonté d’accepter mais aussi de décrire, non sans admiration, la productivité philologique qui apparaît. Une productivité d’autant plus admirable qu’une poétique de la philologie ne donne pas seulement le jour à des textes mais aussi à des mondes : c’est la rêverie sur le mot qui permet à Tolkien de construire un monde fictif (Vincent Ferré) ; c’est par l’invention de mondes fictifs que certains problèmes philologiques se trouvent soudainement résolus : quand la lecture de l’Iliade texte ne permet pas de dire à quelle main Aphrodite fut blessée, il suffit par exemple, comme le rappelle Jean-Christophe Jolivet, de réinventer le monde que dit le texte, d’en livrer une version où c’est la main droite de la déesse qui a subi les assauts de la guerre. C’est encore ce lien entre la lecture du texte et l’invention du monde que met en valeur l’article de Glenn Most : inventer une figure de Sapho revient à avaliser une interprétation et un établissement du texte de la poétesse et inversement, pour donner chair à la fiction de Sapho que l’on entend privilégier, il convient d’abord de prendre une option sur les problèmes textuels que posent certains de ses vers. L’homosexualité ou l’hétérosexualité de Sapho, toutes deux fortement hypothétiques, voire mythiques, ne sont jamais qu’une question d’établissement du texte.
29Une productivité, enfin, qui pourrait bien se retrouver non pas en amont mais en aval du texte : il arrive que l’écrivain appelle de ses mots le travail philologique, qu’il travaille à ce que son texte devienne un objet pour le travail philologique : Jean-Christophe Jolivet montre comment les poètes latins en viennent à créer « eux-mêmes des textes problématiques à destination des philologues » et, à l’autre bout de la chaîne chronologique, on s’aperçoit qu’un Joyce ou un Borges écrivent aussi pour provoquer (et souvent rendre impossible !) le travail philologique d’édition textuelle (Sophie Rabau), l’auteur devenant ainsi comme un « philologue en excès » pour reprendre l’expression de Julia Peslier sur Pessoa. Il y a là bien sûr une manière de donner autorité à son texte en en faisant un objet de commentaire et d’édition, mais peut-être aussi une confuse reconnaissance que lorsqu’un texte reçoit l’attention d’un philologue, il s’inscrit dans le mouvement continu de la création littéraire.
30Une reconnaissance de la productivité philologique ne doit donc pas seulement se comprendre comme une provocation ou une tentative de déconstruire la science philologique. Elle est aussi un hommage admiratif et une invitation des plus sérieuses lancée à chaque philologue à se penser, aussi, comme un créateur de formes à venir et à retrouver, par là, la dimension véritablement inventive de sa pratique, une invitation aussi, faite à chaque écrivain, à se penser comme un philologue, c’est-à-dire comme un réinventeur du langage et des textes. La philologie, qu’elle se présente comme travail des mots au sens large ou modeste restauration des textes, offrirait alors un réservoir de formes et de procédés ; elle dirait, autant le passé de la littérature que son futur non encore écrit.