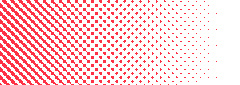Cinéastes militants assassinés : la mort de l’auteur peut-elle lui donner raison ?
1Des cinéastes assassinés, tout compte fait, il y en a eu assez peu dans l’histoire. Il arrive qu’un film dérange, que sa réception pose problème à tout ou partie de la population d’un pays, mais les conséquences de ces controverses ne sont que très rarement fatales. Si les exemples d’assassinat sont heureusement peu nombreux, ils sont en général retentissants. La mort violente d’un artiste n’est pas un événement anodin ; il serait donc impensable qu’elle ne s’accompagne pas d’hommages, de commentaires, de tentatives d’élucidation — sans même parler des suites judiciaires. Parce qu’il est largement admis que l’art est une activité libre, et que cette liberté de création est indispensable au bon fonctionnement de la société, la rupture de ce contrat tacite reçoit la plupart du temps une très large couverture médiatique et politique.
2Exception faite de Pier Paolo Pasolini, dans lequel on s’accordait à voir une figure de proue du cinéma italien au moment de sa mort en 1975, ce sont en général des auteurs confidentiels, ou d’envergure locale, qui sont les victimes d’assassinat. Celui‑ci offre alors aux cinéastes non seulement une visibilité qu’ils n’avaient pas auparavant, mais confère encore à l’œuvre, souvent, une importante plus‑value politique. Un phénomène logique, au vu de la disproportion entre la cause apparente (l’œuvre) et sa conséquence (la mort d’un individu). Que l’assassinat soit un moyen de s’assurer que l’auteur ne réalise pas d’autres films compromettants par la suite, ou qu’il s’agisse simplement d’un acte de représailles, il est tentant d’y voir une preuve de l’efficacité politique de l’art — non au sens où l’œuvre serait en elle‑même dotée d’une puissance de transformation de la société, mais au minimum, au sens où un groupe antagoniste lui reconnaît un fort potentiel de nuisance.
3C’est particulièrement le cas du cinéma militant. Celui du groupe Raqqa Is Being Slaughtered Silently (« Raqqa est massacrée en silence ») est exemplaire. Parmi les membres et collaborateurs de ce collectif militant syrien, formé en 2014, cinq ont été assassinés par l’organisation autoproclamée « État islamique » : Mo’taz Billah Ibrahim, Ibrahim ’Abd al‑Qader, Fares Hamadi, Ahmad Mousa et Naji Jerf. C’est précisément ce qu’il fallait à la presse internationale pour s’intéresser aux films du groupe, critiques des djihadistes mais aussi de la précipitation coupable des forces armées occidentales. De sorte que les cinéastes ont « accompli », par leur disparition, l’un de leurs principaux objectifs, inscrit dans le nom même du collectif : lever le silence sur le massacre de la population syrienne. Tout se passe comme si, à défaut de pouvoir détruire le film, on ne pouvait s’attaquer qu’au cinéaste lui‑même, mais toujours au risque d’augmenter radicalement la portée de sa parole.
4À partir de ce constat, je m’intéresserai aux cinéastes militants assassinés en marge de leur travail, en interrogeant l’idée selon laquelle l’assassinat d’un auteur pourrait lui « donner raison ». Une légitimation a posteriori relativement fréquente, mais sujette à caution, dans la mesure où les meurtres de cinéastes demeurent heureusement exceptionnels, et échappent donc à toute possibilité d’interprétation statistique. Il s’agira également de faire le point sur les conséquences de ces événements dans le champ de l’herméneutique filmique. En quoi la disparition brutale d’un cinéaste engagé modifie-t-elle notre manière de voir son œuvre ? Je tenterai de montrer qu’il peut être raisonnable de lire le film à l’aune de la mort de son auteur, au risque de la téléologie, à condition d’entendre la disparition dans sa dimension esthétique, et non plus seulement factuelle.
La mort comme finalité
5On reproche parfois au cinéma militant de manquer de nuances. Les critiques sont nombreuses contre cette partie de la production cinématographique, souvent à la marge des circuits commerciaux, suspecte d’assumer trop explicitement la radicalité de ses prises de position, et donc de ne pas respecter la diversité des opinions politiques du public. Certains spectateurs le confondent volontiers avec le cinéma de propagande, au motif que tous deux partageraient une vision manichéenne de la politique. Au fond, ce qui est visé dans ce type de critique, ce serait une certaine tendance des films militants à ajouter aux antagonismes politiques des catégories d’ordre moral (le bien/le mal, les bons/les mauvais).
6Or justement, lorsqu’un cinéaste militant est assassiné, cette lecture morale de la politique resurgit. Dans ce cas, en effet, les méfaits du camp opposé ne sont plus seulement d’ordre idéologique ; il ne s’agit plus de dire que la dictature, la police ou le capitalisme sont critiquables, mais qu’ils tuent. La dénonciation d’un régime ou d’une idéologie nécessite des arguments et des preuves. La dénonciation du meurtre, au contraire, se satisfait d’une forme d’évidence morale : tu ne tueras point. Notre vision des films est alors informée par la disparition de l’auteur. En déplaçant la réception sur le terrain moral, l’assassinat peut avoir pour effet d’augmenter la lisibilité du film : il clarifie les oppositions, identifie nettement les forces en présence, et assigne à chacune d’entre elles un coefficient de sympathie.
7Ce phénomène est intéressant, en particulier, dans les situations présentant un conflit de légitimité entre deux camps s’accusant mutuellement de tous les maux, comme la Syrie : nul n’ignore alors le comportement répressif du gouvernement syrien, mais la tolérance des États occidentaux à l’égard du régime de Bachar el‑Assad et la propagande lancée par ce dernier pour discréditer les rebelles compliquent l’équation. En 2012, la mort du cinéaste Tamer al‑Awam, tombé sous les balles du régime en place alors qu’il tourne un documentaire pour l’Armée syrienne libre, suscite l’indignation de la communauté internationale. Face à la mort d’un artiste n’ayant pas directement pris les armes, le doute n’est plus permis. Il est désormais difficile de douter de la sincérité de son film Syria Inside, « comédie documentaire » réalisée l’année précédente, et œuvre à charge contre la dictature médiatique du président Assad.
8Les modalités de réception du film lui‑même sont alors affectées, comme en témoigne le carton en hommage à Tamer al‑Awam dès le générique d’ouverture. Syria Inside met en scène une fausse émission de télévision satirique animée par deux présentateurs jumeaux. À la fin de la première partie du film, l’écran au fond du studio affiche l’image d’un char d’assaut, qui vise l’objectif et fait mine de tirer sur les personnages.
Tamer al‑Awam, Syria Inside, 2011.
9S’ensuit un passage comique dans lequel les deux hommes, partiellement mutilés, entonnent la chanson titre d’une comédie musicale hollywoodienne (There’s No Business Like Show Business, Walter Lang, 1954). La séquence, desservie par des effets spéciaux grossiers, pourrait sembler ridicule. Difficile, pourtant, de ne pas y voir une évocation du destin du cinéaste, sous la forme d’une métaphore dont l’illustration aura rarement été aussi littérale : l’image tue.
10Notons également que le surcroît de légitimité accordé au film ne dépend pas du « succès » de l’assassinat — une tentative infructueuse peut avoir peu ou prou le même effet. Par exemple, l’attentat à la grenade de 2007 contre Samira Makhmalbaf, sur le tournage de son film L’Enfant‑cheval, a révélé la gravité de ses démêlés avec les mouvements conservateurs iraniens. L’événement a même contribué à mettre en avant la portée politique de l’œuvre de la cinéaste, et notamment son engagement féministe, auparavant éclipsé par son talent formel (Le Tableau noir, en 2000, et À cinq heures de l’après-midi, en 2003, avaient tous deux reçus le Prix du jury au Festival de Cannes, une distinction récompensant plutôt les qualités stylistiques d’une œuvre). De même, en 1974, lorsque le groupe d’extrême‑droite Charles Martel attaque le tournage de Dupont‑Lajoie à coup de grenades et de cocktails Molotov1, il devient possible d’établir un lien entre le racisme ordinaire dénoncé par le film d’Yves Boisset et l’existence de groupuscules terroristes tolérés par le pouvoir français.
11À l’inverse, il est des assassinats « réussis » qui n’ont aucun effet sur la réception de l’œuvre du cinéaste, pour peu qu’ils soient marqués du signe de l’accident. C’est le cas de celui d’Eduardo Coutinho, tué par son propre fils Daniel en février 2014 : l’enquête ayant conclu à un « accès de folie », force est d’admettre qu’il s’agit d’un meurtre sans intention meurtrière, et a fortiori sans revendication politique. Le réalisateur avait beau avoir été un représentant important du cinéma militant brésilien dans les années 1970 et 1980, ce ne sont donc pas ses convictions révolutionnaires qui ont été mises en évidence par sa mort brutale, mais bien la tragique fragilité de la condition humaine.
12En somme, le meurtre d’un cinéaste n’est pas seulement un événement malheureux et révoltant, il est en même temps une plus‑value politique offerte à ses films. L’une des preuves les plus notables de l’existence de ce phénomène se trouve dans ses marges les plus indécentes : pour certains cinéastes, il peut être désirable de subir une tentative d’assassinat, dans le but d’offrir à un film une meilleure couverture médiatique. Ainsi, en novembre 2017, le site d’information Al‑Araby al‑Jadeed accuse le réalisateur Muhammad Bayazid d’avoir inventé un attentat au couteau sur sa personne2. Son film The Tunnel, encore en préparation au moment de la rédaction de ce texte, traite des actes de torture commis par le régime syrien sur les prisonniers politiques. Que la supercherie soit avérée ou non, on comprend aisément les bénéfices qu’un tel film pourrait en retirer.
13Dans tous ces cas, l’intention meurtrière agit rétrospectivement sur l’œuvre. Extérieure au film, elle accompagne néanmoins son parcours public et critique, explicitant son positionnement et facilitant sa lecture. A posteriori, il devient possible de raconter l’engagement de l’auteur sous la forme d’un récit cohérent : la folie meurtrière de ses ennemis démontre l’urgence de son combat, tandis que les hommages rendus au défunt valident la pertinence de son point de vue.
14La mort de l’auteur achève son œuvre ; elle lui donne, littéralement, une finalité. Ce qui n’était qu’une somme de films hétérogènes, toujours dépendants des circonstances et de l’interprétation du public, devient un récit cohérent et continu. Ou, pour le dire avec les mots de Pasolini (ironiquement, lui aussi assassiné) :
la mort accomplit un fulgurant montage de notre vie : elle en choisit les moments les plus significatifs […] et les met bout à bout, faisant de notre présent, infini, instable et incertain, et donc linguistiquement non descriptible, un passé clair, stable, sûr, et donc bien descriptible3.
15De même que les images visibles d’un film ne constituent qu’une infime partie de ce qui a été tourné, les souvenirs disponibles d’un individu ne constituent qu’une infime partie de ce qui a été vécu. « Le montage effectue donc sur le matériau du film […] la même opération que la mort accomplit sur la vie4 ».
16Ces deux opérations ont en commun d’ordonner les événements du passé selon un principe directeur. Les circonstances de la mort ne se contentent pas de mettre fin à la vie, elles la rendent racontable, elles lui donnent la forme d’un récit structuré selon les règles classiques de la fable aristotélicienne. Cette tendance de la vie à imiter le régime de l’œuvre rejoint le concept d’« identité narrative » proposé par Paul Ricœur : l’identité d’un individu, comme celle d’un personnage de roman, est faite de discordances successives (les événements sur lesquels il n’a pas de prise) progressivement intégrées, par le récit qu’il fait de lui‑même, à son propre plan de concordance. De sorte que, lorsque survient une donnée inattendue, « la contingence de l’événement contribue à la nécessité en quelque sorte rétroactive de l’histoire d’une vie5 ». C’est au prisme d’une telle conception narrative de l’identité qu’il faut appréhender la métaphore de Pasolini, pour comprendre le rôle décisif de la mort dans le processus de clôture, non seulement de la vie d’un individu, mais de son œuvre (au sens de l’ensemble de ses réalisations). « Telle est la façon par laquelle une vie devient une histoire6 ».
17En filant l’analogie, on peut dire que le meurtrier participe lui‑même à l’acte de création, en tant que monteur de l’œuvre : il sélectionne, parmi l’ensemble des images produites par l’artiste, celles qui méritent que l’on meure pour elles — et donc qui méritent que l’on s’en souvienne. En accomplissant son crime, il donne une direction à l’œuvre, et identifie sa part la plus subversive. Ce faisant, il participe à légitimer un mode de lecture au détriment des autres.
18Dans cette optique, l’assassinat est aussi un coup de force herméneutique. Il accentue le caractère politique du film, et trace une ligne droite entre la signification de l’œuvre et l’événement de la mort. L’intentionnalité du meurtre fonde la certitude d’avoir affaire à une relation causale et non à deux événements distincts, de la même manière que, dans l’effet Koulechov, l’intentionnalité du montage invite le spectateur à recevoir sous la forme d’une association d’idées ce qui aurait pu n’être qu’une juxtaposition arbitraire7. Le film d’un cinéaste assassiné paraît incontestablement militant, en premier lieu, dans la mesure où il n’est plus possible de le percevoir autrement.
Mourir en héros ou mourir en symptôme
19Si l’idée selon laquelle la mort d’un artiste donne « raison » à ses engagements possède quelque pertinence, ce n’est donc pas au sens où l’assassinat révélerait au grand jour une vérité déjà contenue dans l’œuvre, mais plutôt au sens où il institue la grille d’interprétation qui rendra cette œuvre politiquement lisible — parfois même trop lisible. L’assassinat de l’auteur s’inscrit dans un mouvement général de clarification des positions, en aval du film.
20L’interprétation doit faire preuve de la plus grande mesure pour éviter que la signification politique de l’œuvre ne finisse par se réduire à un choix binaire : vie ou mort, coupable ou victime. Pour contenir ce processus de polarisation, il n’est peut‑être pas inutile de remettre l’accent sur le travail d’analyse, donc sur ce qui se trouve en amont de la mort. Que nous apprennent les images quant au destin de leur auteur ? Face à une telle question, la prudence est de mise : il convient de ne pas céder à la tentation téléologique qui conduirait à prêter au film des vertus prophétiques ou divinatoires. Aucun film n’a prévu avec certitude la mort violente de son auteur. Je me contenterai simplement de pointer du doigt des liens possibles entre l’esthétique des films, leur positionnement idéologique, et la physionomie des assassinats.
21Pour éprouver la solidité de cette hypothèse, quoi de mieux que de se confronter directement à un cas limite ? En l’occurrence, il s’agira du court‑métrage Submission (2004) de Theo van Gogh, cinéaste néerlandais assassiné pour ses positions islamophobes. L’idée même que cet événement puisse lui « donner raison », d’une manière ou d’une autre, est insupportable. Aussi cet exemple me permettra‑t‑il de pointer du doigt les inconvénients d’une relecture morale des œuvres de cinéastes assassinés.
22Submission est co‑écrit par Ayaan Hirsi Ali, une femme politique néerlandaise connue pour ses positions conservatrices. Quant à Theo van Gogh, ses propos sur les musulmans, assimilés à des « baiseurs de chèvres8 », n’étaient pas passés inaperçus aux Pays‑Bas. Il s’agit donc d’emblée d’un objet politique et polémique. La forme, elle, repose sur un dispositif simple, qui ne varie que très peu durant les dix minutes que durent le film : une actrice voilée interprète des témoignages (fictionnels) de femmes musulmanes racontant les mauvais traitements qu’elles subissent au quotidien, tandis que l’écran affiche des corps féminins meurtris tatoués de versets du Coran, le tout sur fond de musique orientale et de bruitages évoquant des coups de fouet. D’emblée, Submission ne fait pas mystère de son positionnement à droite — tant dans son texte que dans son paratexte. Un discours limpide, et devenu d’autant plus audible à la suite du meurtre de van Gogh, abattu à Amsterdam par un jeune islamiste le 2 novembre 2004. L’assassin, Mohammed Bouyeri, va jusqu’à laisser sur le corps de sa victime une lettre transpercée d’un poignard, contenant des menaces de mort explicites à l’encontre de Hirsi Ali.
23Il n’est peut‑être pas anodin que le choix de sa première cible se soit porté sur van Gogh, et non sur elle. Hirsi Ali était pourtant députée, et l’on peut supposer qu’elle constituait une menace plus grande pour la communauté musulmane qu’un cinéaste, certes familier de la provocation, mais sans mandat public. Face à ce problème, la notion d’auteur peut offrir un début de réponse. Souvenons‑nous de cette remarque de Michel Foucault :
Les textes, les livres, les discours ont commencé à avoir réellement des auteurs […] dans la mesure où l’auteur pouvait être puni, c’est‑à‑dire dans la mesure où les discours pouvaient être transgressifs9.
24Une punition bien radicale, en l’occurrence. Reste qu’aux yeux du meurtrier, c’est d’abord à l’auteur du film d’en assumer les conséquences, et non (ou seulement de manière secondaire) à sa collaboratrice. C’est dire combien le poids symbolique de la fonction‑auteur demeure écrasant, jusque sur le terrain du calcul politique ou de la croisade religieuse.
25Phénomène médiatique avant d’être un phénomène cinématographique, Submission a donné lieu par la suite à de nombreux commentaires, tant dans les médias traditionnels que sur les réseaux sociaux. Dans le cadre d’une enquête sur l’influence rétrospective de la mort d’un auteur sur son œuvre, les nombreux reuploads du film méritent que l’on s’y arrête brièvement. Une version sous‑titrée en français de Submission est mise en ligne sur YouTube en 2010 par un utilisateur affichant ouvertement son intention militante, dans son nom d’utilisateur (MaelFN) comme dans son profil (qui renvoie à de multiples reprises vers le site du Front National)10. La légende de la vidéo fait explicitement référence à l’assassinat, comme pour démontrer l’apparente lucidité d’un « film qui a coûté la vie au réalisateur néerlandais Theo van Gogh ». Une justification déjà présente dans la première version uploadée sur la plateforme en 2007, que l’on doit à un utilisateur au pseudonyme éloquent, NativeEuropean, et qui demeure très populaire (presque 600 000 vues) malgré une incompréhensible déformation de l’image11. Une autre version, datée de 2013, reprise d’un compte utilisateur supprimé depuis, accompagne le film d’un message pop‑up adressé aux « extrémistes stupides » qui pensent pouvoir « réduire au silence la liberté d’expression simplement en tuant un homme12 ». Une prise de parole anonyme qui s’ajoute à celle de van Gogh, et même la précède, puisque le message est ajouté au tout début de la vidéo. Tous ces partages du film original contribuent à sa légende. Mais surtout, ils se servent de l’interface de YouTube pour faire apparaître des éléments paratextuels (titre, description, nom d’utilisateur, commentaire en pop‑up) susceptibles d’orienter politiquement la réception. Au fond, l’assassinat de van Gogh n’a pas radicalement changé les modalités d’interprétation du film : il s’est contenté de les renforcer.
26Pour le comprendre, penchons‑nous à présent sur l’esthétique de Submission. À plus d’un titre, celle‑ci est déjà marquée par la violence. Le titre lui‑même, à l’origine, renvoie à l’une des traductions possibles du mot « islam »13, mais ses connotations le tirent surtout du côté de la domination sexuelle, comme en témoigne l’ajout des coups de fouet sur la bande son. Le dernier coup de fouet tombe d’ailleurs au moment précis où s’affiche le titre du court‑métrage, ce qui montre que van Gogh assume pleinement cette métaphore. Les tatouages s’inscrivent également dans cet imaginaire, puisqu’ils sont associés à des marques de lacération.

Theo van Gogh, Submission, 2004.
27En outre, chaque idée de mise en scène est répétée plusieurs fois, afin de s’assurer de la clarté du message : c’est le Coran qui soumet et blesse le corps des femmes, la soumission à Allah est une forme d’esclavage, etc. Mais la violence de Submission n’est pas seulement thématique. Elle est également sémiotique : chaque signifiant pointe en ligne droite vers un et un seul signifié, selon des modalités souvent très littérales. Le halo d’obscurité qui enveloppe le personnage renvoie à l’obscurantisme présumé des témoignages ; les tons rouges et ocre de l’image connotent l’orientalité ; quant à l’islam, il est présent sous la forme de ses attributs les plus consensuels (« Allahu Akbar », voile intégral, tapis de prière), selon un imaginaire profondément euro‑centré.
28Ce qui frappe dans Submission, c’est également sa stratégie polémique. Certes, van Gogh milite contre la présence de l’islam en Europe. Mais la cible véritable de son film n’est pas l’islam en tant que religion (même réduite à des attributs caricaturaux), ce sont plutôt les individus qui la pratiquent. J’en veux pour preuve le choix de confier les témoignages à une seule actrice, censée incarner l’archétype de « la femme musulmane », alors que les situations décrites semblent renvoyer à des récits distincts. Lorsqu’elle parle en anglais, sa voix prend des intonations naïves, presque enfantines, accentuées par une absence totale de regard critique sur les faits racontés. Plus frappant encore est le passage dans lequel elle raconte avoir subi des viols à répétition de la part de son oncle : le ton est plus léger que dans le reste du film, et ponctué par de petits rires qui ne cessent de saper la légitimité du témoignage. La souffrance féminine est totalement niée par l’écriture du film, qui choisit d’insister sur la candeur et la désinvolture du personnage — comme si son aveuglement religieux suffisait à lui faire manquer la dimension criminelle d’un viol dont elle est pourtant la victime.
29La dénonciation de l’islam, dans Submission, repose sur une stratégie d’infantilisation de l’adversaire, et ce, à partir d’un simple cas particulier. La grille de lecture est explicitement individualiste, moralisatrice — un choix qui résonne avec la conception de la politique défendue par Theo van Gogh, comme en témoigne son dernier film. Sorti quelques mois après sa mort, 06/05 est un thriller inspiré de la vie de Pim Fortuyn, un politicien d’extrême‑droite néerlandais assassiné pour ses convictions en mai 2002. Le personnage principal y est présenté comme un martyr de la liberté d’expression — ce que van Gogh deviendra lui‑même par la suite, aux yeux des conservateurs néerlandais. En réalité, le meurtrier était un militant écologiste qui a déclaré avoir agi pour des raisons utilitaires, afin de protéger la communauté musulmane des Pays‑Bas, cible privilégiée des attaques de Fortuyn14. D’un côté comme de l’autre, c’est une lecture héroïque de la politique qui prévaut, incarnée par des figures stéréotypées : l’orateur charismatique mais controversé, l’artiste provocateur, le terroriste fanatique, l’activiste se sacrifiant pour supprimer un leader populiste.
30Submission réduisait la politique à une lutte entre individus, et la conception du militantisme défendue par van Gogh se retrouve dans la physionomie de son propre assassinat. De sorte que, si la mort implique toujours une part de hasard, les circonstances dans lesquelles elle survient obéissent tout de même à une certaine logique.
31Dans un cas comme celui‑ci, ce qui est évacué, c’est la dimension possiblement systémique de l’assassinat politique, pourtant présente dans la plupart des exemples recensés. Sans même aborder le cas de régimes autoritaires ciblant explicitement les artistes militants (j’y viendrai par la suite), il est des crimes politiques plus signifiants que celui de van Gogh sur le plan sociologique. Je n’en citerai qu’un exemple : celui de Christian Poveda, assassiné quelques semaines avant la sortie de son film La Vida loca (2009), un documentaire sur les Maras, des gangs salvadoriens ultra‑violents. Les deux cas ont en commun de demeurer relativement isolés, de ne pas s’inscrire dans une vague de meurtres d’intellectuels. Mais ce qui les distingue de manière définitive, c’est la grille de lecture politique sur laquelle ils reposent.
32Dans La Vida loca, nous suivons quelques individus dont la vie entière tourne autour du crime organisé. Ces exemples sont nombreux, présentés dans leur diversité, sans moralisme. En filigrane, le film laisse entrevoir une situation complexe dans laquelle les guerres de gangs ne représentent qu’une petite partie du problème : au rang des facteurs explicatifs, on trouve surtout la misère économique, l’absence de perspectives d’avenir de la jeunesse salvadorienne et la politique sécuritaire menée par le gouvernement de droite dure. Le documentaire ne mobilise ni voix over ni regard surplombant, seulement des entretiens et des moments de vie quotidienne saisis au contact des acteurs. Poveda développe une esthétique de la confiance — confiance dans les individus rencontrés, dans la force d’évocation des images, et dans le réel lui‑même. De sorte que, si l’on peut imaginer que le film de Poveda lui ait coûté la vie (il semble avoir attisé la colère d’une fraction de la Mara 18), ce n’est pas à la suite d’une attaque ciblée contre une communauté ou un mode de vie, comme dans le cas de van Gogh.
33Dans les entretiens qu’il a pu donner avant sa mort, le cinéaste démontre sa connaissance historique et sociologique profonde du phénomène des Maras15. Ce savoir n’est pourtant pas utilisé tel quel dans La Vida loca. Ce sont d’abord les choix de mise en scène qui nous permettent d’appréhender le mode de vie des personnes filmées. La première partie du film alterne entre des séquences à l’hôpital, où apparaît le profond marquage des corps par la violence, et des scènes filmées dans une boulangerie associative qui tente de réinsérer les criminels, et l’on précise bien que l’État n’est pour rien dans ce genre d’initiative. Ces deux lignes temporelles, progressivement rejointes par d’autres, forment l’ossature symbolique du film, tendue entre la destruction physique et l’exclusion sociale.
34Par la suite, une figure de style revient à plusieurs reprises dans La Vida loca : à une séquence en immersion dans le mode de vie des Maras succède une cassure brutale, avec un bref écran noir, un bruit de coup de feu ajouté en post‑production, et un plan sur le cadavre de celui ou celle dont on venait de suivre le quotidien. Il arrive même que ce renversement soudain survienne au terme d’un long processus qui semblait mener à la rédemption. Le procédé rythmique, basé sur la juxtaposition d’une séquence longue et d’une très courte, nous permet de ressentir la froide imprévisibilité de la mort. Mais surtout, la répétition du procédé signale la logique structurelle de l’événement : quoique nécessairement inattendu, le décès n’advient jamais par hasard. La méthode employée par Poveda s’apparente au « montage à distance » théorisé par Pelechian, qui consiste à produire un lien entre plusieurs éléments, non en les rapprochant, mais en les éloignant16. Une technique qui mise sur la mémoire du spectateur, et sur la capacité des images à communiquer entre elles malgré la durée qui les sépare. Conçue pour passer du particulier au général, et dépasser l’unicité intrinsèque de l’image filmique, elle permet ici d’introduire une lecture systémique de la mort — celle des Maras, bien sûr, mais aussi celle de Poveda. Il ne s’agit alors pas de divination : simplement d’analyse politique.
Figures de la disparition prochaine
35Si la mort violente d’un cinéaste est une conséquence de son engagement artistique, comme on peut logiquement le supposer, alors l’analyse de films a toujours quelque chose à nous apprendre sur la forme de cet engagement. Telle est la conclusion que l’on peut tirer de la comparaison entre van Gogh et Poveda. Ce n’est pas seulement la physionomie des meurtres qui diffère, mais aussi la conception de l’action politique sur laquelle reposent les films, et la place qu’ils accordent à la mort elle‑même.
36Il est des situations qui imposent au sujet d’accepter sa disparition prochaine, ou, pour le dire avec Foucault, de « préférer le risque de la mort à la certitude d’avoir à obéir17 ». Le cinéma peut‑il nous aider à comprendre un tel renoncement ? Dans son livre consacré aux images des printemps arabes, Dork Zabunyan a bien montré que cette attitude n’était pas réductible au mythe du martyr, du héros mort pour la cause, mais impliquait un renoncement bien plus profond. Il importe peu que ce soit moi ou un autre dont l’histoire se souvienne. Seul compte, en définitive, « le geste même du soulèvement où se dissipe la frontière ultime, celle entre la vie et la mort18 ». Le cinéaste syrien Ossama Mohammed confessait récemment, au micro des Cahiers du cinéma, avoir fini par accepter la possibilité de sa propre mort, au profit d’une lecture collective de l’action politique : « Les gens qui tombent en ce moment font partie de moi19 ». En disparaissant, je ne fais qu’actualiser la promesse de faire moi‑même partie de ceux qui restent, et qui continuent à lutter.
37Reste à savoir s’il existe des formes privilégiées pour rendre compte de cette modalité singulière de présence de la mort dans la création filmique. On peut également s’interroger sur les conséquences poétiques de cette imprégnation. Pour tenter de répondre à ces questions, je m’intéresserai à présent à une situation dans laquelle les meurtres de cinéastes ont éré relativement nombreux, et liés à une évidente politique répressive : la « guerre sale » et la dictature argentine des années 1970. Je commenterai la manière dont le cinéma militant argentin prend en charge esthétiquement l’idée de la mort prochaine, et inscrit la possibilité de la disparition dans sa texture sensible.
38Parmi les cinéastes assassinés par le régime, nombreux sont ceux qui se sont servis du cinéma pour dénoncer la répression sanglante dont ils seront eux‑même victimes. Ya es tiempo de violencia (1969) d’Enrique Juárez analyse la protestation populaire de mai 1969, connue sous le nom de « Cordobazo », où l’on comptabilise une trentaine de morts sous les balles des militaires, et qui, selon lui, inaugure une ère de violence et de répression sans précédent. On peut supposer que cette critique est à l’origine de la mort du cinéaste, assassiné en décembre 1976 par des agents de la junte militaire. Le film se distingue pourtant par un lyrisme assumé à l’égard des images d’insurrection, avec l’espoir que chaque coup porté au peuple ne ferait que le rendre plus fort.
39La critique des violences d’État est également au cœur d’Operación Masacre (1973), réalisé par Jorge Cedrón et adapté d’une investigation journalistique menée en 1956 par Rodolfo Walsh. Le film se présente comme un objet hybride, tendu entre deux régimes d’images : des images d’archives montrant des manifestations péronistes et des violences policières, pour ancrer le propos dans un espace‑temps réel, et des séquences fictionnelles reconstruisant le destin d’un groupe de civils arrêtés et massacrés par le régime. Ainsi, c’est la fiction qui est mise au service du documentaire, et sommée de combler les blancs lorsque l’enquête bute sur des images manquantes. L’enjeu est mémoriel, puisqu’il s’agit d’honorer les morts de 1956, mais également militant : quinze ans plus tard, les violences d’État sont toujours d’actualité.
40D’ailleurs, Cedrón et Walsh seront tous deux assassinés pour leur engagement péroniste, respectivement en 1980 et en 1977. Le premier aura tout de même eu le temps de réemployer des images d’Operación Masacre dans son film suivant, Resistir (1978). Les séquences fictionnelles y voisinent avec des archives, des commentaires en voix over, et même un entretien filmé avec Mario Firmenich, le dirigeant de l’organisation de lutte armée Montoneros. Cedrón semble avoir cherché à mobiliser la totalité des ressources disponibles, malgré leur hétérogénéité. Mais surtout, le retour des images d’Operación Masacre, tournées en 1973 et représentant un événement de 1956, démontre que la lutte ne cesse de se nourrir du passé pour préparer l’avenir.
41Plus troublants encore sont les exemples de meurtres présentés comme des « disparitions ». Le court‑métrage Las AAA son las tres armas (1979), du groupe Cine de la base, est hanté par ces individus dont il est impossible de savoir s’ils sont déjà morts ou seulement proches de l’être (emprisonnés, torturés…). Reprenant une célèbre lettre ouverte à la junte militaire rédigée par Rodolfo Walsh juste avant sa mort, le film égrène des chiffres vertigineux : 15 000 disparus, à ajouter aux 4 000 morts attestés. En fin de compte, sur la seule période 1976‑1983, on en recensera plus du double. À ce titre, la dictature argentine aura été une véritable « machine à tuer les “subversifs”20 » en même temps qu’une machine à produire de l’ignorance sur ses propres méthodes de répression. Dans Las AAA son las tres armas, la lettre ouverte est interprétée par la voix d’un autre, mais à la première personne du singulier : c’est le fantôme de Walsh qui semble s’adresser à nous depuis la tombe pour nous parler des disparus — auxquels il appartient. Il explique en particulier que des lois existent pour encadrer les conditions de détention et l’usage de la torture en Argentine, mais ne sauraient s’appliquer dans la mesure où, officiellement, le prisonnier n’existe pas.
42Dans un texte consacré à la forme narrative de l’enquête, Jean‑Louis Déotte a bien résumé l’impossibilité matérielle de rendre justice aux disparus :
Quand on dit d’une personne qu’elle est portée disparue, on ne sait pas ce qu’on dit puisque, ne sachant ni si elle vit encore ni si elle a été assassinée, on doit suspendre toute thèse ontologique, tout jugement d’existence21.
43Comme un écho à ce constat, une séquence terrible d’Operación Masacre met en scène les familles des victimes confrontées, impuissantes, à des agents de police pour qui il n’y a littéralement rien à signaler : pas de corps, pas de traces, pas de scandale.
44Ce n’est plus seulement la mort qui demande à être figurée à l’écran, mais un régime d’existence intermédiaire, à l’extrême limite de la vie. Une première solution consiste à tenter, malgré tout, d’offrir une présence sensible à ces morts en sursis. Il est alors nécessaire d’inventer des modèles figuratifs dédiés. Dans Operación Masacre, Cedrón emprunte et détourne une forme issue du cinéma de fiction : le flashback. On assiste d’abord à la découverte du massacre, puis le récit revient en arrière pour expliquer le déroulement des faits jusque là. Operación Masacre se rapproche en cela du film noir ou du film policier, deux genres qui ont contribué à imposer cette structure narrative dans le cinéma classique. Comme dans Citizen Kane (Orson Welles, 1941), la mort est donnée dès l’ouverture, et le film devra ensuite en expliquer les circonstances. Mais à mesure qu’il puise dans ce répertoire classique, Cedrón désamorce les enjeux de l’investigation : au fond, les responsables sont toujours les mêmes, et les victimes ne sont ni plus ni moins coupables que n’importe quel citoyen argentin. Il n’y a rien à expliquer, seulement à constater la marche implacable de la machine répressive, et à pleurer les morts.
45C’est alors que la séquence d’ouverture trouve tout son sens. On y voit l’un des survivants du massacre, Julio Troxler (qui interprète son propre rôle), marchant sur les lieux du crime et décrivant l’un après l’autre ses camarades assassinés, énumérant leur nom, leur profession, et un ou deux souvenirs partagés avec eux. Ainsi, les disparus ne le sont plus tout à fait, à mesure que la pellicule enregistre les traces de leur mémoire. Une entreprise d’autant plus nécessaire qu’elle est menée par celui‑là même qui a été témoin des faits. D’ailleurs, Troxler lui‑même sera assassiné peu de temps après la sortie du film, par la tristement célèbre Alliance Anticommuniste Argentine (AAA), escadron de la mort responsable de la plupart des crimes de la « guerre sale ».
46Autre cinéaste « disparu », en 1976, juste après le coup d’État du général Videla, Raymundo Gleyzer mérite que l’on s’attarde quelques instants sur sa manière d’inscrire la mort à l’écran. Dans Ni olvido ni perdón (1972), il retrace les événements ayant mené au massacre de Trelew, soit l’exécution sommaire, par la dictature, de 16 militants de diverses organisations de lutte armée d’extrême-gauche (ERP, FAR, Montoneros). Pendant les vingt premières minutes, soit deux tiers du film, on assiste à des entretiens avec quelques‑uns des principaux leaders révolutionnaires impliqués. Le spectateur s’imprègne de leur voix, de leur visage, de leurs idées. Puis, le rythme s’accélère brutalement. Se succèdent alors 19 portraits photographiques des militants incarcérés, chaque image restant visible à l’écran pendant quatre ou cinq secondes, tandis qu’une voix over monotone égrène le nom et l’affiliation de chacune des personnes concernées.
Raymundo Gleyzer, Ni olvido ni perdón, 1972.
47Le ton est froid, presque administratif. Mais il est nécessaire de jouer le jeu de l’administration, face à un régime qui nie jusqu’à l’existence même des disparus : le nom est alors la seule preuve que ces individus ont bel et bien existé. Comme le rappelle J.‑L. Déotte, « les disparus demandent à être nommés22 » pour retrouver un semblant d’existence. Quant à l’iconographie de Ni olvido ni perdón, elle se rapproche de celle des hommages rendus aux morts dans les journaux d’extrême-gauche argentins : pour chaque combattant tombé sous les coups du régime, un portrait associé à un nom, dans une présentation visuelle qui « reproduit la pratique mortuaire des niches et tombeaux », empruntée aux pratiques funéraires chrétiennes23.
48Mais Gleyzer va plus loin grâce au montage de ces différents éléments, dont le sens apparaît nettement une minute plus tard : soudainement, un carton blanc sur noir indique « Le massacre », puis la même série de portraits revient à l’identique, mais beaucoup plus rapidement, accompagnée d’un bruit de mitrailleuse. La reconstruction symbolique de l’assassinat ne dure que vingt secondes, comme pour signaler la dimension expéditive de la « justice » argentine (la nuit de leur exécution, les insurgés étaient seulement censés être jugés). Le procédé rythmique inventé par Gleyzer joue sur le choc de la disparition : grâce aux séquences précédentes, ces jeunes fusillés ne nous étaient pas tout à fait inconnus, et leur perte n’en est que plus terrible. Après le massacre, le film se poursuit de manière tout aussi expéditive, avec de brefs plans sur les trois survivants (qui finiront eux aussi par « disparaître » quelques années plus tard), puis une deuxième série de portraits, sur les exécutants et les responsables du massacre. On retrouve alors les deux versants annoncés dans le titre du film (« Ni oubli, ni pardon ») : d’un côté, Gleyzer inscrit la mémoire de chacune des victimes dans l’irréductibilité d’un nom et d’un visage ; de l’autre, il applique le même traitement aux bourreaux, afin que demeure la trace de leur infamie.
49Tous ces procédés se confrontent à un même problème : celui qui consiste à rendre visible « le trouble de la représentation que génère toute disparition24 ». La difficulté est grande, et la résolution nécessairement double : d’un côté, les films s’adossent à des modèles figuratifs préexistants pour inscrire la présence de la mort à l’écran ; de l’autre, ils gardent en leur sein une faille, une rupture dans l’ordre figuratif, qui correspond à la disparition elle-même.
50Au fond, c’est toute l’esthétique de la dictature argentine qui se donne à voir dans ces images. Il y a d’abord la nécessité d’offrir une sépulture cinématographique à ceux dont on ne retrouvera jamais le cadavre. D’où une certaine solennité dans la mise en scène de ces visages et de ces noms, dans lesquels on pourrait presque voir des saints ou des martyrs25. Mais cette montée en visibilité s’inscrit dans un contexte général qui est celui d’une esthétique du secret, du caché, de l’inexistant. Ainsi, dans Las AAA son las tres armas, les personnes présentes sont réduites à quelques fragments : un gros plan de bouche, des boucles de cheveux, des plans d’ensemble où tous les militants sont de dos — en tout cas, rien qui ne permette de mettre un nom sur un visage. C’est le privilège des morts que de ne plus être tenus de dissimuler leur identité. Mais dans un tel contexte, la frontière entre ces deux régimes d’existence est très mince. En même temps qu’un hommage rendu aux compagnons disparus, le film est toujours un pas supplémentaire de l’auteur vers sa propre mort. De sorte que, lorsque survient l’événement du meurtre ou le non‑événement de la disparition, cela ne fait que confirmer la fragilité, mais aussi la puissance de l’engagement cinématographique.
*
51Exceptionnellement, il arrive que ces deux versants, fragilité et puissance, se donnent dans une totale simultanéité. Je pense ici à une séquence rare et bouleversante, qui constitue le terme naturel de cette étude. Le 29 juin 1973, au moment même où une tentative de coup d’État secoue le Chili, le photographe argentin Leonardo Henrichsen filme le déploiement des militaires dans les rues de Santiago, et la panique des citoyens alentours. La séquence, brève, est sidérante. Alors que la caméra s’attarde sur un convoi, un premier soldat vise l’objectif et ouvre le feu, suivi par un deuxième, puis un troisième.
Leonardo Henrichsen, séquence sans titre, 1973.
52On perçoit alors un léger tressaillement de l’image, puis un relâchement total du cadre, avant que le sol n’envahisse l’écran : l’homme derrière la caméra vient d’être touché, enregistrant en temps réel sa propre mort. Un document saisissant, dont la charge affective excède toute analyse. Néanmoins, on peut y voir l’aboutissement naturel de la logique qui pousse un gouvernement à tenter d’endiguer la production cinématographique, avec l’espoir que cela suffise à contenir la protestation elle‑même. Qu’une simple image puisse pousser des militaires à riposter par le feu, voilà en tout cas la preuve définitive de la puissance politique du cinéma.