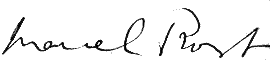
Françoise Leriche, Université Lyon III et équipe « Proust » de l'I.T.E.M. : Focalisation et omniscience dans Sodome et Gomorrhe I et II
Il ne saurait être question -on s'en douted'entreprendre ici, dans un cadre aussi restreint, une étude exhaustive de tous les épisodes de Sodome et Gomorrhe I et II pour déterminer leur mode de focalisation, ni de recenser les manifestations d' « omniscience ». Plus utile me paraît de définir, aussi précisément que possible, ces notions qui, souvent, sont mal comprises et, surtout, de faire apparaître les présupposés théoriques au nom desquels on accuse Proust d'être « négligent », « inconséquent », voire incapable de se rendre compte des incohérences ou des contradictions supposées de son roman.
Si l'on pose en effet comme a priori critique le « réalisme subjectif » de Proust, ou si on lit la Recherche comme une autobiographie fictive (le héros devenu le narrateur de sa propre histoire), les récurrents indices d' « omniscience » embarrassent.... Et quand on est embarrassé, il est tentant de supposer que l'auteur, fatigué, pressé, malade, (etc.), ne s'est pas rendu compte de ce qu'il écrivait. Mais ne faudrait-il pas plutôt remettre en cause ces présupposés critiques ? Pourquoi, a priori, ne pas faire confiance à l'auteur, ou, du moins, à son texte, à son geste créateur, et ne pas lui donner raison contre les rationalisations étroites de la critique ? L'écriture moderne n'a-t-elle pas pour signe distinctif de toujours déplacer les habitudes, d'attenter aux conventions (formelles, morales, linguistiques...) qu'on croyait les mieux établies ? Longtemps, par exemple, on a cru que le jeune Rimbaud agissait par ignorance et manque de maîtrise technique lorsque, dans ses premiers vers, il affaiblissait la césure et multipliait les « incorrections » de toutes sortes : il a fallu plus d'un siècle pour qu'on comprenne que le petit surdoué de Charleville, fort lettré et fort au fait des questions de métrique, se livrait à ce sournois travail de sape de manière concertée. De même, pourquoi considérer comme incohérence chez Proust ce qui pourrait bien être, pour peu qu'on le prenne au sérieux, une innovation narrative inouïe : un récit à la première personne mené par une instance narratrice « omnisciente » ?
Nous prendrons donc pour point de départ les fort utiles clarifications terminologiques que Gérard Genette, dans Figures III (Seuil, 1972), a introduites dans la jungle terminologique et conceptuelle des années 1950-1970, et que la stylistique universitaire issue de Genette a adoptées et développées (« focalisation interne », « focalisation zéro », etc.).
Puis, en revenant sur certains problèmes fort justement posés par les pionniers de la narratologie proustienne (Rogers, Muller, Tadié, Raimond...) [1] , en des travaux dont Genette a brillamment fait la synthèse mais sans toujours accorder une place suffisante aux réels problèmes qu'ils soulevaient, nous verrons, par l'étude de quelques exemples tirés de Sodome II, que le modèle narratif de Proust n'est pas forcément celui auquel on croit (du moins, auquel Genette croit) et que, manifestement, Proust privilégie les récits « omniscients » et la focalisation multiple de façon très délibérée.
Commençons par quelques rappels -et même, par quelques truismes.
Un romancier est, par définition, toujours « omniscient » --puisqu'il a totale maîtrise sur les événements qu'il invente, les personnages et leurs motivations. L' « omniscience » n'est pas une technique en soi, mais le parti pris d'assumer pleinement cette liberté narrative.
« Focalisation », en revanche, est un terme technique, et désigne la façon dont l'information est dispensée -dont l'information est filtrée (ou non). Si un événement est décrit à travers la perception (forcément limitée, partielle) qu'en a un personnage du récit, on parle de « focalisation interne » [2] . Lorsque l'événement est narré directement, de façon « absolue » pourrait-on dire, en tous cas sans la médiation de la conscience perceptive d'un personnage, on parle de récit « non focalisé », ou encore : de « focalisation zéro ».
Certains (certains étudiants, mais pas seulement des étudiants...) ont tendance à s'imaginer spontanément qu'un récit de type « omniscient », à la 3e personne, est un récit non-focalisé, tandis qu'un récit à la 1re personne serait forcément mené en focalisation interne. Or il n'en est rien ! Ces équations simplistes sont erronées, et Genette a insisté avec force sur ce point. En effet, un romancier « omniscient », dans un récit à la 3e personne, a recours très souvent à la focalisation sur l'un ou l'autre de ses personnages : ainsi, dans une même scène, Stendhal fait alterner la perception qu'en ont Julien Sorel et Madame de Rênal, en une sorte de jeu de champ / contre-champ avant la lettre ; de sorte qu'un récit à la 3e personne ne cesse de faire alterner focalisation-zéro et focalisations internes -autrement dit : narration médiatisée et narration non médiatisée (perception des faits par les personnages, et savoir absolu de l'auteur). Jusqu'ici, c'est simple. Mais, ce qui paraît moins évident, et c'est ici qu'il convient de ne pas se tromper, c'est qu'il en va presque exactement de même pour le récit à la 1re personne, comme l'a montré Genette [3] : le narrateur d'un récit à la 1re personne raconte, lui aussi, directement (donc, pas de « filtrage » par la conscience perceptive d'un « personnage » : focalisation-zéro) et il peut lui aussi, sans que cela soit une nécessité narrative, présenter les faits en fonction de la perception qu'en avait le héros (donc le personnage qu'il était) à l'époque considérée. C'est uniquement dans ces cas-là que le récit à la 1re personne recourt à la focalisation interne (sur le héros) [4] : le reste du temps, quand le narrateur raconte, analyse directement, le récit à la 1re personne rejoint le cas général du récit non-focalisé. Mais il faut tout de suite ajouter un correctif -du moins pour définir le récit à la 1re personne de type réaliste-- : le récit du narrateur, pour rester vraisemblable, ne peut narrer que ce que le protagoniste sait -c'est-à-dire : ce qu'il savait à l'époque des faits-- ou ce qu'il a appris depuis.
Autrement dit : le récit de type autobiographique qui vise la vraisemblance exclut
1) la narration de scènes dont le héros n'a été ni l'acteur ni le témoin, ou dont il ne peut avoir eu connaissance par la suite ;
2) la focalisation interne sur des personnages autres que le héros (puisque le narrateur, s'il est bien le héros plus âgé, peut relater comment il a perçu lui-même telle ou telle scène, mais non comment les autres personnages la percevaient) ;
3) enfin, que le narrateur fasse des incursions psycho-narratives dans les motivations et les sentiments d'autrui (ou alors, il faut des modalisateurs indiquant qu'il s'agit d'une supposition, d'une déduction logique : peut-être ; sans doute ; il/elle devait croire, etc.).
Ainsi, la seule différence qui existe entre récit à la 1re personne et récit à la 3e personne n'est nullement une différence de cadrage focal (puisque la narration peut y être aussi bien non-focalisée que focalisée). Simplement, dans le cas d'une autobiographie fictive de type réaliste, le romancier doit respecter la vraisemblance, c'est-à-dire le savoir possible du héros devenu narrateur.
Or la critique proustienne, dont Genette dans Figures III synthétise les travaux, a remarqué très tôt l'invraisemblance de nombreux passages de la Recherche : d'une part, des scènes dont le héros n'a été ni acteur ni témoin ; d'autre part, de fort nombreuses analyses des pensées et sentiments de personnages autres que le héros.
En ce qui concerne les premières (par ex., dans Sodome II : les scènes entre Charlus et Morel, Morel et le prince de Guermantes, la vie secrète de M. Nissim Bernard, etc.), Genette suggère (op. cit., pp. 220-221) qu'il ne faut pas se hâter de crier à l'invraisemblance ou à l'intervention du romancier « omniscient », mais que le héros peut très bien avoir appris tout cela par des « ragots ». Ici vient ma première objection : si des « ragots » peuvent en effet avoir permis au narrateur de savoir que Morel déjeunait souvent avec le baron dans des restaurants de la côte (SG II, p. 395), par exemple, ou que Morel s'est rendu un soir dans la villa louée près de Balbec par le prince de Guermantes (p. 467), la rumeur pouvait-elle lui permettre de connaître en détail le contenu de la conversation entre Charlus et Morel au restaurant de Saint-Mars-le-Vêtu (pp. 395-399), le ton avec lequel les paroles avaient été prononcées, le détail du menu, les motivations secrètes de l'un et de l'autre et leurs réactions intimes ?
Qui mieux est : lors du rendez-vous manqué de Morel chez le prince (pp. 467-468), qui pouvait connaître à la fois les actions et réactions de Morel, laissé « seul » au salon, et les recherches inquiètes menées par le prince dans sa villa après la fuite du jeune homme ? Si donc le héros a pu, par des ragots, apprendre le rendez-vous, il n'aurait pu en aucun cas apprendre comment la scène s'était déroulée - sauf à recueillir les confidences de Morel d'une part, celles du prince d'autre part, et à reconstituer le puzzle. Et il en va de même pour quantités d'autres scènes, qu'il serait long et fastidieux d'énumérer.
Peut-on vraisemblablement supposer que le héros passe son temps à confesser les uns et les autres pour vérifier et compléter les informations fournies par les « ragots », et peut-on imaginer que chacun des personnages interrogés satisferait sa curiosité, lui livrant sans vergogne et avec complaisance les pensées les plus intimes qu'il aurait éprouvées dans telle ou telle circonstance ? Il faut bien admettre, sans chercher à biaiser, que ces scènes, nombreuses dans Sodome II, excèdent le savoir du héros à l'époque des faits ainsi que le savoir qu'il a pu recueillir par la suite.
On peut donc d'autant moins nier l'existence du romancier « omniscient » que la narration proustienne opère de constantes incursions dans les pensées et sentiments des personnages autres que le héros. Citons, par exemple, l'huissier de la princesse de Guermantes, dont sont décrits les émois secrets lorsqu'il reconnaît dans le duc de Châtellerault l'inconnu qu'il avait rencontré « l'avant-veille » (pp. 37-38, et aussi 35) : comment le héros pouvait-il pu connaître cette rencontre, lui qui n'a découvert l'existence de l'homosexualité que quelques heures avant la réception en question ? N'étant pas au courant de la vie secrète de l'huissier, comment, tendu et nerveux comme il l'était lui-même, aurait-il pu porter une attention suffisamment attentive à l'intonation avec laquelle l'huissier prononçait le nom du duc de Châtellerault pour y déceler une « tendresse veloutée » ? Seule une personne avertie de cette rencontre aurait eu quelque motif pour scruter ainsi l'attitude des deux hommes, et écouter avec attention les intonations de « l'aboyeur » pour tenter de percevoir si son professionnalisme l'emportait ou non sur son trouble... Quant au héros, à supposer qu'il ait appris plus tard cette rencontre, comment expliquer que ce soir-là, il ait porté une telle attention aux nuances phonatoires de l'huissier, et que cette nuance imperceptible l'ait à ce point frappé qu'il s'en soit souvenu, ensuite, au moment où il aurait appris les moeurs de cet homme ? Dans « Un amour de Swann », Swann se rendait bien compte qu'il est impossible de tout scruter, de tout analyser pour tenter de deviner ce que l'on nous cache, et que c'est au contraire lorsqu'on sait les pensées secrètes d'autrui qu'on peut déceler le sens d'une intonation, les traces imperceptibles d'un embarras. L'analyse de la voix de l'aboyeur est bel et bien menée par un romancier « omniscient », et Genette est bien forcé de reconnaître, malgré qu'il en ait, qu'il y a là un problème insoluble, et que cette position extérieure de la narration met en péril le « réalisme subjectif » du roman proustien [5] .
Ainsi,
- la focalisation interne tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre des personnages,
- les nombreuses occurrences de psycho-narration (ou psycho-description) explicitant les pensées intimes de personnages autres que le héros,
- et, ajouterai-je, la multiplicité des scènes dont le héros ne peut connaître le détail,
tout cela amène Genette à décrire le roman proustien comme « polymodal », « pluriel » (op. cit., pp. 223-224).
La difficulté n'est donc pas dans l'alternance entre focalisation interne et focalisation-zéro, parfaitement normale, on l'a vu, pour un récit à la 1re personne, mais dans le fait que la narration en focalisation-zéro tantôt respecte les limitations du savoir du protagoniste, tantôt -souvent !ne se soucie pas de telles limitations et, donc, se fait « omnisciente ».
Or ces occurrences d' « omniscience » sont en effet trop nombreuses, trop systématiques pour qu'on puisse parler de lapsus, ou d'infractions isolées à la règle. Toutefois, Genette ne va pas jusqu'à considérer que Proust abolisse la règle d'un récit de type autobiographique. Ainsi, selon lui, la réponse à la question « qui parle ? qui raconte ? » ne fait aucun doute : c'est le héros, devenu narrateur de sa propre vie.
Mais comment expliquer que Proust, l'auteur réel de cette autobiographie fictive, puisse inclure autant d'éléments discordants, autant de scènes que le « héros-narrateur » ne peut connaître ? Inconséquence ?
C'est cette idée d'inconséquence de Proust qui transparaît implicitement dans le chapitre suivant de Genette, consacré aux « voix narratives » (op. cit., chapitre « Voix », pp. 225-267) :
C'est sans le vouloir, peut-être sans le savoir, et pour des raisons qui tiennent à la nature profonde --et profondément contradictoirede son propos, que la Recherche attente aux conventions les mieux établies de la narration romanesque en faisant craquer non seulement ses « formes » traditionnelles, mais [...] la logique même de son discours [6] . ( p. 259 -je souligne)
Sans le vouloir, sans le savoir... La critique proustienne en est restée longtemps à cette hypothèse.
Or, depuis 1972, le développement des études génétiques proustiennes a montré une intéressante évolution dans l'écriture de la Recherche : la quasi-totalité des scènes qui excèdent le champ de connaissance du protagoniste sont des additions progressives à la trame initiale.
Il est donc clair que le roman proustien n'est pas contradictoire en son principe, --c'est-à-dire : au départ--, mais que cette apparente contradiction actuelle RESULTE du choix tardif de Proust de multiplier ces scènes et épisodes relevant de l' « omniscience » du romancier, et donc, de faire éclater la forme choisie initialement (entre 1908 et 1911), qui était très cohérente [7] .
Sodome I, avec son grand discours théorique sur l'inversion qui excède évidemment le champ de savoir du héros hétérosexuel, mériterait une étude à part entière : nous ne pouvons pas l'entreprendre ici. Mais quelques exemples de Sodome II fourniront matière à notre propos.
A. Prenons un premier exemple, très simple : le grand passage digressif sur l'amabilité de la marquise douairière de Cambremer, qui n'hésite pas à honorer de sa présence les plus insignifiantes réunions mondaines de la région de Balbec (SG II, pp. 162-164).
Ce récit itératif, majoritairement en focalisation zéro, multiplie les détails narratifs et descriptifs que seul pourrait connaître un intime des maîtres de maison, et accumule des éléments de psycho-narration. Ainsi apprend-on les motivations de la marquise (peur de décevoir, alors qu'elle « eût préféré aller se promener ou rester dans ses merveilleux jardins de Féterne » --p. 163) ; et le texte insiste surtout sur l'état d'esprit des maîtres de maison ayant organisé le goûter (la fièvre de l'attente, le mépris pour les matinées des autres et la diminution de prestige qui en résulte pour la marquise, le soulagement de la voir arriver et le regain de prestige dont bénéficie alors la marquise, le snobisme, l'hypocrisie, etc. : pp. 163-164). Ce récit excède le champ de savoir du héros au moment où il intervient dans le roman (le lendemain de son arrivée à Balbec !), car le jeune homme, jusqu'alors, n'a jamais fréquenté les Cambremer, ni les « hobereaux » ou les « francs-bourgeois » de la côté normande [8] ; il ne peut résulter non plus d'une expérience ultérieure du personnage, qui, lors de ce second (et dernier) séjour à Balbec, ne fréquentera qu'Albertine, les Verdurin, Charlus, et, occasionnellement, fera quelques visites à des nobles locaux, mais appartenant tous, cependant, aux vieilles familles aristocratiques de la région (les Cambremer, M. Verjus de Crécy) : rien n'autorise donc à dire que le héros ait participé à des goûters donnés par des « hobereaux » [9] (comment les aurait-il connus ?) et encore moins par de simples bourgeois de la région. En tout état de cause, pour juger de ce qui relève de l'expérience du héros (donc de la vraisemblance du récit), le lecteur ne doit s'appuyer que sur les données effectives du récit, et non pas se mettre à imaginer la vie que le personnage pourrait avoir menée sans que le texte le dise : un personnage fictif n'est pas une personne réelle, son existence se réduit à ce que la narration en dit. Par conséquent, la narration de ces goûters de Madame de Cambremer chez les nobliaux ou bourgeois normands présente toutes les caractéristiques du récit « omniscient » --alors qu'il eût été facile pour Proust de placer cet épisode plus tard dans le déroulement du séjour à Balbec et de faire participer le héros à l'un de ces insignifiants goûters honorés par la marquise, afin de décrire la scène par le biais d'une focalisation interne sur le jeune homme, ou médiatisée par ses souvenirs (selon la logique autobiographique de la remémoration).
A tout le moins l'auteur aurait-il pu employer des modalisateurs pour présenter les pensées de la marquise et de ses hôtes (Madame de Cambremer eût sans doute préféré ; je m'imaginais le soulagement qu'ils devaient éprouver quand, après le premier morceau [...], un des invités annonçait la calèche [etc.]).
Dans cet épisode, le choix du récit « omniscient » est donc manifeste -de même que sa place, au milieu de la section des « Intermittences du coeur » caractérisée par sa dominante introspective, introduit une variation de ton et de mode narratif forcément voulue [10] .
B. Deuxième exemple, plus étonnant et plus sophistiqué : le récit du premier trajet du protagoniste en « tram » pour aller à son premier dîner Verdurin (on se bornera ici aux pages 259-261, c'est-à-dire au début du trajet).
Rappelons que notre jeune homme n'a jamais fréquenté les Verdurin [11] : il ne connaît donc pas les « fidèles », à l'exception de Cottard qui a été son médecin à Paris. Pour qu'il ne soit pas « perdu » à l'arrivée à la gare de Douville-Féterne et sache trouver les voitures envoyées par la Patronne, il faut donc qu'il voyage dans le même train que Cottard, autrement dit : que le docteur, qui emprunte le train à la station de Graincourt, ne manque pas le train où se trouve déjà notre héros, parti de la station de Balbec, et, si possible, qu'il monte dans son wagon.
Aussi, le petit train ne s'arrêtant qu'un instant à Graincourt, première station après Doncières, je m'étais mis à la portière tant j'avais peur de ne pas voir Cottard ou de ne pas être vu de lui. Craintes bien vaines ! (p. 259)
Ici, donc, on attendrait une description de ce que le héros voit de la portière : Cottard, la gare, les « fidèles », etc. Autrement dit, on s'attend à une description focalisée par le regard du personnage en situation.
Or que fait le texte ? Il procède de façon étrange, et retorse :
Je ne m'étais pas rendu compte à quel point [...]
Le texte passe donc en focalisation zéro : l'instance narratrice énonce (et, de surcroît, par prétérition) un savoir que n'a pas le personnage -un savoir que le héros, qui n'a jamais vu les fidèles, ne peut pas avoir. Mais voyons la suite :
Je ne m'étais pas rendu compte à quel point le petit clan ayant façonné tous les « habitués » sur le même type, ceux-ci, par surcroît en grande tenue de dîner, attendant sur le quai, se laissaient tout de suite reconnaître à un certain air d'assurance, d'élégance et de familiarité, à des regards qui franchissaient, comme un espace vide où rien n'arrête l'attention, les rangs pressés du vulgaire public, guettaient l'arrivée de quelque habitué qui avait pris le train à une station précédente et pétillaient déjà de la causerie prochaine. (Ibid.)
Cette description, finalement, a toutes les apparences d'une description focalisée par le regard du héros qui, s'étant mis à la portière de crainte de manquer Cottard (le seul qu'il connaisse), apparemment s'aperçoit (« Craintes bien vaines ! ») qu'il peut reconnaître le petit groupe des fidèles sans les avoir jamais vus.
Mais a-t-on vraiment affaire à une description focalisée sur le héros ? Voyons plutôt la suite :
Ce signe d'élection, dont l'habitude de dîner ensemble avait marqué les membres du petit groupe, ne les distinguait pas seulement quand, nombreux, en force, ils étaient massés, faisant une tache plus brillante au milieu du troupeau des voyageurs -ce que Brichot appelait le « pecus »-- sur les ternes visages desquels ne pouvait se lire aucune notion relative aux Verdurin, aucun espoir de jamais dîner à la Raspelière. D'ailleurs, ces voyageurs vulgaires eussent été moins intéressés que moi si devant eux on eût prononcé -- et malgré la notoriété acquise par certains - les noms de ces fidèles [...]. Mais, si les noms des fidèles n'étaient pas connus du « pecus », leur aspect pourtant les désignait à ses yeux. Même dans le train (lorsque le hasard de ce que les uns et les autres d'entre eux avaient eu à faire dans la journée les y réunissait tous ensemble), n'ayant plus à cueillir à une station suivante qu'un isolé, le wagon dans lequel ils se trouvaient assemblés, désigné par le coude du sculpteur Ski, pavoisé par Le Temps de Cottard, fleurissait de loin comme une voiture de luxe et ralliait à la gare voulue le camarade retardataire. (Op. cit, p. 259-260 et 260-261).
Ce regard est-il donc celui du héros hic et nunc ? ou ne serait-ce pas plutôt le regard, en récit itératif, du vulgum pecus ? Dans la dernière phrase, notons que le personnage focal semble être le « camarade retardataire » qui aperçoit, du quai où il attend, le wagon « de luxe » --mais ce regard peut être tout aussi bien celui du « pecus » stationné sur le quai.
Viennent ensuite dix lignes d'un récit itératif non-focalisé, consacré à Brichot, puis :
Quelquefois l'inverse se produisait : un fidèle avait dû aller assez loin dans l'après-midi et en conséquence devait faire une partie du parcours seul avant d'être rejoint par le groupe ; mais même ainsi isolé, seul de son espèce, il ne manquait pas le plus souvent de produire quelque effet. Le Futur vers lequel il se dirigeait le désignait à la personne assise sur la banquette d'en face, laquelle se disait : « Ce doit être quelqu'un », et avec l'obscure perspicacité des voyageurs d'Emmaüs discernait, fût-ce autour du chapeau mou de Cottard ou du sculpteur Ski, une vague auréole, et n'était qu'à demi étonnée quand à la station suivante, une foule élégante, si c'était leur point terminus, accueillait le fidèle à la portière [...], ou bien si c'était à une station intermédiaire, envahissait le compartiment. (Op. cit, p. 261)
Dans tout ce passage sur le train, la narration est donc majoritairement « omnisciente », avec des effets de focalisation externe, montrant les fidèles vus (de manière habituelle, itérative) par le vulgum pecus --et non pas par le héros lors de ce premier voyage en tram vers la Raspelière.
Et en effet, peu après, nous est donnée la preuve que le héros à sa portière n'a pas pu voir les fidèles « nombreux, en force, massés, faisant tache au milieu de troupeau des autres » ... car on apprend qu'en réalité, les fidèles sont arrivés en retard ce jour-là, qu'ils ont failli manquer le train, et qu'ils ont déboulé sur le quai au pas de course juste au moment où le train allait repartir, dirigés par Cottard. Du reste, le groupe qui le suit se limite à Ski, Brichot et Saniette !
Donc, si l'on reconstitue la scène :
- le héros s'est mis à la portière à l'arrivée du tram à la gare de Graincourt : mais il ne peut repérer Cottard (ni aucun des fidèles) sur le quai...
- le train s'apprête à repartir ; Cottard arrive sur le quai au pas de course, suivi de Ski, Brichot et Saniette (voir p. 267).
- le chef de gare signale au train d'attendre ; Cottard, qui a repéré le héros, dirige sa petite troupe vers son wagon.
Par conséquent, le regard repérant sur le quai la « masse » nombreuse des fidèles stationnés, et les identifiant comme groupe homogène à leur air d'assurance et à leur élégance vestimentaire, ne peut être celui du héros à la portière lors de ce premier trajet. Ainsi, la description focalisée de la page 259, qui semblait correspondre au spectacle vu par notre protagoniste, est assignable finalement au regard anonyme du « pecus ». (Précisons : il s'agit bien d'une description focalisée, mais focalisée sur le « pecus » anonyme, et non sur le héros -ce qui contredit formellement les lois d'un récit à la première personne de type autobiographique).
Peut-on résoudre la difficulté en envisageant qu'il s'agisse d'une expérience faite par le héros lors des dîners suivants -autrement dit d'un savoir « ultérieur » du héros ? Cette explication n'est pas satisfaisante sur le plan de la vraisemblance psychologique, et contredirait l'expérience exposée par ce texte. En effet, lors des voyages suivants, le héros connaît individuellement tous les fidèles (leur identité, leur physique) pour les avoir vus lors de ce premier dîner ; il ne peut donc plus être dans la situation d'un inconnu qui intuitivement, tel un pèlerin d'Emmaüs, les « reconnaîtrait », les repèrerait comme groupe homogène rien qu'à leur seul « air d'assurance, d'élégance et de familiarité » . Bien sûr, par la suite, le héros a pu remarquer dans le groupe des « fidèles » cette allure commune, mais le fait de connaître chacun d'eux par son identité propre (donc de reconnaître les « fidèles » immédiatement, individuellement, par leur visage, parmi les voyageurs attendant sur le quai) rend impossible l'expérience décrite à la page 259, à savoir, celle qui consiste à identifier comme groupe des inconnus par un regard purement extérieur, un pur regard d'ethnologue. (On parlera donc ici, techniquement, d'une focalisation « externe » : le « pecus » est ce témoin anonyme que le romancier fait intervenir.)
Cette description, focalisée sur des personn(ag)es autres que le héros, relève donc de l'omniscience du romancier. Pourtant, il aurait été facile à Proust de faire du héros le personnage focal de cette scène -si son projet avait été bel et bien de retracer le vécu du héros dans le récit d'un narrateur autodiégétique. Il suffisait, pour cela, de ne pas inventer cette histoire de « retard » des fidèles, et de les masser bel et bien sur le quai de la station de Graincourt ! Ce « retard », expliqué peu après (p. 267), a pour fonction de montrer la néfaste fantaisie de Ski, responsable de l'incident ; mais cet incident comique aurait fort bien pu être inséré dans un autre trajet que celui-ci. La vraie fonction du retard du groupe, à cet endroit, c'est donc surtout d'empêcher que la description initiale soit lue comme une expérience du héros. Donc, par le biais d'une improbable focalisation externe sur le vulgum pecus, de réaffirmer la liberté du romancier, en faisant échouer (une fois de plus) la possibilité de lire la Recherche comme une narration de type autobiographique.
C. Enfin, voyons un troisième et dernier exemple (parmi des quantités d'autres de même nature). Si l'on regarde la suite immédiate de cette scène de première rencontre des « fidèles » dans le tram, on peut constater que Proust, curieusement, évite toute focalisation interne sur le héros (qui, pourtant, devrait observer les personnages et en tirer hypothèses et enseignements), de même que les informations fournies ne sont pas médiatisées par les souvenirs ou le savoir ultérieur du protagoniste. Au contraire, Proust adopte résolument la focalisation-zéro, multiplie les scènes que le héros ne peut avoir vécues, et, en relatant ces scènes (Mme Verdurin défaisant les amours ancillaires de Brichot -p. 262--, la duchesse de Caprarola en visite de condoléances chez Odette -p. 262-263--, etc.), recourt systématiquement au récit de pensées et de sentiments que le héros ne saurait avoir recueillis par des « ragots ».
Ainsi, p. 262 : « Mme Verdurin, écarlate d'orgueil quand elle daignait monter [les étages de Brichot] ». A supposer que Brichot ait raconté au héros cette scène plutôt honteuse pour lui, aurait-il pensé à rapporter la couleur « écarlate » du visage de la Patronne, et « l'orgueil » est-il la cause la plus évidente pour expliquer le teint cramoisi d'une femme d'âge mûr qui vient de monter à pied quatre étages ? Aucune modalisation ne vient ici émettre le moindre doute sur l'explication de ce teint écarlate par l'orgueil : il est manifeste que la narration ne vient pas relayer des propos qui auraient pu être rapportés au héros par Brichot -voire par la Patronne elle-même--, mais qu'il s'agit d'un récit directement pris en charge par l'instance narratrice. L'omniscience, ici, ne fait aucun doute.
De même encore, p. 264 : [une fois sa visiteuse partie] « Odette aurait bien voulu avoir dit simplement la vérité ». Il s'agit là de pensées intimes, non exprimées. Comment le héros pourrait-il les connaître ? (à supposer, d'ailleurs, qu'il ait su la visite de la princesse de Caprarola à Odette, et, chose plus improbable, la teneur exacte de la conversation entre les deux femmes.)
La scène dans le tram entre le héros et ses compagnons de voyage ne commencera donc réellement qu'à la page 267, après huit longues pages de présentation « omnisciente » des trois « fidèles » encore inconnus du héros (Brichot, Ski, Saniette), alors que, tous se trouvant réunis dans le même compartiment, ils auraient pu être présentés « en situation » par le regard du protagoniste -du moins si Proust avait voulu respecter la logique du réalisme subjectif qu'implique une autobiographie fictive. Rien ne l'en empêchait. Là encore, il ne l'a pas voulu.
On pourrait étudier de la sorte quantité d'autres passages, où Proust privilégie la liberté du romancier. Cette tendance à une narration directe, à focalisation multiple, qui accumule les faits excédant le champ de connaissance du héros, tendance qui se confirme de plus en plus à partir de la publication de Du côté de chez Swann, en 1913, abolit subrepticement le cadre initial de l'autobiographie fictive. Le héros, peu à peu, devient un personnage parmi les autres, même si c'est le personnage focal le plus représenté -mais le roman à la 3e personne aussi privilégie UN personnage focal !
Alors, bien sûr, à chaque occurrence d'omniscience, de focalisation interne sur un personnage autre que le héros, de focalisation externe non modalisée, on peut invoquer le lapsus, l'inadvertance de l'auteur. Mais ce type d'excuse, qui peut valoir pour une occurrence isolée perdue au milieu d'un texte qui serait par ailleurs d'une cohérence focale irréprochable, commence à devenir embarrassant dès lors que ces « inadvertances » deviennent un phénomène récurrent. Faut-il admettre avec Albert Feuillerat [12] que Proust, à partir de 1914, ne savait plus du tout ce qu'il faisait et a gâché la cohérence initiale de son roman ? D'une part, la précision dans le jeu des parallélismes, des échos, l'attention portée à la composition, à l'agencement des épisodes, la subtilité dans le réglage du suspense, tout cela interdit d'affirmer que l'auteur ne maîtrisait plus son texte. Mais surtout, Feuillerat ne connaissait pas la genèse de l'oeuvre, et il ignorait que la plupart des développements narratifs et thématiques postérieurs à 1914 (qu'il croyait erratiques) étaient déjà prévus de longue date par Proust ! Il en va de même pour la question des « voix narratives » et du jeu focal. En fait, dès le volume publié en 1913, les expériences psychologiques majeures (sadisme de Mlle Vinteuil, mais aussi jalousie de Swann) étaient déjà présentées par une narration omnisciente, grâce à la focalisation sur des personnages autres que le héros (Mlle Vinteuil, Swann) et à la description (pas toujours modalisée) de leurs pensées et réactions intimes. Ainsi, dans Sodome et Gomorrhe II, Proust poursuit un type de narration qu'il a toujours pratiqué, mais la multiplication des personnages secondaires rend le procédé plus visible, statistiquement plus fréquent, et l'invraisemblance d'autant plus grande, plus perceptible, que Proust ne cherche pas (plus ?) à l'atténuer.
C'est donc, de toute évidence, en le voulant, et en le sachant, que Proust « fait craquer » la logique même de la forme autobiographique ! Revendiquant à tout instant (ou presque) son statut de romancier manipulateur, il nous empêche de lire la Recherche comme l'autobiographie du personnage « je ». Ce personnage-« je » ne saurait être, dès lors, que le sujet de l'énoncé -mais non, comme le suppose Genette, le sujet de l'énonciation [13] .
Pourquoi cet hiatus entre « je-narré » et instance narratrice omnisciente ? Une explication génétique me paraît probable. N'oublions pas que, dès 1913, Proust dut se défendre en permanence d'avoir écrit ses souvenirs, ses Mémoires, et protestait vigoureusement quand la critique le considérait comme un écrivain « subjectif » (c'est-à-dire: autobiographique), revendiquant au contraire l' « objectivité » et insistant sur la nature romanesque de son entreprise. Dans une lettre de 1921, il exprimait à un ami son regret d'avoir rendu possible ce malentendu en choisissant la forme-je : « [...] comme j'ai eu le malheur de commencer mon livre par Je' et que je ne pouvais plus changer, je suis subjectif' in aeternum. J'aurais commencé à la place Roger Beauclerc occupant un pavillon', etc. ... j'étais classé objectif' [...]. [14] » (je souligne.) Proust était donc pleinement conscient qu'entre une autobiographie réelle et une autobiographie fictive, la différence formelle étant inexistante, la distinction est bien difficile à établir pour le lecteur (ne reposant finalement, comme Philippe Lejeune l'a montré, que sur la présence ou l'absence d'un « pacte autobiographique » plus ou moins aisé à repérer). Il n'est pas douteux -à mon sens que c'est précisément pour lutter contre cette assimilation abusive qu'il a multiplié délibérément les occurrences d'omniscience. Les études de genèse, depuis trente ans, nous ont appris que Proust -telle Pénélope-- modifiait sans cesse les structures de son roman, et qu'il a continué même après la publication du premier volume ; qu'il en ait aussi changé, subrepticement (mais consciemment !), le pacte narratif, n'a rien pour surprendre les généticiens ! Il ne pouvait certes plus changer le « je »-narré en un « il », mais il lui était parfaitement possible de glisser d'une narration (majoritairement) centrée sur le vécu et le savoir du protagoniste à une narration tendant à l' « omniscience », exhibant son caractère romanesque.
« O audace géniale » de Vinteuil « expérimentant », s'exclamait Swann dans une addition tardive (1913) à « Un amour de Swann » (RTP, I, 345) ; ce commentaire correspond en fait à une notation auto-référentielle de Proust à sa propre expérimentation : un important changement de structure qu'il venait d'introduire dans son roman in extremis, au moment où il en corrigeait les épreuves [15] ! La focalisation plurielle, l'incompatibilité pragmatique entre le « je »-personnage et le narrateur omniscient, ne relèveraient-elles pas, elles aussi, d'une de ces « audaces géniales » de créateur ? Le septuor, apothéose de l'oeuvre de Vinteuil, est encore plus inouï, d'une modernité formelle plus discordante, que la fluide sonate...
[1] Brian B. ROGERS : Proust's Narrative Techniques, Droz, 1965 ; Marcel MULLER : Les Voix narratives dans la Recherche du temps perdu, Droz, 1965 ; Jean-Yves TADIE : Proust et le roman, Gallimard, 1971 ; Michel RAIMOND : La Crise du roman, des lendemains du naturalisme aux années 20, Corti, 1966 -voir aussi Proust romancier, plus tardif (1985).
[2] Ajoutons qu'il existe une variante de ce procédé, la « focalisation externe », lorsque le spectacle est vu non pas par un personnage de l'histoire, mais par un observateur extérieur, anonyme, dont la présence atténue le point de vue omniscient (donc le savoir absolu) du romancier --que ce témoin soit réellement mis en scène (tel le promeneur qui découvre Verrières au début du Rouge et le Noir) ou implicite, virtuel (Ainsi, dans une scène où personne ne regarde le protagoniste, une formulation du type : « Il sembla hésiter » : à qui ? à quelqu'un qui aurait observé la scène). Voir plus loin, pour un exemple dans Sodome II, notre section « C ».
[3] Voir, dans Figures III, chapitre « Mode », section « Polymodalité » (op. cit., éd. de 1972, pp. 214-224).
[4] Genette : « Répétons-le encore : l'emploi de la « première personne », autrement dit l'identité de personne du narrateur et du héros, n'implique nullement une focalisation du récit sur le héros. Bien au contraire, le narrateur de type « autobiographique », qu'il s'agisse d'une autobiographie réelle ou fictive, est plus « naturellement » autorisé à parler en son nom propre que le narrateur d'un récit « à la troisième personne », du fait même de son identité avec le héros : [suit l'exemple de Tristram Shandy : l'exposé des « opinions » actuelles du protagoniste, mêlées au récit de sa « vie » passée, ne choque pas, tandis que dans Tom Jones, l'intrusion des opinions de Fielding dans le récit de la vie du personnage paraît « indiscrète »]. Le récit impersonnel tend donc à la focalisation interne par la simple pente [...] de la discrétion et du respect pour [...]l'ignorance de ses personnages. Le narrateur autobiographique n'a aucune raison de ce genre pour s'imposer silence, n'ayant aucun devoir de discrétion à l'égard de soi-même. [...] Il peut, s'il le souhaite, choisir [la focalisation sur le héros], mais il n'y est nullement tenu, [...] puisque le narrateur, pour s'en tenir aux informations détenues par le héros au moment de l'action, doit supprimer toutes celles obtenues par la suite, et qui sont bien souvent capitales.
Il est évident [...] que Proust s'est dans une large mesure imposé cette restriction hyperbolique, et que le mode narratif de la Recherche est bien souvent la focalisation interne sur le héros. » (op. cit., p. 214 -les italiques étant ceux de l'auteur, j'utilise les caractères gras comme marque d'insistance.)
Genette motive ce choix narratif : si Proust emploie fort souvent la focalisation interne sur le héros, c'est qu'il a voulu retracer les erreurs, l'ignorance du personnage, qui ne perd ses illusions et sa naïveté que progressivement.
NB : Lorsque Genette, dans cette section, oppose à la focalisation sur le personnage la « focalisation sur le narrateur » [sic], c'est certainement une inadvertance. Quand le narrateur raconte et commente l'action, c'est précisément ce que la narratologie nomme « focalisation zéro », le narrateur ne pouvant en effet, en aucun cas, être un « personnage focal » (puisqu'il est, au moment où il narre, non plus « personnage » de l'action narrée, mais en position d'extériorité, de surplomb, par rapport aux faits -passés-- qu'il narre). Le récit de pensées (ou psycho-description), même si ces pensées sont celles du héros, relève de la focalisation zéro tout aussi bien que le récit des actions du héros.
[5] « La vraie difficulté commence lorsque le récit nous rapporte, sur-le-champ et sans aucun détour perceptible, les pensées d'un autre personnage au cours d'une scène où le héros est lui-même présent [...]. Voilà pour le coup une paralepse [c'est-à-dire une information que le récit ne devrait pas donner] à tout jamais et en toute hypothèse irréductible à l'information du narrateur, et que nous devons bien attribuer au romancier « omniscient » --et qui suffirait à prouver que Proust est capable de transgresser les limites de son propre « système » narratif. » (Genette, op. cit., p. 221 -je souligne).
[6] Quand Genette dit que Proust fait craquer « la logique même de son discours », il veut dire : la narration « autodiégétique », c'est-à-dire : la logique de l'autobiographie fictive.
[7] Sur ce glissement progressif de forme narrative, de l'essai autobiographique initial (1908-1909) à la forme de l'autobiographie fictive (1909-1911) puis à la narration de type « omniscient » (à partir de 1911-1912), voir ma contribution au colloque de Cerisy-la-Salle : « Pour en finir avec Marcel' et le narrateur' : questions de narratologie proustienne », in B. BRUN éd., Marcel Proust 2, Minard, Revue des Lettres modernes, janvier 2000, pp. 13-42. Centré sur le « Je » proustien, cet article entend monter comment la continuité pragmatique entre je-narré et je-narrant, évidente au départ (1908-1911), se distend peu à peu pour finir par disparaître, le « je-narré » continuant à désigner le personnage-acteur, le protagoniste du roman dont l'instance narratrice ne peut plus, à partir de 1911-1912, être considérée comme voix ou écriture ; ce « je-narré » devient alors l'équivalent d'un « il », c'est-à-dire qu'il désigne le sujet de l'énoncé (« je-narré » du héros, auteur d'un certain nombre d'actions et opérations réflexives ou mémorielles), mais non le sujet (même fictif) de l'énonciation, laquelle énonciation est assignable à un « Romancier omniscient. » Selon cette mienne conception des choses, il n'y a donc plus de continuité pragmatique entre « Je » de l'énonciation et « je » de l'énoncé, mais une discontinuité théorique. Pourquoi un romancier posant un personnage anonyme ne le désignerait-il pas par « je » ? Butor, dans la Modification, ne fait pas autre chose en désignant le personnage par le pronom « vous » : il n'y a pas plus de continuité référentielle entre ce personnage- « vous » et le narrataire qu'entre le personnage-« je » de Proust et l'instance narratrice (ou, entre ce personnage-« je » et le lecteur qui, après tout, peut se couler dans ce « je » offert à toutes les identifications).
[8] Durant son premier séjour à Balbec, tout jeune homme accompagné de sa grand-mère, il n'a rencontré que les Guermantes séjournant au Grand-Hôtel (Mme de Villeparisis, Saint-Loup, M. de Charlus), quelques uns des estivants de l'hôtel, Elstir, et les jeunes filles, qui sont vite devenues son unique centre d'intérêt et ses uniques fréquentations.
[9] A supposer que M. de Chevrigny soit un de ces « hobereaux » de la région, notons que le héros ne le rencontre qu'aux stations du petit tram. Le texte ne parle jamais de la moindre visite chez lui, ni, bien sûr, de réception ou de goûter.
[10] Je n'ignore pas qu'à une étape primitive dans la genèse du roman proustien (Cahier 64, datant de 1909-1911), le héros était (ainsi que « Maria »-Albertine) l'hôte des Cambremer (alors appelés « Chemisey ») lors de son dernier séjour à « Querqueville »-Balbec. Il pouvait donc connaître de près les habitudes et les préférences de la marquise douairière, et pouvait être l'un de ces invités que la vieille dame emmène avec elle à ces goûters sans élégance. Mais cette étape primitive a été totalement refondue lors des changements successifs dans le scénario des séjours balnéaires, pendant la guerre. Il me paraît difficile de soutenir que Proust, qui avait alors tout son temps et ne travaillait nullement dans l'urgence, ait simplement « oublié », en rédigeant cette digression sur les goûters, que le héros ne logeait pas chez les Cambremer, car cette scène est intégrée justement dans l'épisode de l'arrivée du jeune homme au Grand-Hôtel ! On pourrait sans douter trouver ainsi, pour chaque épisode d'omniscience, une explication génétique et invoquer la « distraction » de l'auteur lors de la refonte des épisodes... mais cela ferait tellement de « distractions » que cette explication ne peut être sérieusement retenue, sauf peut-être pour des épisodes retouchés très tardivement (1921) -ce qui n'est pas le cas pour l'épisode ici en question.
[11] Le texte le précise de façon très explicite, p. 149 : « [...] les Verdurin (des invitations de qui je n'avais jamais profité, et qui seraient certainement heureux de me recevoir, si j'allais à la campagne m'excuser de n'avoir jamais pu leur faire une visite à Paris), [...] » (je souligne). Le même passage précise également que c'est la première fois que les Verdurin séjournent sur la côte normande.
[12] Feuillerat, A. : Comment M. Proust a composé son roman, New-Haven, Yale University Press, 1934
[13] Rappelons que Marcel Muller, dès 1965 (Les Voix narratives dans la Recherche du temps perdu), avait bien saisi le problème : il subordonne ce qu'il appelle « Narrateur » à deux instances textuelles supérieures : le « Romancier » (manifestation de l' Omniscient dans le roman) et l' « Ecrivain » (manifestation dans le roman de l'artiste en langage) (op. cit., p. 8). Muller considère (en se fondant sur le texte) que l'auteur du récit ne saurait être le protagoniste lui-même, et qu'une distance « asymptotique » existe entre le récit que le personnage écrira peut-être, et le roman que nous lisons. Tout cela est profondément juste. Le seul problème, c'est que, dès lors, la « voix narrative » qu'il répertorie comme « le Narrateur » (« narrateur-greffier », dit-il, ou film intérieur que se fait rétrospectivement le personnage) n'a aucun statut énonciatif ! Il faudrait admettre que le récit serait le monologue intérieur du héros fictif, écrit par un écrivain réel. Mais tout interdit de voir dans la Recherche un monologue intérieur : entre le vécu du héros et son organisation dans une écriture consciente d'elle-même, s'auto-commentant, il n'y a aucune place narratologique pour un monologue intérieur, ni pour un « film » rétrospectif ou récit « nu » qui précéderait une écriture à venir.
[14] Marcel Proust, Correspondance, éd. Kolb, Plon, tome XX, p. 542. Il s'agit de la lettre à Jacques Boulenger du 29 novembre 1921.
[15] Cette innovation majeure, c'est l'invention du personnage de Vinteuil, réalisée sur les épreuves d'imprimerie alors même que le premier volume était sous presse.